Vidéo accessible en ligne :
https://www.folkoperan.se/pa-scen/folkoperan-replay
Satyagraha, en sanscrit l’attachement ferme à la vérité, est le principe de contestation, non-violente, instaurée par Gandhi. Contestation non-violente certes mais très ferme et préconisant, une fois son adhésion acquise, une action aux conséquences parfois très violentes sur les Satyagrahis eux-mêmes puisque il ne s’agit nullement de nier l’affrontement mais d’en assumer les effets sur soi-même. C’est donc une lutte âpre aux suites physiques possiblement dures. C’est le premier mérite du rappel du libretto. Second point : si les luttes sont violentes, c’est que les politiques impérialistes et racistes des gouvernements envers les indiens ont été terriblement injustes et malveillantes. L’Histoire a fait de Gandhi une image d’Épinal : un gentil pacifiste contre des méchants anglais, Satyagraha rappelle les enjeux de cette guérilla à ciel ouvert.
Glass donne à chacun des trois actes un nom de personnes chères à Gandhi (au passé Tolstoï, au présent, Tagore et au futur, Martin Luther King, en héritier du Gandhisme). Pour autant, les trois actes relatent des étapes décisives du combat de Gandhi n’ayant qu’un vague rapport avec le texte chanté et sans qu’il y ait à proprement parler d’action.
Chaque scène-historique est décrite dans le livret par un court texte (qu’on trouve dans le livret du CD de l’enregistrement en 1984 du New York City Orchestra & Chorus dirigé par Christopher Keene) dont un résumé est projeté ici sur de fins écrans et sur un rideau de cordelettes qui sépare l’orchestre de la scène au fond à jardin.
Toute la mise en scène repose sur des évocations de ce chemin sinueux et fragile, de cet affrontement de cultures, de cette mise en réseau entre le texte, l’histoire, les protagonistes, les participants, le public. Il est ainsi beaucoup question de fils, tressés, sur lesquels on s’enroule, desquels on tombe aussi parfois.

Toutes les techniques circassiennes sont présentées et évoquent par métaphore filée les combats des Satyagrahis.
Certaines des paroles qu’on imagine être les plus significatives sont également projetées à certains moments ((Les textes sont tirés de la Bhagavad Gita et sont des adaptations plutôt que des traductions mot à mot)), ce qui permet de suivre globalement une action éclatée dans le temps et l’espace et qui trouve des échos métaphoriques dans la mise en scène proposée par Tilde Björfors. On proposera les (courtes) indications du livret, scène par scène pour suivre le déroulement sur le plateau.
Acte I : Comte Léon Tolstoï
Scène 1 : le champ du jugement de Kuru est un extrait d’un texte de la Bhagavad Gita (Chant du bienheureux ou Chant du Seigneur).
La Bhagavad Gita est une partie du poème épique Mahabharata que Gandhi aimait beaucoup et qui l’a guidé toute sa vie comme source spirituelle, morale et quasi théorique. Elle raconte l’histoire de Krishna, conseillant le prince guerrier Arjuna dans un moment de doute, avant une bataille qui risque d’entraîner la mort des membres de sa famille.
On imagine aisément comment Gandhi, activiste et autorité morale, a pu s’identifier au personnage d’Arjuna.
Sur la scène, deux maisons royales s’affrontent sous le regard des Dieux (chanteurs suspendus, baladés de gauche à droite). C’est aussi le conflit intérieur de Gandhi, ici encore habillé à l’occidentale, parachuté dans l’histoire dès l’ouverture du rideau par des câbles traversant en diagonale le plateau.
Arjuna, cuirassé, se tient derrière Gandhi et un archer derrière le guerrier, démultipliant artificiellement ses bras et tirant de vraies flèches sur les côtés (on pense aux sons idoines lors du prélude du Tannhäuser de Castellucci ((lire le compte-rendu de Guy Cherqui en bas de page)).
Le guerrier et Gandhi cherchent leur équilibre (c’est le sens du texte) sur des structures de bois.
Krishna, visage bleu et costume doré, suspendu, énonce : « si tu ne veux pas prendre le chemin de la vérité alors tu évites ton devoir ».

Pendant ce trio de voix, deux athlètes en blanc et noir s’affrontent sur une planche à bascule et rivalisent de cabrioles devant un écran lumineux qui fait écho aux sauts. Le combat, on le voit, est périlleux et incertain.
La force du spectacle réside dans les liens tissés dans la salle et on réentend dans la captation les cris et soupirs qui étaient aussi les nôtres et faisaient de cette représentation d’opéra une expérience participative très prenante. On peut vibrer et être fortement ému à l’Opéra. Rarement on y frissonne comme pendant ce spectacle. Peur, tensions, compassion : tout le spectacle est vécu comme rarement.
Scène 2 la ferme de Tolstoï (1910)

Elle relate la première expérience de vie collective en Afrique du Sud, en harmonie avec autrui et avec, comme principe, l’autogestion. Les Satyagrahis construisent leurs logements, tissent leur vêtements, cultivent, cuisinent, gèrent collectivement leurs fermes, sans partage de tâches lié aux castes (rappelons que le nettoyage des latrines était réservé aux intouchables).Le texte chanté dit notamment : « seul l’immature voit une différence entre le savoir théorique et la pratique appliquée ».
Sur la scène, des bobines tressées, des jeux d’équilibre sur des ballons bobines géantes. La musique et les chœurs sont légers et tournent en boucle harmonieusement à l’image du moulin de ferme en vidéo. C’est une scène aérée où tout « roule ».
Scène 3 : le vœu (1906)

Le gouvernement britannique impose une immatriculation et des prises d’empreintes digitales de tous les Indiens (L’Asiatic Registration Act de 1906 aussi appelé Black Act). La musique se fait plus sombre pendant que des hommes en noir rappelant les SS brutalisent les indiens vêtus de blanc sauf leurs bas de pantalon teintés de rouge.
Lors d’une assemblée, les orateurs (ici les chanteurs accrochés aux échelles latérales) convainquent les Satyagrahis de de lutter contre le Black act jusqu’à la mort. Quelques indiens dans une nacelle tournée par un Gandhi occidental sur un monocycle tressent un filet qui les enserre et les retient. C’est le vœu consenti qui lie.
Lors du climax du chœur et de la musique, alors que la lumière se fait plus violente en fond de scène, aveuglant de plus en plus le public, du verre brisé est déposé devant la troupe : circassiens ET chanteurs alignés devant la scène et qui se déchaussent. Lorsque la musique s’arrête, la troupe s’avance d’un pas et marche sur le verre. Le truc est connu, il n’en reste pas moins impressionnant.
Émotion forte garantie et pause bien méritée de 5 minutes.
Acte II Rabindranath Tagore
Scène 1 : Confrontation et sauvetage (1896)

Gandhi a fait un séjour de six mois en Inde et informe son pays des conditions des émigrants en Afrique du Sud.
Ici, Gandhi en occidental se débat dans un réseau de fils lâches, de gauche à droite.
Lorsque Gandhi revient en Afrique du Sud, c’est la panique et la foule furieuse le poursuit. Il est protégé, nous dit le livret, par la femme du commissaire Mrs Alexander qui ouvre son parapluie pour l’abriter.
La chanteuse portée par des câbles est une femme géante qui surplombe Gandhi. L’effet est impressionnant, d’autant qu’on ne sait, au début, si elle est soutenue par des câbles ou soutenues par des circassiens empilés. Elle se soulève (câbles donc), donne un violon au Gandhi qui en joue, en unisson avec l’orchestre, toujours sur son écheveau.
Pendant que des occidentaux à chapeaux melons lui lancent des boulettes de papiers, Gandhi se débat avec ses liens, pirouette à tout va sur lui-même, pendant que la musique se fait plus sombre, puis retombe sur ses pieds sous les applaudissements d’un public rassuré.
Scène 2 : L’Opinion Indienne (1906)
Le journal de Gandhi propage les principes et idées des Satyagrahis (jusqu’à 20 000 lecteurs rien qu’en Afrique du Sud).

Gandhi attaché en hauteur circule de gauche à droite comme une machine à écrire géante et déverse sur la scène de longues rames de papiers rarement interrompues qui forment de longues bandes (on pense au manuscrit de On the road de Kerouac). Les bandes sont récupérées par des Satyagrahis au sol.
Un rideau s’élève, sur lequel sont projetés des pages du journal. On pense à une œuvre d’art de Jitish Kallat dans le pavillon Indien de la dernière Biennale de Venise qui projetait sur un écran de brouillard la lettre de Gandhi à Hitler lui enjoignant d’éviter toute violence avant la guerre.
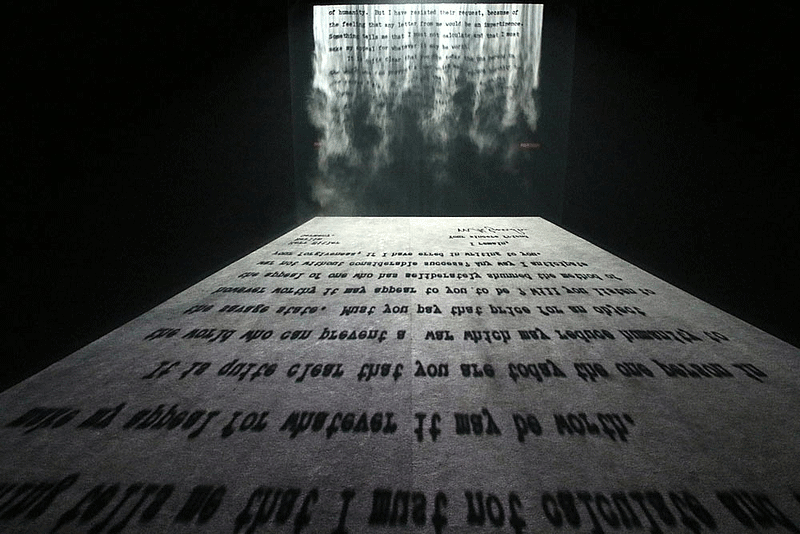
L’impression d’imprimerie mécanique est accentuée par la musique miroitante et le jeu d’une acrobate dans un anneau géant. Les idées ici sont la circulation, le centre d’équilibre.
Scène 3 : Protestation
Les chefs du mouvement sont condamnés à la prison pour avoir refusé l’ordre de quitter l’Afrique du Sud.
La musique se fait plus sombre et profonde pendant que les mots de Krishna (chantés par Gandhi) recommandent aux hommes de ne haïr personne et de se débarrasser des mots « Je » et « Moi ».
Une prison projetée est apparue sur la passerelle, une vraie grille sépare un autre groupe derrière Gandhi qui, déterminé, avance droit et écarte de son chemin les obstacles en bois glissés devant lui. Jeux d’ombres et de lumières.
Le livret indique que les Satayagrahis décident alors de remplir les prisons en commettant toutes sortes d’infractions. Plus tard, ils décident tous de brûler leurs papiers si le Black Act n’est pas abrogé.
Pendant que les chanteurs, en haut, montrent leurs cartes, les circassiens étalent et font une tresse géante des papiers que Gandhi déroulait dans sa machine à écrire (une sorte de papier souple comme de l’essuie-tout).
Un tonneau de métal est introduit sur scène ainsi qu’une torche. Le papier tressé est alors tendu entre deux poteaux de métal. C’est en silence, avec projection de feu sur le rideau de fond de scène, qu’un acrobate représentant Gandhi, vêtu pour moitié à l’occidental, moitié en indien, se met à marcher sur la corde ainsi réalisée. Il se tient en équilibre jusqu’à ce que la corde brûle à l’aide du feu sorti du baril. L’acrobate tombe alors dans un trou gigantesque, ouvert discrètement, sous la scène.
C’est le baptême du feu des Satyagrahis. Et preuve que l’im-possible l’est parfois.
La captation nous montre un spectacle où le feu met longtemps à prendre. Le soir où nous étions dans la salle, la corde avait vite cédé, ce qui accentuait encore l’impossible rendu possible, son lien fragile, sa chute et donc l’échec, sinon inévitable, du moins faisant partie des risques potentiels à assumer.
Acte III : Martin Luther King
La Marche de Newcastle (1913)
À la suite de nouvelles mesures injustes (limitation de l’immigration sur critères ethniques, impôts spéciaux, mensonges du gouvernement…), les Satyagrahis cherchent à renforcer leur pression et à agrandir leur troupe en faisant une grande marche vers la frontière du Transvaal. Les participants sont prêts à tout abandonner hormis vêtements et couvertures.
La musique se fait plus lancinante et le chœur reprend une importance prépondérante.

C’est l’occasion de funambulisme, d’acrobates les uns sur les autres pendant que la structure octogonale en bois que l’on aperçoit à plusieurs reprises (elle était un bloc quadrangulaire au début de l’opéra, dont les entames servaient à entraver Gandhi dans sa marche, et pendant la première scène, Gandhi « surfait » dessus en miroir d’Arjuna) est attachée en hauteur, se sépare en trois partie qu’une circassienne actionne comme un moulin ou des quilles de jonglages géantes. On retrouve le côté apaisé du moulin de la ferme de Tolstoï, y compris musicalement. C’est l’image de la Roue de la fortune, de la Balance cosmique.
Des projections partent de la structure en bois puis gagnent le rideau de fond de scène. On reconnait, entre autres (inconnus, hommes, femmes, de tous âges) Tolstoï, Nelson Mandela, Gandhi…
Les chanteurs lèvent le poing, les circassiens jonglent.
Retour de la musique sombre avec une superbe séance de trapèze à rubans. Épreuve de lâcher prise, de tournoiement, d’endurance, de retours en arrière avec des courses vers le public qui la ramènent vers le fond de la scène. Épreuve de confiance en soi aussi.
Pendant ce temps, les chanteurs apparaissent derrière un voile blanc (la seule possession autorisée ? La couverture ?), pendant que Gandhi plus apaisé que jamais circule sur scène.
La structure en bois maintenant stabilisée en étoile devient métier à filer pendant que Gandhi tire la laine et que la troupe dans un mouvement chorégraphié en cercle fait tourner la roue qui enfile la laine comme un engrenage. Au centre de l’étoile, en projection, la Terre.
Une toile d’araignée se déploie sur les dernières notes, à l’aide de câbles astucieusement placés, partant de la scène et courant au-dessus des spectateurs.
Le lien avec les premières scènes d’affrontement humains sous les regards des dieux se fait à nouveau. Tout comme la musique de Glass, toujours très cyclique. On remarque d’ailleurs la même puissance émotionnelle qui ouvre et ferme aussi Einstein On The Beach, premier volet de la trilogie. Curieuse musique, en apparence froide, qui pourtant tire assez facilement des larmes au début et à la fin.
Tout le travail de Tilde Björfors et Cirkus Cirkör a consisté à remettre du lien dans les propositions de scène du livret de Constance DeJoong, inspiré par les événement historiques du mouvement Satyagrahis, la musique de Philip Glass, dont les cycles collent plus que jamais à la philosophie indienne et les textes de la Bhagavad Gita, fond idéologique et culturel de Gandhi. C’est finalement un travail presque contraire à ce à quoi la mise en scène contemporaine nous a habitués en reliant, de manière très lisible, les morceaux épars de Glass (on pense à la technique d’écriture de Mille Plateaux de Deleuze et Guattari), qui peuvent, on l’imagine, être très libres suivant les mises en scène. On assiste donc à la naissance de Gandhi, l’activiste, tiraillé entre les deux cultures, mélangeant l’historique et le culturel, la pratique et la théorie, les échecs, les réussites, les prises de risque, l’abnégation et la volonté de s’inscrire dans quelque chose de plus grand que soi, à tout prix (y compris la prison et la mort). Quoi de mieux que de révéler cela par le biais d’un opéra à la mise en scène des plus physiques mais qui n’oublie jamais le(s) texte(s) (paroles et situations projetées et non simples surtitres), les vidéos, les machines, le jeu d’acteur et les jeux avec les possibilités mécaniques du théâtre. Art total enfin.
Toute la force du spectacle est de tirer parti de son fonctionnement collectif. Un orchestre qui entraîne la machine et anime les tours de cirque. Une équipe de chanteurs étroitement associés aux circassiens devant un public vibrant vraiment de tous ses sens. C’est ce qui convient à cette œuvre politique et nécessaire à notre époque où le monde d’après ressemble malheureusement furieusement au monde d’avant avec toujours plus d’injustice sociale et de racisme comme le dénoncent les récentes émeutes américaines suivant le décès de George Floyd.
Jean-Louis Bergeaud, dit Murat, chanteur auvergnat et grande gueule notoire, publiait en 1981 un 45 tours, Suicidez-vous le peuple est mort puis, dix ans après, une très belle chanson de rupture, Le Lien défait. Le temps d’une représentation, l’illusion opère et on veut bien croire le contraire des prophéties de la Cassandre de Chamalières.
La captation est toujours visible sur le site de FolkOperan mais on ne peut que vous conseiller de l’éviter pour privilégier une expérience qui se doit de rester avant tout scénique ;
Pour poursuivre la lecture :
http://blogduwanderer.com/bayerische-staatsoper-2016–2017-tannhauser-de-richard-wagner-le-4-juin-2017-dir-mus-kirill-perenko-ms-en-scene-romeo-castellucci
Video accessible en ligne :
https://www.folkoperan.se/pa-scen/folkoperan-replay

