
Emmanuelle Haïm est une habituée de l'Opéra de Lille, Artiste en résidence – son Concert d'Astrée y est en résidence depuis 2004, avec quelques belles réussites dont l'inoubliable Castor et Pollux de Barrie Kosky en 2014 ou bien le Serse de Cavalli dans la version française de Lully en 2015. Cette production était également signée du metteur en scène Guy Cassiers, dont on retrouve ici l'intérêt pour les images vidéos intégrées au fil narratif. The Indian Queen fait partie des œuvres lyriques rangées au rayon confidentiel des semi opéras. Mi parlée mi chantée, elle combine un livret de John Dryden et Robert Howard qui fut créé en 1664 avec un accompagnement orchestral de John Banister. Lorsque Henry Purcell se lance dans le projet d'un semi opéra à partir du même livret, il ignore qu'il ne lui reste qu'un an à vivre. C'est à son frère Daniel que reviendra la tâche de compléter une œuvre qui, dès lors, souffrit d'une réputation de partition inachevée. Hormis un prologue, des fragments d'actes I et II, il faut se contenter d'un air dans l'acte IV et un chœur pour le V.
L'intrigue donnerait le tournis au spectateur baroque le plus aguerri, au point qu'une chatte parfois n'y retrouverait pas forcément ses petits. Nous sommes dans l'Amérique d'avant les conquistadors, au moment où s'affrontent Aztèques du Mexique et Incas du Pérou. Le général inca Montezuma emporte la victoire et fait prisonnier le prince mexicain Acacis. Pour témoigner de sa gratitude, le Grand Inca, offre au guerrier le soin de choisir sa récompense. L'ambitieux, Montezuma lui demande la main de sa fille, Orazia. Le Grand Inca se renie, avançant l'argument que les origines de Montezuma sont trop obscures pour qu'il consente à lui céder sa fille. Fou de rage, le général tourne les talons… et change de camp, rendant du même coup la liberté à Acacis qui se trouve être lui aussi secrètement amoureux d'Orazia. Désormais au service des armées mexicaines (L'opéra baroque aurait-il invité le guide du routard ?), Montezuma remporte la victoire sur ses ex-alliés et capture le Grand inca et sa fille. C'était sans compter sur le retour de Zempoalla, reine illégitime des Mexicains, tombée elle aussi sous le charme de Montezuma. Ce dernier refusant de céder à cet amour, elle le fait emprisonner avec les deux autres. Cette reine férue de sorcellerie demande à son magicien Ismeron d'appeler au Dieu des rêves et aux Esprits aériens pour décrypter ses songes. Peine perdue, elle décide alors sur le conseil du sinistre Traxalla, d'immoler les trois victimes en sacrifice rituel. Le retour inattendu d’Amexia, reine légitime des Mexicains, transforme le drame en joyeuse délivrance : elle reconnaît Montezuma comme son propre fils, ce qui lui permet du même coup d'accéder au trône aztèque et d'épouser Ozaria puisque le Grand Inca consent enfin à un mariage qui scelle une union politique et sentimentale. Pauvre Acacis… il se suicide de dépit amoureux, geste presque anecdotique et hors champ.

Il est touchant de constater à quel point cette Amérique fantasmée porte en elle les reflets des luttes politiques qui agitent le vieux continent au sortir de la Guerre de Trente ans. L'indien n'est pas comme plus tard chez Fuzelier-Rameau, cet objet de projection morale qui sert de bonne conscience coloniale et de badigeon rococo. The Indian Queen croise les fils d'une intrigue amoureuse et familiale, sur fond de conflit, de lutte pour le pouvoir et d'usurpation politique. Ce drame héroïque use à l'envi d'une langue extrêmement ornée qui puise dans l'exotisme des décors pour rehausser le contraste voulu par Dryden, évoquant en filigrane des guerres meurtrières et des sacrifices, sur fond de dialogues raffinés et de nobles héros. Cette approche aseptisée relègue au second plan la question des conflits sanglants qui servent d'arrière-fond à ces luttes d'orgueil qui opposent Montezuma et l’Inca.
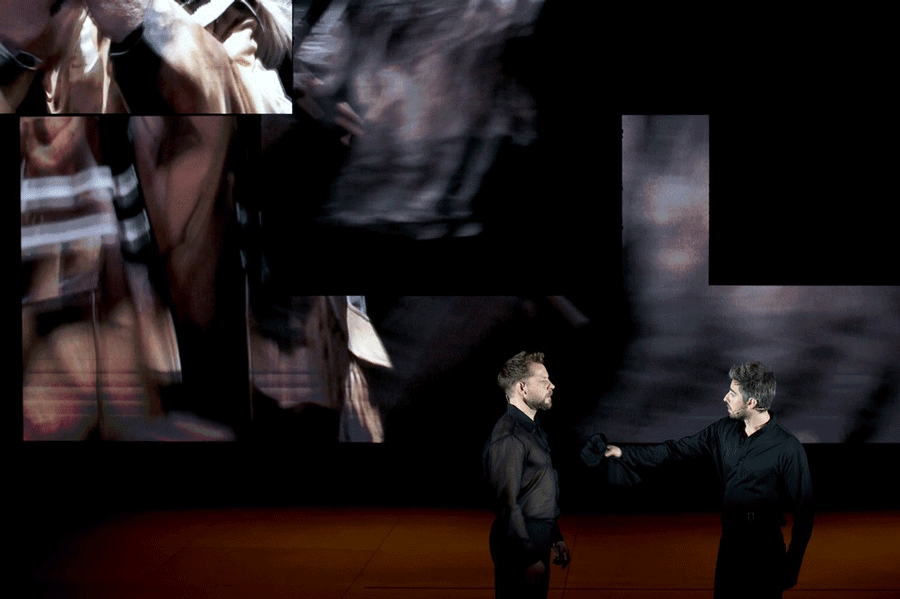
La mise en scène de Guy Cassiers développe des mérites et des contradictions qui naissent tout naturellement d'une utilisation abondante (pour ne pas dire excessive) des images vidéos. La grande référence dans ce domaine, c'est le Tristan de Bill Viola et Peter Sellars, où les images du premier dévorent le travail scénique du second. À une époque où la dimension visuelle s'impose dans le monde de l'opéra (comme ailleurs), il faut savoir jusqu'où un spectacle ne repose pas exclusivement sur le fait d'écouter avec les yeux. Les vidéos de Frederik Jassogne sont projetées sur cinq écrans de tailles différentes, actionnés verticalement ou horizontalement et dont l'assemblage forme une image. L'iconographie du spectacle puise dans les reportages du reporter de guerre mexicain Narciso Contreras. Au-delà du trait d'union entre sa nationalité et le livret, c'est plus généralement la thématique de la guerre et des conflits armés qui est ici exposée. La beauté paradoxale de ces photographies tient à la combinaison de leur sujet principal (des zones de guerre au Moyen-Orient) avec des images plus abstraites comme des ciels chargés de nuages noirs, des plumes d'oiseau, des intérieurs dévastés par les bombes mais dont les débris de meubles et d'objets sont pour ainsi dire magnifiés par la qualité des images. Cette définition et ce contraste souvent en noir et blanc, s'accorde au parallèle que nous évoquions plus haut entre l'extrême stylisation du langage et la cruauté de la thématique sous-jacente.

Il en résulte une mise en scène qui joue principalement sur la mise en espace et la mise à distance des drames qui s'imbriquent les uns dans les autres. L’histoire de la lutte entre les Incas et le Mexique est racontée simultanément par les vidéos enregistrées et le jeu en direct des acteurs. Guy Cassiers joue sur le décalage entre des images projetées montrant des personnages tels qu'on les imagine dans une forme fantasmée et théâtrale du pouvoir (costumes, maquillages, accessoires…) et des acteurs récitant leurs répliques en direct, avec des costumes d'une sobriété intégrale et des micros miniature pour amplifier la voix. Cette distance donne à voir sous les oripeaux grandiloquents du pouvoir, le corps de l'action comme une machine théâtrale dont on montrerait les rouages. Le procédé pourtant fait long feu, prisonnier d'une alternance de gros plans, effets de ralentis et désynchronisation entre images et voix en direct. La musique opère comme des trouées de lumières dans ce continuum invariablement sombre et verbeux.
Si la faute incombe en partie au livret de Dryden-Howard, elle résulte également d'une approche en définitive étrangement puritaine et hiératique, de ces histoires d'usurpation et de pouvoir légitime, de loyauté et de trahison, d’amour et de devoir. La forme hybride du semi opéra implique qu'on puisse contourner les obstacles des formes "pures", qu'elles soient du théâtre chanté ou du théâtre parlé. Dans l’opéra "dramatique" ou semi opéra, la tension entre texte et musique vient du fait que les deux ne coïncident pas toujours. La troupe d'acteurs britanniques connaît sur le bout des doigts l'art de faire résonner les vers avec tout le luxe d'une prononciation châtiée. L'excellence idiomatique est irréprochable de bout en bout. Les deux jeunes héros, James MacGregor (Montezuma) et Matthew Romain (Acacis) rivalisent de brio pour se disputer la main de la frêle Orazia (Elisabeth Hopper) face à au vétéran Christopher Ettridge, Grand Inca au visage étrangement tatoué. Le jeu de Julie Legrand en Zempoalla souffre des gros plans et des éclairages par en-dessous, qui en exagèrent volontiers l'esprit démoniaque et cruel. Au sombre Traxalla de Ben Porter, on ajoute une note d'humour décalé quand, du costume en brocard, il sort un smartphone pour lire les dernières nouvelles du front.
La combinaison entre charge visuelle et dépouillement laisse paradoxalement assez peu d'espace à la musique. Le choix opéré par Emmanuelle Haïm est de recourir quasi exclusivement à des compositions d'Henry Purcell pour compléter les manques de cette partition laissée inachevée à la mort de l'auteur. On notera cependant une belle ouverture de Matthew Locke (extrait de The Tempest) à l'Acte IV et un Ground somptueux de John Blow (extrait de Venus et Adonis) à l'Acte V. La direction d'Emmanuelle Haïm inscrit la musique de Purcell dans des tempi assez larges et volubiles, occasion pour elle de varier les climats et faire exister la partie musicale de ce semi opéra au-delà d'une durée somme toute modeste. On notera la présence du toujours éblouissant Sylvain Fabre, alternant les fonctions de percussionniste hors pair et de bruiteur dans les scènes parlées. Le chœur du Concert d'Astrée se couvre de gloire tout au long de la soirée et tout particulièrement dans le While Thus We Bow Before Your Shrine à l'acte V. La distribution n'affiche pas un niveau égal, entre le timbre anodin du ténor Hugo Hymas (Garçon indien, Gloire) ou les contours acidulés de Rowan Pierce (Quivera). Carine Tinney se tire avec les honneurs de son personnage de Dieu des rêves (Seek not to know what must not be reveal'd), doublée par Zoë Brookshaw pour les interventions des esprits aériens et le gracile I attempt from love’s sickness to fly in vain, tandis que Gareth Brynmor John est aux abonnés absents en Ismeron. Nick Pritchard et Ruairi Bowen tentent de percer en Suivants de l'Envie mais c'est le baryton-basse Tristan Hambleton qui marque les esprits dans son intervention en Grand prêtre dans le V. Absolument et définitivement hors-concours, la soprano Anne Dennis illumine le plateau par la qualité et la souplesse de sa ligne vocale. La matière du chant est ici d'une intensité et d'une projection à ce point maîtrisées (So when glitt’ring Queen of Night) – parfaite démonstration qu'on peut avec un pareil instrument aborder sans difficulté des rivages romantiques ou contemporains.
Vidéo en streaming : The Indian Queen à l'Opéra de Lille

