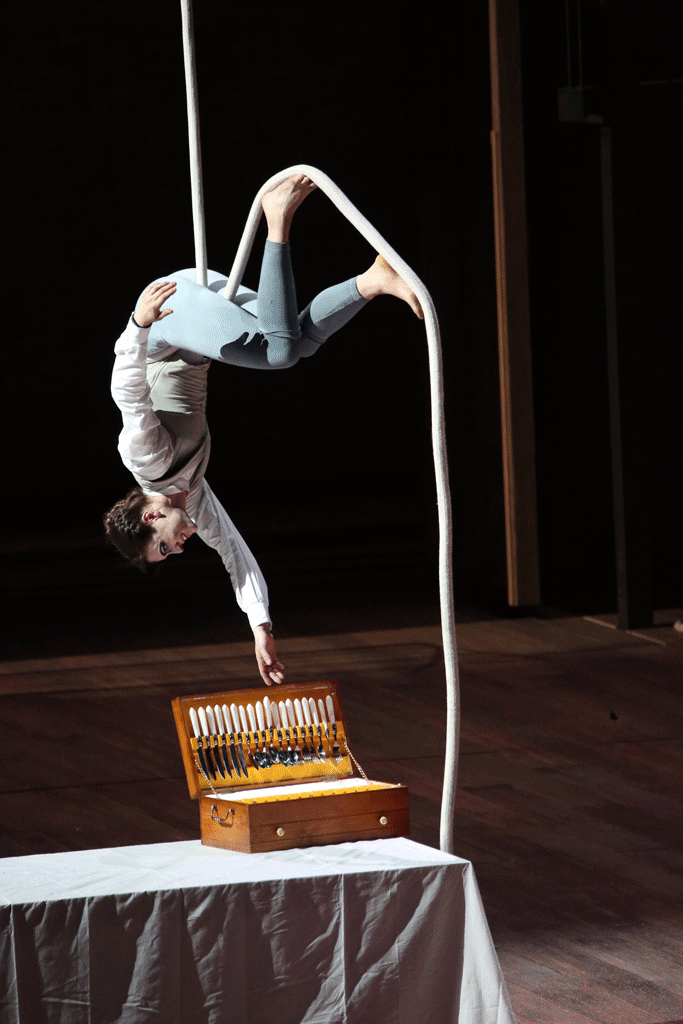 La Pie voleuse n’est pas très connue du public, si l’on excepte la fameuse ouverture, souvent jouée dans les concerts et toujours présente dans les très nombreux CDs d’ouvertures de Rossini. C’est un opéra dit semiserio, et sa trame et sa construction rappellent les opéras comiques d’ambiance paysanne à la française : l’histoire est celle d’une jeune servante, Ninetta, injustement accusée de vol et condamnée à mort, sauvée in extremis par la découverte de la vraie voleuse, une pie malicieuse, attirée comme on sait par tout ce qui brille. Rossini s’est inspiré d’un drame français de 1815, La pie voleuse de Louis Charles Caignez sur une musique d’Alexandre Piccini, inspiré d’un fait qu’on dit véridique ((l’histoire est passée à la postérité dans Les bijoux de la Castafiore, l’un des derniers Tintin)).
La Pie voleuse n’est pas très connue du public, si l’on excepte la fameuse ouverture, souvent jouée dans les concerts et toujours présente dans les très nombreux CDs d’ouvertures de Rossini. C’est un opéra dit semiserio, et sa trame et sa construction rappellent les opéras comiques d’ambiance paysanne à la française : l’histoire est celle d’une jeune servante, Ninetta, injustement accusée de vol et condamnée à mort, sauvée in extremis par la découverte de la vraie voleuse, une pie malicieuse, attirée comme on sait par tout ce qui brille. Rossini s’est inspiré d’un drame français de 1815, La pie voleuse de Louis Charles Caignez sur une musique d’Alexandre Piccini, inspiré d’un fait qu’on dit véridique ((l’histoire est passée à la postérité dans Les bijoux de la Castafiore, l’un des derniers Tintin)).
Ce n’est pas une œuvre légère, mais un authentique drame paysan, prenant racine dans la France profonde de la Restauration (l’action se passe en Ile de France, non loin de Paris). Ce n’est pas un hasard si l’œuvre s’ouvre par les roulements de tambour qui accompagnaient la guillotine et qui sonnent au moment du cortège qui accompagne l’infortunée à l’échafaud, et se ferme ou peu s’en faut par les cloches interdites sous la révolution, qui sonnent la découverte de la pie : le tambour révolutionnaire tue, la cloche chrétienne sauve.
 Les sources historiques du drame en font une authentique histoire d’essence populaire (comme l’était l’opéra-comique français), mais aussi un opéra à sauvetage dans la tradition de la fin du XVIIIe. Rossini embrasse un style déjà ouvert par Méhul ou Cherubini (dont il s’était déjà inspiré dans Torvaldo e Dorliska en 1815), mais il ouvre aussi sur Auber ou le bel canto romantique : on trouve des échos d’une histoire parallèle dans La Sonnambula de Bellini, opera semiseria de style paysan où une jeune fille est accusée faussement d’infidélité. « La pie » dans cette histoire étant remplacée par la découverte du somnambulisme d’Amina. Ce n’est pas non plus un hasard si Bellini et Felice Romani le librettiste puisent leur inspiration dans un vaudeville de Scribe de 1819.
Les sources historiques du drame en font une authentique histoire d’essence populaire (comme l’était l’opéra-comique français), mais aussi un opéra à sauvetage dans la tradition de la fin du XVIIIe. Rossini embrasse un style déjà ouvert par Méhul ou Cherubini (dont il s’était déjà inspiré dans Torvaldo e Dorliska en 1815), mais il ouvre aussi sur Auber ou le bel canto romantique : on trouve des échos d’une histoire parallèle dans La Sonnambula de Bellini, opera semiseria de style paysan où une jeune fille est accusée faussement d’infidélité. « La pie » dans cette histoire étant remplacée par la découverte du somnambulisme d’Amina. Ce n’est pas non plus un hasard si Bellini et Felice Romani le librettiste puisent leur inspiration dans un vaudeville de Scribe de 1819.
D’un certain point de vue, La pie voleuse est une œuvre singulière dans la production rossinienne, plus souvent adossé à des tragédies (Voltaire), comédies (Beaumarchais), ou contes et épopées (Cenerentola, Armida). Cette singularité s’entend aussi dans une musique plutôt sérieuse, plutôt symphonique aussi, surtout dans l’acte II qui pose aussi les racines du genre Grand Opéra. Cette œuvre exige de la tension, mais aussi une certaine dynamique, parce qu’elle alterne des moments de pur style rossinien habituel (acte I) et dans l’acte II des moments plus solennels, plus majestueux aussi, souvent des ensembles choraux, par exemple la scène du cortège menant Ninetta à l’échafaud ou celle du procès, exceptionnellement développée, quasi verdienne.
 La mise en scène de Gabriele Salvatores ((Le réalisateur du film Mediterraneo(1991), Oscar du meilleur film étranger en 1992)), qui retourne au théâtre après 28 ans d’absence, est centrée sur la figure métaphorique de la pie, interprétée par la magnifique acrobate Francesca Alberti, personnage central de “femme-libre” qui gère le drame, voltigeant, montant, descendant, courant comme une sorte de génie, de Gimini Cricket, d’Ariel de l’espace théâtral (à jardin des coulisses, à cour des loges de théâtre) se jouant des cordes et des poulies, et manœuvrant des machines de théâtre rappelant les scènes baroques qui font monter ou descendre des décors, comme si elle était la magicienne du théâtre, le metteur en scène, l’inventeur du drame.
La mise en scène de Gabriele Salvatores ((Le réalisateur du film Mediterraneo(1991), Oscar du meilleur film étranger en 1992)), qui retourne au théâtre après 28 ans d’absence, est centrée sur la figure métaphorique de la pie, interprétée par la magnifique acrobate Francesca Alberti, personnage central de “femme-libre” qui gère le drame, voltigeant, montant, descendant, courant comme une sorte de génie, de Gimini Cricket, d’Ariel de l’espace théâtral (à jardin des coulisses, à cour des loges de théâtre) se jouant des cordes et des poulies, et manœuvrant des machines de théâtre rappelant les scènes baroques qui font monter ou descendre des décors, comme si elle était la magicienne du théâtre, le metteur en scène, l’inventeur du drame.
Les costumes sont "XIXe siècle", couleur paysanne d’opéra-comique, avec quelque note référée à la modernité ou au cinéma (Le podestat est vêtu comme Nosferatu quand il poursuite la jeune Ninetta en prison). Au milieu de tous ces signes, les marionnettes splendides de la famille Colla (surtout durant l’ouverture, avec un petit "théâtre sur le théâtre " du plus bel effet), annoncent l’histoire, la racontent où miment les moments clefs. De petits signes nombreux qui n’ajoutent rien d’indispensable à l’affaire.
Peut-être Salvatores pouvait-il s’épargner les marionnettes, tant de fois utilisées dans cette salle, et peut-être utiliser mieux son idée de théâtre dans le théâtre, en se concentrant sur la pie-acrobate comme mascotte et créatrice de drame et de trame. La direction d’acteurs reste traditionnelle, et les meilleurs sont ceux qui savent d’eux-mêmes incarner un rôle, comme Alex Esposito ; pour le reste, les idées manquent un peu, sauf à certains moments, comme celle du tribunal installé dans les loges du théâtre (côté cour), comme un spectateur juge de l’action. En revanche la découverte du vol par la pie ne me semble pas scéniquement gérée au mieux ni au plus clair, et l’idée de campanile, soulignée par la cloche énorme, n’est pas rendue avec évidence par le décor pourtant assez efficace de Gian Maurizio Fercioni qui signe aussi les costumes.
Entendons-nous : la mise en scène ne développe pas suffisamment ses bonnes idées, comme celle de la cage où se retrouvent Ninetta et son Podestat-vampire, et se noie dans trop de lieux communs, en suivant un fil dramatique assez traditionnel essayant de se donner l’air de…
Si elle ne dérange pas, elle n’enthousiasme pas non plus.
La direction musicale de Riccardo Chailly ne méritait pas les huées de la Première, qui s‘est terminée par des échanges de noms d’oiseaux (c'était le moment où jamais) entre loggione (poulailler) et platea (orchestre), comme souvent aux premières d’opéra italien. C’est signe positif : la Scala respire encore et son public est encore vivant.
Riccardo Chailly est familier de l’univers rossinien : on lui doit des enregistrements qui ont fait date de Barbiere di Siviglia, La Cenerentola, Guglielmo Tell et Il Turco in Italia. Sa direction est précise, très claire, fait respirer la partition et donne à en entendre les moindres détails , laissant se développer les bois et les cuivres de manière très dynamique, qui rappelle un peu dans le soin donné aux détails d’orchestration les Meistersinger de Wagner que l’orchestre a joué quelques semaines auparavant ; d’ailleurs, Wagner ne dédaignait pas Rossini. Chailly alterne ainsi moments très dynamiques et d’autres plus solennels ou plus dramatiques.
Mais l’ensemble, toujours tendu, semble un peu distant, manque quelque peu d’homogénéité, peut-être aussi à cause de la musique elle-même, qui hésite entre le Rossini souriant des opéras-bouffes, et un Rossini plus symphonique qui annonce des œuvres plus monumentales. Un personnage travesti comme Pippo annonce clairement le futur Jemmy de Guillaume Tell. Chailly ne réussit pourtant pas à alléger quelque peu des moments assez longs comme la scène du tribunal de l’acte II, très sombre, très dramatique, plus majestueuse musicalement (ce Rossini rappelle beaucoup un Cherubini ou un Spontini, et annonce certains moments verdiens) : de là une impression de symphonisme excessif, un peu froid, un peu lent, laissant moins d’espace à la théâtralité, à la sensibilité aussi et laissant moins d’espace aux chanteurs, plus souvent couverts par l’orchestre dans ce second acte. Il demeure évident que ce Rossini qui quelques mois auparavant avait signé La Cenerentola, ne pétille pas comme le Champagne, et ne peut être lu comme une œuvre légère ni cristalline. Mais il reste une performance de l’orchestre de la Scala qui force le respect, un orchestre dont le son rend la monumentalité, voire la majesté de l’ensemble au point qu’on est au seuil de Beethoven quelquefois. Étonnant.
La distribution réunie est aussi respectable, composée de trois générations de chanteurs rossiniens, de Pertusi, trente années exemplaires au service de Rossini, à Alex Esposito, né en 1975, l’un des plus grands chanteurs rossiniens du moment, et une belle série de voix de nouvelle génération.
Michele Pertusi, le podestat, mûr et méchant, figure vampirique dans la mise en scène de Salvatores, reste une basse impressionnante, même si le tempo un peu lent du chef ne lui facilite pas la vie, en le mettant quelquefois en difficulté, soit dans la dynamique, soit dans les aigus. Il reste clair que Michele Pertusi est toujours un chanteur de référence dans ce répertoire.
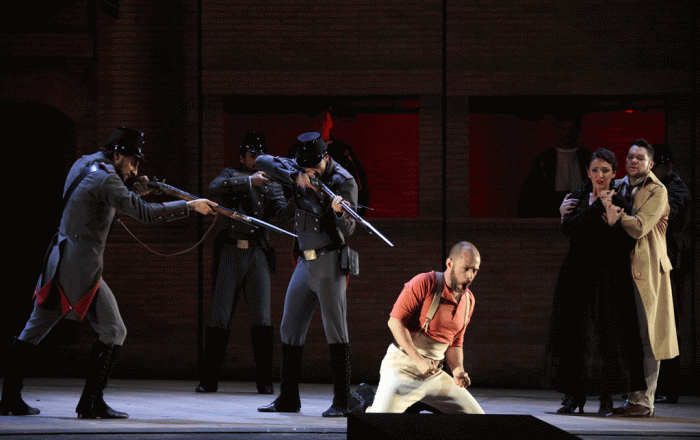 Alex Esposito joue une figure paternelle, celle du vétéran, probablement soldat des ex-armées napoléoniennes. Il en donne une véritable incarnation dans un style impeccable. Ce chanteur qu’il soit Figaro, Assur ou Fernando, des figures très différentes, incarne parfaitement ces personnages variés : son Fernando est vif, très humain, énergique, et la voix est forte, modulée, pleine de toutes les nuances voulues, avec une maîtrise unique des variations de style et grande personnalité scénique. Impressionnant.
Alex Esposito joue une figure paternelle, celle du vétéran, probablement soldat des ex-armées napoléoniennes. Il en donne une véritable incarnation dans un style impeccable. Ce chanteur qu’il soit Figaro, Assur ou Fernando, des figures très différentes, incarne parfaitement ces personnages variés : son Fernando est vif, très humain, énergique, et la voix est forte, modulée, pleine de toutes les nuances voulues, avec une maîtrise unique des variations de style et grande personnalité scénique. Impressionnant.
 L’autre soldat, c’est Giannetto, qui très vite se change en “gentil” fiancé à la morale bourgeoise bien installée, amoureux de Ninetta qu’il aspire à épouser. Edgardo Rocha, voix nouvelle dans la galaxie des ténors rossiniens, bien représentés dans le monde ibérique et ibéro-américain a une voix jeune, très claire, au timbre lumineux et aux aigus attendus avec de jolies modulations et douceurs, mais il manque encore de personnalité, même si le rôle n’est pas vraiment intéressant. À suivre de toute manière.
L’autre soldat, c’est Giannetto, qui très vite se change en “gentil” fiancé à la morale bourgeoise bien installée, amoureux de Ninetta qu’il aspire à épouser. Edgardo Rocha, voix nouvelle dans la galaxie des ténors rossiniens, bien représentés dans le monde ibérique et ibéro-américain a une voix jeune, très claire, au timbre lumineux et aux aigus attendus avec de jolies modulations et douceurs, mais il manque encore de personnalité, même si le rôle n’est pas vraiment intéressant. À suivre de toute manière.
Le père, Fabrizio, est Paolo Bordogna, baryton-basse de référence dans les rôles rossiniens et belcantistes en ce moment : voix claire, belle personnalité scénique, qui rend justice à l’humanité du personnage.
Du côté des rôles féminins la Lucia di Teresa Jervolino est juste : humaine, malgré ses excès, elle se rend bientôt compte que ses accusations l’ont mené au-delà de ce qu’elle voulait. La voix a les agilités mais est plus à son aise dans le registre central qu’à l’aigu, un peu crié dans l’air A questo seno resa mi fia du second acte. En revanche le Pippo de Serena Malfi dont on se souvient la belle Cenerentola romaine (d’Emma Dante) a trouvé son rythme de croisière en cette troisième représentation. La voix est vivace, bien calibrée, peut-être un peu moins dans les ensembles. Elle descend profond dans le grave, et possède la dynamique et la fraicheur voulue.
La Ninetta de Rosa Feola est très contrôlée, très attentive à chanter avec style et élégance, avec une émission claire et un beau phrasé. Même si le rôle n’exige pas d’agilités stratosphériques, sa voix a encore des failles à l’aigu, pas vraiment impressionnant. Elle reste prudente et manque un peu de personnalité, là où le personnage en démontre beaucoup, sauf dans la scène du cortège vers l’échafaud où elle est vraiment émouvante. L’artiste promet beaucoup, la prestation lui fait honneur, même si elle est encore un peu verte.
Quant aux rôles secondaires, ils sont bien tenus, comme l’Ernesto de Giovanni Romeo, le préteur de Claudio Levantino ou Antonio (Matteo Mezzaro), et surtout l’Isacco de Matteo Macchioni, un ancêtre de Mastro Trabucco ((La Forza del Destino)) ou Parpignol ((La Bohème)).
En conclusion, on pouvait rêver d’une fête rossinienne qui n’a pas eu lieu, parce que la mise en scène, la direction musicale, la distribution n’ont pas totalement enthousiasmé. Mais le spectacle demeure très digne, et ne méritait pas tant de méchant bruit. Ni cet excès d'honneur, ni cette indignité.

