
Il est deux choses qui subsisteront sur terre, tant qu'il y aura des humains : l'amour et la guerre ! (René Barjavel)
On reste bouche bée au départ face au décor monumental de Heike Scheele, qui rappelons-le, a été la décoratrice de Stefan Herheim pour le Parsifal de Bayreuth, mais aussi pour sa Rusalka entre autres. Elle construit presque grandeur nature un grand théâtre en ruine, délabré, dans le style des ruines d’Hubert Robert. Un théâtre qui n’est pas tombé en ruine, mais qui a été bombardé par la guerre et qui devient l’espace des derniers résistants ou résiliants, qui en font un espace de plaisir, de ce plaisir charnel qui fait oublier les guerres. Et pourtant les lits métalliques où évoluent les danseurs et les couples sont des lits qui rappellent les lits militaires, la guerre n’est jamais bien loin. Elle l’est si peu que très vite, les soldats de Bellone interrompent les ébats et vont installer une vie parallèle entre amour et guerre : « Faites l’amour et la guerre ».
On a aimé gloser sur une œuvre qui représentait les Indes, c’est à dire tout ce qui n’est pas nous, tout ce qui n’est pas l’Europe, l’ailleurs que depuis deux siècles on commençait à connaître, en important des denrées ou des êtres, en exportant des condamnés (on fait venir des indiens, et on envoie des Manon…). Sidi Larbi Cherkaoui en a fait une magnifique réflexion sur l’ailleurs et l’exil, sur les migrations, Clément Cogitore une machine très mode et bien-pensante sur la culture des quartiers, l’exotisme pour les spectateurs du centre de Paris. Ici Lydia Steier, en fait une méditation mélancolique sur l’irréductibilité de l’amour et de la guerre.
Toute la période baroque et la poésie précieuse sont pleins de poèmes d’amour construits sur des métaphores de guerre, et le vocabulaire de l’amour est souvent un vocabulaire de conquête, on fait le siège d’une dame, qui finit par succomber en une délicieuse défaite, devant son vainqueur. Ces exemples, pris à Denis de Rougemont dans L’amour et l’occident, sont assez parlants, naissent dans l’antiquité se poursuivent au moyen âge (l’amour courtois) et dans la poésie précieuse. Et sans compter les représentations de l’amour muni d’un arc et de flèches pour frapper. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que Lydia Steier installe une fausse opposition où peu à peu on va voir fusionner et la guerre et l’amour.
C’est donc un projet abstrait, assez provocateur parce qu’au départ il ne fait pas spectacle ; l’impression est une succession de moments et de mouvements où les personnages se ressemblent et fusionnent, dans un décor fixe. Lydia Steier, ose le décor fixe dans une œuvre qui fait voyager d’un coin à l’autre du monde. D’une certaine manière, elle supprime les entrées, puisque tout le monde est sur scène et qu’il n’y pas plus d’entrée – un mot qui implique un mouvement), mais une présence statique de tous, qui occupent le décor tantôt dans les loges tantôt sur la scène. Du coup ce théâtre en ruine devient refuge (un peu branlant) face aux explosions qui viennent de l’extérieur.
Ainsi Lydia Steier propose-t-elle une direction assez rigide, au prix de coupures notamment à la fin ou sa vision mélancolique exclut toute réjouissance, adieu donc l’air de Zima « régnez plaisirs de yeux », ou la danse finale, qui ne cadraient ni avec les choix de mise en scène, ni avec le tempo particulièrement retenu d’Alarcón, qui surprend dans une entrée habituellement aussi dansante.
Certes, on doit défendre l’interprétation de l’œuvre dans son ensemble, sans coupures, selon les canons contemporains, mais qui n’étaient pas ceux du XVIIIe où les œuvres s’adaptaient aux circonstances, aux théâtres, aux chanteurs. Alors vu le parti pris scénique qui a sa logique et sa rigueur, nous ne jugerons pas de ces interventions.
Bien plus intéressant l’autre parti pris de la production, que de lier de manière bien plus articulée les danses et le chant, et la chorégraphie (excellente) de l’argentin Demis Volpi (qui avait signé la chorégraphie du récent Guillaume Tell lyonnais) prend souvent le pas, au point de montrer non un opéra-ballet mais bien plus un ballet-opéra. Une chorégraphie qui mêle danse et mouvements, jeu et danse, pas de deux très classiques et mouvements apparemment désordonnés où se mêlent chanteurs et danseurs de manière particulièrement fluide et harmonieuse. Ainsi donc du prologue qui nous montre une sorte de Venusberg gouverné par Hébé (Kristina Mkhitaryan) où tout est à peu près permis et où François Lis et Cyril Auvity au premier plan se donnent ardemment l’un à l’autre, couple parmi d’autres avant de prendre leurs rôles pendant les entrées, ainsi donc également du pas de deux magnifique du début de la troisième entrée « Les fleurs », sous la reproduction de la voûte du foyer du Grand Théâtre (dans cette production, le théâtre n’est jamais loin) devenue une sorte de parodie bien proche d’une turquerie à la Mozart ou Rossini dans un jeu de dupes et de déguisements.

Le théâtre justement, est un décor somptueux envahi par des gravats, par des rochers, bombardé et poussiéreux, mais dont on se demande au départ la fonction, si ce n’est celui du refuge de la liberté des corps : que le théâtre soit un lieu de perdition, celui qui écrit est trop bien placé pour le nier, mais au-delà de la perdition, ce sont deux éléments qui frappent :
- L’expression d’une liberté absolue des corps entre eux, et d’un effacement de la frontière des genres : ici pas de chant alternant avec le ballet. Les deux fonctionnent de conserve. Demis Volpi crée des mouvement tantôt clairs, tantôt ambigus, mais ne renonce jamais à faire bouger les personnes, tout autour, sur les rochers, dans les loges et sur le plateau – cette osmose entre mouvements de danse et mouvements de mise en scène frappe dès le départ, mais surprend d’abord tant on croit que décor et personnes vont bouger selon les entrées, au point que les deux premières entrées apparaîtraient un peu convenues ou ennuyeuses, tant on saisit lentement le propos de la production qui s’installe peu à peu.
- L’exploitation du lieu, de l’espace qui rend hommage à ce qu’est le théâtre, un espace où se mélangent les genres, les êtres, les classes sociales. Un espace social qui fait société à lui tout seul et qui est presque par sa structure métaphore du corps social, mais aussi un espace qui malgré les bruits de bottes, reste protégé, reste le dernier lieu où quelque chose se passe, où quelque chose peut se passer. La monumentalité du décor, presque à l’échelle, permise par le grand plateau de Genève impose le théâtre comme un « lieu », même en ruines, même avec des gravats et des balustres brisées… il reste d’ailleurs quelques lampes dans les loges, quelques rideaux rouges qui subsistent de la splendeur perdue, et quelques lustres, dont on sait depuis Baudelaire : « Ce que j’ai toujours trouvé de plus beau dans un théâtre, dans mon enfance, et encore maintenant, c’est le lustre, — un bel objet lumineux, cristallin, compliqué, circulaire et symétrique. »((Charles Baudelaire, Mes opinions sur le théâtre, Mon cœur mis à nu, Journaux intimes, Ed.1887))
Ces lustres bougent descendent jusqu’au niveau de l’acteur, remontent, selon les moments et les circonstances.

Le lieu unitaire qu’est le théâtre évolue grâce aux éclairages, aux dispositions des lits métalliques, à l’apparition de rochers, comme des coulées de lave refroidie qui ont obstrué la scène, fermant un peu plus l’espace. Dans ce théâtre en effet la scène fonctionne peu, elle reste décorative, c’est la salle qui fait scène, un peu comme dans le décor du Capriccio de David Marton à Lyon en 2013. Car ce théâtre-là est espace non fonctionnel.
Le travail de Lydia Steier et Demis Volpi met du temps à s’installer et à prendre sens. La première partie reste un peu statique, tout comme la direction d’Alarcón très précise au demeurant adopte un tempo loin d’être vraiment dansant (cela ne swingue pas comme d’habitude). Il faut attendre la deuxième partie, où se mêlent soldatesque et petit groupe orgiaque dirigé par Hébé et l’entrée des fleurs, pour que les choses prennent sens, en des tableaux vraiment suggestifs, comme l’apparition de la végétation le long des parois du théâtre, faisant le plus en plus ressembler l’ensemble à un tableau d’Hubert Robert, ou le long pas de deux initial .
Enfin le dernier tableau « Les Sauvages », mené à un train de sénateur, sur un tempo exceptionnellement ralenti, donne une idée fort mélancolique de l’ensemble, comme la fin de quelque chose et pourquoi pas, d’un monde qui se fixe sous la neige qui tombe. C’est un moment de suspension du temps, où l’on a envie qu’il s’étire à l’infini. Là où l’on appelait une sorte de réveil joyeux, d’ouverture sur un futur, on a comme l’entrée d’un tunnel sombre dont on n’est pas près de revoir la lumière.

Au total, après avoir suscité une adhésion plus que réservée, l’ensemble du spectacle prend tout sa cohérence et l’entreprise Steier/Volpi est convaincante, d’abord parce qu’elle va ailleurs et qu’elle raconte une autre histoire, qui est aussi celle de ces Indes, galantes ou non, histoire de guerres, fratricides ou non, coloniales ou non, partant du constat que le prologue oppose Hébé (la jeunesse, la vigueur) et Bellone, déesse de la guerre chantée par un homme (l’excellent Renato Dolcini), où comme souvent les prologues commencent par un ἀγών (une compétition) et finissent ici par une fusion. Une fusion qui s’affirme par la relative unicité de ces personnages multiples qui s’habillent à vue, comme s’ils étaient UN revêtant PLUSIEURS costumes, au point qu’il est difficile de distinguer Bellone d’Osman ou d’Adario, confiés au même chanteur et il en va de même pour les autres chanteurs et chanteuses assumant des rôles doubles ou triples. Lydia Steier vise volontairement à la confusion et des genres et des êtres. Et là aussi le spectateur est presque « délicieusement » perdu.

A ce travail très intéressant correspond l’engagement de Leonardo Garcia Alarcón au service de l’entreprise, avec sa Cappella Mediterranea. Il avait aussi accompagné la production parisienne, il sert ici sans doute encore de manière plus convaincue l’entreprise de Lydia Steyer et Demis Volpi, adaptant ses tempi, proposant une version plus retenue et plus intimiste (notamment, on l’a vu dans une quatrième entrée sortant vraiment des sentiers battus), mais gardant ce son très clair, cette précision des attaques, ce soin apporté au phrasé qui font de la performance musicale une vraie réussite. Attentif aux chanteurs, mais aussi aux mouvements des danseurs et du corps de ballet (vraiment remarquable), il accompagne le plateau avec un souci d’osmose des différents éléments, dans un opéra où les éléments sont si disparates et nécessite un travail de mise en cohérence.
Ce qui frappe dans cette approche, c’est la fluidité, c’est l’absence total d’effets qui pourraient sembler artificiels : il n’y a littéralement rien de trop, on est dans un sorte d’équilibre classique très dominé qui met aussi en confiance les forces du plateau, le chœur formidable dirigé par Alan Woodbridge et le ballet du Grand théâtre. Tous son entremêlés, chœur, ballet, solistes en une unité tellement marquée qu’il est quelquefois difficile de comprendre qui fait quoi. Les chanteurs semblent danser, les danseurs semblent chanter. Rameau chante et danse en même temps et c’est un vrai bonheur que cette confusion.
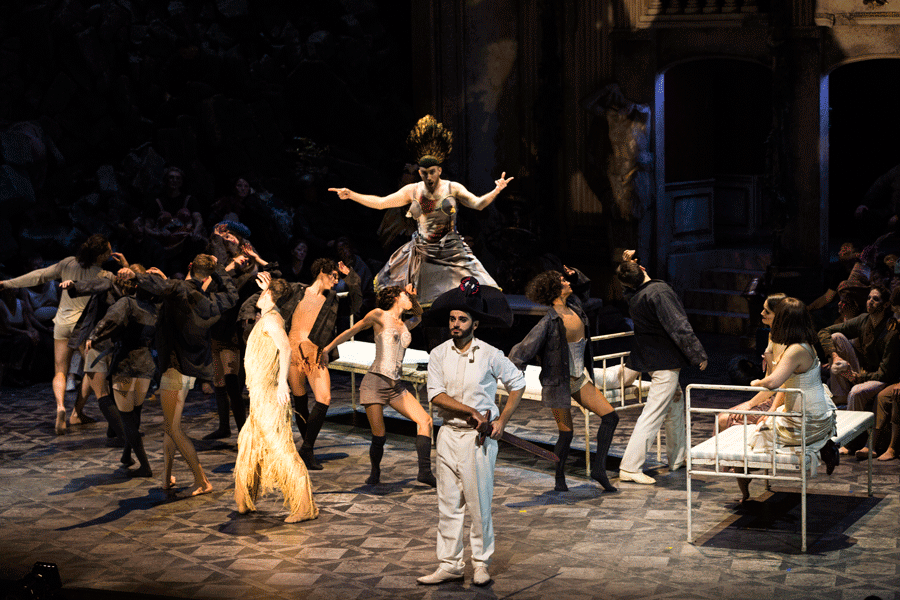
Évidemment le groupe des chanteurs est particulièrement stimulant d’abord par une commune prononciation et diction impeccable du français. Il y a sur le plateau beaucoup d’italiens dont on admire la clarté d’émission, et c’est un caractère qu’il faut vraiment souligner. Chacun affirme une personnalité vocale, qui s’adapte aux personnages divers que chacun interprète. La Hébé séduisante de Kristina Mkhitaryan a une voix bien contrôlée et homogène, une diction impeccable et particulièrement apte à colorer. C’est elle qui peut-être a la partie la plus flatteuse et elle s’en sort avec les honneurs. Roberta Mameli (Amour, Zaïre) n’a rien à lui envier, avec son phrasé impeccable, sa fraîcheur et aussi son humour). Belle incarnation de Fatime par Amina Edris, à la couleur sombre, particulièrement intéressante ici et de Phani par Claire de Sévigné, élève particulièrement douée du Jeune Ensemble. Toutes les chanteuses chantent leur rôle pour la première fois, c’est à signaler.
D’ailleurs dans la distribution seuls François Lis (Huarscar,Don Alvaro) et Cyril Auvity (Valère, Tacmas) ont déjà l’expérience de leurs rôles, au-delà du couple amusant et dansant qu’ils forment au prologue, ils affichent chacun une belle santé vocale, basse au timbre sonore et profond de François Lis, et ténor particulièrement relevé pour Cyril Auvity, en grande forme, qui impressionne dans les deux rôles qu’il chante.
Pour les autres – des italiens- c’est une prise de rôle aussi et ils sont excellents. Gianluca Buratto (baryton) pour le rôle d’Ali, un rôle de caractère un peu caricatural, dans lequel il excelle, Le ténor Anicio Zorzi Giustiniani assume ses deux rôles (Damon, Don Carlos) avec beaucoup d’engagement et de justesse, et tous deux dans un français impeccable, tout comme la basse Renato Dolcini, assumant avec relief et intelligence trois rôles, Bellone, Osman, Adario.

Pour les fêtes, et après deux spectacles discutables (Aïda et Orfeo) sur les trois déjà proposés depuis septembre, Aviel Cahn a fait le joli cadeau d’un spectacle musicalement incontestable et résolument original et séduisant, signé d'une Lydia Steier nettement plus convaincante dans l’entreprise Rameau que l’entreprise Mozart à Salzbourg.

