
Vidéo à regarder sur Opéravision :
https://operavision.eu/fr/bibliotheque/spectacles/operas/semele-komische-oper-berlin
Même à l’époque où Haendel n’était plus guère connu qu’à travers les interprétations éléphantesques du Messie par des milliers d’exécutants, au moins deux airs pour soliste avaient survécu à l’oubli : « Ombra mai fù », évidemment, dans des versions plus que lentes, adaptées pour tous les instruments possibles, mais également le presque aussi lent « Where’er You Walk », dont s’emparèrent les voix aiguës les plus variées, de Leontyne Price aux contreténors et aux jeunes sopranistes, mais aussi les contraltos (Kathleen Ferrier) et les barytons (Lawrence Tibbett ou Bryn Terfel). En dehors de cette aria, que restait-il de Semele il y a un siècle ? Presque rien, puisqu’il faudrait attendre 1925 pour que soit montée à Cambridge la première production scénique de cette œuvre d’un compositeur ayant renoncé à la scène, puis la fin des années 1950 pour que cet oratorio revienne pour de bon grâce aux efforts de la Handel Opera Society, et les années 1980 pour qu’il s’inscrive enfin au répertoire des théâtres.
Comme c’est souvent le cas, la qualité de la musique de Haendel rend difficile de résister à la tentation d’en proposer une représentation scénique, même si Semele porte bien le titre d’oratorio. Cela dit, le livret initial, destiné à John Eccles qui le mit en musique vers 1706, était bien celui d’un opéra (même s’il ne fut jamais monté), et si l’adaptation qui en fut proposée à Haendel fut donnée sous la forme d’un concert, en pleine période de Carême, elle n’en conservait pas moins ses vertus dramatiques. Même s’il brilla surtout par ses comédies en prose, comme The Way of the World (1700), William Congreve savait aussi écrire des tragédies en vers, et Semele montre que la musique anglaise a bien perdu à ne pas plus souvent l’employer comme librettiste. Sémélé périt brûlée par la foudre et les éclairs de Jupiter, ayant deviné à son divin amant de se montrer à elle non sous l’aspect d’un mortel, mais sous son vrai visage. Et Congreve sut fort habilement tisser son drame autour de ce feu omniprésent, la première scène du premier acte étant consacrée à un sacrifice lors duquel « des flammes montent de l’autel », les prêtres commentant l’apparition d’ « éclairs d’heureux présage ». Plus tard, l’héroïne se vante d’avoir convaincu le maître des dieux de laisser inemployés son tonnerre et sa foudre (dans l’air célèbre « Endless pleasure »). C’est Junon qui déclare « brûler » de rage et de jalousie.
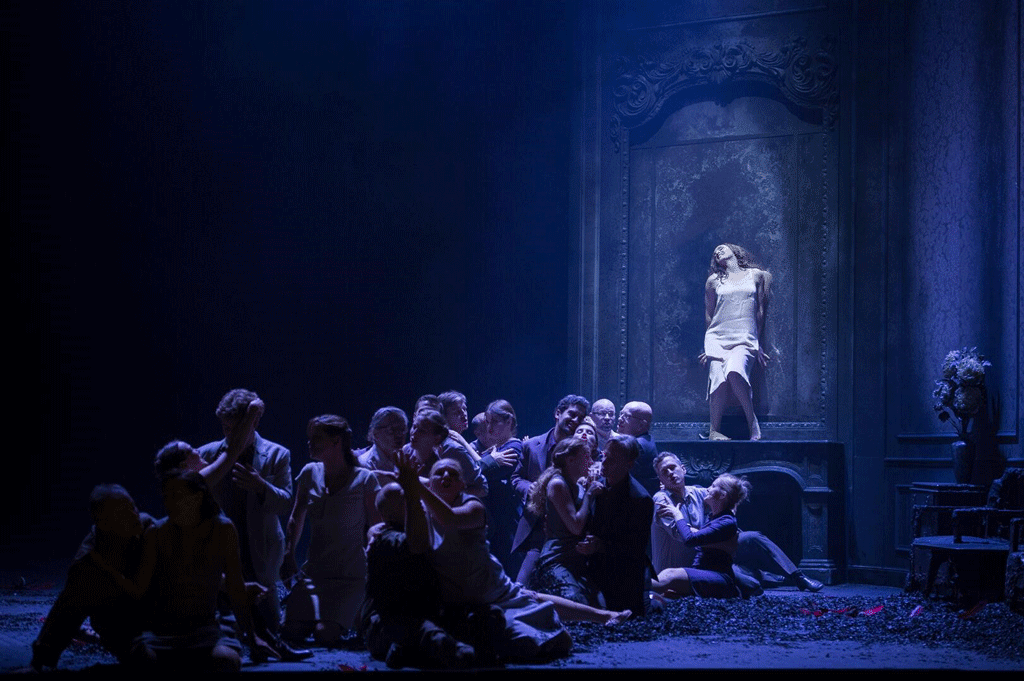
Pour mettre en scène cet « opéra paillard », selon le verdict de Charles Jennens, librettiste du Messie, Barrie Kosky n’a pas hésité à montrer l’effet de ces ardeurs dont il est tant question. Collaboratrice régulière de Laura Scozzi, pour qui elle a notamment réalisé les décors d’une inoubliable production des Indes galantes vue à Bordeaux puis à Toulouse, Natacha Le Guen de Kerneizon a imaginé en guise de cadre unique pour l’action des trois actes un grand salon avec ses moulures et ses trumeaux, mais un salon noirci par les flammes qui l’ont léché de trop près : les meubles ont été dévastés, les cendres s’accumulent dans les coins, et le fond de la salle se perd dans une obscurité brumeuse. Les parois sont percées de quelques portes, mais les cheminées servent aussi de voie d’accès : initialement surgie d’un tas de braises dans lequel elle se plongera à nouveau à la fin de l’œuvre, Sémélé disparaît aspirée dans un âtre lorsqu’elle choisit Jupiter de préférence à Athamas, et c’est par un autre que tout le chœur fera plus tard son entrée. Le feu n’est cependant pas la seule figure récurrente du spectacle, et les miroirs jouent aussi un rôle central, qu’ils soient tenus à la main ou fixés au-dessus des cheminées, comme celui qui sert un moment de prison à la coquette Sémélé, telle une Alice qui, ayant voulu passer de l’autre côté du miroir, se retrouverait coincée entre deux mondes. Et l’héroïne finit ici comme une nouvelle Cendrillon, finira non pas dans la cheminée mais juchée sur son manteau, brûlée, abandonnée de tous.
Comme toujours, on reconnaît aussi la griffe Kosky à la fluidité avec laquelle le chœur évolue, d’autant plus habile que, grâce à la souplesse permise par l’oratorio, Haendel n’hésite par à le faire revenir à plusieurs reprises pour de courtes interventions : le chœur de la Komische Oper est désormais rompu à la « méthode Kosky » et se montre toujours musicalement impeccable et dramatiquement pertinent. Dans la fosse, l’orchestre maison se compose évidemment d’instruments modernes, mais on croirait entendre une formation baroqueuse grâce à la direction experte de Konrad Junghänel, à qui l’on doit quelques enregistrements ayant fait date, de cantates de Bach notamment. Junghänel est aussi un vrai chef d’opéra, qui dirige régulièrement le répertoire mozartien à Wiesbaden, qui dirige régulièrement à la Komische Oper, et qui sait maintenir la tension nécessaire à une œuvre scénique (malgré ces bruits de tonnerre qui viennent couper la musique à plusieurs reprises, parfois de manière un peu intempestive).

Cette production repose aussi en grande partie sur les épaules de chanteurs-acteurs aptes à traduire dans leur corps autant que par leur voix les intentions du metteur en scène. Si l’Iris de Nora Friedrichs ne sort guère du stéréotype de la secrétaire-starlette, le Somnus éloquent d’Evan Hughes est un personnage déjà plus ambigu. En Cadmus, Philipp Meierhöfer se transforme de père d’abord inflexible en beau-père enthousiaste alors que les derniers moments du spectacle semblent reproduire le déroulement du premier acte, le mariage d’Ino reprenant les mêmes épisodes (pose du voile de la mariée, remise des alliances, arrivée des invités qui se bousculent pour embrasser la future épouse). Malgré un timbre sans séduction particulière, Eric Jurenas compose un Athamas touchant, par sa maladresse autant que par ses émois. Le rôle (d’abord confié à une seule artiste en 1744) d’Ino/Junon appelle une voix de contralto, sans qu’il soit possible de tricher : les deux chanteuses ici présentes font mieux que remplir leur contrat, Ezgi Kutlu avec notamment un « Hence, away » sans histrionisme mais à la vocalisation précise et au grave dense, tandis que Katharina Bradić (la récente Dalila de Strasbourg) possède en outre cette mélancolie qui sied particulièrement à Ino.

Pourtant, cette captation s’avère surtout remarquable pour le couple central, dont Barrie Kosky a réglé le jeu avec toute son acuité habituelle. Barbe de dieu grec et chevelure louis-quatorzienne, Allan Clayton impose un Jupiter hors du commun, virevoltant et narquois dans ses premières apparitions, avec un léger embonpoint qui ne l’empêche nullement de multiplier les entrechats, grave et tourmenté au dernier acte, la voix suivant cette évolution, s’autorisant des intonations nasales dans un premier temps pour mieux ensuite jouer de tout son charme, comme dans le fameux « Where’er You Walk » qui conclut ici la première moitié de la représentation. Quant à Nicole Chevalier, dont le nom masque la nationalité américaine, sa prestation est bluffante sur tous les plans. On se rappellera peut-être l’avoir vue en Eudoxie dans La Juive montée par Peter Konwitschny pour l’OperaBallet Vlaanderen, mais ceux qui s’attendraient à une « simple » colorature en seront pour leurs frais : la soprano chante Traviata un peu partout, ce qui laisse supposer que ses moyens vont au-delà de la seule virtuosité. De fait, on se réjouit d’entendre une Sémélé à la voix aussi ample, même si un air brillant comme « No, no, I’ll take no less » impressionne surtout comme moment de théâtre, véritable crise de nerfs à laquelle succombe une héroïne ici particulièrement déchirée par un conflit intérieur aigu. Sémélé n’est pas ici une pin-up pour paparazzi, mais bien un personnage complexe, et c’est tant mieux.
Vidéo à regarder sur Opéravision :
https://operavision.eu/fr/bibliotheque/spectacles/operas/semele-komische-oper-berlin
