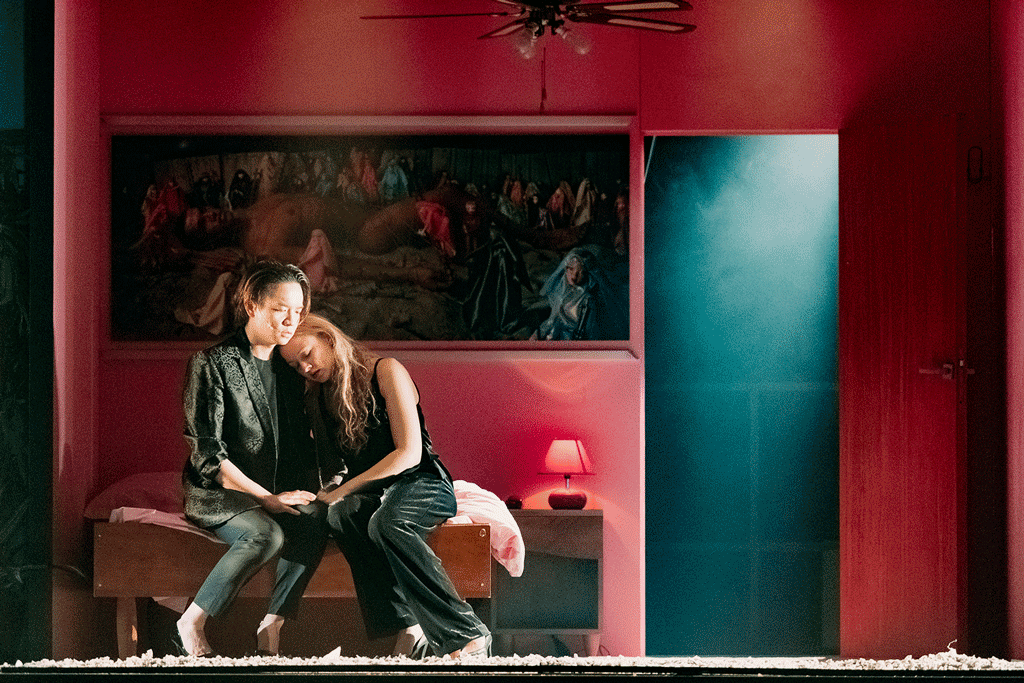La salle se remplit dans le brouhaha ordinaire. Comme une sorte de réflexion du spectacle à venir, le public est bigarré, composé aussi bien d’habitués du théâtre de la Croix-Rousse ou de l’Opéra que de jeunes lycéens en sortie scolaire.

Déjà présents sur scène, les musiciens simplement vêtus de jeans et de t‑shirts, prennent le temps d’accorder leurs instruments, affairés à la préparation de ce qui va suivre. Ils occupent une place conséquente dans le surprenant décor pensé par Velica Panduru. Dans un dispositif frontal pleinement revendiqué, on se trouve face à ce qui pourrait être la coupe transversale d’un bâtiment à étage, positionné au lointain, dégageant un espace de jeu allant jusqu’à l’avant-scène. L’instrumentarium qui est formé de trois claviers, de deux clarinettes et d’un saxophone, de deux guitares – acoustique et électrique – ainsi que d’une batterie, se situe avec les musiciens au rez-de-chaussée, dans une grande pièce ouverte sur la scène. Décorés de lambris jaune, les murs sont éclairés par la vive lumière de plusieurs néons blancs. Au-dessus, se trouve ce qui pourrait être un appartement avec trois pièces distinctes de jardin à cour : une salle à manger avec une table et des chaises en formica, avec plusieurs plantes vertes assez hautes, tout cela entouré de parois quadrillées dans une teinte vert d’eau ; une chambre rose avec un lit et une table de nuit surplombés par une composition graphique de l’artiste américain David Lachapelle intitulée Would-be Martyr and 72 Virgins sur laquelle on voit un jeune homme nu regardant au loin, par-delà la salle, allongé au sol, ficelé par des liens, entouré de poupées Barbie, de différentes couleurs et voilées – image qui nous absorbe par le regard du personnage, en évoquant autant l’esthétique queer que la place des hommes et des femmes-objets ou encore les martyrs dans les conflits moyen-orientaux ; enfin, une salle de bains blanche avec toilette et lavabo. Ce décor lumineux et coloré mérite vraiment qu’on s’y attarde et attire instantanément l’œil qu’il retient par ses implicites suggestifs. La terre n’a pas encore tremblé mais on devine une faille signifiante avec la coupe massive qui laisse voir l’intérieur. Quant à l’ordre géométrique du décor dans son ensemble, il semble avoir quelque chose de la maison de poupées sur le point de se casser. Ajoutons à cela qu’il est flanqué de deux praticables, sur lequel on voit deux rangées de chaises devant lesquelles se trouve un prie-Dieu à jardin et un pupitre à cour. Et à l’aplomb de ces deux espaces, on remarque des néons lumineux en forme de croix latine à jardin et la Star-spangled Banner à jardin éclairée par un projecteur – renvoyant à l’Amérique du séisme original. Comme la situation d’un monde enclavé entre l’église et l’État.
La scène s’anime alors. Un des chanteurs entre à jardin. Il regarde le public en silence et va s’installer derrière le pupitre à cour. Les musiciens jouent un air enjoué pour l’ouverture. Les autres apparaissent dans les pièces à l’étage, l’une d’entre eux se place même devant le prie-Dieu. Tous face au public. Le chant s’élève alors. I thought everything was over and I had lost my lover.I thought my life was permanently out of order… Les personnages rappellent les illusions qui constituaient leur quotidien. Et annonce déjà la certitude que quelque chose a changé. Radicalement. Brutalement. Et définitivement. I was looking at the ceiling and then I saw the sky continuent-ils en chœur.
Sur le plateau comme dans une peinture animée et sonore, on va les voir à rebours dans leurs existences respectives ressemblant à une prison aux parois invisibles les mettant sous les regards de tous y compris des nôtres – la salle de bains à l’étage va d’ailleurs se convertir en cellule dans un centre de détention pour l’un des personnages. Sur sa porte, après qu’une pancarte y aura été accrochée, on pourra lire « Closed ». Un effet d’insistance supplémentaire afin de renvoyer chacun à sa forme de vie carcérale, résolument verrouillée. Entre faux-semblants et habitudes délétères – telle la nôtre peut-être.
Plusieurs trajectoires se croisent peu avant le séisme. Dewain – le baryton Alban Zachary Legos – est arrêté pour vol. Consuelo, sa compagne d’origine sud américaine – la mezzo-soprano Clémence Poussin, est désespérée, seule avec son enfant et ne se sent pas chez elle dans ce pays qui persécute les étrangers. Mike – le baryton Aaron O’Hare – est le policier qui arrête Dewain.

Il entretient une relation sentimentale de loin en loin avec Tiffany – la soprano Louise Kuyvenhoven – journaliste éprise de lui, qui le suit partout, qui filme tout, tout le temps. Rick, l’avocat de Dewain – le ténor Biao Li sublimement juché sur des talons – est attiré par Mike qui, même s’il affirme ses convictions en une société hétéronormative, ne lui semble pas pleinement indifférent et connaît certains tourments nocturnes – la scène quelque peu ambiguë où dévêtu, il gémit dans le lit, face à la composition de David Lachapelle, le laisse penser en tout cas. Enfin, soumis à ses appétits sexuels qu’il ne peut réprimer, David, le pasteur – le ténor Christian Joël – va par exemple, jusqu’à abuser de Leila – la soprano Axelle Fanyo. C’est d’ailleurs une des scènes les plus rudes du spectacle. Et malgré cela, les filles chantent en chœur leur attirance irrépressible et fatale pour les bad boys, sous une boule à facettes, dans un tableau digne d’une comédie musicale à Broadway.

La musique et les chants d’inspiration allant du jazz au gospel en passant par le rock ou le funk emportent toujours vers la douceur, la cruauté de ces moments de vie empreints de tous les désordres de notre monde – en 1994 de la même façon qu’aujourd’hui comme le souligne Eugen Jebeleanu : la domination masculine brutale sur les femmes – rappelons l’affichage en français sur le mur de la salle de bains-cellule du titre « À nos sœurs assassinées » en lettres bleues ; le racisme ; l’hyper-virilisation ; les dérives judiciaires et policières ; l’outrance médiatique… Ce theatrum mundi faits de « dérèglements » auxquels chacun d’entre nous « participe volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment ». Certes, toute gravité est écartée, toute tentation purement tragique est déjouée. Les personnages très stéréotypés par leur langage populaire, par leur tenue ou par leurs attitudes – citons Leila vêtue telle une madone digne d’une photographie de David Lachapelle ou de Pierre et Gilles, distribuant des préservatifs au public ou encore la rapide relation sexuelle entre Mike et Nick derrière les plantes de la salle à manger – parviennent à mettre toute pesanteur à distance et même à faire rire le public. Le refus de toute homogénéité musicale dans l’œuvre participe aussi de cette atténuation formelle. Considérons simplement qu’atténuer la forme permet ici de laisser percevoir davantage le fond.
Le tremblement de terre advient : depuis les cintres tombent des gravats, les lumières vacillent. Sur les décombres, une femme travaillant dans une brigade cynophile traverse le plateau, tenant un chien en laisse – autre détail à la fois réaliste et plaisamment incongru. Le monde a changé. Et au-dessus, un ciel « extrêmement étoilé » : le monde se découvre à proprement parler. Et chacun se découvre au même instant. Sous nos yeux, ces individus ordinaires mais dessillés deviennent en quelque sorte les héros de leur propre existence : le spectacle vivant recèle des pouvoirs qui rendent justement extraordinaires. I was looking at the ceiling and then I saw the sky, reprennent-ils en chœur pour le final.
Grâce à la présence lumineuse d'un orchestre dirigé par Vincent Renaud avec un art savant des ruptures de style et un rythme qui ne s'essoufle jamais, et celle de tous les artistes, grâce à leur grande maîtrise vocale – soulignons par exemple, le timbre clair du ténor Biao Li ou celui des trois sopranos, l’onde sismique passe et nous traverse. Dans un singulier mouvement spéculaire, le regard juste et engagé du metteur en scène sur cette œuvre en résonance avec le monde actuel, nous interpelle sur notre présent et ses incohérences mettant régulièrement en péril toute possibilité de concorde. Il nous interpelle également sur notre propre identité, sur notre capacité à user pleinement de la liberté essentielle d’être soi-même, dont on dispose parfois avec tellement d’entraves.
Avec cette dernière création, Eugen Jebeleanu et Yann Verburgh témoignent de leur capacité à s’approprier avec finesse d’autres formes que le théâtre. Sans surajouter à la densité essentielle de cet opéra-pop, ils nous invitent avec tous les artistes, à en redécouvrir les subtilités par une composition esthétique soignée et un rigoureux travail de direction. Un moment jubilatoire !