La scene liriche de Puccini repose sur un livret pas toujours très audacieux, signé Giuseppe Giacosa et Luigi Illica d'après les fameuses "Scène de la vie de Bohème" de Henri Murger. Ce best-seller dont on a peine aujourd'hui à imaginer le succès populaire, décrocha ses lauriers dès sa publication en épisodes, puis dans une version adaptée au théâtre et enfin sous forme de roman. L'action débute dans une mansarde, lieu parisien qui sert d'antichambre à la renommée pour les jeunes artistes. Trois issues se présentent à ces "bohémiens" : la reconnaissance (seul moyen d'accéder à la canonisation académique), la mort (l'assurance de finir exposé aux regards des curieux sur les bancs de la morgue) ou bien la maladie (phase transitoire qui se déroule dans les couloirs de l'assistance publique). Chez Claus Guth, les quatre compères Rodolfo, Marcello, Schaunard et Colline voyagent plus loin encore que les étoiles qu'ils fixent au-dessus des toits de Paris. L'action est déplacée dans l'espace confiné d'un vaisseau-mansarde, naviguant vers une destination rendue aléatoire par une défaillance des réacteurs. L'équipage ère dans l'univers sans but, avec des réserves vitales qui s'amoindrissent et un moral en berne – à l'instar des personnages imaginés par Murger. En superposant l'épuisement physique et mental des artistes changés en astronautes, Guth réussit à extraire du livret l'angoisse envahissante de conditions matérielles qui consument leurs rêves et leurs idéaux. Fallait-il pour autant ajouter à chaque changement de tableau une bruyante respiration off, comme pour surligner l'intention et banaliser la ligne principale de cette mise en scène ?
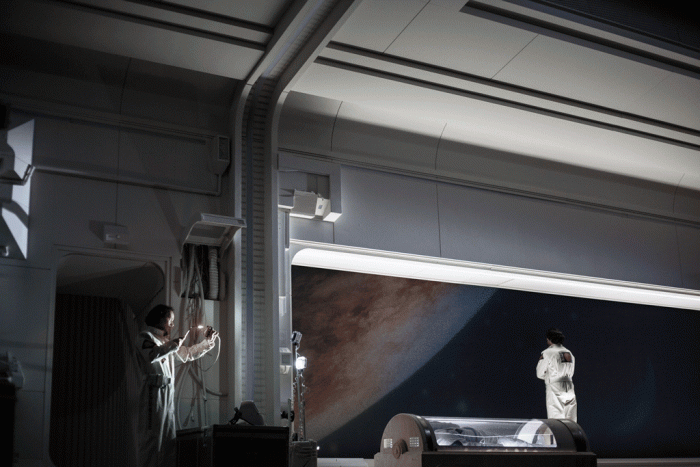 "Faisons resurgir le temps depuis longtemps révolu" écrit notre Rodolfo bloggeur sur l'écran projeté au-dessus de la scène. Deuxième ligne rouge : l'irruption de figurants circassiens qui déroulent invariablement de cour à jardin une série de souvenirs et de flashs mémoriels. Claus Guth se sert du fil autobiographique et infini du "Je me souviens" de Georges Perec, comme miroir magique dans lequel défilent des images qui se bousculent avec l'incongruité et l'abstraction d'un compte-rendu de rêve. Une liste infinie dont l'énonciation-même laisse entendre dans son sillage un écho réverbéré, une berceuse lexicale, multiforme et volontairement diffuse qui finit par faire perdre nos repères.
"Faisons resurgir le temps depuis longtemps révolu" écrit notre Rodolfo bloggeur sur l'écran projeté au-dessus de la scène. Deuxième ligne rouge : l'irruption de figurants circassiens qui déroulent invariablement de cour à jardin une série de souvenirs et de flashs mémoriels. Claus Guth se sert du fil autobiographique et infini du "Je me souviens" de Georges Perec, comme miroir magique dans lequel défilent des images qui se bousculent avec l'incongruité et l'abstraction d'un compte-rendu de rêve. Une liste infinie dont l'énonciation-même laisse entendre dans son sillage un écho réverbéré, une berceuse lexicale, multiforme et volontairement diffuse qui finit par faire perdre nos repères.
On pourrait ranger paresseusement ce kaléidoscope dans une énième rubrique décorative "surréaliste" s'il ne s'agissait d'une démarche volontaire pour reconstituer un arrière-fond référentiel et narratif. Depuis le Ballon rouge d'Albert Lamorisse en passant par le dragon en papier et la fusée à damiers rouges et blancs de Tintin, c'est toute une galerie nostalgique et enfantine qui défile avec une allègre incongruité dans le couloir de ce vaisseau spatial. Impossible non plus de ne pas penser à ce voyage sur la lune de Georges Méliès, Solaris de Tarkovski, les couloirs et les caissons d'hibernation de Discovery One dans le chef d'œuvre de Kubrick 2001 : A Space Odyssey… De ces deux dernières références, Guth retient l'atmosphère de désolation et de désespérance d'un voyage voué à l'échec.
Ni le décor (bluffant) d'Etienne Pluss, ni la dramaturgie d'Yvonne Gebauer ne parviennent pourtant à relier entre eux les éléments référentiels pour donner à cette Bohème interstellaire la cohérence et l'unité d'une enveloppe d'images qui épouserait la trame de l'opéra en faisant oublier au passage des coutures et des raccords trop visibles et trop téléphonés (Les variations entre rouge et blanc de la fusée à la robe de Mimi, la planète rouge et la lune blanche etc.). Il reste à s'interroger sur les réactions virulentes d'un public, oublieux sans doute d'une époque très récente où la Grande Boutique resservait ad nauseam et vingt ans durant, le charme décati de la production de Jonathan Miller… La manière de rendre le destin fatal de Mimi séduit par le refus de recourir aux habituels poncifs tuberculeux. Apparue mystérieusement au détour d'un couloir avec une bougie à la main, la frêle héroïne fuit vers le fond de scène au moment où tombe le rideau comme aspirée par le manque d'oxygène et la vaste voûte céleste. "La mort n'est pas un événement de la vie. On ne vit pas la mort." écrit Ludwig Wittgenstein dans son Tractatus Philosophicus. Reprise dans les notes de programme, cette citation tombe sans un pli sur une dernière scène qui est sans doute la plus réussie de la soirée.
La mise en scène de Claus Guth a le mérite de questionner La Bohème de Puccini à la lumière d'un imaginaire qui, faute de convaincre totalement, ne verse jamais dans le n'importe quoi qu'on aurait tendance à lui attribuer. Il y a dans ce space opera une forme de modernité en creux qui pèche, non par excès mais par manque. La fixité du décor dans les premiers tableaux et le paysage lunaire en seconde partie, ne sont pas propices à donner l'élan nécessaire au délire d'images du Café Momus avec Musette en danseuse avec robe à lamé et ce mime extraordinaire (Guérassim Dichliev) qui d'un geste dans l'air dessine un univers invisible et fascinant. En définitive : Plus de Fellini et moins de Tarkovki.
 Il manque au plateau vocal la Mimi de Sonya Yoncheva. L'étoile tant attendue est remplacée par Nicole Car, soprano de qualité mais à l'émission et aux couleurs trop surveillées pour permettre de rentrer totalement dans le personnage. Le duo qu'elle forme avec le Rodolfo très véhément d'Atalla Ayan est souvent déséquilibré par des intonations défectueuses. La ligne assez peu soignée du ténor brésilien se borne à lier entre elles des notes qui mériteraient une projection moins forcée. Artur Rucinski (Marcello) tire brillamment son épingle du jeu malgré un jeu d'acteur assez rudimentaire tandis qu'Alessio Arduini (Schaunard) et Roberto Tagliavini (Colline) assurent un service minimum dans leurs rôles de comparses bonhommes et rigolards. La piquante Musetta d'Aida Garifullina cavalcade joliment sur une ligne d'aigus qu'elle déploie sans effort, à l'inverse d'un Marc Labonnette un peu terne en Alcindoro.
Il manque au plateau vocal la Mimi de Sonya Yoncheva. L'étoile tant attendue est remplacée par Nicole Car, soprano de qualité mais à l'émission et aux couleurs trop surveillées pour permettre de rentrer totalement dans le personnage. Le duo qu'elle forme avec le Rodolfo très véhément d'Atalla Ayan est souvent déséquilibré par des intonations défectueuses. La ligne assez peu soignée du ténor brésilien se borne à lier entre elles des notes qui mériteraient une projection moins forcée. Artur Rucinski (Marcello) tire brillamment son épingle du jeu malgré un jeu d'acteur assez rudimentaire tandis qu'Alessio Arduini (Schaunard) et Roberto Tagliavini (Colline) assurent un service minimum dans leurs rôles de comparses bonhommes et rigolards. La piquante Musetta d'Aida Garifullina cavalcade joliment sur une ligne d'aigus qu'elle déploie sans effort, à l'inverse d'un Marc Labonnette un peu terne en Alcindoro.
D'une façon générale, on peut dire que Gustavo Dudamel réussit ses premiers pas dans la fosse de l'Opéra de Paris. Il faut fermer les yeux sur une première partie où le chef vénézuélien tire à lui une couverture à l'aspect plus symphonique que réellement dramatique. Étranger aux enjeux et au rythme propre de la scène, il peint à fresque là où il conviendrait de saisir des détails et un modelé plus allant. La seconde partie lui offre la possibilité de donner à la narration une dimension sensible qui fait oublier la distanciation et la froideur.

à revoir sur culturebox


Une proposition originale, qui nous sort des sempiternelles mansardes et sanglots. Ce n'est pas totalement convaincaint et la première partie se traîne un peu . Le dernier acte par contre est sidérant de beauté a la fois visuelle et musicale . Quel chef!!!
Bons chanteurs, Nicole Car se moule très bien dans ce personnage fantomatique voulu par Guth. Une belle expérience, et je ne pense pas que Puccini ait été " trahi "!!!