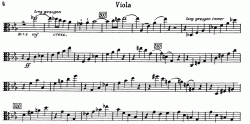La sélection proposée du Knaben Wunderhorn ne restera certes pas comme un grand souvenir lyrique. Les deux troubadours partenaires d'Inbal ne déméritent jamais, mais les voix, volontaires et professionnellement astucieuses, sont un peu justes, pour ce répertoire du moins. Inbal conduit un solide accompagnement de routine, qui convient à ses détracteurs et ne dérange pas outre mesure ses partisans : eins, zwei, ou alors, eins, zwei, drei. Beaucoup de grands chefs ont dirigé comme ça (aujourd'hui, ce n'est plus très tendance). Le chant n'est pas dans l'orchestre et on en est frustré ici (Rheinlegendchen) ou là (Revelge). La précision de la battue trouve certes une réponse impeccable dans l'orchestre, mais le Klang et l'expression sonnent comme blasé, malgré les solos délicats et précis, de cor anglais et de trompette. Dietrich Henschel conte et dit admirablement, mais il faut être près pour s'en rendre compte, ce qui est, heureusement ici, notre cas. Pour les compères placés en hauteur, le compte n'y est pas. Quand l'espace sonore se raréfie assez pour qu'il se fasse entendre, il est néanmoins poignant, à défaut d'offrir un beau timbre – Wo die schönen Trompeten blasen.
Ekaterina Gubanova déploie sa verve volontiers truculente, roborative, se jouant d'un équilibre d'intonation capricieux. C'est gênant dans son Irdische Leben, moins, par le caractère populaire qui est valorisé, dans Wer hat dies Liedel erdacht ? : mais ici comme ailleurs, le naturel de la pulsation et de la ligne font défaut – dans ce lied à l'accent entre tous délicat, la leçon éblouissante donnée par Boulez (avec Röschmann) à Pleyel nous reste dans l'oreille – à jamais. Scintillements, fraîcheur, transparence des rythmes et des textures font défaut, alors même que l'économie de moyens et la sobriété de direction sont au rendez-vous : cette musique est bien plus difficile qu'il n'y paraît, et le fait qu'elle soit parmi les moins entendues de Mahler au concert n'y change rien. Avec le tissu orchestral si fin de la Philharmonie Tchèque, Inbal était cependant parvenu à un résultat beaucoup plus personnel et abouti avec Thomas Hampson dans les Kindertotenlieder il y a sept ans à Pleyel, qui nous laisser espérer davantage ici.
Une toute autre dimension est atteinte après l'entracte. Cette 4e nous offrait exactement les mêmes traits qu'Eliahu Inbal nous avait fait goûter dans la 9e donnée l'an dernier pour son 80e anniversaire sur la même scène. Superficiellement, il s'agit d'un Bruckner véloce et aux arêtes nettes : d'aucuns diront racé tandis que d'autres diront brutal, ou superficiel. Mon point de vue est que l'intérêt profond, et singulier du Bruckner d'Inbal ne se laisse pas cerner par ces caractérisations rapides. Un mot d'abord de la réalisation, qui se situe nettement au-dessus de ce que le Philhar avait offert dans la 9e (et qui était déjà fort honorable, mais non exempt d'équilibres perfectibles ou d'incertitudes rythmiques). Ici tout est conforme aux standards mondiaux les plus élevés. Tous les cuivres rendent une clean sheet millimétrée, et le danseur étoile du cor David Guerrier fait vibrer sa corde avec un aplomb d'intonation confondant. Les bois tournent mais l'excellence demeure. Aux flûte et hautbois solos, après la paire Mosnier-Devilleneuve puis Prévost-Devilleneuve, nous avions la Prévost-Doise. Il m'est arrivé d'avoir des réserves quant au hautbois de ce dernier, principalement pour une tendance au phrasé indécis ou étale : aucun de ces défauts n'empêchaient d'admirer sa sonorité et son autorité ici. Prévost aussi mène une carrière moins exposée et célébrée que sa consoeur, mais c'est un immense flûtiste, dont l'expressivité immédiate est de nature à rendre lumineuses les petites parenthèses de retransitions brucknériennes (comme avant la réexposition du premier mouvement).
Les cordes, emmenées non par Amaury Coeytaux comme prévu mais par Virginie Buscail, offrent à Inbal une tenue dynamique de chaque instant face à la masse d'harmonie, y compris dans les  torrents de sextolets du finale, d'une lisibilité rare (je me souviens d'une phalange aussi solide que le LSO, sous une baguette aussi experte que celle d'Haitink, rencontrer toutes les peines du monde à maintenir des équilibres satisfaisants dans cette page redoutable). Enfin, une mention très spéciale dans ce concerto pour orchestre qu'est aussi la Romantique revient aux altos, exemplaires d'un bout à l'autre du concert, et couverts de gloire dans leurs deux morceaux de bravoure des deux premiers mouvements de la symphonie. L'intensité est présente au plus haut point mais ce n'est là le plus frappant et important : par la justesse et la concentration, le pupitre parvient à une qualité et une rectitude de phrasé qui convoque tout un imaginaire sonore et rhétorique, à l'éloquence wagnérienne en diable, sans grand chose à envier à leurs collègues des plus vénérables formations porteuses d'une tradition en la matière, de Munich à Berlin via Dresde. Leurs interventions dans le II auront d'ailleurs été les hauts lieux du seul mouvement un peu en retrait dans cette exécution, où la grande modulation centrale, quoi que belle et exacte, manquait un peu de l'exultation polyphonique (peut-être par refus excessif de la licence agogique) qui en fait un des plus bouleversants passages de la musique de Bruckner, et de toute la musique symphonique – voire ci-après. Un moment d'abandon, pourtant désirable à cet endroit qui a l'accent d'un Verwandlungmusik de semaine sainte, n'était certes pas au programme de cette lecture remarquable d'abord par la tenue de fer des mouvements extrêmes, aux vertus aussi sévères que jouisseuses.
torrents de sextolets du finale, d'une lisibilité rare (je me souviens d'une phalange aussi solide que le LSO, sous une baguette aussi experte que celle d'Haitink, rencontrer toutes les peines du monde à maintenir des équilibres satisfaisants dans cette page redoutable). Enfin, une mention très spéciale dans ce concerto pour orchestre qu'est aussi la Romantique revient aux altos, exemplaires d'un bout à l'autre du concert, et couverts de gloire dans leurs deux morceaux de bravoure des deux premiers mouvements de la symphonie. L'intensité est présente au plus haut point mais ce n'est là le plus frappant et important : par la justesse et la concentration, le pupitre parvient à une qualité et une rectitude de phrasé qui convoque tout un imaginaire sonore et rhétorique, à l'éloquence wagnérienne en diable, sans grand chose à envier à leurs collègues des plus vénérables formations porteuses d'une tradition en la matière, de Munich à Berlin via Dresde. Leurs interventions dans le II auront d'ailleurs été les hauts lieux du seul mouvement un peu en retrait dans cette exécution, où la grande modulation centrale, quoi que belle et exacte, manquait un peu de l'exultation polyphonique (peut-être par refus excessif de la licence agogique) qui en fait un des plus bouleversants passages de la musique de Bruckner, et de toute la musique symphonique – voire ci-après. Un moment d'abandon, pourtant désirable à cet endroit qui a l'accent d'un Verwandlungmusik de semaine sainte, n'était certes pas au programme de cette lecture remarquable d'abord par la tenue de fer des mouvements extrêmes, aux vertus aussi sévères que jouisseuses.
 Rapidité maîtrisée des transitions d'une part, permanence (ou presque) d'une pulsation nettement dessinée, sentie et circulant dans l'orchestre, d'autre part, sont ces vertus. Elles le sont parce que ce sont des vertus rares et précieuses dans Bruckner, singulièrement, et dans le répertoire romantique tardif dont Inbal s'est fait le chantre depuis des décennies, en général. A cet art de l'absence de complaisance mais aussi de la dé-sophistication, il est possible de répondre par de l'indifférence, voire, je l'ai entendu aussi bien après sa magistrale Faust Symphonie de Liszt à Pleyel que sur ses Bruckner, par le reproche d'une direction séquentielle, épisodique. Il s'agit alors de s'entendre sur les termes : séquentielle, la direction d'Inbal l'est, dans la mesure où sa caractérisation des matériaux se distingue par sa neutralité et où une idée musicale peut sembler succéder à une autre sans que leur écart ne soit investi, expressivement, par un travail de direction. La réputation d'indifférence, d'apparent désintérêt, suit d'ailleurs Inbal jusque dans ses répétitions. Mais ce qui est séquentiel en ce sens ne saurait être épisodique, au sens de la suite picturo-narrative que d'aucuns histrions de la baguette tendent à nous imposer dans les grandes architectures symphoniques. Ainsi, et pour ne prendre que le plus évident des exemples, le passage au second thème du finale dans l'exposition initiale évite tout ralentissement, qui confine généralement au silence une fois l'ostinato perdu aux cors et timbales, si bien que, compte-tenu du tempo fort allant adopté, l'enchaînement surprend par sa soudaineté, et que celle-ci fait disparaître le problème de la non-transition : car après tout, c'est ainsi que c'est écrit, et c'est un changement de point de vue important : les deux grandes idées ne sont pas séparées, mais collées littéralement. Le fait qu'à la récapitulation elles se retrouvent en revanche jetées de part et d'autre d'un gouffre de silence a un prix théâtral qui est l'observance de cette radicale continuité initiale. Tout le finale est sous la baguette d'Inbal marqué par cette urgence (maintenue dans une cohésion rythmique admirable) qui jette là ce qui doit être dit plutôt que de le déclamer, conservant la solennité pour la seule péroraison. Inbal ne se contente pas, du reste, de régler le métronome une fois pour toute, et manie avec dextérité des animando guerriers d'une terrible efficacité (retransition avec le retour mineur du thème du 1er mouvement, ou l'exceptionnelle exécution de la première grande marche du finale (E à F), qui gagne toujours à recevoir ce surcroît d'excitation motrice, que produit un phrasé pressant chaque triolet et retenant légèrement l'arrivée du suivant.
Rapidité maîtrisée des transitions d'une part, permanence (ou presque) d'une pulsation nettement dessinée, sentie et circulant dans l'orchestre, d'autre part, sont ces vertus. Elles le sont parce que ce sont des vertus rares et précieuses dans Bruckner, singulièrement, et dans le répertoire romantique tardif dont Inbal s'est fait le chantre depuis des décennies, en général. A cet art de l'absence de complaisance mais aussi de la dé-sophistication, il est possible de répondre par de l'indifférence, voire, je l'ai entendu aussi bien après sa magistrale Faust Symphonie de Liszt à Pleyel que sur ses Bruckner, par le reproche d'une direction séquentielle, épisodique. Il s'agit alors de s'entendre sur les termes : séquentielle, la direction d'Inbal l'est, dans la mesure où sa caractérisation des matériaux se distingue par sa neutralité et où une idée musicale peut sembler succéder à une autre sans que leur écart ne soit investi, expressivement, par un travail de direction. La réputation d'indifférence, d'apparent désintérêt, suit d'ailleurs Inbal jusque dans ses répétitions. Mais ce qui est séquentiel en ce sens ne saurait être épisodique, au sens de la suite picturo-narrative que d'aucuns histrions de la baguette tendent à nous imposer dans les grandes architectures symphoniques. Ainsi, et pour ne prendre que le plus évident des exemples, le passage au second thème du finale dans l'exposition initiale évite tout ralentissement, qui confine généralement au silence une fois l'ostinato perdu aux cors et timbales, si bien que, compte-tenu du tempo fort allant adopté, l'enchaînement surprend par sa soudaineté, et que celle-ci fait disparaître le problème de la non-transition : car après tout, c'est ainsi que c'est écrit, et c'est un changement de point de vue important : les deux grandes idées ne sont pas séparées, mais collées littéralement. Le fait qu'à la récapitulation elles se retrouvent en revanche jetées de part et d'autre d'un gouffre de silence a un prix théâtral qui est l'observance de cette radicale continuité initiale. Tout le finale est sous la baguette d'Inbal marqué par cette urgence (maintenue dans une cohésion rythmique admirable) qui jette là ce qui doit être dit plutôt que de le déclamer, conservant la solennité pour la seule péroraison. Inbal ne se contente pas, du reste, de régler le métronome une fois pour toute, et manie avec dextérité des animando guerriers d'une terrible efficacité (retransition avec le retour mineur du thème du 1er mouvement, ou l'exceptionnelle exécution de la première grande marche du finale (E à F), qui gagne toujours à recevoir ce surcroît d'excitation motrice, que produit un phrasé pressant chaque triolet et retenant légèrement l'arrivée du suivant.
Le cas de Bruckner est évidemment spécial, eu égard à la réputation d'une absence générale de transitions que charrie toujours la réception de sa musique. Cette absence est factuelle, à peu près partout dans les mouvements de forme sonate et apparentées, où l'enjeu est habituellement compris comme transition entre éléments motiviques ou thématiques. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas, chez Bruckner, de transitions du tout : simplement que la responsabilité du chef suppose de faire ressortir le caractère, l'aspect transitionnel au sein du matériau lui-même, car nul ne peut sérieusement soutenir que les cathédrales brucknériennes ne sont faites que de blocs sonores bruts, dépourvus de liens organiques comme de vie et de transformations intérieures. En restituant (à l'instar d'un Boulez mais, comme un Rögner, de façon plus radicale et moins civilisée) l'articulation des thèmes principaux à leur simplicité, Inbal parvient d'une autre façon à exposer le discours unificateur d'interprétations d'apparences beaucoup plus subjectives (et dont le canon reste furtwänglerien) avec lesquelles il partage le refus du maniérisme cérémoniel, qui a toujours pour conséquent, à des degrés divers, la progression itératives par monolithes – dont on peut certes défendre les mérites cumulatifs.
Sur un plan plus directement esthétique, ces approches peuvent paraître faire violence à un texte dont la lettre, généreuse en assertion et proclamation et avare d'argumentation et de commentaire, semble commander un ton statique dans l'expression. Elles peuvent aussi sembler pauvre en religiosité, ce qui serait assurément fautif. Mais ces deux reproches sont largement infondés. Le premier peut se voir opposer l'idée, toute furtwänglerienne, que même Bruckner peut, et mérite de se voir joué dans un esprit schenkérien, et ainsi, recevant un traitement comparable à celui de Brahms et des Classiques, d'être classicisé ; l'idée a un parfum de paradoxe sur le plan théorique, mais celui-ci se dissipe quelque peu quand on ne retranche de la théorie canonique de l'Ursatz que son substrat esthétique : l'appréhension non linéaire de la musique, la conquête de l'unité au moyen du synoptique. En outre, de toutes les pages du maître de Saint Florian, aucune ne se prête autant au jeu, sans doute que la 4e, et singulièrement de son finale. Aucune n'est à ce point soudée par une idée fixe construite sur l'énonciation de la triade fondamentale, et aucune ne fait un usage aussi monomaniaque de l'unité thématique par le profil du triolet, décliné dans autant de motifs, et combiné sur autant de valeurs de notes. Pour ce qui est de la religiosité, ce n'est pas l'intention mais le résultat qui compte. La vie échevelée de cette évangélisation sauvage dans sa virtuosité vaut bien des offices à la liturgie artificiellement grave.