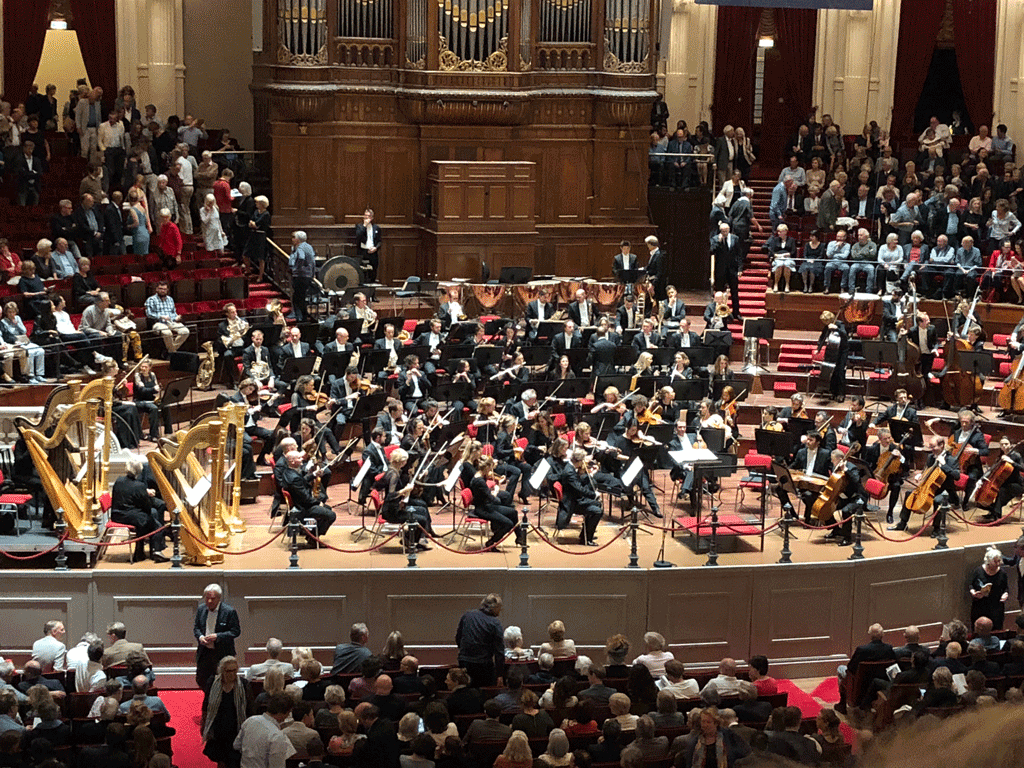
Les chefs invités par le Festival de Bayreuth pour diriger la production du Ring effectuent souvent en amont quelques concerts destinés à « se faire la main ». On se souvient que Kirill Petrenko avait dirigé un Rheingold à Rome avec l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. C’est Daniele Gatti qui va diriger le prochain Ring de 2020, avec un metteur en scène encore inconnu. Alors, le « Chefdirigent » propose à son orchestre des extraits essentiellement symphoniques du Ring, allant de Rheingold (entrée des Dieux au Walhalla) à Götterdämmerung, comprenant des morceaux de bravoure comme la « Chevauchée des Walkyries » et les « Murmures de la forêt » de Siegfried, et la scène finale de Götterdämmerung, l’immolation de Brünnhilde avec Eva-Maria Westbroek, qui pour l’occasion s’est aussi essayée à Brünnhilde.
Un Beethoven romantique et tendu
En première partie, le programme proposait la symphonie n°2 de Beethoven relativement peu jouée. L’affirmation d’un arc Beethoven-Wagner illustre la passion de Wagner pour son illustre prédécesseur, marquée en 1870 par son essai Beethoven, qui au contraire de ses écrits précédents et dans le sillon de Schopenhauer, affirme que le drame naît de la musique, et que la musique est le moyen de l’élévation. L’essai Beethoven paraît en pleine composition du Götterdämmerung et ce fil était un des intérêts de ce programme, même si l’approche de Gatti avec cet orchestre de pages parmi les plus fameuses du Ring constituait bien sûr pour l’auditeur le plat de résistance d’un concert qui a largement tenu ses promesses.
On a déjà évoqué une « manière Gatti », qui revient sur les partitions, qui propose des approches inhabituelles aux orchestres en leur expliquant les motifs de ses propositions. Avec le Mahler Chamber Orchestra qui se réunit pour faire de la musique, c’est évidemment une aubaine,t andis qu’ avec un orchestre installé comme le Royal Concertgebouw Orchestra le « Chefdirigent », doit au début de son mandant instaurer un rapport, une confiance et des habitudes nouvelles : Mariss Jansons et Daniele Gatti n’ont pas forcément la même manière de diriger ou d‘approcher les œuvres. Mais à ce concert on sent une alchimie continuer de se mettre en place.
 Daniele Gatti a un intérêt profond pour le romantisme, pour ses excès, pour ses ruptures comme pour ses ineffables moments d’élévation. Et la lecture de son Beethoven doit être lue à cette aune-là. Même pour une symphonie considérée comme plus « classique » et encore marquée par Haydn. Et en ressort une approche à la fois vigoureuse et contrastée.
Daniele Gatti a un intérêt profond pour le romantisme, pour ses excès, pour ses ruptures comme pour ses ineffables moments d’élévation. Et la lecture de son Beethoven doit être lue à cette aune-là. Même pour une symphonie considérée comme plus « classique » et encore marquée par Haydn. Et en ressort une approche à la fois vigoureuse et contrastée.
De fait, la composition de la symphonie est contemporaine du moment où Beethoven perçoit les premières manifestations de la surdité, et donc traverse des moments difficiles. L’approche de Gatti n’est pas « classique » au sens où Sainte-Beuve l’entend : « Le classique, dans son caractère le plus général et dans sa plus large définition, comprend les littératures à l’état de santé et de fleur heureuse »
Il l’écrivait à propos de la littérature, mais n’en serait-il pas de même pour les autres arts. Or si l’on considère en littérature des classiques comme Racine ou Pascal, peut-on leur appliquer la définition de fleurs heureuses. On rejoindra plutôt Proust qui disait « Seuls, en effet, les romantiques savent lire les ouvrages classiques, parce qu’ils les lisent comme ils ont été écrits, romantiquement ».
On pourrait croire à un débat littéraire dissertatoire, mais on en est loin. Il s’agit justement d’une question de lecture, d’approche des œuvres, et Daniele Gatti dans ce concert nous montre chez Beethoven comme chez Wagner une approche romantique et des œuvres « romantiquement » écrites.
La symphonie de Beethoven que nous avons entendue est une œuvre qui semble déchirée entre une joie affichée et une tension réelle en arrière-plan. Si elle a été créée en 1803, elle a été composée en 1802, à un moment où sa surdité s’est aggravée, et où il a pensé au suicide. La symphonie ne se ressent pas de si graves alertes, mais l’approche de Gatti induit ces événements, notamment au début premier mouvement (le dialogue entre bois et cuivres inquiétants), et pendant tout la symphonie par des contrastes de tempo alternant moments de sérénité et de flux plus tendus. Le rythme est assez rapide, avec une clarté extraordinaire du rendu, qui fait entendre la légèreté de certains thèmes, avec en sourdine des contrebasses moins légères…Ce qui était dit plus haut sur le romantisme est d’autant plus vérifiable que la période où Beethoven écrit est vraiment l’ère du « Romantik » (plus tardif en France). Ainsi Gatti nous dit-il de ne pas trop nous fier à cette musique qui semble être une « fleur heureuse », et qui ne l’est pas tout à fait. C’est en tous cas une magnifique exécution d’un Beethoven qui glisse vers les symphonies futures (et déjà, l’Eroica, à peine postérieure). Les « orages désirés » de Chateaubriand sont ici pleinement vécus. La lecture de Gatti révèle l’énergie vitale Beethovénienne, empreinte aussi de gravité, comme un combat entre deux pôles. Et cette lecture rend cette complexité avec des moments vraiment sublimes comme ce larghetto étonnant de sérénité « tendue » et une mouvement final éblouissant.
Un Wagner pour orchestre d'exception
Comme souvent quand on va diriger un Ring à Bayreuth, on propose donc des concerts préparatoires, où on met à l’épreuve la lecture de la partition faite dans le secret des cabinets. Si Gatti propose souvent des extraits wagnériens dans ses programmes, il se concentre ici autour de célèbres pièces orchestrales du Ring, ainsi que de menues adaptations sans les voix qui interviennent (Rheingold notamment, où les voix sont remplacées par des interventions des cuivres). En ayant sous la main un orchestre aussi virtuose que le Concertgebouw, Gatti peut sans crainte s’y essayer, même si l’orchestre est peu familier de Wagner.
Ce Wagner-là est incroyablement lisible et limpide, d’une vraie sensibilité qui assume un vrai romantisme wagnérien. On reste fasciné d’abord par la performance de l’orchestre très attentif (des cuivres étonnants dans l’entrée des dieux au Walhalla) avec un système d’écho d’un incroyable effet sonore et des cordes d’un raffinement et d’une discrétion prodigieuses : on sent que Gatti veut rendre ici effectif la discrète ironie wagnérienne qui au-delà de l’ivresse musicale nous fait comprendre tout ce qui se cache derrière ce faux triomphe : Erda a déjà tout dit et Wotan a déjà quasiment tout perdu, une entrée au Walhalla pour rien. Il y a là des moments prodigieux parce que l’on entend tous les niveaux, cordes extraordinaires de subtilité, cuivres en premier plan mais trop polis pour être honnêtes. Un son au relief multiplié par l’acoustique de la salle du Concertgebouw.
La chevauchée des Walkyries s’y enchaîne, en un rythme vraiment soutenu et rapide : Gatti veut rendre sans doute l’idée presque mécaniste d’un travail unique et répétitif, un travail « machinal » des Walkyries. La question du texte se posera plus tard, car il y a du théâtre derrière. Pour l’instant musicalement c’est totalement virtuose, étourdissant, spectaculaire et pour tout dire impressionnant : une fois de plus l’orchestre démontre ici ses extraordinaires capacités à épouser à la fois les contrastes et les rythmes.
Dans « Les murmures de la forêt », nous sommes dans une autre vision, avec un début éblouissant, dans une recherche d’une ambiance qui se diffracte en incroyables moirures où le volume est retenu d’une manière étonnante, jusqu’à l’apparition de la flûte (l’oiseau), les sons sont distribués avec une singulière profondeur avec des couleurs qui rappellent la Pastorale de Beethoven, inutile de souligner la performance des cordes, de l’ordre du sublime. La direction de Gatti rend parfaitement le crescendo entre les murmures initiaux et le moment final du triomphe juvénile d’un Siegfried éperdu, les dernières mesures sont exaltantes de joie et d’énergie.
Siegfried encore dans la pièce suivante, où le Voyage de Siegfried sur le Rhin est introduit par le réveil du couple, avec un orchestre très retenu, très sensible, exaltant les phrases les plus positives dans un crescendo incroyablement maîtrisé : une romance sans paroles d’une intensité rare, qui rend l’ivresse joyeuse, aidée par la distribution de la musique dans l’espace de la salle, qui emporte le cœur ; moment d’émotion pure qui s’enchaine avec un Voyage sur le Rhin à la fois rapide et léger, presque primesautier et Gatti préserve dans ces pages archi connues une clarté qui fait que chaque niveau est perçu et que la partition apparaît dans toute sa complexité : un travail analytique qui ne tue jamais la synthèse, avec une incroyable respiration de la musique.

Et la fin de ce Voyage est reliée par quelques mesures avec l’intervention finale de Brünnhilde, montrant en même temps combien dans cette musique les liaisons souterraines fonctionnent au-delà des simple leitmotives, par un système d’écho, par un système cohérent de tonalité.
La scène finale du Götterdämmerung est interprétée par Eva-Maria Westbroek, et peut-être sa situation au-devant de l’orchestre nuit-elle à la projection de la voix. Si pour la première partie, les choses sont équilibrées, pour la deuxième où l’orchestre est plus puissant, la voix se perd un peu. Si Eva-Maria Westbroek est une magnifique chanteuse, une somptueuse Sieglinde, elle n’est peut-être pas encore une Brünnhilde du Götterdämmerung, les aigus sont tendus et le tempo soutenu adopté par Daniele Gatti ne lui convient peut-être pas, elle a du mal à reprendre son souffle. L’orchestre est cependant tout à fait extraordinaire notamment au moment où elle prononce son « Ruhe » qui clôt la première partie, un orchestre sombre, presque hoffmannien, d’une rare fluidité.
L’enchaînement avec la seconde partie est marqué par un orchestre relativement allégé (coups de cimbales effleurés…) sans ruptures, dans une sorte de continuité qui laisse au départ la voix en expansion ; un merveilleux travail d’équilibre, assez miraculeux.
Les choses se tendent au moment de l’immolation, avec un orchestre à son sommet, vision tendue et large, d’une incroyable respiration, mais Westbroek, au demeurant respectable, n’arrive pas à dominer les vagues orchestrales, avec des aigus qu’on sent difficiles et elle se perd un peu dans la marée sonore. Les dernières mesures de l’embrasement du Walhalla et du retour au Rhin sont tout simplement sublimes, on y trouve le lyrisme, l’épopée, la sensualité, les accents, mais aussi la clarté, l’incroyable limpidité avec des silences qui suspendent – les dernières mesures en crescendo et descrescendo sont extraordinaires (les harpes !) : c’est bouleversant à tous niveaux. L’orchestre du Concertgebouw a répondu et avec quelle maestria au défi d’un concert parmi les plus spectaculaires et les plus beaux de cette fin d’année, et on se prend à rêver d’un Ring intégral, tant la performance est éblouissante et on devine quelques options très théâtrales de Gatti quand il sera en fosse à Bayreuth. Le silence étonné qui succède à cette tempête sonore est éloquent et précède le délire dans la salle.


Oui, oui, mieux vaut – et de beaucoup ! – les concerts que les productions scéniques : à Bayreuth désormais, elle rivalisent toutes dans le laid, le grotesque, le non-respect de la musique, sans parler, naturellement, du respect des oeuvres en elles-mêmes. Ah ! Mais oui, c'est vrai, on va venir me dire soit que "respect", c'est tout ce qu'il y a de plus réac ; soit que le respect des oeuvres consiste précisément à les faire vivre en les transformant en tout autre chose que ce qu'elles sont…
J’aimerais que vous lanciez un mouvement de soutien à Gatti.