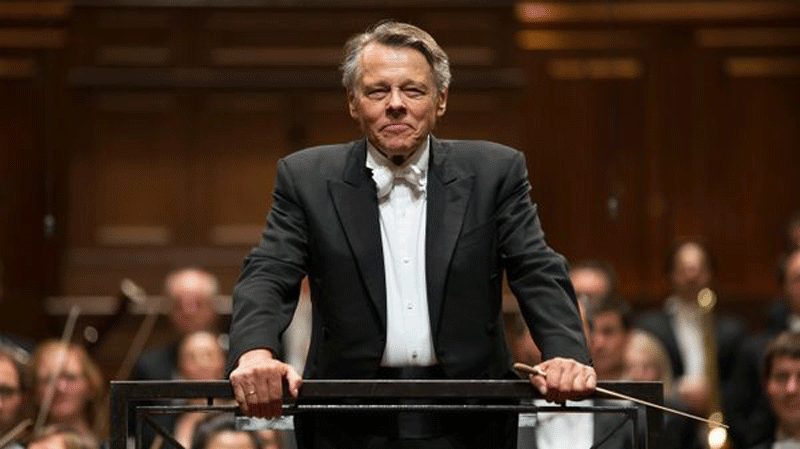
Le Philharmonique de Vienne cultive comme jamais, dans ses tournées des dernières années, sa culture de l’indépendance à l’égard de toute férule de chef. Rien que sur la décennie écoulée, on a vu se succéder, pour leurs seuls concerts parisiens, Lorin Maazel, Zubin Mehta, Valery Gergiev, Daniel Harding, Christian Thielemann, Christoph Eschenbach, Riccardo Chailly, Daniel Barenboim, Andris Nelsons et donc son maître Mariss Jansons (une liste qui recoupe largement celle des chefs récemment choisis pour le concert du Nouvel an, et à laquelle il faudrait ajouter, pour les tournées extra européennes notamment, au moins Riccardo Muti, Gustavo Dudamel et Adam Fischer). Un esprit chagrin pourrait remarquer que c’est peut-être le symptôme d’une période où l’orchestre ne bénéficie pas d’une ou deux relations spéciales, intenses et approfondies. Pourtant, sans successeurs évidents à Böhm, Karajan et Bernstein, Vienne est toujours Vienne, et c'est en un sens à mettre au crédit du système de gouvernement autosuffisant et associatif, resté inchangé en son principe depuis 177 ans. C'est aussi à mettre au crédit d'un patrimoine instrumental unique dans sa personnalité et sa préservation, une tricherie des plus légitimes. Et si l'aura d'une grande baguette d'élection manque, il ne fait pas de doute qu'avec un Muti ou un Jansons, le Wiener vient défendre davantage qu'une excellence instrumentale : il défend et illustre ce qu'est une trace institutionnelle dans l'histoire de l'interprétation, une marque apposée sur des répertoires, qui altèrent profondément la signification même de ces répertoires.
Le Schumann et le Berlioz de Jansons sont, pour autant que je sache, des contrées inconnues des auditoires de concerts parisiens, du moins à ce siècle. Ce qu’on y trouve ne présente cependant pas de véritable surprise, ni bonne, ni mauvaise. Les qualités habituelles de cette direction parmi les plus économes d’effets (elle l’est de plus en plus) sont affirmées sans une once de démonstration, et avec pour limite un engagement physique dont le déclin, depuis quelques années, se fait parfois sentir quant à l’emprise que le maître letton exerce sur l’orchestre. Le contexte n’est pas ici anodin, ce concert étant l’avant-dernier d’une longue, éprouvante tournée européenne de l’orchestre, et qui devait dès le lendemain s’achever à Hambourg. C’est donc un chef en possession partielle de ses moyens qui conduit ici les Viennois : lesquels, on le sait, sont cependant capables du meilleur pour faire honneur à une baguette qu’ils ont en respect et en affection.
Et de fait, ce concert aura plutôt donné à entendre de bons Wiener, c’est-à-dire une phalange qui, en se montrant simplement à son niveau normal, se trouve pratiquement seule dans sa catégorie d’excellence : non au sens banalisé de la virtuosité clinique et standardisée (ou clinquante), mais de la richesse et du caractère des timbres, et de la force d’affirmation stylistique, et d’appropriation de leur coeur de répertoire. Le son viennois est particulier dans tout, et presque plus dans Schumann que dans, par exemple, Schubert ou Brahms. Cela tient sans doute à ce que la culture interprétative des symphonies de Schumann doit davantage à des imaginaires sonores rhénans et prussiens, privilégiant la compacité du son, et évitant le plus souvent le piège de l’épaisseur par une domination assez nette des cordes. Les Viennois ont presque toujours affirmé dans ces symphonies leur profil sonore plus brillant et coloré, au risque de l’excès d’éclat. Leur contribution historique à la discographie n’en reste pas moins d’une intrigante parcimonie : qu’on songe que seules quatre intégrales en studio ont été gravées par eux (par Solti, Mehta, Bernstein et Muti, dans cet ordre), regroupées du reste sur un petit quart de siècle. Une poignée de disques mémorables isolés s’y ajoutant (Böhm ou Karajan dans la 4e, Sinopoli ou Levine dans la 2e…), mais ce coup d’oeil rétrospectif rappelle que le Schumann des Wiener est à la fois une matière passablement rare et précieuse. Il fut toutefois loisible aux Parisiens d’y goûter en qualité et quantité appréciables, lors d’un concert monographique de 2012 où Thielemann avait proposé les 1ère et 4e symphonies, ainsi que la Fantaisie pour violon et orchestre.
Mariss Jansons, comme Thielemann, fait sans doute partie des chefs qui tendent à restreindre la propension de l’orchestre à l’extraversion de timbre, sans le brider pour autant : plutôt en l’enracinant dans un fondu des individualités, dans la lignée karajanienne à laquelle, chacun à sa manière, ils se réfèrent. C’est donc une pâte orchestrale à la fois équilibrée et parfaitement reconnaissable qui s’empare de l’introduction de la Frühlingssinfonie. Cette introduction fait sans doute partie des plus délicates du répertoire romantique, en ceci qu’elle bascule aisément dans une pompe d’autant plus difficile à soutenir que son jeu de références stylistiques, aux degrés ambigus, son caractère de pastiche d’ouverture (qui se retrouve de façon plus subtile dans le début du finale), ne produisent plus aisément de charme immédiat. Il est particulièrement intéressant d’entendre et de réentendre l’orchestre de répertoire par excellence jouer ces pages, qui ont besoin d’une prise en main décomplexée, assumant le semi-kitsch de l’orchestration et de l’harmonie (la soudaineté toujours bizarre de la modulation mineure) pour lui donner du chic et de l’assurance. Une mission dont les Wiener s’acquittent avec sérieux et efficacité, de nouveau.
On peut se montrer plus réservé sur la suite du mouvement. La transition vers l’allegro fait partie de celles qui peuvent transmettre une irrésistible excitation, sans nécessairement recourir à une accélération spectaculaire (le geste et le pas naturels du thème ne sont pas ceux de l’urgence mais de la résolution, et il n’est donc pas absurde d’ignorer délibérément l’indication molto vivace). La grande trouvaille de cette transition est son soudain basculement du verbe dans l’action, ce décrochage de la tension accumulée, rendu physiquement tangible par le motif descendant de cor à nu, le brusque dévoilement jeté là. J’ai le souvenir (alors même que je ne suis pas, en général, un grand admirateur de ses transitions dans le répertoire symphonique) d’une remarquable négociation de ce passage par Thielemann. Ici, on se contente de retrouver le charme indiscutable du cor viennois, le vibré de sa texture, mais pas l’élan qui l’amène, et pas le surcroît dynamique (un crescendo est demandé) qui modifie le caractère du thème sur lequel la phrase débouche. La suite se distingue par un ton souverainement élégant, qui frustre néanmoins d’une verve rythmique (presque possible à ce tempo assagi) plus spirituelle. Un intérêt certain de ce tempo, néanmoins, est de prendre le temps de dire le second groupe thématique, avec ces bois plus aptes que d’autres à soigner l’accentuation mélancolique du motif mineur. L’emphase éprise des appels de cordes qui suivent bénéficie aussi d’un tempo qui valorise l’ampleur de phrasé des doubles croches. Et le caractère un peu besogneux du développement sur la cellule obstinée du thème principal trouve une forme d’à‑propos dans son renforcement, dans la mesure où la force de caractère des timbres le permet. En somme, l’orchestre réussit là où beaucoup échoueraient.
Une dimension de piquant, d’enthousiasme et de gourmandise populaire que Thielemann réussissait à transmettre, manque cependant, et ne parvient pas à transcender le retour, au terme du développement, du matériau introductif, dont la pompe ne peut être simplement la répétition du climat initial de la symphonie mais réclame cette fois une sauvagerie qui lui est ici refusée. Il manque de même au Larghetto, fort soigné, une spontanéité et peut-être, aussi, une légèreté d’archet – qui n’est sans doute pas la préoccupation naturelle des Viennois dans cette musique. Ce qu’on entend là est d’une grande beauté plastique (quels altos !) et d’une dignité expressive certaine, mais qui fait trop songer à l’imaginaire sonore étreignant d’un mouvement lent brahmsien. Manquent un trait chambriste, et surtout le caractère quasi improvisé du flux mélodique, qui donne à l’idée principale sa circulation fantomatique, et en fait un texte schumannien par excellence : pour un peu, on reprocherait ici aux Viennois de trop aller au bout des phrases. On ne peut à l’inverse qu’apprécier cette qualité naturelle dans un scherzo exemplaire de continuité et de hauteur stylistique, et où le fruité, et l’impact dynamique de l’orchestre font merveilles dans le si difficile second trio. Le finale est lui aussi de belle facture ; on y a le souvenir de Viennois à l’humour plus sophistiqué, avec une pointe de sucrerie, lors du concert de Thielemann. Il n’est pas à exclure que, dans la conduite du motif principal de croches, les personnalités sans doute différentes de Rainer Küchl et de Volhard Steude puissent expliquer ce changement de ton. Les oppositions de timbres et de registres sur le thème kreislerien, avec ces bois aigres-doux et ces basses majestueuses, sont délicieuses. Mais la légère frustration d’une fête orchestrale plus exubérante demeure. Ni la consistance des choix interprétatifs, ni la qualité de réalisation ne sont attaquables où que ce soit dans cette 1ère : ce qui est en cause est un sérieux qui se passe de toute distanciation, de toute dimension de jeu. Il me semble que le texte porte en lui-même l'idée qu'il a besoin de jeu pour exprimer son sérieux.
Le même esprit rigoureux, et le même geste large et structuré habitent une Fantastique à la personnalité plus franchement incarnée. Là aussi, il existe sans doute une manière propre à l’orchestre de faire sonner l’oeuvre : plus encore que dans Schumann, s’agit-il de la rencontre de deux idiomes des plus typés, dont l’interaction manque rarement d’attraits à travers les âges (que l’on songe à Monteux, Davis, Muti, Gergiev). Cette tradition a beau ne pas en être une, faute de régularité et de quantité, cela n’empêche de considérer les Wiener comme un instrument rêvé pour jouer la Fantastique : il offre, du moins se rapproche plus que n’importe quel autre de l’impossible compromis entre un lyrisme aérien et une grande pureté d’intonation pour porter l’idée fixe, des timbres de caractère, une immense réserve de puissance et une exceptionnelle profondeur de champ sonore, avec ses basses amples (et plus souples, détendues que les berlinoises). Ce dernier aspect est d’ailleurs d’emblée réjouissant, dans les oppositions de registres de l’introduction (l’abyssale entrée des basses en sextolets). Toute l’introduction est d’ailleurs superbe, bâtissant un climat puissamment caractérisé, à la respiration évidente.

On peut ressentir la même frustration que dans Schumann s’agissant de la transition vers l’allegro de Rêveries – passion, et bien que celle-ci ne soit absolument pas de la même nature, et qu’elle n’appelle pas vraiment d’excitation rythmique. Il n’empêche que la continuité entre le ton de l’introduction et l’exposé de l’idée fixe (joué avec sa reprise), comme du reste dans bien des interprétations, peut sembler excessive, et manquer le caractère figuratif, ou du moins narratif propre au style de Berlioz : il s’agit, après tout, d’une apparition de personnage dans le programme. On oublie assez vite, cependant, cette réserve, car la suite du mouvement est propre à séduire, par son raffinement, autant qu’à enthousiasmer par son impact. Dans la préparation de la spectaculaire récapitulation au terme du développement (où toute vulgarité sera évitée mais où l’effet de force sera maximal), le hautbois solo et les jeux d’imitations aux cordes intermédiaires sont d’une rare beauté foisonnante, et met idéalement en exergue la façon personnelle qu’a Berlioz de créer de la tension : en juchant la cantilène sur un chaos organisé, en faisant s’épanouir la mélodie au-dessus d’un perpétuel questionnement rythmique et harmonique, en superposant des états émotionnels opposés dans une transition continue. Il n’est pas innocent que ces pages extraordinaires prennent toujours un relief particulier avec l’un des meilleurs, sinon le meilleur des orchestres wagnériens.
On peut être plus réservé sur Un Bal, mouvement où le tempo, extrêmement éloigné de celui indiqué, est sans doute le plus difficile à défendre de ceux proposés. L’orchestre s’y emploie pourtant, et les parties extrêmes du mouvement mettent bien sûr en valeur la svelte puissance des cordes graves. La qualité générale d’intonation, l’ampleur dynamique, en particulier aux bois, donne assurément du relief à l’ensemble, en particulier dans la variation centrale autour de l’idée fixe, où le niveau de détail, voire de décantation est appréciable. Mais il est difficile de ne pas ressentir cette valse comme pataude, et dépourvue de sa fonction narrative principale – d’enivrement. La Scène aux champs fait en revanche très forte impression, et renouvelle à sa manière la leçon d’équilibre discursif et orchestral administrée par Muti dans la même salle, il y a dix ans (avec l’ONF), avec bien sûr un luxe de moyens supplémentaires. La respiration est ample mais le magnétisme rythmique opère, grâce à la précision des phrasés, la franchise des coups d’archets jusque dans les mesures les plus délicates. La redoutable deuxième présentation de la mélopée, avec son extraordinaire contrepoint à trois voix aux cordes, prend évidemment avec les Viennois des proportions d’ivresse formidables, et là encore sonne comme une prémonition wagnérienne. Il est permis d’avoir des réserves individuelles (le cor anglais assez neutre aux extrémités du mouvement, la clarinette plutôt effacée dans son grand solo central), mais tout le déroulé du tableau pivot de l’oeuvre s’offre dans une rare splendeur.

Le diptyque final est assurément la partie de la symphonie jouée avec le plus de personnalité. Celle-ci ressortit à parts égales à la signature sonore de l’orchestre et à la battue étale de Jansons. La brillance de timbres des Viennois confère sans doute une texture inhabituelle à la Marche au supplice, grâce à la réserve de puissance des bois et des violons, jamais complètement recouverts par la cuivraille. L’ensemble ne recherche pourtant la modération dynamique, et malgré cela l’ensemble évite la fréquente saturation qui, au TCE, peut finir par rendre le son comme paradoxalement étouffé. Le gueuloir berliozien fait son effet, sans oublier de respirer, et offrant même, avec l’aide du tempo placide, une acuité d’articulation peu commune (à l’image de ces réponses des bois aux cuivres à H, qu’on n’entend guère en général). Le Songe d’une nuit de Sabbat a la bonne idée d’être le mouvement le plus réussi de toute la soirée. La variété de jeux de timbres et d’effets spéciaux met certes en valeur les qualités de chaques pupitres, de la gouaillerie de la clarinette en mi bémol sur le retour saracastique de l’idée fixe, à la sensualité poisseuse des seconds violons sur les cris de sorcière de la Ronde de Sabbat, en passant par le timbre apocalyptique des cors dans leurs chorals en réponse au Dies Irae. Mais tout cela, dans une certaine mesure, est le minimum que l’on attend de cet orchestre dans ces pages. Ce qui fait le prix de cette exécution est la façon qu’ont les Viennois d’habiter le tempo de Jansons dans la fugue de la Ronde, et encore plus dans sa superposition finale au Dies Irae, alors même qu’il fait observer le retour au tempo du solo de petite clarinette au début du fugato, donc en annulant, selon l’indication de Berlioz, l’effet d’accélération qui s’est créé avant. C’est donc lourd, astringeant, étouffant, mais cela marche, parce que le quintette a la réserve de puissance et la franchise de phrasés qui permet de transformer la lenteur en force d’articulation contrapuntique.
La qualité dramatique de ce finale se révèle ainsi pleinement dans sa dimension accumulatrice, de marteau et d’enclume, et elle est révélée par les moyens expressifs de la musique pure. C’est justice rendue à la plus géniale hybridation qui fut de celle-ci avec la musique à programme, dont il n’est pas fortuit qu’elle opérât suivant la même dualité (fugue/programme narratif) que le finale de l’opus 110 de Beethoven. On ne citerait pas spontanément l’oeuvre comme faisant partie des chevaux de bataille de Jansons. Même s’il l’a certainement moins souvent jouée que les grandes symphonies de Tchaikovsky, Bruckner ou Mahler, on note tout de même qu’il l’avait déjà retenue en deux occasions spéciales : son premier Europa Konzert avec les Berliner (Istanbul 2001), et un des rares concerts de la Radio Bavaroise donnés aux Proms (2013). Son choix pour une tournée entière des Wiener confirme l’existence d’une relation spéciale et au long cours. Cette Fantastique n’a rien d’un rôle de composition pour ce chef, ni pour cet orchestre, et si l’on n’est pas obligé de la goûter, il est juste d’y voir une lecture dense, mûrement réfléchie et dont le niveau de réalisation impose la cohérence.
