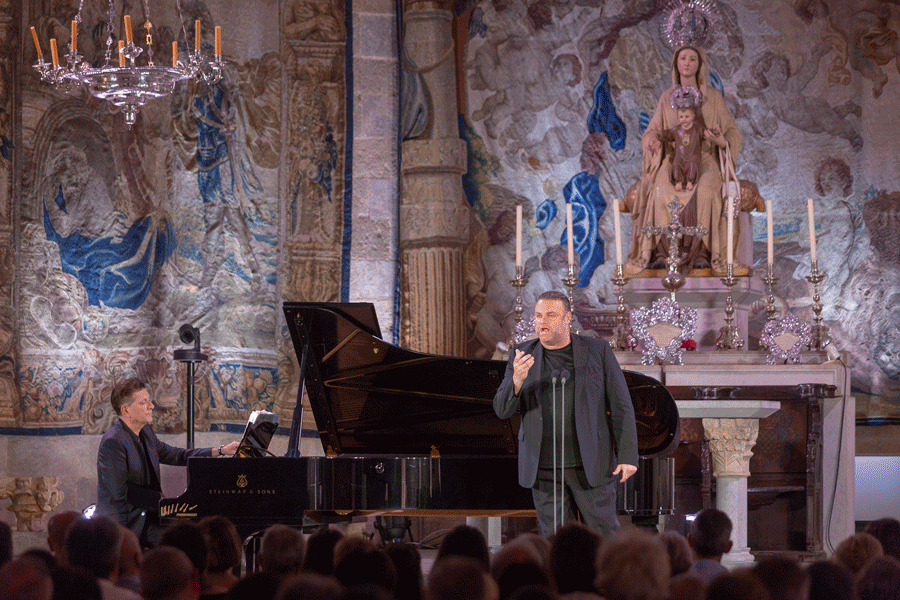 Un récital, parfois, peut tenir lieu de photographie. Dans le cadre à la fois austère et surchargé de l’Església del Carmen, Joseph Calleja, the Maltese tenor, offre quelques tubes et des airs moins connus. La loi du genre, dira-t-on, mais aussi une prise de risque. A 41 ans, la voix est un peu plus sombre, et celui qui a signé chez Decca à 25 ans (coiffant ainsi Pavarotti et ses 26 printemps, merci Wikipédia, guiness des records) connaît sans doute assez bien, avec l’âge, ses défauts et qualités. Mais peut-être pas assez pour les exposer aussi crûment à « an amazing audience », certes acquise à sa cause dans la touffeur d’une soirée estivale.
Un récital, parfois, peut tenir lieu de photographie. Dans le cadre à la fois austère et surchargé de l’Església del Carmen, Joseph Calleja, the Maltese tenor, offre quelques tubes et des airs moins connus. La loi du genre, dira-t-on, mais aussi une prise de risque. A 41 ans, la voix est un peu plus sombre, et celui qui a signé chez Decca à 25 ans (coiffant ainsi Pavarotti et ses 26 printemps, merci Wikipédia, guiness des records) connaît sans doute assez bien, avec l’âge, ses défauts et qualités. Mais peut-être pas assez pour les exposer aussi crûment à « an amazing audience », certes acquise à sa cause dans la touffeur d’une soirée estivale.
Principale faiblesse, la diction, particulièrement criante dans le répertoire français. De « la fler que tu m’avais jétée » (Carmen, Bizet) à « pourquoi mé réveiller » (Werther, Massenet), les « e » ont du mal à passer et, d’une manière générale, le français est pâteux. Jusqu’à une interprétation surjouée de « La Vie en rose », théâtralisée à l’extrême, pompière même, saturée de trémolos. On peut néanmoins se consoler en songeant que « Je vois la vie en rosé » est un hommage discret au vin rosado local ; la cuvée 2017 se vend 7,95 €, c’est très raisonnable. Dans ce répertoire, Joseph Calleja peine à s’imposer, manque de véracité, ne fait à l’évidence pas corps avec la langue, et la musique s’en ressent.
Le voici en revanche qui nage comme un poison dans l’eau trouble de Macbeth (« Ah, la paterna mano »). Ici, la diction est assurée, le legato maîtrisé, et les qualités vocales, tout en générosité, s’épanouissent enfin, avec le talent consommé de celui qui sait conclure un aigu surpuissant d’une délicatesse piano presque susurrée. Bonheur réitéré chez Puccini, dont les étoiles brillent en toute légèreté. Entrée quelque peu surjouée, après les premières notes de piano (Vincenzo Scalera, impeccable), visage douloureux, on craint Super Mario et c’est pourtant la douleur nue qui surgit. Le timbre retrouve sa fraîcheur, voici que revient le vibratello jusqu’alors disparu, impose sa délicatesse et le désespoir du condamné à mort explose tandis que le visage se pourpre sous l’effort.
Car, et la qualité est ici indéniable, la générosité, d’emblée s’impose. Calleja ne cherche pas à s’économiser, le récital est attaqué vaillamment, avec un peu de douleur il est vrai, et c’est la même ampleur vocale qui sera donnée jusqu’au quatrième (!) bis. La fatigue ne se fait guère sentir ou bien il y puise une volupté nouvelle, où s’épanouit la voix. Il ne néglige pas le lyrisme un peu facile des romances de salon d’un Francesco Paolo Tosti (« Ideale », « A vuchella ») mais y fait montre d’un certain mordant, le timbre se réconcilie avec métal, de manière quelque peu jouissive (et honteuse). « Vaghissimma sembianza » (Stefano Donaudy) le trouve à son meilleur, alliance de puissance et de légèreté, nuances et couleurs naturellement projetées et, là encore, des aigus filés délicieux.
Dans un récital, on ne regarde pas assez le décor. Ici, il est gothique, saturé de tentures et derrière le piano, une vierge à l’enfant trop richement décorée écoute sentencieusement. Faut-il chanter « La Vie en rose » dans une église gothique, certes restaurée, entonner « O Sole mio » (ah ! ce sourire entendu du pianiste !), les mains dans les poches, à proximité d’un Christ sculpté, aux genoux ensanglantés ? Le ténor a tous les privilèges, même celui de concevoir un récital varié, trop varié, qui se conclut par la possibilité d’une retraite paisible en chanteur de variétés. « Because », conclut-il, au quatrième rappel, générosité là encore, en hommage à Mario Lanza, qu’il a découvert dans The Great Caruso, de Richard Thorpe, inénarrable biopic d’antan. Las ! Le plafond peint frémissait encore du célèbre soleil napolitain (Eduardo Di Capua et Alfredo Mazzucchi, on les oublie souvent, la Sacem se frotte les mains) et ce « pourquoi » résume assez bien la soirée. Un bis en trop, un répertoire parfois étranger aux qualités de Joseph Calleja, un don de soi évident et des airs dans lesquels il donne le meilleur de lui-même. Sans doute peut-il à présent prendre le risque d’être un peu moins ténor et un peu plus sombre. On le sent sincère lorsqu’il remercie son comparse. Et c’est mérité : Vincenzo Scalera gratifie le public de quelques solos bienvenus, dont Trois préludes, admirablement jazzy et sacrilèges, de Gershwin. Ces deux-là pourraient bien explorer le répertoire des musicals.

