Chaque temple a besoin de ses idoles et de ses héros. D’autant plus s’il s’agit du temple de l’opéra par antonomasie, le Teatro alla Scala, qui n'a pas manqué d'accueillir avec un sincère enthousiasme la présence de Jonas Kaufmann en ce 28 septembre, pour un récital dont le programme ne pouvait que susciter l’intérêt.

Cet avant-dernier rendez-vous d’une tournée qui a mené la star des ténors dans toute l’Europe, de Bordeaux à Wiesbaden en passant par Paris, Bad Wörishofen, Vienne, Linz, (sept soirées en deux semaines) a affiché complet, avec bonne part du public venu de l’étranger pour l’occasion.
Si Franz Liszt est surtout connu pour être un des plus grands virtuoses du clavier, les Lieder choisis mettent en lumière la liberté de ton et la fantaisie qui donnent vie à des pages pas vraiment évidentes, aux préciosités de timbre inhabituelles, passant de la tension rageuse de Vergiftet sind meine Lieder à l’enchantement suscité par la vue de la cathédrale de Cologne dans Im Rhein, im schönen Strome. Avant la pièce Die drei Zigeuner typique de l’inspiration hongroise, c’est le très coloré et très marqué Ihr, Glocken von Marling, qui exalte les qualités d’un Kaufmann qui chante ces pièces avec ardeur, mais sans manquer de raffinement ni de variété d’accents.
C’est une toute autre atmosphère qui marque les cinq Rückert-Lieder de Mahler, où le ténor prodigue ses mezzevoci à la recherche des couleurs dominantes dans ces musiques du début du XXe siècle. Ce sont les pages les plus inspirées de la soirée, avec une voix idéalement accompagnée par le piano d’Helmut Deutsch, rigoureusement fidèle à la partition, avec des sons clairs et des harmonies bien dessinées, mais jamais mécaniques, privilégiant la netteté des accents et des couleurs plutôt qu’une recherche inutile des effets à laquelle nous ont habitués bien des exécutions avec orchestre.
Le chant de Kaufmann, direct et généreux dans sa recherche de nuances et de mezzevoci qui mène la voix quelquefois aux limites de la justesse, s’intègre parfaitement à ce jeu pianistique. Ainsi Liebst du um Schönheit stupéfie et frappe, parce que pour une fois il ne nous inonde pas dès le début de l’explosion solaire du final, mais y arrive – et c’est splendide – progressivement en partant d’une sourde inquiétude.
Ich bin der Welt abhanden gekommen, au jeu des voyelles susurrées à mezzavoce provoque des applaudissements spontanés et mérités, avant la péroraison de Um Mitternacht.

Après que les pièces d’Hugo Wolf eurent introduit la deuxième partie du concert, avec une sélection de pages juvéniles aux accents de ce romantisme impulsif aux lignes vocales fragmentées, bien adaptées à la vocalité du ténor, déchiquetée et âpre par moments, l’attention est attirée par l’exécution des quatre derniers Lieder de Richard Strauss.
La curiosité est grande d’entendre ces pièces qui ont été idéalement interprétées par les plus grandes voix de soprano d'après guerre, ici accompagnées au piano et en plus par une voix masculine, même si c’est celle de Kaufmann. À l’audition reste dans la mémoire la grande musicalité et la flexibilité vocale du ténor, mais dans l’ensemble, le résultat laisse perplexe. Seul Im Abendrot, le quatrième et dernier des Lieder marque par les couleurs et les effets. Au reste, pour le moment, le ténor ne réussit pas à rendre les atmosphères évocatoires que seule la voix féminine peut obtenir, à force de souplesse et de sinuosités que la voix d’un ténor dramatique ne peut obtenir.
Il manque la couleur de la mélancolie, de la sérénité apaisée devant l’inconnu du dernier crépuscule : Ist dies etwa der Tod ? – Est-ce ainsi, peut-être que l’on meurt ? La réponse en musique arrive avec une autre touche d’orchestration géniale où Strauss cite son poème de jeunesse Tod und Verklärung , comme pour fermer le cercle.
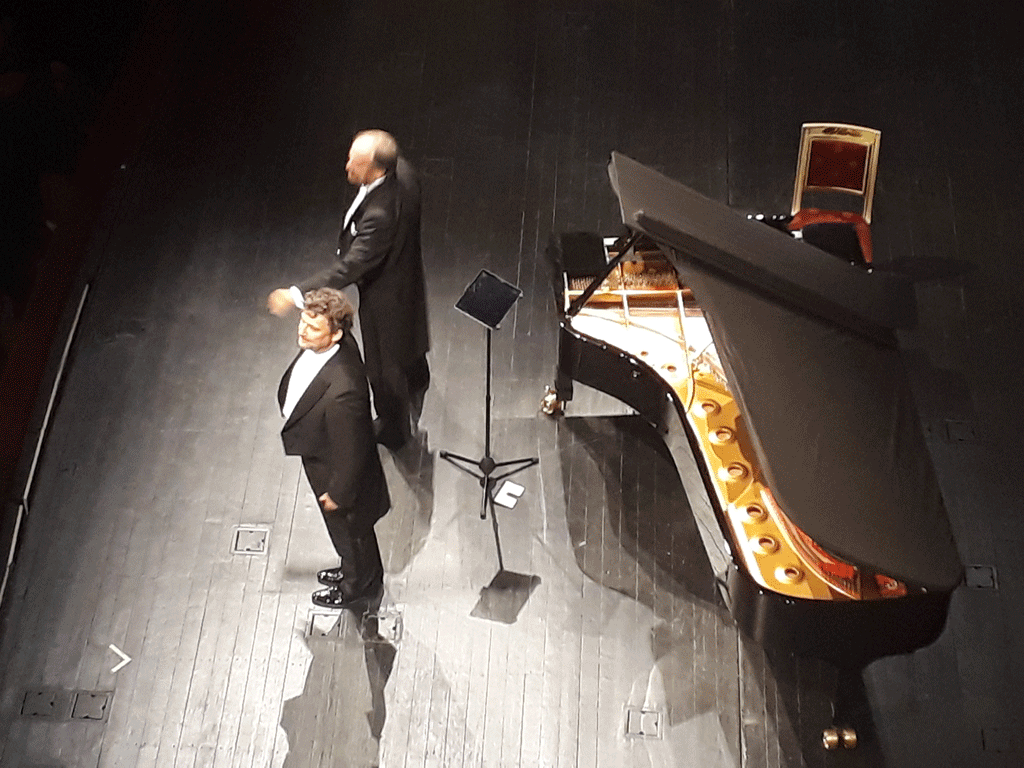
Trois bis de Richard Strauss et basta ? Inimaginable dans le temple milanais et alors voilà Se quel guerrrier io fossi…Celeste Aida de Verdi (si le phrasé du récitatif est plutôt improbable et expédié, la pose de voix qui s’atténue est une leçon et nous rappelle que Kaufmann est peut-être le seul ténor aujourd’hui à même de respecter l’écriture de Verdi), La fleur que tu m'avais jetée de Bizet (comme pour l’air précédent, la note finale est une spécialité-maison !) pour un Don José inégalable aujourd’hui, puis E lucevan le stelle de Puccini qui déchaine un enthousiasme digne des divi des temps passés. Et avant le long triomphe final, un dernier et intense Es muss ein Wunderbares sein de Franz Liszt.

