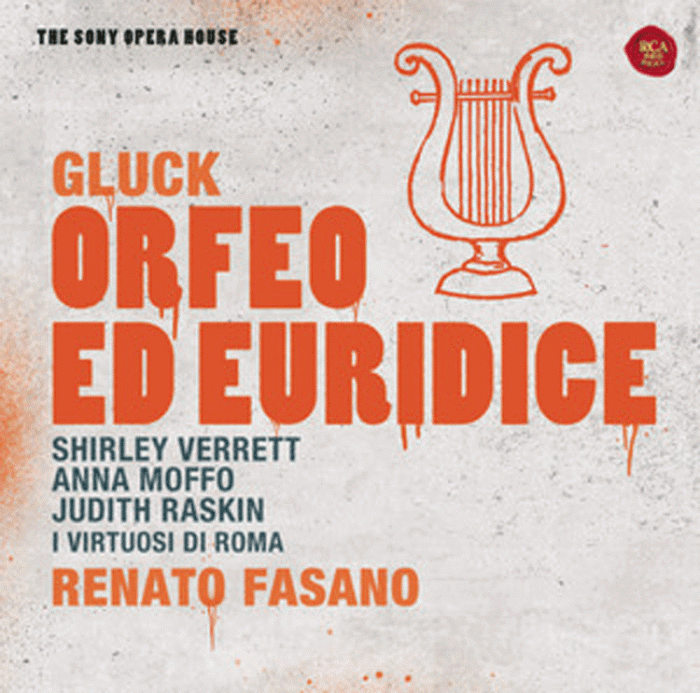 Avouons-le humblement : nous avions oublié l’existence de cet enregistrement d’Orfeo ed Euridice et c’est avec plaisir que nous l’avons redécouvert. En 1965, date de sa réalisation dans les studios romains de RCA, ce projet était de toute évidence novateur puisqu’il tentait de redonner vie à cette partition, dans un esprit « baroque ». Douze ans après la mort de Kathleen Ferrier qui s’était emparée du rôle, la proposition du chef italien Renato Fasano était « avant-gardiste », celui-ci choisissant pour l’occasion non pas un grand orchestre classique, mais une formation réduite capable de s’apparenter aux sonorités et au jeu des instruments anciens. Nos oreilles ont depuis eu la chance d’être éduquées, la révolution baroque ayant transformé nos préjugés et fini de convaincre les plus réticents, même si l’on peut continuer d’admirer les visions de Monteux (RCA 1955), Rosbaud (Philips 1956), Karajan (Salzbourg 1959), ou Solti (Decca 1969).
Avouons-le humblement : nous avions oublié l’existence de cet enregistrement d’Orfeo ed Euridice et c’est avec plaisir que nous l’avons redécouvert. En 1965, date de sa réalisation dans les studios romains de RCA, ce projet était de toute évidence novateur puisqu’il tentait de redonner vie à cette partition, dans un esprit « baroque ». Douze ans après la mort de Kathleen Ferrier qui s’était emparée du rôle, la proposition du chef italien Renato Fasano était « avant-gardiste », celui-ci choisissant pour l’occasion non pas un grand orchestre classique, mais une formation réduite capable de s’apparenter aux sonorités et au jeu des instruments anciens. Nos oreilles ont depuis eu la chance d’être éduquées, la révolution baroque ayant transformé nos préjugés et fini de convaincre les plus réticents, même si l’on peut continuer d’admirer les visions de Monteux (RCA 1955), Rosbaud (Philips 1956), Karajan (Salzbourg 1959), ou Solti (Decca 1969).
Si Renato Fasano peut passer pour un précurseur, sa contribution demeure modeste : son orchestre dégraissé répond cependant davantage aux exigences baroques que celui de Vaclav Neumann à la même époque pour EMI (un compact Gewandhausorchester Leipzig ) et le tissu orchestral allégé, accompagne les voix sans les écraser ou tenter de rivaliser avec elles. Chaque tableau est différencié pour suivre l’éprouvant voyage d’Orfeo contraint pour rejoindre sa bien-aimée, de se rendre aux Enfers avant de retrouver des territoires plus avenants. D’une poésie singulière et d’une extrême originalité, la partition de Gluck donne parfois le sentiment d’être inutilement secouée, le tempo subissant des variations que l’on qualifiera d’audacieuses, qui perturbent l’ordonnancement interne de l’œuvre, sans pour autant les dénaturer. Généralement lentes, mais jamais aussi pesantes que celles dirigées par Neumann dans la gravure concurrentielle avec Grace Bumbry (Emi), les scènes narratives, calmes ou méditatives sont maîtrisées, même si celles-ci sont souvent interrompues par des parties dédiées aux ballets très éruptives, comme pour déstabiliser l’auditeur ou produire de purs effets : mais après tout d’autres chefs, comme Minkowski, cultiveront quelques années plus tard cette tendance, pour le plus grand bonheur de certains….
Alors à l’orée d’une grande carrière, Shirley Verrett est un fort séduisant Orfeo, au profil racé et androgyne, tandis que sa voix sombre aux reflets mordorés, rugueuse par moment, modelée à d’autres est tout sauf monotone. Moins voluptueuse et virtuose que celle de Marilyn Horne qui campera un des plus saisissants Orfeo cinq ans plus tard sous la baguette de Georg Solti, Verrett captive par son interprétation vibrante et fouillée qui culmine dans un « Che faro senza Euridice » mouillé de larmes, d’une très grande beauté. Trop star, Anna Moffo passe un peu à côté du rôle délicat d’Euridice, qu’elle aborde de haut, sûre de son magnétisme et de son aura, mais qu’elle donne l’impression de survoler, sans mettre de sa personne, trop absente pour être concernée. C’est d’autant plus regrettable qu’à cette période l’instrument possède encore cette chair et ce moelleux qui disparaîtront très rapidement pour ne laisser échapper que métal et stridences prématurées dans l’aigu. Judith Raskin est une erreur de casting, son Amore rabougri et convenu, sans le moindre allant donnant des envies de meurtre. Un peu trop bruyants, quasi hollywoodiens, les membres du Chœur Polyphonique de Rome, dirigés par Nino Antonellini auraient mérité plus d’égards, leur constante sauvagerie irritant parfois nos tympans, mais l’ensemble demeure de belle tenue.

