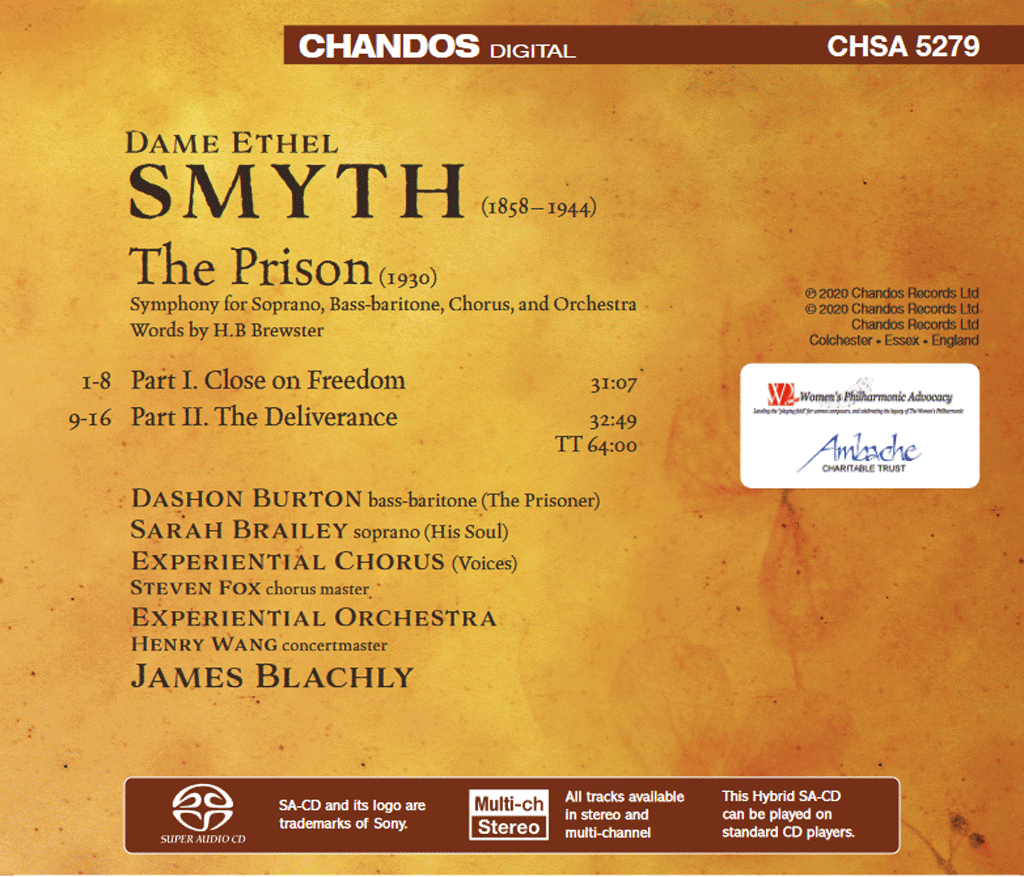Cet été, le label Chandos a décidément de la suite dans les idées. Après avoir publié il y a quelques mois une intégrale de l’opéra de Luigi Dallapiccola Il prigioniero, voici qu’il propose The Prison, de Dame Ethel Smyth. Si les titres sont voisins, et les thèmes parfois proches, on ne saurait pourtant imaginer œuvres plus dissemblables, en termes de notoriété comme sur le plan de l’écriture. Pour ne pas être le plus joué des compositeurs du XXe siècle, Dallapiccola n’en jouit pas moins d’une certaine reconnaissance, notamment en France (Il prigioniero fut mis à l’affiche du Palais Garnier en avril 1968, couplé à la Médée de Darius Milhaud) ; mais qui peut prétendre avoir entendu une œuvre d’Ethel Smyth hors des frontières du Royaume-Uni, ou même du monde anglophone ?
Cet été, le label Chandos a décidément de la suite dans les idées. Après avoir publié il y a quelques mois une intégrale de l’opéra de Luigi Dallapiccola Il prigioniero, voici qu’il propose The Prison, de Dame Ethel Smyth. Si les titres sont voisins, et les thèmes parfois proches, on ne saurait pourtant imaginer œuvres plus dissemblables, en termes de notoriété comme sur le plan de l’écriture. Pour ne pas être le plus joué des compositeurs du XXe siècle, Dallapiccola n’en jouit pas moins d’une certaine reconnaissance, notamment en France (Il prigioniero fut mis à l’affiche du Palais Garnier en avril 1968, couplé à la Médée de Darius Milhaud) ; mais qui peut prétendre avoir entendu une œuvre d’Ethel Smyth hors des frontières du Royaume-Uni, ou même du monde anglophone ?
Cette compositrice britannique n’est pourtant pas tout à fait n’importe qui, et elle a, encore aujourd’hui, quelques titres de gloire. Premièrement, avant les représentations de L’Amour de loin de Kaija Saariaho données en décembre 2016 au MET, Ethel Smyth était la seule femme dont une œuvre ait été jouée sur la scène new-yorkaise : en mars 1903, son opéra en un acte Der Wald fut donné deux fois par le MET, en lever de rideau avant Il Trovatore ou La figlia del reggimento. La lecture des critiques parues à l’époque dans la presse est assez éloquente, par son mélange de faux compliments et d’attaques misogynes. La musique de cet opéra (écrit sur un livret en allemand et créé à Berlin l’année précédente) est jugée « masculine », « tout sauf féminine », c’est-à-dire dénuée de douceur et de délicatesse, donc complexe et ambitieuse. C’est aussi une musique « ultra-moderne, stridente, informe, passionnée », autrement dit, post-wagnérienne.
Deuxièmement, bien que décorée de l’Ordre de l’Empire britannique en 1922 et donc gratifiée du titre de « Dame », Ethel Smyth fut une rebelle, membre du mouvement pour le vote des femmes ; elle composa une Marche des femmes qui devint l’hymne officiel des suffragettes, et passa deux mois en prison lorsqu’une centaine de militantes furent arrêtées pour jets de pierre sur divers bâtiments. Dans sa vie privée, Ethel Smyth s’avéra tout aussi hors normes : après s’être éprise d’Emmeline Pankhurst, leader de la Women’s Social and Political Union, elle tomba amoureuse de Virginia Woolf qui ne consentit à lui accorder que son amitié.
Née en 1858 dans la banlieue de Londres, Ethel Smyth partit à 19 ans étudier la composition auprès de Carl Reinecke au conservatoire de Leipzig. Elle se mit à produire des œuvres régulièrement à partir des années 1880, notamment des opéras dont le livret fut coécrit avec un certain Henry Bennet Brewster, philosophe américain installé en Europe, auquel elle fut unie par une solide amitié jusqu’en 1908, date à laquelle Brewster mourut. Ainsi furent conçus Fantasio, opéra-comique d’après Musset (Weimar, 1898), Der Wald mentionné plus haut, et The Wreckers, opéra en trois actes (Leipzig, 1906), dans lequel d’aucuns n’hésitent pas à voir « l’opéra anglais le plus important qui ait été composé entre Purcell et Britten ».
En l’association Retrospect Opera, Dame Ethel a trouvé récemment d’ardents défenseurs qui, dans le cadre de leur lutte pour la défense des compositeurs britanniques des XIXe et XXe siècles, ont courageusement décidé d’enregistrer The Wreckers, mais aussi les opéras en un acte Fête galante (Birmingham, 1923) et The Boatswain’s Mate (Londres, 1916), tous trois dirigés par Odaline de la Martinez, infatigable avocate de la musique de Smyth. C’est sous la baguette de la même cheffe qu’avait été gravé, pour Chandos, le concerto pour violon, cor et orchestre, CD sorti en 1996. En 2019, en revanche, le label a confié à Sakari Oramo le soin d’enregistrer la Messe en ré composée en 1891 par Ethel Smyth.
C’est une autre équipe encore qui a été chargée de The Prison, dernière œuvre de grandes dimensions d’une compositrice frappée par des problèmes d’audition qui allaient bientôt l’empêcher de cultiver son art. Pour cette symphonie (la seule de son catalogue), elle était revenue à son cher Henry Brewster, qui avait publié en 1891 une sorte de dialogue néo-platonicien intitulé The Prison. Quatre amis incarnant des tendances philosophiques divergentes y discutent d’un texte récemment découvert, censément écrit par un condamné à mort la veille de son exécution. Chez Brewster, le Prisonnier monologue, tandis que les quatre commentateurs dialoguent. Ethel Smyth a choisi de faire disparaître toute la glose pour se focaliser sur le soliloque du détenu, mais comme elle souhaitait employer deux solistes et un chœur, elle en a partagé le texte entre le Prisonnier proprement dit (baryton), son âme (soprano) et les voix qu’il entend dans sa cellule (chœur). Il faut néanmoins reconnaître que ce livret passablement abscons n’est sans doute pas ce qu’il y a de plus impérissables dans l’œuvre, malgré toute l’admiration de la compositrice pour la manière dont y est évoquée « la lutte pour échapper aux limites du moi ». Car c’est d’une prison toute métaphorique qu’il s’agit ici et, au bout d’une heure passée à s’interroger sur le sens de la vie, le Prisonnier accepte son sort qu’il voit enfin sous un autre angle : « Passez donc, immortels ! Voyez, je fais éclater les liens qui vous retenez en moi ; je me dissous, j’imprime ma marque ineffaçable sur la matrice du temps ! » Le héros ayant demandé « bannières et musique », tout s’achève au milieu des trompettes militaires, et à l’instar du Christ disant à Marthe « Je suis la résurrection et la vie », jadis formule préférée des enterrements britanniques, le Prisonnier et son âme déclarent « Je suis la joie et la tristesse, Je suis la gaieté et l’orgueil, l’amour, le silence et le chant, Je suis la pensée, l’âme, le foyer »…
La musique, elle, est paradoxalement plus limpide que cet amphigouri et la pâte orchestrale convoquée pour les soutenir reste constamment fluide, sans déchaînement de fureurs bruyantes. Par son format, l’œuvre rappelle la Symphonie lyrique de Zemlinsky (1922), à cela près qu’elle donne régulièrement la parole à un chœur, absent chez l’Autrichien, et que les deux solistes y dialoguent bien davantage, leur voix se superposant même parfois. Pas d’ouverture, le dialogue commence aussitôt, et se déploie avec une grande souplesse, sans numéros fermés, sans jamais se couler dans aucun moule préétabli, ce qui donne à la première écoute l’impression d’une composition aux contours assez insaisissables, seules les interventions du chœur étant de nature plus manifestement mélodique ou de forme un peu plus traditionnelle. Evidemment, bien qu’écrivant en 1930, Ethel Smyth reste une femme de sa génération, née la même année que Puccini et que la Française Mel Bonis. The Prison ne semble pas si éloigné de certaines œuvres d’Elgar (né un an avant Smyth), et malgré sa formation germanique, Debussy reste pour elle l’horizon indépassable de la modernité.
Le livret d’accompagnement est hélas très discret en ce qui concerne « The Experiential Orchestra and Chorus ». Le site Internet de cette formation new-yorkaise nous apprend que ses premiers concerts datent de 2009, l’originalité consistant à installer le public parmi les instrumentistes mêmes, ou à les faire danser sur Le Sacre du printemps. Le son de l’orchestre est précis et ciselé, comme on le constate notamment dans le premier interlude orchestral (« Premières lueurs de l’aube », plage 7), et son fondateur et directeur musical James Blachly sait diriger ses forces pour atteindre les nobles objectifs qu’il se fixe et pour créer « une expérience » d’écoute. Le chœur, apparemment réuni pour l’occasion, et conduit par Steven Fox, se montre lui aussi à la hauteur de la tâche. Côté solistes, Sarah Brailey prête à l’Ame la pureté pudique mais jamais froide d’un soprano clair dénué de toute lourdeur trop matérielle. Lauréat d’un Grammy Award, Sarastro à Dijon, Limoges et Caen en 2017, Dashon Burton possède une voix somptueusement timbrée, et son répertoire indique assez l’aisance dont il doit disposer dans le grave ; seul certains aigus semblent parfois un rien engorgés. A tous deux on sait gré d’avoir fait l’effort d’apprendre une partition qu’ils ont peu de chances de réinterpréter de sitôt. A moins que, réévaluation de la création au féminin aidant, la compositrice connaisse enfin une plus large gloire posthume.