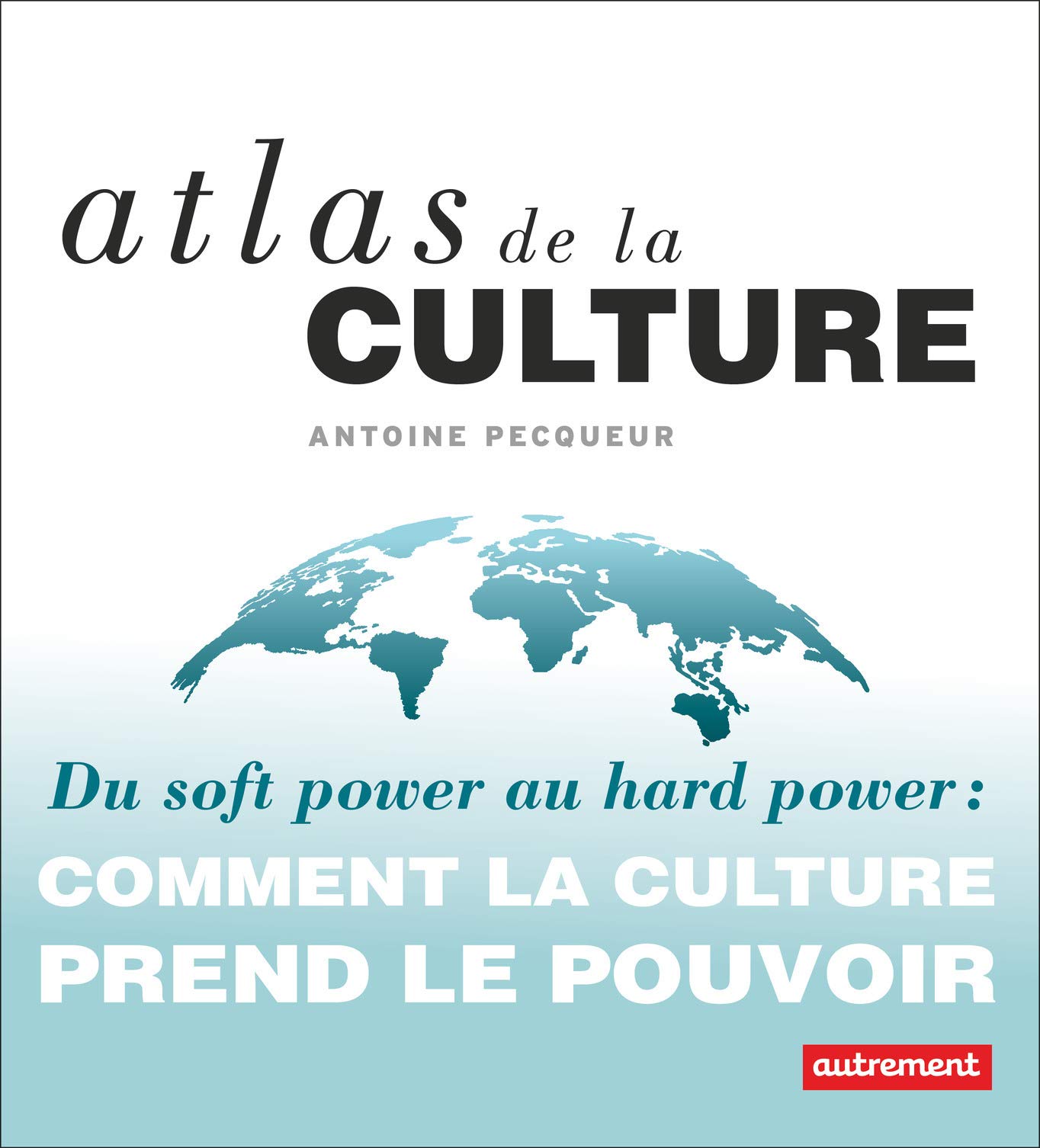
Un livre excellent mais inconfortable comme Atlas de la culture, Du soft power au hard power : comment la culture prend le pouvoir, (Éditions autrement 2020) d’Antoine Pecqueur, nous permettrait d'apprécier, en soi, la différence entre une démocratie – fondée sur la liberté d'expression et de la presse, même lorsqu'il s'agit de révéler des faits qui déplaisent aux élites dirigeantes – et un régime autoritaire. La fonctionnalisation de l'art au service du pouvoir est l'un de ces arguments que les autocraties (et « démocratures ») qui se multiplient dans le monde – même au sein de l'Union européenne – se garderaient bien d'expliciter : qu'un tel livre puisse circuler, être lu et faire l'objet de discussions est une preuve encourageante de la vitalité durable de la pensée critique, malgré son impopularité actuelle. À l'heure où les sirènes qui circulent dans la vaste mer de la culture mondiale se font passer pour vertueuses et désintéressées, toutes incluses dans le dur service de l'art, Antoine Pecqueur nous incite à nous demander si, par hasard, derrière leur chant ne se cache pas quelque chose qui n'a rien à voir ni avec l'art ni avec la vertu.
S'il a toujours été clair que l'art et la culture ne sont pas politiquement neutres – l'acte même de donner "forme" à quelque chose, c'est-à-dire de sélectionner, combiner et orienter les éléments de la réalité dans un objet artistique est déjà politique – il est également clair que le pouvoir préfère ne pas thématiser l'assujettissement de l'art et de la culture à ses propres fins de domination, préférant au contraire faire comme s'ils étaient libres et acceptaient spontanément ses objectifs. Pecqueur, qui s’appuie sur une énorme quantité de documents qui passent au crible le monde entier, de l'Europe à l'Amérique, en passant par l'Afrique, les monarchies du Golfe, la Chine et la Russie, révèle précisément ce que les élites voudraient garder caché, à savoir que la culture mondiale – ici plus ouvertement et sans vergogne, ou là plus subtilement – participe activement au renforcement et à la célébration des différents systèmes de pouvoir, même si ces systèmes sont antidémocratiques et violents.
Mais ceci, dira-t-on, est une constante de l'histoire. Pendant les quatre siècles qui vont de la fin du XIVe siècle à la Révolution française, avec ramifications diverses au XIXe siècle (il suffit de penser à la relation de Wagner avec Louis II de Bavière), l'art a été une arme indispensable des classes dirigeantes, qui l'ont utilisé précisément pour assurer ce précieux "soft power" capable d'élaborer des idées, des valeurs, des modèles de comportement, l'efficacité de la propagande, en répandant la patine ennoblissante de la beauté artistique sur les "hideux léviathans aux entrailles de bronze" (Hobbes). Une grande partie de la culture entre le début du XVe siècle et la Révolution française est à l'écoute des intérêts des classes dirigeantes, c'est-à-dire l'aristocratie et les élites ecclésiastiques, et produit des chefs‑d'œuvre au nom et au bénéfice exclusif de la seule partie de la société autorisée à jouir de droits. En un sens, nous sommes tous encore bénéficiaires de ce pacte faustien entre l'art et le pouvoir : sans ce pacte, nous n'aurions pas l'Orlando Furioso de l'Arioste, la chapelle Sixtine, les Chambres de Raphaël, les merveilleux portraits de Federico da Montefeltro et Battista Sforza par Piero della Francesca, pris de profil sur fond de leurs terres ; nous n'aurions pas le madrigal du XVIe siècle, les motets et les chansons des maîtres flamands, la Missa Hercules Dux Ferrariae avec laquelle Josquin Desprez rend hommage à Ercole D'Este, tirant le cantus firmus de la messe des syllabes du nom de l'illustre dédicataire. Sans le pacte entre la musique et le pouvoir, nous n'aurions pas les œuvres les plus importantes de Haydn (même si, dès qu'il a pu le faire, il a rompu les liens qui l'unissaient à la famille Estérhazy), les cinq cents sonates pour clavecin de Domenico Scarlatti (écrites pour les cours portugaise puis espagnole), les œuvres de Spontini célébrant Napoléon et inaugurant avec Fernand Cortez le genre de l'exotisme lyrique ; nous n'aurions pas la masse immense d'art et de culture consacrée en France à la célébration du Roi Soleil ; nous n'aurions pas les quatuors "Razumovsky" de Beethoven (qui, cependant, traitait ses mécènes de haut).
Ce n'est toutefois pas un hasard si, dès que l'occasion s'est présentée, les artistes des siècles passés se sont empressés de rompre leurs liens avec le pouvoir politique. En effet, le mécène récompensait ceux qui travaillaient pour lui par un "bénéfice", c'est-à-dire un revenu qui le soulageait de ses besoins matériels, mais en échange il demandait aux peintres, écrivains, architectes et musiciens de renoncer à leur liberté : en s'attachant au pouvoir, les artistes savaient très bien qu'ils n'étaient plus maîtres d'élaborer des idées et d'affirmer des valeurs qui pouvaient potentiellement entrer en conflit avec les intérêts de leurs mécènes. Tous n'ont pas accepté cette contrainte sans réserve ; on peut même dire que la plupart des artistes de ces quatre siècles ont vécu la limitation de leur liberté comme un joug difficile à supporter. Beaucoup ont résisté, Bach s'est rebellé à plusieurs reprises contre les caprices de ses mécènes, mais le cas le plus flagrant de résiliation brutale par un musicien de son contrat de dépendance vis-à-vis d'un mécène est le fameux "coup de pied au cul" que Mozart a reçu de la main de son mécène, l'archevêque Colloredo, lorsqu'il a annoncé qu'il ne souhaitait plus poursuivre le service. Le père de Mozart, un homme de l'Ancien Régime, s'en désespère, mais son fils ne fait qu'écrire des lettres vantant sa "liberté" nouvellement acquise. Dès lors, la dépendance d'un musicien à l'égard d'un mécène sera une exception : il y a, comme nous l'avons dit, la relation de Wagner avec Louis II de Bavière, mais Wagner lui-même a commencé sa carrière mouvementée en étant arrêté par la police de Dresde alors qu'il combattait sur les barricades aux côtés des révolutionnaires de Bakounine, et tous les autres artistes romantiques ont préféré mourir dans la pauvreté pour ne pas abdiquer leur liberté de création.
Les choses sont plus compliquées au XXe siècle. Au "petit siècle", les liaisons dangereuses entre l'art et le pouvoir ont écrasé l'art dans une étreinte fatale. Les totalitarismes – le fascisme en Italie, le nazisme en Allemagne et le stalinisme en Russie – ont développé une politique culturelle qui non seulement imposait des limites à la liberté d'expression, mais prescrivait également un canon esthétique que les artistes devaient suivre. Le cas tragique de Chostakovitch et de Prokofiev en Russie, qui ont été contraints de composer des œuvres de célébration au nom du "réalisme socialiste", et menacés par le régime si leurs œuvres n'étaient pas appréciées : Lady Macbeth du district de Mzensk (1936) de Chostakovitch est un chef‑d'œuvre du théâtre musical du XXe siècle, mais a attiré un article de la Pravda qui équivalait à une condamnation claire ("Le chaos au lieu de la musique") et une menace pour sa vie même. Le cas des artistes allemands pendant le nazisme a également été terrible. Seuls quelques-uns n'acceptent pas de se plier au régime hitlérien et émigrent à l'étranger : Erich Kleiber (le père de Carlos), Thomas Mann, Arnold Schönberg, Theodor W. Adorno, Bertolt Brecht, Kurt Weill, Fritz Lang et d'autres, artistes de théâtre, intellectuels, philosophes et musiciens ; beaucoup d'autres choisissent la voie plus confortable de l'"émigration interne", c'est-à-dire qu'ils se retirent dans leur espace privé sans collaborer avec le régime mais sans s'y opposer. Les cas de Richard Strauss, tranquillement enfermé à composer dans sa villa de Garmisch et convaincu que sa célébrité le protégerait des appétits nazis, et de grands compositeurs comme Hans Pfitzner et Carl Orff ou de grands chefs d'orchestre comme Herbert von Karajan et Wilhelm Furtwängler, qui se sont rangés de manière plus ou moins convaincante du côté des nazis, font encore débat. Klaus Mann, le fils de Thomas, fait l'apologie tragique du sort qui attend l'artiste lorsqu'il vend son âme au diable, c'est-à-dire au pouvoir, dans son beau roman Mephisto, dont István Szabó a tiré un film en 1981 avec Klaus Maria Brandauer dans le rôle-titre.
Les démocraties nées après la guerre, précisément pour éviter que l'art ne soit à nouveau soumis au pouvoir, ont développé un système de soutien et de subventions de l'État qui s'est ramifié en un réseau d'institutions où le mécène et le destinataire de l'art, le bénéficiaire de ses créations, devenait la communauté dans son ensemble. Malheureusement, cet effort n'a pas réussi, comme le montre très bien le livre de Pecqueur, à faire apprécier cette liberté aux artistes au point de les faire renoncer à se soumettre au pouvoir.
La différence, par rapport au passé, n'est pas tant ce que l'individu est prêt à faire – le livre montre la volonté de puissance des artistes sous tous les cieux – mais l'échelle des intérêts politiques en jeu, l'ampleur du pouvoir servi, qui pour la première fois est mondial. En fait, il ne s'agit plus de l'habituelle synergie "art et politique", comme au temps de Machiavel, mais de celle, plus inquiétante, "art et géopolitique" : "Cet atlas chemine ainsi à travers les continents pour décrypter cette nouvelle donne géopolitique. Au fil des pages qui vont suivre, nous montrons ainsi que les nouvelles routes commerciales de la Soie sont aussi un mégaprojet culturel, que la construction de musées enflamme les rivalités entre les pétromonarchies du Golfe, que les pays du groupe de Visegrád ((alliance politique et culturelle entre la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie)) développent leur nationalisme par le biais des arts".
Pecqueur note à juste titre que c'est précisément la poursuite aveugle et sans scrupules de leurs propres intérêts géopolitiques par les "démocratures", c'est-à-dire les pays qui nient la démocratie à la fois en tant qu'organisation étatique et en tant que valeur, qui rend particulièrement précieuse la capacité de l'art à élaborer une mythologie autour du pouvoir qui peut en quelque sorte ennoblir ses actions. C'est ainsi que, selon l'auteur, l'art se transforme de soft power en hard power, une sorte de proche parent de la guerre : lui aussi vendu, avili, une " continuation de la politique par d'autres moyens ".
La combinaison de la musique et du pouvoir dans le cas des dictatures chinoise et russe est particulièrement frappante et lourde d'implications éthiques. Ces dictatures mènent une politique tellement agressive que l'administration Biden a été contrainte de modifier radicalement l'échelle des priorités de la politique étrangère américaine. Engagée dans une série de guerres, d'actions militaires, de provocations, d'actes de suppression de la dissidence et de déni de démocratie (les dernières élections russes, qui se sont terminées il y a quelques jours, ont été jugées "les plus truquées de son histoire"), la Russie a grand besoin d'artistes pour fournir au régime une façade présentable. "Valery Gergiev est l'un des hommes les plus puissants de Russie. […] Proche de Vladimir Poutine, dont il est le ministre fantôme, Gergiev exerce son influence dans les sphères politique et économique. Ce n'est pas un hasard si en 2018, en pleine crise entre la Russie et la France, Emmanuel Macron l'a invité à dîner à l'Élysée : c'était parfait pour faire passer des messages directement à Vladimir Poutine." Gergiev ne recule pas, même quand la guerre est en jeu. "En 2008, alors que la Russie menait son offensive contre la Géorgie en Ossétie et en Abkhazie, le chef d'orchestre, d'origine ossète, a donné un concert à Tskhinvali, en Ossétie du Sud. Le choix de Tskhinvali est symbolique : l'attaque de cette ville par les troupes géorgiennes était le casus belli. Avant le concert, Valery Gergiev a prononcé un discours, avec des groupes d'enfants, des soldats et des représentants de l'Église orthodoxe dans le public, le drapeau russe en arrière-plan, et la mise en scène était parfaite. En russe puis en anglais, Gergiev a qualifié l'attitude de la Géorgie d'"acte d'agression"… La musique porte la mémoire de ceux qui sont morts au combat", a poursuivi le chef d'orchestre, avant de diriger une symphonie de Tchaïkovski : "De la musique russe, pour souligner encore plus la puissance culturelle du pays", a commenté Pecqueur. D'ailleurs, Gergiev lui-même ne tarit pas d'éloges à l'égard de son illustre patron : "Poutine est très pragmatique et a compris que la culture était la seule chose que la Russie n'avait pas encore perdue. À mon avis, il est l'un des rares hommes politiques qui pourraient empêcher la désintégration du pays. Je le respecte pour ce qu'il a fait dans de nombreux domaines, notamment – et surtout ! – dans la culture. Ces dernières années, notre pays a retrouvé un rôle sur la scène internationale, et nous avons de nouveau fait entendre notre voix ». Qui sait si ce "retour à l'écoute" positif en Russie inclut également pour Gergiev les assassinats politiques, comme celui de l'espion Alexandre Litvinenko, empoisonné sur commande par le gouvernement russe au polonium 210, ou celui de la journaliste anti-régime Anna Politkovskaïa, abattue d'une balle dans le visage, ou encore la récente tentative d'assassinat du principal opposant politique de M. Poutine, Alexandre Navalny, aujourd'hui en prison. Impressionnante la page 35 du livre de Pecqueur, où un tableau montre impitoyablement la correspondance entre les concerts et les discours pro-Poutine de Gergiev et certains des événements les plus terribles de l'histoire récente impliquant la Russie. L'universitaire français a raison : à ce niveau, l'art n'est plus un soft power mais un hard power comme celui des bombes et des fusils, tout aussi explicite, tout aussi brutal.
La relation entre le régime chinois et son artiste principal, le pianiste Lang Lang, est également très présente, et pas particulièrement flatteuse pour lui. La Chine est la première économie mondiale et chacun connaît, de la pression sans précédent en faveur de la 5G aux accords de la "Route de la Soie" (que nous regretterons probablement), sa capacité à exercer une hégémonie sur les économies des autres pays. Ces dernières années, la Chine a pénétré l'Afrique si profondément qu'elle s'est emparée d'abord de ses infrastructures, puis de ses matières premières, et enfin de sa culture : l'auteur du livre parle même de "Chinafrique", et ce n'est malheureusement pas une exagération : il est inquiétant de penser qu'à partir de l'année prochaine, dans les écoles kenyanes, la langue chinoise fera partie des matières principales. Si l'on accepte de voir les choses telles qu'elles sont, il est clair que Pékin ne s'arrêtera pas à la simple domination économique de l'Afrique ou du reste du monde : l'objectif final du Dragon est l'exportation à l'échelle mondiale d'une idéologie illibérale, d'un système de valeurs civiles fondé sur la soumission et l'obéissance au régime, et d'une structure étatique où aucune forme de dissidence n'est prévue ou autorisée. Les instituts "Confucius" constituent la principale arme de pénétration de la culture chinoise dans le monde. Le premier Institut Confucius en Afrique a été construit à Nairobi en 2005, en 2018 il y a déjà 54 instituts dans 33 pays. "Le choix des lieux", note Pecqueur, "est stratégique, et lié à la dynamique des échanges. Et Pékin ne compte pas s'arrêter là : elle prévoit d'atteindre une centaine de sites dans un court laps de temps".
Ces dernières années, cependant, de nombreuses voix se sont élevées dans le monde contre ces instituts Confucius, accusés d'être de facto des centres d'espionnage et de renseignement chinois. En ce sens, on doit partager le cri d'alarme de Pecqueur : les "échanges" culturels et commerciaux avec la Chine, sur le papier, se révèlent invariablement être des opérations politiques favorables aux seuls Chinois : "Loin d'être une connexion entre différents pays, ce qui se dessine à travers ce tissu d'initiatives [l'auteur fait notamment référence à une série d'échanges culturels bilatéraux Europe-Chine], c'est la force de l'emprise économique chinoise : les trains qui arrivent chargés en Europe et repartent presque vides en Chine en sont un exemple flagrant". Mais la Chine, comme nous l'avons vu avec Hong Kong (et le verrons peut-être avec Taïwan, si les États-Unis ne parviennent pas à l'empêcher), là où elle n'arrive pas avec la persuasion économique, elle arrive avec la pression militaire. Le "Quad", c'est-à-dire le quadrilatère formé par les démocraties des États-Unis, de l'Inde, du Japon et de l'Australie, et la nouvelle alliance militaire "Aukus" entre les États-Unis, l'Australie et la Grande-Bretagne (voir la récente affaire des sous-marins français), sont des initiatives visant précisément à contrer l'expansionnisme chinois.
"Qu'ont en commun les stars du piano Lang Lang et Yundi Li ou les actrices Zhou Xun et Zhang Ziyi, cette dernière jouant dans le film Le Tigre et le Dragon ? Ils sont tous chinois mais vivent à Hong Kong", écrit Pecqueur. Pékin a en effet confié à ces artistes le rôle officieux d'ambassadeurs, en essayant de s'enraciner dans l'ancienne colonie britannique également par leur présence culturelle : "Le régime, poursuit Pecqueur, a créé un statut de "résident spécial" pour permettre aux artistes chinois de conserver leur citoyenneté chinoise et de s'installer à Hong Kong, même s'ils n'y travaillent pas en permanence…". L'opération ne s'arrête pas à un bout de papier, car tous ces artistes se retrouvent sous les feux de la rampe lors d'événements officiels. Lang Lang, par exemple, était avec les Berliner Philharmoniker lors du grand concert célébrant le 20e anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Le fait que dans l'ancienne colonie britannique, les opposants soient arrêtés, que les journaux libres soient fermés, que toute forme de dissidence soit interdite, que la rébellion des "parapluies jaunes", c'est-à-dire des jeunes qui ne veulent pas perdre leur liberté, que la Chine soit accusée de nettoyage ethnique sur son propre territoire à l'encontre de la minorité musulmane ouïgoure, qui est traitée d'une manière inédite depuis les camps de concentration nazis, n'intéresse manifestement pas Lang Lang.
Comme beaucoup d'artistes convaincus que leur art compte plus que tout – tout récemment un architecte italien qui, dans une interview publiée il y a quelques jours dans La Repubblica, se réjouissait des magnifiques opportunités que lui offrait la Chine, comme s'il parlait de la Suisse – Lang Lang ignore le caractère social de l'art et se comporte comme si la musique n'avait aucun rapport ni aucune responsabilité vis-à-vis de la réalité extérieure au son. En d'autres termes, la musique vivrait dans son propre monde « hyperuranien » de correspondances formelles ailées et de mise en œuvre de fins purement musicales : un monde irénique, totalement abstrait et séparé des dynamiques sociales. C'est une erreur flagrante, d'autant plus grave qu'elle résulte d'une deminutio ((perte de droits, déclassement)) infligée à la musique elle-même, d'une sous-estimation délibérée de sa valeur en tant que cri contre l'injustice et préfiguration d'un monde plus humain. Il ne faut pas se tromper : l'enchantement de la musique repose sur des hypothèses axiologiques précises, sur un système de valeurs qui fait partie de son message et qui est profondément ancré dans ses structures expressives mêmes. Ignorer les présupposés éthiques, idéaux, libertaires, humanistes et philosophiques de la musique, penser que ce qu'elle dit ne concerne que le monde des sons et ne constitue pas un regard critique sur la réalité dans son ensemble, responsabilisant ceux qui la jouent et ceux qui l'écoutent, c'est ne pas comprendre ses implications les plus profondes.
Le répertoire pour piano interprété par Lang Lang est l'enfant des conquêtes des Lumières, de la Révolution française et des grands idéaux de la génération romantique : ceux qui interprètent Beethoven sans percevoir "rien de la bourgeoisie révolutionnaire… l'écho de ses mots d'ordre… la tension vers cette totalité dans laquelle la raison et la liberté doivent être garanties, ne le comprennent pas de la même manière que ceux qui sont incapables de suivre le contenu purement musical de ses pièces" (Th. W. Adorno). La musique du classicisme viennois, celle du romantisme et même avant celle du baroque tardif de Bach et Händel présupposent les valeurs de l'humanitas des Lumières – liberté, égalité, fraternité, justice – ; elles honorent et exigent d'honorer ces valeurs ; elles vouent un respect absolu et même un culte à l'humanité de l'individu auquel elles s'adressent, en qui elles voient enfermée, comme dans un cercueil, l'humanité tout entière. Pecqueur cite à juste titre cette déclaration inquiétante du pianiste chinois : "La musique améliore la vie. Elle guérit, unit, inspire et fait de nous de meilleures personnes. La musique est puissante. Je veux que chaque enfant ait accès à des expériences musicales qui enflamment quelque chose de merveilleux en lui, tout comme la musique a produit quelque chose d'incroyable en moi", une déclaration qui contraste fortement avec la réalité de l'oppression et de la violence que le pianiste chinois contribue lui-même à entretenir. Malheureusement pour lui, ajouterons-nous, Lang Lang est étranger aux valeurs contenues dans la musique occidentale, son indifférence à l'humanisme niché dans la fibre des pièces qu'il aborde, son incompréhension de ce à quoi renvoient les symboles musicaux dans une tension on ne peut plus explicite et éloquente, tout cela transparaît dans ses prestations : raté, au sens où l'on dit d'un tir qui n'atteint pas la cible.
Ce livre incontournable nous fait réfléchir sur la fonction de l'art et de la musique, sur l'attrait silencieux qui émane des sons. La splendeur de la musique n'est pas abstraite et déconnectée de la conscience de la réalité sociale, du pacte implicite qui lie ceux qui composent, ceux qui exécutent et ceux qui écoutent, du désir de se pencher sur l'humanité souffrante et de la soulager de sa douleur, de l'obéissance à la loi morale qui est en nous et au ciel étoilé qui nous surplombe. La musique est nécessairement liée à une intention éthique, elle ne peut passer sous silence la souffrance d'un seul être humain à la poursuite d'un rêve de puissance, même s'il s'agit de la représentation la plus séduisante du meilleur des mondes possibles. Il en écrit un que ni Poutine ni Xi Jinping n'auraient aimé : "Préceptes. Faites le bien chaque fois que c'est possible, aimez la liberté par-dessus tout, ne reniez jamais la vérité, pas même au pied du trône" (L. van Beethoven, 1793).


