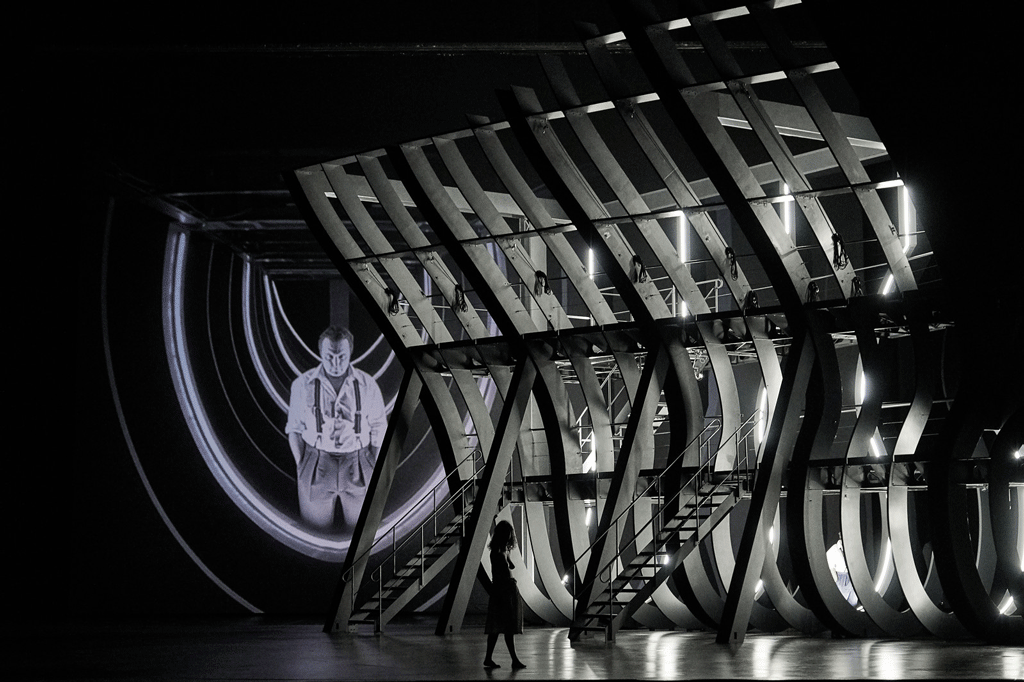Rappelons à ceux qui l'auraient oublié que Boccanegra est un corsaire, un armateur, un marchand… une authentique figure de cette cité de Gênes au XIVe Siècle, véritable empire commercial des rives de la Méditerranée jusqu'aux rivages à la Caspienne et des Flandres. On doit au poète et dramaturge espagnol Antonio Garcia Gutiérrez le sujet qui inspira Verdi pour Le Trouvère et Simon Boccanegra. Les fortunes de ces deux opéras ne seront pourtant pas identiques, le second devant attendre après une création décevante en 1857, une reprise enfin triomphale en 1881. L'adaptation de Francesco Maria Piave butait déjà sur une typologie des rôles trop accentuée et une intrigue où l'improbable le disputait à la complexité. En adaptant à son tour le livret, Arrigo Boito mettra en valeur de façon plus homogène la question du pouvoir qui sert de fond à la peinture morale d'une galerie de personnages caractéristiques.
Calixto Bieito a déjà démontré par le passé à quel point il était fasciné par les racines baroques, qui éclairent largement le romantisme espagnol. La lecture du synopsis tourne rapidement au casse-tête, laissant le spectateur aux prises avec l'intrication des relations sociales et familiales. Cette complexité et cette sorte de brouillage narratif permanent dessinent une forme d'opéra en creux, non immédiatement spectaculaire car authentiquement introspectif et métaphysique. Impossible de contourner la relation du peuple avec le pouvoir – relation qui donne à Simon Boccanegra la première place parmi les opéras "politiques" de Verdi. Que se passe-t-il dans la tête d'un homme politique ? Où se situe la frontière entre le privé et le public ? Le personnage qui intéresse Bieito est au carrefour des problématiques soulevées par Elias Canetti dans Masse et Pouvoir (1960) et ce, dès l'incipit : "Il n'est rien que l'homme redoute davantage que le contact de l'inconnu".
Le livret rend fidèlement le récit très contemporain de cette intrigue politique qui porte Boccanegra au pouvoir. L'opposition des patriciens cherche à imposer un pouvoir héréditaire mais le navigateur ne joue pas le rôle escompté d'homme de paille. Paolo lui fait espérer un mariage avec Maria, la fille de Fiesco, pour le décider à accepter la charge de Doge. La découverte du cadavre de sa bien-aimée sonne le glas de ses ambitions, en même temps que le peuple afflue pour célébrer son élection à la tête de la cité. La mise en scène de Bieito ne montre rien de moins que cette déchirure intérieure qui agite Simon, devenu homme de pouvoir. Le corsaire doit renoncer à l'harmonie de ce "poème de l'amour et de la mer", contraint désormais de vivre sur la terre ferme, prisonnier d'un pouvoir qui l'arrime à une tragédie intérieure.
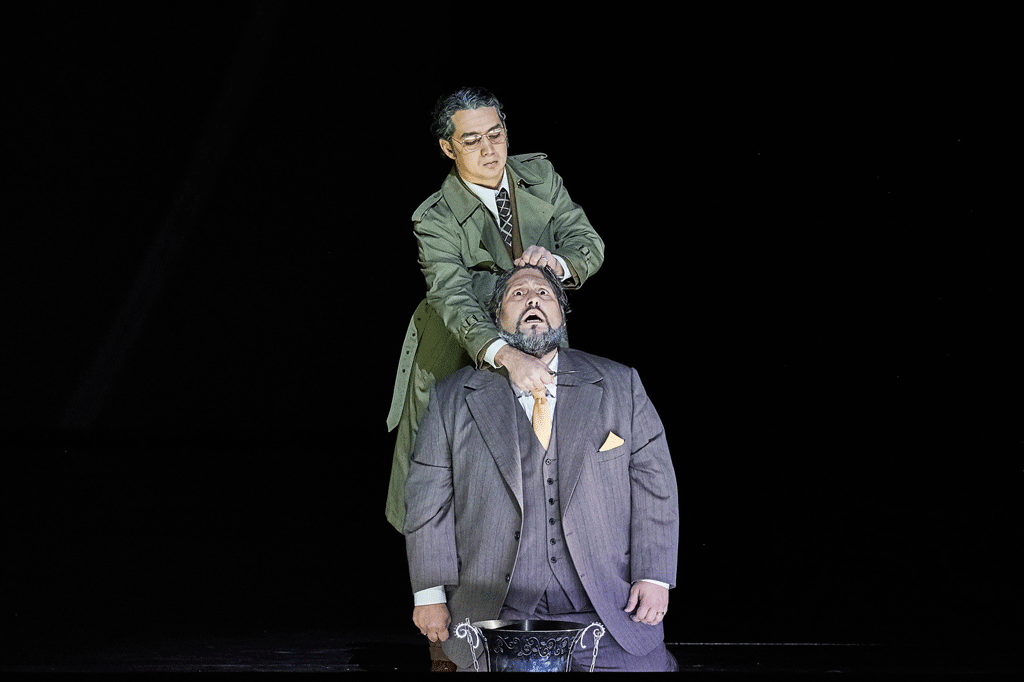
Paolo est le symbole du plébéien arriviste et de l'éminence grise qui n'hésite pas, après avoir poussé à l'élection de Simon et l'avoir conseillé, à l'empoisonner. Cette thématique du poison pénétrant le corps de Simon Boccanegra est consubstantielle à la question d'un pouvoir qu'il accepte et refuse dans un même mouvement. Dévoré par cette contradiction, il brûle et se désagrège littéralement, victime d'un tourment moral qui n'a d'équivalent que celui d'un Boris Godounov – autre personnage d'opéra ayant inspiré à Calixto Bieito l'une de ses plus belles mises en scène.
On a souvent lu ici et là que le travail de l'espagnol (faudra-t-il encore longtemps préciser qu'il n'est pas catalan, même s'il a longtemps travaillé à Barcelone ?), versait irrésistiblement dans la provocation et la laideur. Est-ce donc si provocant et si laid de montrer Paolo transportant avec lui une façon de seau à champagne dans lequel il plonge régulièrement un linge pour s'éponger le front ? Ou plutôt s'agira-t-il de refuser d'aller chercher plus loin et considérer que l'étrange accessoire tient à la fois du crachoir ("tenir le crachoir", servilité politique), de la vasque de toilette (se laver de toute responsabilité, tel Ponce Pilate) et surtout d'urne fatale puisqu'il n'hésitera pas à y verser le poison. La corruption de l'eau avec laquelle Paolo lavait la tache (indélébile) de son péché politique, sera à l'origine de l'empoisonnement et de la lente agonie de Simon. Le travail remarquable de Bieito permet de mettre en valeur cet accessoire symbolique et donne à la notion de corruption un sens complexe qui mêle morale et politique, enrichissant ce qui n'était alors qu'un simple ressort théâtral.
"C’est dans la masse seulement que l’homme peut être libéré de cette phobie du contact" nous dit Elias Canetti. Observons le peuple qui accourt du fond de la scène pour célébrer l'élection de Boccanegra à la fin du prologue. Les éclairages de Michael Bauer magnifient ces taches de couleur et ces visages, saisis par en dessous pour mieux en montrer l'agitation et l'excitation. Tous veulent toucher le corps de Simon qui se livre à eux, les bras en croix et la tête renversée – figure christique qui résume à elle seule le quiproquo d'une situation dominée par la douleur et la joie extrêmes. À la fin de l'acte I également, plébéiens et patriciens s'accusent mutuellement du rapt d'Amélia. Bravant la colère collective, Simon impose à tous le silence et le tumulte s'adoucit progressivement, tandis que le doge foudroie l'assemblée d'un regard terrible et bienveillant.
La présence d'une figurante exhibant sa nudité a provoqué le soir de la première son lot de cris d'effrois. Il suffisait pourtant de s'en tenir au livret et constater qu'il s'agit très logiquement de Maria, fille de Fiesco et mère d'Amélia, l'enfant qu'elle a eue de Simon. Séparée de sa fille, victime d'un père abusif qui la séquestra et lui interdit de voir son bien aimé, elle meurt dans la déchéance. C'est son cadavre que découvre Simon au moment où il est élu doge. Si Bieito fait le choix de la montrer en scène, errant d'un bout à l'autre de l'ouvrage, c'est dans une perspective quasi shakespearienne qui fait écho à la scène du spectre dans Hamlet. Témoin misérable, impuissant et muet de l'action qui se déroule sous ses yeux, le fantôme de Maria accompagne la destinée de Simon jusque dans son agonie finale. Le livret nous apprend également qu'Amélia porte en réalité le prénom de sa mère, rien d'étonnant au fait que Bieito la montre incapable d'enlacer son amoureux Gabriele Adorno, davantage victime de la violence des hommes qu'objet de vénération. Sa mise désordonnée fait plutôt allusion au fait qu'elle a été abusée par son prétendant, résurgence de la thématique très présente chez Bieito de la corruption de l'innocence (Die Gezeichneten, l'Ange de feu, Die Soldaten etc.). À l'entracte, le corps nu de Maria parcouru par des rats est projeté sur le rideau de scène. Le symbole est ambivalent, l'animal répugnant souille le corps, propage les maladies. Sarah Derendinger avait déjà montré dans l'avant-propos et la conclusion de Die Soldaten, des vidéos superposant une jeune fille avec le cadavre d'un rat agité par des vers qui le dévorent. La thématique de l'animal parasite rejoint une fois de plus la notion de "masse et pouvoir", avec la dimension politique des rongeurs anthropomorphes qui finissent par dévorer le corps de la bien-aimée comme le poison détruit lentement le corps de Simon.
Les rats sont également les passagers clandestins et les propagateurs de maladies que transportent les navires dans leurs cales. C'est le trait d'union qui nous conduit au somptueux décor signé Susanne Gschwender, à qui l'on doit déjà (entre autres) les remarquables Otello et Parsifal de Calixto Bieito. Sur une immense scène tournante qui occupe tout le plateau de Bastille est posée la coque d'un navire que l'on a aucune peine à identifier comme le vaisseau du corsaire Simon Boccanegra. Ce décor est moins référence narrative que dimension onirique et espace mental. Il prolonge la perspective psychologique qui traverse l'œuvre de part en part, plaçant le personnage de Simon au point de rotation autour duquel tournent les protagonistes. Observons ce navire de plus près : laideur encore ? Ceux qui le prétendront auront la mémoire courte, à moins qu'ils n'aient applaudi à tout rompre la grandiloquente et très mussolinienne proue en carton-pâte qui ornait l'inoubliable production de Francesca da Rimini, montée in loco par le Zeffirelli du pauvre : Giancarlo Del Monaco.

Susanne Gschwender a voulu un navire contemporain dont la proue gigantesque monte jusqu'aux cintres et qui semble de toute évidence mis en cale sèche. L'épave qui servit de vaisseau au corsaire amoureux de la mer n'a plus à imposer que des dimensions de cargo (moderne navire marchand) et un intérieur sur plusieurs niveaux reliés par des escaliers métalliques. Un jeu de néons obliques en dessinent les contours et éclairent le personnage de Simon Boccanegra, qui erre à l'intérieur comme une âme en peine. Plusieurs caméras fixes filment les espaces intérieurs et captent le regard inquiet du personnage qui semble se regarder comme dans un miroir. L'image, projetée en très gros plan à l'arrière de la scène, nous fait pénétrer dans les méandres d'une conscience agitée qui – littéralement encore – tourne en rond en même temps que le plateau. Dans le final de l'acte III, ce sont les mêmes images dramatiques de Paolo, Fiesco, Amelia qui reviennent en boucle comme une série de flashs dans l'esprit de l'agonisant. Impossible de croire que Calixto Bieito ait oublié son Strehler – n'en déplaise aux nostalgiques qui regrettent de ne pas retrouver la célèbre voile noire en fond de scène. Avec des moyens techniques et une approche intellectuelle complètement différente, Bieito fait du navire le réceptacle réflexif en même temps que l'expansion métaphysique du personnage de Simon.
Ouvrons un ouvrage de construction navale : on y découvre que le carénage est une opération technique qui permet l'entretien des navires mis en cale sèche afin de pouvoir réparer ou nettoyer la partie située sous la ligne de flottaison. Le lexique employé à cette occasion est plus freudien que réellement technique : les "œuvres vives" désignent la partie immergée de la coque (nécessaire à la navigation), par opposition aux "œuvres mortes" qui désignent la partie située au-dessus de l'eau. Mis en cale sèche, le navire et la personne de Boccanegra n'est donc plus qu'une unique "œuvre morte", dont la navigation se réduit désormais aux tourments à la fois immobiles et circulaires d'une introspection psychologique qui doit se résoudre à un démantèlement.
Ajoutons deux détails encore : tout d'abord, les deux poutres qui soutiennent la carène qui représentent la croix du blason de Gênes et puis surtout ce bulbe d'étrave (renflement sous la proue qui permet d'améliorer l'hydrodynamique du bateau) qui évoque l'image de la corne ducale du doge… posée de travers, comme abandonnée sur l'immense plateau. On pourra objecter qu'il s'agit là de la coiffe du doge de Venise et non de celui de Gênes… mais la tentation était sans doute trop forte pour ne pas pointer une allusion, même subliminale, qui vient s'ajouter à la longue série des détails qui signent un travail de scénographie de tout premier ordre.
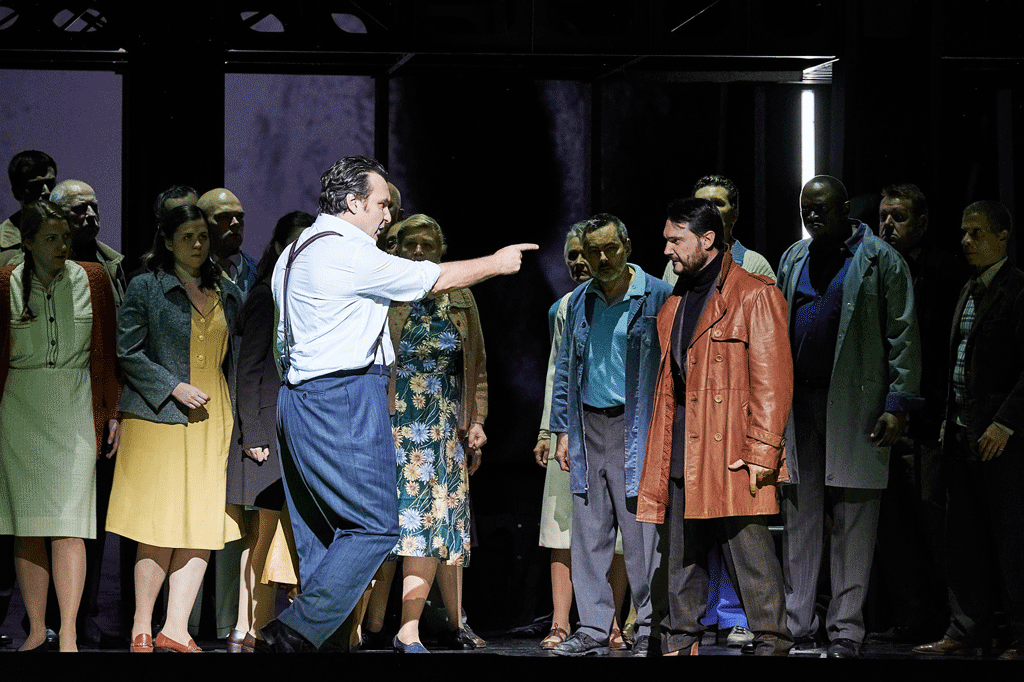
Il restera à parler du plateau vocal qui – là encore – vient répondre à l'excellence des Cappuccilli , Freni, Ghiaurov… par des qualités intrinsèques certes différentes mais d'un niveau absolument irréprochable. Honneur à Amelia, unique dame de cet opéra d'hommes : Maria Agresta donne au rôle une assurance et une maturité qui font fi de la fragilité des voix de sopranos qu'on y entend la plupart du temps. Chanté avec une ampleur de souffle et une projection généreuse, Come in quest'ora bruna se tire des changements de registres avec brio. La suite pèche par la rectitude des lignes (Nell'ora soave) et le peu de variété dans les couleurs. Francesco Demuro campe un Gabriele Adorno à l'émission corsetée mais puissante (O Inferno!… Sento avvampar nell'anima). On est davantage séduit par la veulerie et la fièvre du Paolo de Nicola Alaimo et la véhémence de Mikhail Timoshenko en Pietro. Des lauriers également pour la basse Mika Kares qui sait ne pas exagérer la noirceur de son Fiesco sans céder, comme dans la scène du pardon, à l'expressivité du caractère. Cette pierre philosophale pourrait bien faire de lui un futur Roi Marke de grand talent.

"Je suis maître de moi comme de l'univers" semble nous dire le Boccanegra – Cinna de Ludovic Tézier dans son Plebe, patrizi, popolo. Le chant n'oublie jamais le mot parlé, prononcé, au point que la palette vocale semble tout entière au service d'une incarnation psychologique qui traduit la complexité et les paradoxes du personnage. On admire cette probité de la projection et ce timbre vrai qui jamais ne cherche à forcer ses moyens pour imposer un discours dont les contours et le message tient de la morale hugolienne dans Les Contemplations((http://www.biblisem.net/meditat/hugobouc.htm))
Il fallait à cette soirée une direction musicale capable de rivaliser avec les ambitions du théâtre et les moyens du plateau. Fabio Luisi connaît de toute évidence les écueils sur lesquels se sont fracassés tant de Simon Boccanegra. Sa battue tient la bride haute à la tentation d'animer hors de propos un drame qui demeure pour l'essentiel non spectaculaire et introverti. On sort pourtant moins impressionné que lors de son Falstaff, donné ici même la saison dernière. La faute à une vision qui subit le plateau plus qu'elle ne l'anime et une façon d'imposer une respiration assez rectiligne aux bois et cordes de l'orchestre de l'Opéra de Paris. Trop sage sans doute pour peindre une marine qui exige une palette et des contrastes expressifs plus véhéments.