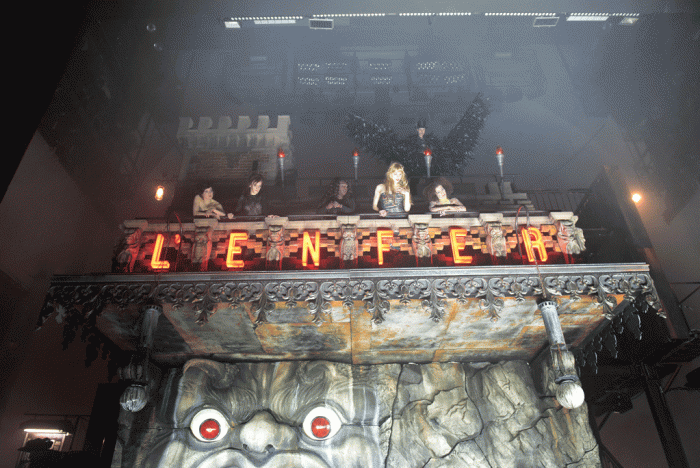 Que connaît-on du Faust de Goethe ? L’histoire du pacte avec le diable et celle de Marguerite, c’est à dire le premier Faust, mais tout le reste, foisonnant, désordonné, philosophique, lyrique est peu connu du public non germanophone. L’ensemble des milliers de vers (un peu plus de 12000 vers) a été mis en scène par Peter Stein en 2000 à Hanovre dans un hangar, et la représentation durait 21h, avec ses entractes, ses déplacements du public, tantôt dans le spectacle, tantôt devant, tantôt autour (le spectacle a été repris à Berlin, puis Vienne) dont on a gardé une captation. Plus récemment à Berlin même ce fut le tour de Robert Wilson, au Berliner Ensemble qui en fit une fresque musicale. Giorgio Strehler en son temps avait voulu en faire le couronnement de sa carrière, son grand œuvre qu’il n’acheva jamais au Piccolo Teatro, mais de nombreux metteurs en scènes se sont attaqués au monument. L’œuvre est tellement plurielle, étourdissante, verbeuse quelquefois aussi, avec un texte étonnant, effervescent, qui sonne, qui gueule, qui joue sur les mots, qui s’amuse et qui bout, que Castorf lui-même souligne que dans une œuvre où il y a tout, on peut tout faire.
Que connaît-on du Faust de Goethe ? L’histoire du pacte avec le diable et celle de Marguerite, c’est à dire le premier Faust, mais tout le reste, foisonnant, désordonné, philosophique, lyrique est peu connu du public non germanophone. L’ensemble des milliers de vers (un peu plus de 12000 vers) a été mis en scène par Peter Stein en 2000 à Hanovre dans un hangar, et la représentation durait 21h, avec ses entractes, ses déplacements du public, tantôt dans le spectacle, tantôt devant, tantôt autour (le spectacle a été repris à Berlin, puis Vienne) dont on a gardé une captation. Plus récemment à Berlin même ce fut le tour de Robert Wilson, au Berliner Ensemble qui en fit une fresque musicale. Giorgio Strehler en son temps avait voulu en faire le couronnement de sa carrière, son grand œuvre qu’il n’acheva jamais au Piccolo Teatro, mais de nombreux metteurs en scènes se sont attaqués au monument. L’œuvre est tellement plurielle, étourdissante, verbeuse quelquefois aussi, avec un texte étonnant, effervescent, qui sonne, qui gueule, qui joue sur les mots, qui s’amuse et qui bout, que Castorf lui-même souligne que dans une œuvre où il y a tout, on peut tout faire.
C’est un défi : Castorf ne propose pas l’intégralité du texte, mais la représentation dure sept heures. Comme toujours chez lui, c’est un important travail intertextuel qui est mené, un travail d’autocitation, parsemé de traces d’autres spectacles, à commencer par sa mise en scène du Faust de Gounod (la représentation est parsemée d’extraits sonores de Gounod) à Stuttgart l’automne dernier à laquelle cette production est liée par des échos précis.
Mais comme toujours chez Castorf, l’intertextualité et l’autocitation sont dépassées par la force intrinsèque du spectacle, le spectateur « novice » y trouve son compte, tout comme le spectateur castorfien averti.
Pour rentrer dans le spectacle, il faut une totale disponibilité pour être enlevé et bousculé, et emporté sans distance, pour se laisser porter par le show, car c’en est un, chansons, musiques, films, vidéos se succèdent avec des moments sublimes de poésie, des trous noirs faits de discussions interminables qui découragent certains spectateurs (notamment en début de seconde partie), des scènes impressionnantes à la vidéo dans des espaces d’un incroyable réalisme (reconstitution d’un wagon de métro parisien des années 60– les anciennes et historiques rames Sprague – et de la station Stalingrad) dans un coin déserté – mais aisément trouvable au spectateur fouineur – du foyer du théâtre.
Et c’est un spectacle, comme le Faust de Stuttgart, qui laisse un espace tout particulier à la culture littéraire ‑extraits de Zola (Nana)- et l'histoire française notamment des années cinquante ou soixante, chansons françaises (« Ne me quitte pas » notamment), images de la guerre d’Algérie, images de Paris, la bouche de métro « Stalingrad » (comme à Stuttgart),
 le cabaret « L’Enfer », dont la façade du 53 bd de Clichy (aujourd’hui un Monoprix…) est reproduite à l’identique, éléments d’un décor hétéroclite où l’on découvre espaces imbriqués et empilés, boutiques de frusques, chambres étouffantes, lits gigogne de caserne, comptoir de cabaret, terrasses, le tout disposé comme souvent sur une tournette (sauf la station de métro, extérieure à la scène), comme à l’Odéon pour La Dame aux Camélias comme à Bayreuth ou comme à Stuttgart, parce qu’Aleksandar Denić conçoit un décor à la fois théâtral et cinématographique, extérieur et intérieur, dont les angles de vues vont être multipliés par la vidéo comme d’habitude aux mains de Andreas Deinert et Mathias Klütz qui, loin d’être des techniciens, sont des acteurs du spectacle, essentiels pour lui donner son rythme et sa respiration, avec le montage de Jens Crull et Maryvonne Riedelsheimer.
le cabaret « L’Enfer », dont la façade du 53 bd de Clichy (aujourd’hui un Monoprix…) est reproduite à l’identique, éléments d’un décor hétéroclite où l’on découvre espaces imbriqués et empilés, boutiques de frusques, chambres étouffantes, lits gigogne de caserne, comptoir de cabaret, terrasses, le tout disposé comme souvent sur une tournette (sauf la station de métro, extérieure à la scène), comme à l’Odéon pour La Dame aux Camélias comme à Bayreuth ou comme à Stuttgart, parce qu’Aleksandar Denić conçoit un décor à la fois théâtral et cinématographique, extérieur et intérieur, dont les angles de vues vont être multipliés par la vidéo comme d’habitude aux mains de Andreas Deinert et Mathias Klütz qui, loin d’être des techniciens, sont des acteurs du spectacle, essentiels pour lui donner son rythme et sa respiration, avec le montage de Jens Crull et Maryvonne Riedelsheimer.
Ainsi donc la lecture de Castorf est-elle, comme souvent une lecture du mythe éclairée par l’état du monde, ou mieux, une recherche dans le monde d’aujourd’hui des traces du mythe : le mythe de Faust est structuré par le choix d’un homme en fin de vie, constatant son échec, qui va choisir l’égoïsme et la jouissance. Méphisto qui en est le guide est celui qui a façonné le monde comme un espace où toute utopie a disparu au profit de la loi du plus fort, notamment dans le cadre d’une horreur économique : loi du plus fort = loi du marché= loi de la jungle, telle est l’équation effrayante de la situation du monde d’aujourd’hui, où il n’y a plus d’utopie et où il ne reste que nostalgie.
Or Castorf voit la France, et notamment Paris, comme le dernier espace d’une nostalgie érigée comme source de poésie et d’humanité, mais aussi d’un lieu d’une persistance d’un éternel féminin qui s’oppose à un masculin transitoire, d’où une mise en scène dans la mise en scène où le groupe des hommes s’oppose au groupe des femmes, où apparaît la Nana de Zola, la Marguerite de Faust comme putain sublime ou respectueuse, mais aussi les femmes opprimées victimes  (puissante scène de Valentin vu comme le frère abusif (arabe) qui maudit la sœur qui a osé forniquer avec l’ennemi). Castorf fait en effet de la guerre d’Algérie un symbole universel de colonisation, sans espace pour les identités, une colonisation qui loin d’être un mouvement humaniste d’accès à une « civilisation » n’est que l’exemple symbolique de la loi du plus fort dont il était question plus haut. D’ailleurs, il cite le psychanalyste Frantz Fanon, qui a écrit sur les conséquences psychologiques de la colonisation sur les colonisés et les colonisateurs (Sartre a écrit une préface célèbre à son livre « Les damnés de la terre » en 1961). La colonisation comme exemple du travail de Mephisto, pour imposer la domination de l’économie, mais aussi celle des êtres et notamment des femmes (il y a dans l’équipe des actrices noires magnifiques), l’histoire de Marguerite devenant un emblème de l’esclavage féminin au service de l’homme (d’où l’insistance sur Nana). C’est tout cet espace de recherche sur notre monde et ses manifestations les plus brutales que Castorf lit dans l’ensemble du Faust, et notamment dans sa recherche d ‘un éternel féminin (Marguerite=Hélène) et de la déchéance progressive d’un Faust qui retrouve la désespérance initiale et sombre dans l’alcool (Prodigieux Martin Wuttke à la diction de plus en plus pâteuse).
(puissante scène de Valentin vu comme le frère abusif (arabe) qui maudit la sœur qui a osé forniquer avec l’ennemi). Castorf fait en effet de la guerre d’Algérie un symbole universel de colonisation, sans espace pour les identités, une colonisation qui loin d’être un mouvement humaniste d’accès à une « civilisation » n’est que l’exemple symbolique de la loi du plus fort dont il était question plus haut. D’ailleurs, il cite le psychanalyste Frantz Fanon, qui a écrit sur les conséquences psychologiques de la colonisation sur les colonisés et les colonisateurs (Sartre a écrit une préface célèbre à son livre « Les damnés de la terre » en 1961). La colonisation comme exemple du travail de Mephisto, pour imposer la domination de l’économie, mais aussi celle des êtres et notamment des femmes (il y a dans l’équipe des actrices noires magnifiques), l’histoire de Marguerite devenant un emblème de l’esclavage féminin au service de l’homme (d’où l’insistance sur Nana). C’est tout cet espace de recherche sur notre monde et ses manifestations les plus brutales que Castorf lit dans l’ensemble du Faust, et notamment dans sa recherche d ‘un éternel féminin (Marguerite=Hélène) et de la déchéance progressive d’un Faust qui retrouve la désespérance initiale et sombre dans l’alcool (Prodigieux Martin Wuttke à la diction de plus en plus pâteuse).
Pour accéder à cette universalité d’un monde perdu, tous les langages sont interpelés, et d'abord les langues : on entend de l’allemand, du français, du portugais, mais aussi les langages musicaux, le rap, le Lied (merveilleuse interprétation de Der Leiermann, extrait du voyage d’hiver de Schubert, à l’accordéon avec la voix de Kathrin Angerer (habituellement Sophie Rois)), la chanson dans tous ses états, avec « Ne me quitte pas » en allemand, mais aussi des allusions au musical américain (fulgurant numéro de claquettes par Alexander Scheer), mais aussi la parodie et l’auto dérision : Alexander Scheer (étourdissant) prend l’accent belge pour imiter le rythme du discours de Dercon, le successeur de Castorf. L’effort de Castorf est de proposer la vision d’une totalité, vue de dedans, de dehors, à l’écran, au théâtre, dans une multiplicité de points de vue et de cadres pour rendre compte visuellement du foisonnement et des possibles multiples du Faust de Goethe : qu’est-ce que Faust, sinon cette folie sisyphéenne et prométhéenne d’une reconquête égoïste dans un monde où plus rien n’est régi par le bon, et qui est par l’économie et la loi du plus fort, régi par le mal (Mephisto). Dans un tel monde, tout est sérieux et rien n’est sérieux, tout est horrible et tout est farce, tout est important et tout est dérisoire, ou dérision.
Une mise en scène de Frank Castorf est comparable à un tableau contemporain dont la lecture est ouverte, où les perspectives et les linéarités sont explosées, où il y a une ligne générale mais illustrée de manière omnidirectionnelle. Inutile de chercher à comprendre dans l’instant, il y a des choses immédiates et d’autres qui exigent un retour, une réflexion, un approfondissement ,comme le travail sur un tableau après le premier regard nécessite un retour fouillé. Le travail théâtral de Castorf est un travail intellectuel, fruit de recherches multipolaires, qui cherche des sources dans la littérature, l’iconographie, la filmographie, qui propose un regard « hyperthéâtral » au sens d’hypertextuel, fruit aussi d’une composition qui n’a rien de hasardeux, ce que certains spectateurs prennent pour « n’importe quoi » (on l’avait vu à l’Odéon avec une Dame aux Camélias reçue par un public indisponible et fossile) est au contraire très construit et d’une très grande exigence pour les acteurs, pour le metteur en scène, et aussi pour le spectateur, toujours pris pour un être pensant et actif, et jamais comme un récepteur passif. Sans doute cette exigence intellectuelle profonde n’est-elle pas en phase avec un monde zappeur et surfeur, et en rendre compte dans le détail est impossible dans les détails sont multiples, cachés, évidents, cryptiques : on découvre des affiches de vieux films (comme les séries Z du Ring de Bayreuth) inquiétants ou fantastiques,  Les yeux sans visage de Georges Franju (1960) ou La main du Diable
Les yeux sans visage de Georges Franju (1960) ou La main du Diable  de Maurice Tourneur (1942), certaines à peine visibles du spectateur, on découvre aussi les inscriptions sur les murs, L’EST qui rappelle l’orgueilleux OST qui domine le toit de la Volksbühne, l’œil se promène ainsi dans cet ensemble de signes multiples, semés pour dessiner un récit qui n’est que lieu sémiologique que le spectateur déchiffre ou non, comprend ou non.
de Maurice Tourneur (1942), certaines à peine visibles du spectateur, on découvre aussi les inscriptions sur les murs, L’EST qui rappelle l’orgueilleux OST qui domine le toit de la Volksbühne, l’œil se promène ainsi dans cet ensemble de signes multiples, semés pour dessiner un récit qui n’est que lieu sémiologique que le spectateur déchiffre ou non, comprend ou non.

Il importe d’ailleurs peu de tout comprendre, et notamment rechercher une linéarité. Ce théâtre n’a rien de classique au sens où il proposerait une seule vision claire et ordonnée, mais l’entreprise de Goethe non plus, qui est entreprise de théâtre impossible parce que fresque d’un regard global sur le monde à travers ses mythologies. En ce sens, le travail de Castorf est une grande nuit de Walpurgis, un vaste Sabbat où l’on boit le liquide dans lequel un fœtus est conservé, où s’exhibent les corps, où l’on joue avec de long pénis qui se balancent, où l’on prend un demi de bière sur la tête, où l’on parle à un caniche noir dans un des monologues les plus forts de la soirée (Martin Wuttke) où l’on marche à l’aide de barils de pétrole comme avec des échasses (Méphisto, Marc Hosemann), ou sur eux en les faisant rouler comme un objet de cirque (le baril de pétrole, signe fort de l’horreur économique que Castorf raconte dans le Ring de Bayreuth) et qui traîne ici et là comme dans le décor du Faust de Stuttgart.
Alors au service de cette entreprise sur l’infini théâtral et l’horreur dérisoire du monde, une troupe proprement hallucinante, presque infernale parce qu’au-delà de la performance de ces sept heures déchaînées, il y a quelque chose d’une beauté diabolique dans ce travail proprement inouï, qui tient de la revue berlinoise, du film américain, de la tragédie, du film de guerre (la préparation de l' attentat du milk bar d'Alger en 1956), du thriller, du pur théâtre quand on entend s’élever les vers de Goethe, reconnaissables entre tous, parce que vers, parce que jeux de langages et jeux sonores, parce que flux ininterrompu et dantesque.
 Alors bien sûr la distribution est un défilé de stars du théâtre qui accompagnent Castorf. Martin Wuttke, la vedette, qui est lié au parcours de Castorf et à tout le théâtre brechtien (c’est aussi le grand Arturo Ui de référence) , mais aussi protagoniste d’un célèbre feuilleton TV « Tatort », le commissaire Andreas Keppler, célèbre dans toute l’Allemagne, qui joue ce Faust chenu muni d’un masque souple qui n’est pas sans rappeler l’acteur mythique Bernhard Minetti, en vieillard lubrique fasciné par la « putain respectueuse » Marguerite (Valery Tscheplanowa) qui sera plus tard Hélène, comme un éternel féminin glorifié par les costumes de revue composés par Adriana Braga ; ce masque, il l’enlève pour être non un Faust « jeune », mais mur et déjà marqué par le monde et les blessures, sparadrap au coin de l’œil, un Faust amer qui de temps en temps remet le masque de vieillard ou qui va aussi retomber en enfance à la fin, avec son petit tricycle jouant avec deux mini-drapeaux algériens avant de prononcer sa dernière parole « nous sommes immortels » (en français dans le texte), son compère Méphisto est Marc Hosemann, plus jeune, plus virevoltant, frère du Méphisto du Faust de Stuttgart, portant aussi à un moment des chaps de cowboy en fourrure
Alors bien sûr la distribution est un défilé de stars du théâtre qui accompagnent Castorf. Martin Wuttke, la vedette, qui est lié au parcours de Castorf et à tout le théâtre brechtien (c’est aussi le grand Arturo Ui de référence) , mais aussi protagoniste d’un célèbre feuilleton TV « Tatort », le commissaire Andreas Keppler, célèbre dans toute l’Allemagne, qui joue ce Faust chenu muni d’un masque souple qui n’est pas sans rappeler l’acteur mythique Bernhard Minetti, en vieillard lubrique fasciné par la « putain respectueuse » Marguerite (Valery Tscheplanowa) qui sera plus tard Hélène, comme un éternel féminin glorifié par les costumes de revue composés par Adriana Braga ; ce masque, il l’enlève pour être non un Faust « jeune », mais mur et déjà marqué par le monde et les blessures, sparadrap au coin de l’œil, un Faust amer qui de temps en temps remet le masque de vieillard ou qui va aussi retomber en enfance à la fin, avec son petit tricycle jouant avec deux mini-drapeaux algériens avant de prononcer sa dernière parole « nous sommes immortels » (en français dans le texte), son compère Méphisto est Marc Hosemann, plus jeune, plus virevoltant, frère du Méphisto du Faust de Stuttgart, portant aussi à un moment des chaps de cowboy en fourrure  « wooly chaps », un Mephisto gardien du troupeau humain ( l’inverse du bon pasteur) léger et cynique, survolant le monde comme une aire de jeu, à leur côté Byron (George Sand mettait en parallèle Goethe et Byron, l’un pour Faust, l’autre pour Manfred) parce que Byron avait un échange avec Goethe, mais aussi sans doute par la guerre de libération de la Grèce colonisée par les turcs, un Byron joué par Alexander Scheer proprement hallucinant, qui est aussi Anaxagoras (rappelons dans le Faust II le débat Anaxagore/Thalès sur l’eau et le feu) : on se souviendra de son monologue époustouflant d’un Byron/Manfred suicidaire, et Wagner (avec un jeu sur le Wagner du Faust et Richard Wagner – extrait musical compris) joué par le remarquable Lars Rudolph aux incroyables mimiques , sorte de double de Scheer pendant toute la première partie. Les femmes, Lilith Stangenberg, Hanna Hilsdorf, Kathrin Angerer qui chante Der Leiermann (remplaçant Sophie Rois) le Lied conclusif du Winterreise, accompagnée à l’accordéon par Sir Henry, dans un de ces moments suspendus incroyables de poésie, mais aussi les acteurs issues des mondes ex-colonisés ou colonisateurs, Thelma Buabeng (Ghana) et Angela Guerreiro (Portugal), sans oublier Abdoul Kader Traoré (Burkina Faso)en rappeur du métro (Baron Samedi & Monsieur Rap rencontrent Aimé Césaire). Tous les niveaux se croisent en un paradigme castorfien qui n’a rien d’un hasard,
« wooly chaps », un Mephisto gardien du troupeau humain ( l’inverse du bon pasteur) léger et cynique, survolant le monde comme une aire de jeu, à leur côté Byron (George Sand mettait en parallèle Goethe et Byron, l’un pour Faust, l’autre pour Manfred) parce que Byron avait un échange avec Goethe, mais aussi sans doute par la guerre de libération de la Grèce colonisée par les turcs, un Byron joué par Alexander Scheer proprement hallucinant, qui est aussi Anaxagoras (rappelons dans le Faust II le débat Anaxagore/Thalès sur l’eau et le feu) : on se souviendra de son monologue époustouflant d’un Byron/Manfred suicidaire, et Wagner (avec un jeu sur le Wagner du Faust et Richard Wagner – extrait musical compris) joué par le remarquable Lars Rudolph aux incroyables mimiques , sorte de double de Scheer pendant toute la première partie. Les femmes, Lilith Stangenberg, Hanna Hilsdorf, Kathrin Angerer qui chante Der Leiermann (remplaçant Sophie Rois) le Lied conclusif du Winterreise, accompagnée à l’accordéon par Sir Henry, dans un de ces moments suspendus incroyables de poésie, mais aussi les acteurs issues des mondes ex-colonisés ou colonisateurs, Thelma Buabeng (Ghana) et Angela Guerreiro (Portugal), sans oublier Abdoul Kader Traoré (Burkina Faso)en rappeur du métro (Baron Samedi & Monsieur Rap rencontrent Aimé Césaire). Tous les niveaux se croisent en un paradigme castorfien qui n’a rien d’un hasard,
– d’un côté Goethe et sa vision de l’organisation/désorganisation d’un monde façonné par Méphisto,
– de l’autre Nana de Zola avec cette longue très longue scène d’un dialogue des prostituées – autres damnées de la terre- à la limite du supportable (les spectateurs les moins résistants sortent)
– enfin Frantz Fanon (sur le colonialisme) : la raison du plus fort… Il faudrait au moins un petit livre pour retisser les fils d’une histoire qui est histoire et spectacle, mais aussi autofiction et spectacle (on a vu comment Castorf se cite, mais cite aussi indirectement ou directement son histoire) et qui est revue, une revue berlinoise (il y a un moment très fort où les acteurs crient « Nach Berlin ! ») folle et construite d’un petit monde, du tout petit monde de la Volskbühne, du grand monde Faustien, du monde encore plus grand qui nous entoure, le tout imbriqué, tissé, traversé par ce concentré de mondes qu’est le décor d’Aleksandar Denic.
Fascination, admiration, étonnement devant ce spectacle tonneau des Danaïdes, inépuisable.

