
« Mais réfléchissez, réfléchissez, vous êtes sur terre, c'est sans remède ! » s’exclame Hamm dans Fin de Partie. Ce fatalisme insistant résonne encore à nos oreilles quand on quitte la patinoire et que la nuit est désormais tombée sur la cité des Papes. Pourquoi Beckett ? Parce qu’il y a une résurgence évidente de sa pensée dans le théâtre de Copi. Parce qu’on retrouve le même désespoir riant. Et le Munstrum Théâtre en fait l’éclatante preuve avec 40° sous zéro.
L’atmosphère embrumée de la salle installe dans un climat particulier annonciateur d’une bascule dans le domaine de l’étrange. La pénombre ne laisse rien deviner du plateau, les gradins étant la seule partie de la salle faiblement éclairée. Un bruit sourd. Noir. Une créature aux contours surnaturels dans la pénombre se trouve en contrebas du public. Légèrement surélevée, arborant une longue tunique et une coiffe imposante, elle chante. Girls just want to have fun, le titre rendu célèbre par Cindy Lauper au début des années 80 est ici réorchestré mais n’en reste pas moins reconnaissable. Les gestes sont féminins, la voix masculine. Inattendu et captivant. Les paroles clairement féministes font se rejoindre les combats d’hier avec ceux d’aujourd’hui. Nous voici plongés dans un réel instantanément disqualifié et atomisé par cette apparition d’une autre dimension (François Praud à la voix renversante). Sans visage – entre le masque et le jeu des lumières déjà finement composé. Sans sexe. Sans identité. Un être issu d’une dimension possiblement attenante au théâtre de Copi qui surgit alors brusquement.
Lumières. Un lieu sans âme, sans âge. La toile du fond de scène semble marquée par le gel – d’emblée le titre fait sens. Une table, des chaises, un plan de travail, à jardin. Entre un personnage couvert de multiples parkas – Christian Lacroix a travaillé à partir de plusieurs influences pour confectionner des costumes tout à fait étonnants. Madre se défait de la superposition de manteaux d’hiver qu’elle porte, laissant tomber chacun d’eux avec de fines particules qui s’en échappent. Comme la neige d’un ailleurs fantastique. Elle a pris soin de suspendre à un croc de boucher la dépouille d’un animal velu non-identifiable, gibier probablement tué au cours d’une chasse dont elle rentre. Elle grogne. Une autre créature sous un imposant patchwork bariolé entre alors et vient s’installer à la table, non sans se cogner. L’hilarité gagne les rangs des spectateurs, hypnotisés et tendus vers ces personnages extraordinaires brouillant tous les repères. On reconnaît ici l’esthétique développée par le Munstrum Théâtre.
Le dialogue s’engage. Madre veut savoir pourquoi Irina – la créature dissimulée sous sa toile multicolore – a arrêté ses cours de piano. « Je me promène » répond-elle sur-le-champ. « Par quarante degré sous zéro ? ». Indignation saugrenue de Madre. Les voix sont masculines, les corps évoluent dans des mouvements évoquant la féminité. Des êtres toujours sans sexe, sans visage particulier car tous masqués, vidés de toute histoire, de toute personnalité. Enveloppes absurdes et violentes à l’exemple de leurs gestes, de leurs paroles : Madre écorche le gibier rapporté, jette quelques morceaux de ses entrailles à un animal de compagnie court sur pattes et à poils très longs au point de dissimuler sa gueule qui traverse régulièrement le plateau. Pas de repères, disait-on. Un refus catégorique de tout réalisme au profit d’un univers fantaisiste et effrayant à la fois, outrancièrement théâtral, outrageusement expressif et factice.

Irina semble étrangère à toute forme de désir. Son sexe et ses transformations ont mutilé son intériorité en profondeur, laissant une béance. Madre et Madame Garbo – personnage faisant autant penser à une lady Gaga en héroïne d’Hitchcock qu’à un oiseau de mauvaise augure dans son imposante tenue toute noire – vont se la disputer, allant presque jusqu’à l’écarteler, elle rendue somme toute indifférente à leur combat brutal pour la posséder. On reste par exemple, stupéfait devant ce coït aussi loufoque que dérangeant, que lui impose Madame Garbo l’ayant entourée dans du ruban adhésif, serrée contre elle. Avec Madre, elles multiplient les poursuites pour la laver de ses excréments – dont Irina finira par se recouvrir non sans y ajouter une pluie de paillettes par-dessus. Elles sortent de scène, y reviennent irrémédiablement – l’enfermement est dès lors prégnant. Elles tombent, subissant les effets d’un étrange breuvage à base de mirabelles contenu dans un jerrican, elles se relèvent et repartent. Hystériques, elles hurlent, vocifèrent trivialités, injures et non-sens en tous genres. Beckett n’est jamais loin et le théâtre de Feydeau non plus comme l’indique Louis Arène à juste titre. Jusque dans l’entrée futuriste et pleine de bizarrerie de Garbenko et du général Pouchkine.
À bout de souffle avec les comédiens très engagés, on est submergé par le grotesque adossé au tragique dominant. On rit tout en mesurant gravement ce vide – une véritable « figure esthétique » dans ce « théâtre sans but » pour reprendre les mots du metteur en scène – tout en percevant la désolation sous-jacente devant le réel rejeté car inacceptable dans ces composantes. On rit même si on ressent – partage ? – cette difficulté d’être au monde. On ressent le froid glacial du titre. Le théâtre de Copi est métaphysique et le Munstrum Théâtre n’évacue absolument pas cela dans un trop grand raffinement d’effets visuels. Bien au contraire, la dramaturgie souligne ici avec justesse cette poétique de la lutte et du désenchantement – même s’il ne s’agit plus de revendiquer l’homosexualité dans la société française des années 70.
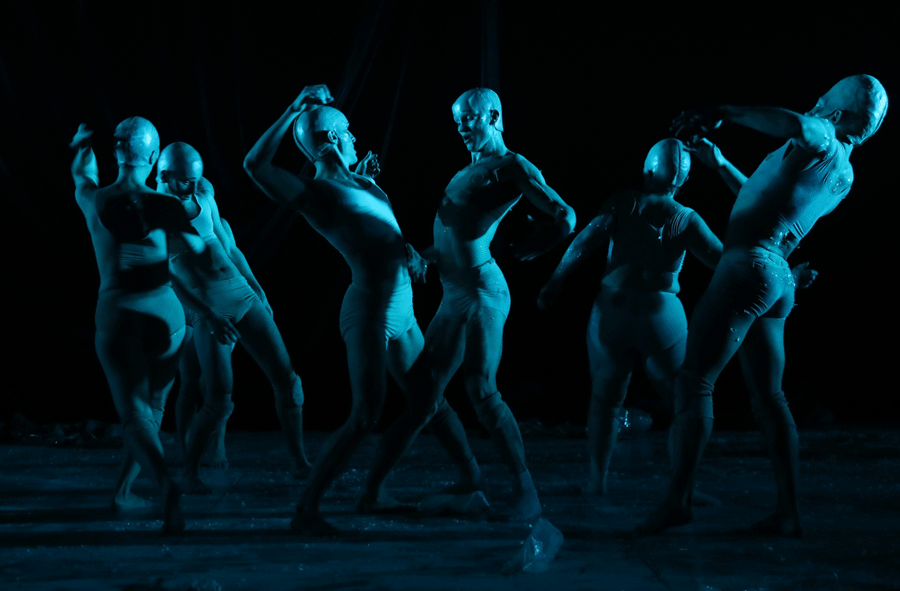
Changement de décor à vue et s’élève une version hardcore du Paradis blanc de Michel Berger, sous une lumière stroboscopique verte pour un moment de cabaret digne d’un film de science-fiction. Les Quatre Jumelles débutent ainsi, dans la continuité. Les personnages sont tout aussi indistincts que les précédents quant à leur sexe – hommes et femmes jouant les deux duos de sœurs – quant à leur épaisseur psychologique. La seule épaisseur est finalement celle des faux seins et fausses fesses que portent les comédiens sous les costumes toujours aussi baroques, toujours aussi réussis mais qui, une fois retirés, laissent voir en pleine lumière la fausseté de l’enveloppe. Dans des situations tout aussi absurdes que dans la première pièce, les sœurs vont se droguer, se tuer – « Où est la morphine ? Je vais me foutre une overdose ! » – vont être tuées et parce que c’est du théâtre, parce que tout est faux, elles vont revenir à la vie. L’hystérie toujours. Le froid glacial toujours aussi. Le délabrement du décor – le rideau de fond de scène instable finit par tomber – permet une brèche, une ouverture salvatrice vers le fond de la patinoire, révélant le cadre de scène. Mais là encore, c’est une fausse piste pour une échappatoire. Les sœurs reviennent inévitablement au plateau pour y mourir à tour de rôle et revenir à la vie. Encore et encore. Dans une sorte d’éternel recommencement.
Les monstres vont pourtant finir par se libérer de tous les éléments qui les dissimulaient en les enveloppant. Les corps vont entamer une danse frénétique, vont s’enlacer, se mêler dans un ballet final. Celui de la victoire sur l’abîme.
Avec cette création adroitement pensée, à la dimension plastique très soignée, Louis Arène et tous les comédiens du Munstrum Théâtre ouvrent une voie. Celle d’un théâtre libérateur, jubilatoire et qui permet de supporter le pire. Autrement dit, le monde comme il est, comme il va – et il va souvent mal. Parce que nous sommes sur terre – et c’est bien sans remède. Parce que nous sommes finalement tous des monstres en quête d’une humanité joyeuse et apaisée.

