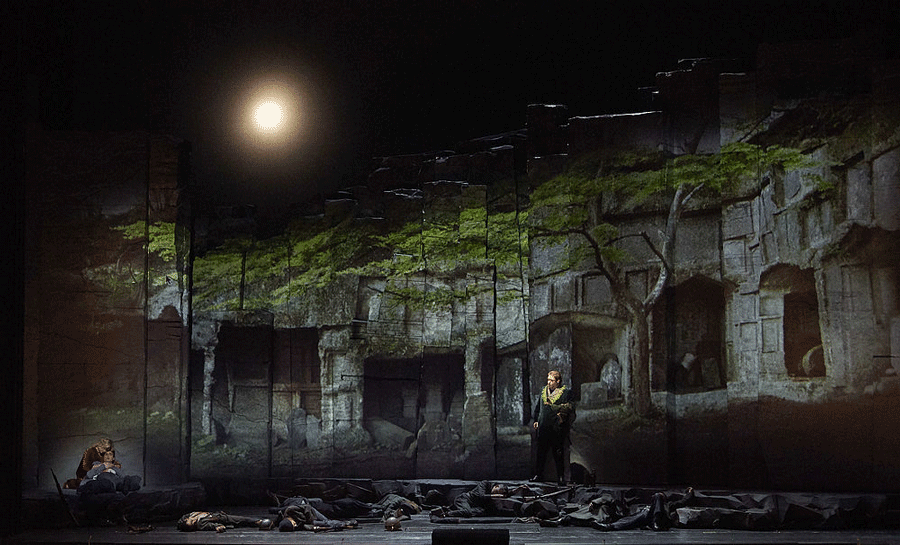La précédente production signée Robert Carsen aura tenu une vingtaine d’années, soit exactement 28 représentations, un chiffre très moyen pour cette maison dont la production historique de Tosca en compte 612, mais Die Frau ohne Schatten n’est pas Tosca. Étrange destin en ces cinquante dernières années que celui de ce titre de Strauss, plutôt rare hors de Vienne ou Munich avant les années 90 et qui aujourd’hui fait courir les foules. Une fois de plus se vérifient les effets de mode. Considérez qu’à la Scala la production de Die Frau ohne Schatten de Ponnelle et Sawallisch en 1986 était la création de l’œuvre dans ce théâtre et qu’à l’Opéra de Paris l’entrée au répertoire a eu lieu en 1972 avec reprise en 1980, et une nouvelle production (Robert Wilson) en 2002 reprise en 2008. Soit quatre saisons en 47 ans…
La production de Vincent Huguet ne restera pas a priori dans les mémoires, mais elle est si insipide qu’elle pourrait parfaitement rester longtemps au répertoire : pas de complexité pour les reprises parce que la direction d’acteurs en est minimaliste, un décor rocheux de Aurélie Maestre référencé plutôt dans l’avant-guerre (il aurait pu être signé Emil Preetorius), même si on pense par le style à certains décors de Richard Peduzzi (sans doute pour faire Chéreau…) et un décor initial orientalisant qui quant à lui ferait plutôt penser (de très loin) à la production parisienne de 1972, reprise en 1980 de Nikolaus Lehnhoff…considérations inactuelles…à moins que ce ne soit un simple échantillon de la misère de l’école française de mise en scène d’opéra aujourd’hui.
Il est vrai que l’œuvre n’est pas évidente à mettre en scène, seuls récemment un Warlikowski ou un Guth ont su traduire, avec d’ailleurs des idées voisines, la profondeur du livret. Huguet a choisi l’illustration.
Le livret est suivi attentivement en version conte de fées assez noir : le décor rocheux à quelque chose de l’entrée des enfers, on pense à l’entrée de la gorge de la nécropole de Petra, mais sans jamais faire rêver, sans jamais nourrir l’imaginaire, avec quelques allusions à l’époque de création (première guerre mondiale) et un dernier acte est d’une rare indigence, avec ses rochers à la « sésame ouvre-toi ». Le reste ne vaut pas beaucoup mieux, avec des déplacements mal fichus, une absence de propos ou de traduction dramaturgique qui aboutit au total un spectacle déjà vieux et déjà dépassé, dont la piètre qualité ressort encore plus face à la flamboyance de l’approche musicale.
Incontestablement, Dominique Meyer dans le fameux débat de Capriccio (prima la musica o prima le parole) a choisi prima la musica. C’est le sens de la politique menée depuis qu’il est à Vienne, où il a su réunir les chefs et les chanteurs les plus grands, avec d’ailleurs une certaine diversité, sans investir trop dans des productions essentiellement pensées pour le répertoire, pilier de la maison et donc pour la durée.
Vienne n’est pas le lieu du Regietheater, ni de ses déclinaisons, ni de la modernité scénique et ne l’a jamais été depuis que j’en observe la programmation, sauf peut-être au moment de Claudio Abbado et Klaus-Helmut Drese (notamment par le cycle Tarkovski, mais aussi l’appel à des metteurs en scène comme Berghaus ou Bondy), c’est plutôt un lieu de l’enracinement d’une certaine tradition, un lieu de référence, un lieu qui s’inscrit dans une histoire ou une durée : l’archive du site de l’opéra qui relaie chaque distribution au quotidien depuis 1869, en est pour moi l’emblème. Le public répond par un remplissage exceptionnel de la salle qui atteint presque les 100%.
Ainsi face à cette production, on peut affirmer sans crainte que nous sommes dans prima la musica. Et même vu la qualité du résultat, primissima la musica.
Christian Thielemann avait déjà offert en 2011 une mémorable interprétation du chef d’œuvre de Strauss au Festival de Salzbourg (production Christof Loy). L’effet produit aujourd’hui est encore supérieur. Je serais malhonnête en affirmant que ce type d’approche correspond toujours à mon goût, mais force est de constater que dans ce style d’interprétation nous atteignons la perfection. Thielemann soigne chaque détail, pèse chaque son, est tour à tour retenu et intime, à d’autres moments éclatant, rutilant, explosif, tout en veillant à ne jamais couvrir le plateau, ce qui dans cette œuvre est quelquefois un défi. Le son est époustouflant, avec des variations de tempo (on attendrait d’ailleurs un peu plus rapide) très théâtrales (il n’y a pas de théâtre en scène, il en faut en fosse) et un sens incroyable de la couleur et du détail et, notamment au deuxième acte, de la dynamique. Il est vrai qu’il est aidé par un orchestre de la Staatsoper extraordinaire, avec les plus grands solistes des Wiener Philharmoniker, des bois à se damner (Daniel Ottensamer, fils du regretté Ernst et frère de Andreas !) et des cordes d’une ductilité et d’une souplesse uniques. Avec un tel joyau en fosse, nous avons simplement droit à une de ces exécutions qu’on peut appeler anthologiques, qui plus est absolument complète.

Il dirige une aussi une distribution de celles qui marquent pour longtemps les mémoires. Il est rare, vu les difficultés des rôles que Die Frau ohne Schatten soit mal distribué, et surtout dans la Haus am Ring, mais une telle perfection est quand même rarement atteinte.
La troupe de l’Opéra de Vienne est importante, et peut suppléer aux malades, c’est le cas ce soir où le Geisterbote de Sebastian Holecek, un spécialiste du rôle qu’il a chanté aussi dans la production munichoise dirigée par Kirill Petrenko, est remplacé par Wolfgang Bankl, un pilier de la troupe. Sans doute moins brillant, il est néanmoins solide et assume le rôle, quelquefois légèrement couvert par l’orchestre.
Autre malade, le manchot, Ryan Speedo Green, remplacé par Markus Pelz, autre membre de la troupe. Avec ses deux collègues ils constituent un trio de frères à charge de Barak de très bon niveau, engagés dans le jeu, tout comme la voix du Faucon (Maria Nazarova) et celle du jeune homme confiée à Benjamin Bruns, un luxe. Les solistes des ensembles (notamment les voix des enfants qui ne sont pas nés) complètent le plateau. En somme, aucune faille dans cette très nombreuse distribution.

L’Empereur c’est Stephen Gould (ce sera Schager en octobre), comme toujours solide, impeccable dans le phrasé, avec son intelligence du texte et sa voix claire. Il est ce soir un peu en retrait au niveau du volume (le rôle est redoutable notamment au troisième acte), mais la prestation reste de celles qui sont sans grand reproche.

Même remarque pour Wolfgang Koch, qui par sa bonhommie, son allure en scène, sa seule présence est le Barak du moment. Il ne suffit pas de le chanter, il faut aussi être dans le personnage qui est évidemment l’anti-Empereur, l’homme du peuple, qui veut simplement vivre, dont la bonté et la disponibilité quotidiennes en font une victime potentielle. Il ne demande rien, n’a pas l’ambition chevillée au corps ou du moins elle ne lui est pas instillée comme on va l’instiller à son épouse, et ce personnage, Koch l’a fait sien, aussi bien chez Warlikowski à Munich qu’à Vienne dans la vision (?) de Vincent Huguet. C’est d’abord cela qui s’impose. Et puis il y a la voix, le sens des mots, la diction, le phrasé, l’expression quelquefois bouleversante. Koch est un de ces chanteurs (un peu irrégulier quelquefois cependant) mais qui les soirs de grâce reste irremplaçable. Et ce fut un soir de grâce ((Voilà ce que le Blog du Wanderer écrivait en 2013 sur lui à propos de son Barak munichois : « Wolfgang Koch, Barak lointain successeur de Walter Berry est ici sans doute le plus totalement adéquat des quatre protagonistes : la voix est chaleureuse, douce. Le chant est stylé, la diction impeccable et la clarté de l’émission exemplaire. Il incarne le personnage, avec un style physique un peu pataud, un peu lourdaud, mais s’il l’incarne physiquement, vocalement il diffuse une noblesse intérieure qui le rend terriblement émouvant. Une très grande réussite pour un rôle qui pourrait fort bien devenir fétiche pour lui ».)).
Du côté des Dames, trois sopranos dramatique, très différentes par la couleur vocale, comme le veut l’œuvre, on demande à l’impératrice d’être d’abord immensément lyrique avec les moyens du soprano dramatique, à la femme du teinturier d’être immensément dramatique, et à la nourrice d’être immensément expressive, en ayant une voix de mezzo dramatique à la limite du soprano. Les trois rôles sont d’ailleurs presque toujours confiés à des sopranos dramatiques à différents stades de la carrière.
Evelyn Herlitzius est la nourrice. On connaît les caractères de cette exceptionnelle chanteuse qui tient d’abord à une expressivité unique, un sens de l’incarnation rare avant des qualités vocales quelquefois problématiques. La voix, on le sait, connaît des accidents, et des fragilités. Mais voilà, quand on est une chanteuse « à tête », avec une intelligence exceptionnelle, les accidents vocaux pour certains rôles ont moins d’importance. Pour la nourrice, ce personnage ambigu et aveuglé par son dévouement à l’impératrice, ce personnage qui a des accidents de l’âme, la voix peut avoir des failles elle reste bouleversante. Herlitzius est simplement la nourrice du jour…

On se souvient qu’en 2013, Munich avait appelé Polaski, et la composition, en dépit d’une voix un peu en difficulté avait été impressionnante. Herlitzius est ici en moindre difficulté vocale, et la voix est tellement expressive, rauque quand il faut, déchirée quand il faut, avec une diction et un tel poids donné aux mots qu’on se met à genoux. Chassée dans sa barque au troisième acte, elle arrache les larmes, Prodigieux. Chapeau.
Camilla Nylund en impératrice succède à des Behrens, à des Jones, à des Rysanek pour ne citer que celles qui m’ont marqué pour la vie. Plus récemment, une Pieczonca était intéressante à Munich, plus qu’une Merbeth en tous cas.

Nylund est d’abord un « lyrico-dramatique », elle abordé les rôles wagnériens les plus lyriques comme Senta, Elsa ou Elisabeth, mais elle chante aussi régulièrement Sieglinde. Certains ont pu penser que l’impératrice était pour elle peut-être moins adéquate…Erreur…Elle y est bouleversante, notamment au troisième acte où elle atteint une intensité et une humanité rares, et elle se projette immédiatement au rang des impératrices exceptionnelles par l’incarnation. La voix est chaude, large, contrôlée, les aigus sont ouverts, magnifiquement portés et surtout homogènes, avec une ligne de chant exemplaire : c’est elle aussi une incarnation. Elle devient sans conteste l’impératrice du moment, elle y réussissait à Berlin avec la mise en scène de Claus Guth, elle est ici prodigieuse de profondeur et d’engagement vocal.
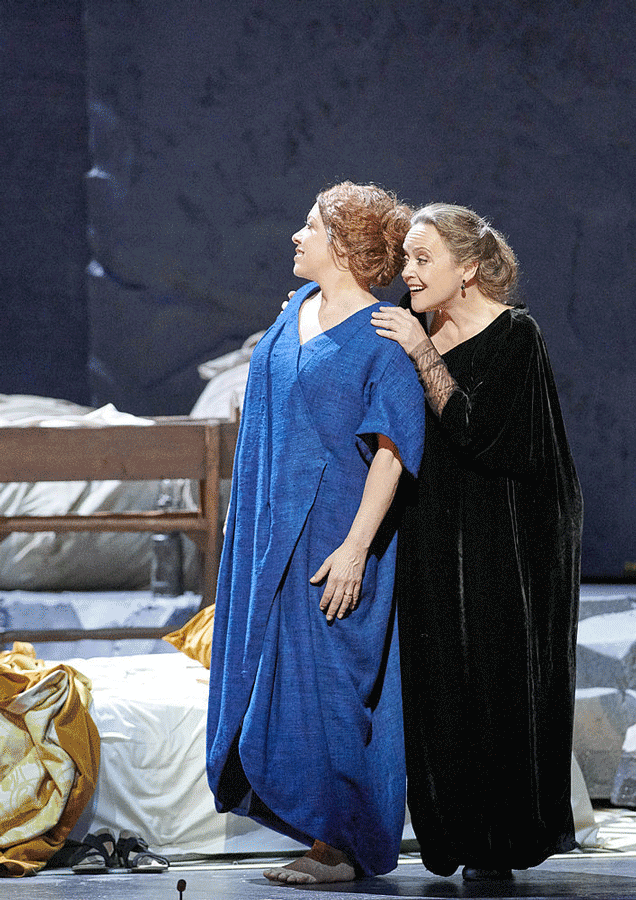
Enfin Nina Stemme. Disons sans ambages que la cantatrice suédoise est ici une légende vivante. Il faut courir l’entendre dans ce rôle de la teinturière qui lui colle immédiatement à la peau. Qui a entendu Nilsson ou Jones dans ce rôle pensait être à jour dans ses légendes…mais Stemme vient s’y ajouter sans difficulté. Elle est aujourd’hui sans rivale parce qu’elle a tout : phrasé, diction, couleur, puissance qui semble infinie, des ressources inépuisables d’énergie, et une présence scénique qui ne doit rien à la mise en scène et qui doit tout à l’adéquation de cette personnalité à ce rôle ainsi qu’à l’intelligence et à l’intuition de la chanteuse. Elle cloue sur place et c’est tout.
On a vite oublié la mise en scène, mais plateau et fosse sont littéralement inoubliables. Vienne reste la très grande maison de toujours…