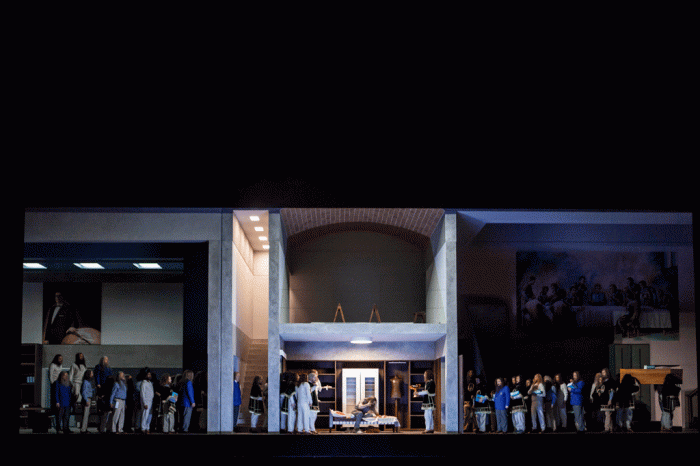
Une production de plus, une production sans plus
La précédente production, signée Krzysztof Warlikowski et créée pendant la saison 2007–2008 de l’ère Mortier n’a tenu que 7 représentations en mars 2008 : ce fut un scandale, mais comme souvent à Paris où une partie du public n’a jamais brillé par l’ouverture d’esprit. Le successeur de Mortier a aussitôt veillé à la mettre au rancard, parce que l’intelligence de ce travail devait le heurter. Lissner aurait sans doute fait un meilleur coup en proposant un remake de sa production à Warlikowski, 10 ans après que d’afficher ce travail pâle et sans grand intérêt, signé Richard Jones.
Il y a de nombreuses manières d’aborder Parsifal qui ne s’épuisent pas : il est vrai que Wagner y a mis tant de choses que l’œuvre fait la fortune des metteurs en scène. Richard Jones a choisi une opposition frontale entre le monde du Graal, une secte qui obéît aux préceptes de Titurel dans une espace scénique fortement scandé par un décor imposant et coulissant, face au monde vide (pratiquement pas de décor) d’un Klingsor généticien tout occupé à implanter dans des épis de maïs les graines qui produiront les filles fleurs dressées pour séduire. Une société face à un seul, mais qui porte quelque chose de l’Absolu du mal
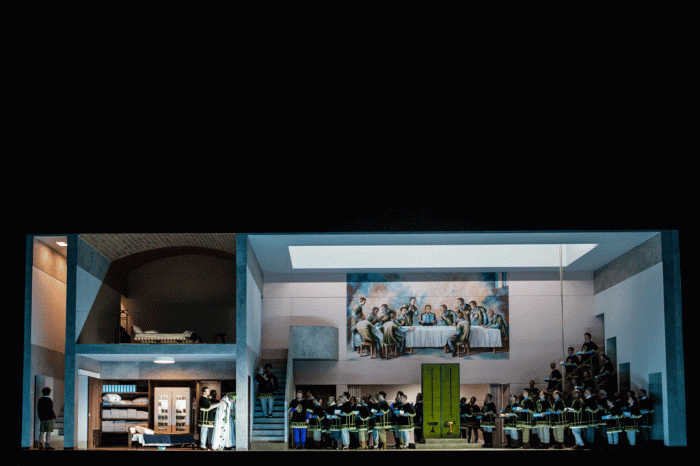
Premier acte
Le premier acte installe donc le royaume du Graal dans une communauté hiérarchisée, soumise aux diktats du livre « Wort », la Parole, de Titurel, dont un buste imposant orne le côté jardin. Et en coulissant se succèdent un réfectoire bibliothèque cuisine (végétarienne, apprend-on dans le programme), où un robot malaxeur indique qu’on fait son pain, signe de la parfaite autonomie de la communauté, et où un immense portrait de Titurel (Reinhard Hagen) le doigt sur une mappemonde indique aussi les ambitions dominatrices de ce royaume fermé. À cette pièce, où sur les rayonnages sont rangés des centaines d’exemplaires du livre « Wort » (en toutes les langues, « Mot » et « Word » sur la tranche aussi) avec des cases où reposent des sacs à dos, preuve des intentions évangélisatrices de la communauté qu’on suppose partir çà et là. La deuxième pièce ramène ses ambitions à leur juste proportion puisque c’est la chambre d’Amfortas, lit ensanglanté, dominé en mezzanine par le lit de Titurel, veillé en permanence, qu’on nous montre assez mal en point. La troisième pièce est dominée par une reproduction de la Cène, où le Christ est remplacé par Titurel, et au pied du tableau l’écrin géant du Graal. La cérémonie du Graal est en effet une Cène, censée régénérer les chevaliers, quant à la dernière pièce, elle est disposée en gradins d’où les chevaliers assistent à l’ostension du Graal.

Ces chevaliers semblent organisés hiérarchiquement : les jeunes en survêtement gris et sandales ne cessent de lire le « Livre », les plus vieux en blazer cravate apparaissent au moment de la cérémonie. Et Gurnemanz, en survêtement bleu semble être quant à lui « l’entraîneur » de l’équipe, en réalité celui à qui échoit la formation des jeunes recrues et leur management. Tout ce beau monde au moment de la cérémonie revêt une tunique de velours vert vaguement médiévale.
Tout cela avec un luxe de détails, dont le traitement de Titurel est un exemple. On ne voit jamais Reinhard Hagen, remplacé par un figurant sous assistance, mais c’est le visage du chanteur qui est plus ou moins repris dans le portrait et dans le buste. D’autres sont plus prosaïques comme la marmite de soupe fumante qui va être servie aux chevaliers. Enfin Parsifal apparaît, adolescent vêtu comme un teenager soigné, en bermuda au look décontracté (chez Tcherniakov, c’était aussi un très jeune homme, mais une sorte de Wanderer un peu perdu issu d’une quelconque banlieue). Seul le cygne traditionnel, avec sa flèche, comme sorti des réserves des cygnes de l’Opéra, subsiste, car il faut quand même suivre le livret avec la précision voulue.
On comprend donc à ce premier acte
- Que cette secte encore puissante est menacée, parce que le gourou est dans une faiblesse extrême et que le successeur désigné Amfortas, ne vaut pas beaucoup mieux
- Que ce rite est plutôt fatigué
- Que Parsifal s’affiche comme moins perdu que d’habitude, plutôt un garçon du monde extérieur, de la culture d’aujourd’hui, voire des beaux quartiers vu son look.
Au total, c’est globalement le livret qui se déroule, dans un contexte de « Mandarom » bien hiérarchisé, une société dans la société qui s’est abstraite du monde extérieur pour vivre sous les lois particulières imposées par un Titurel désormais déliquescent. À part ce contexte qui semble un simple habillage, c’est un Parsifal tout à fait ordinaire et traditionnel qui nous est montré.
Notons néanmoins par pure coquetterie une entorse à la tradition : la fin du premier acte est marquée par des applaudissements, ce qui devient ordinaire et normal et qui a bien changé depuis 1973 à l’Opéra de Paris : les spectateurs d’alors se souviennent d’une part des fanfares dans le Grand Escalier de Garnier qui comme à Bayreuth annonçaient la fin des entractes et surtout d’une affichette qui avait beaucoup frappé le jeune wagnéromane que j’étais à son premier Parsifal où il était dit que « la fin recueillie du premier acte » excluait toute manifestation d’applaudissements et que à la fin du deuxième acte, les spectateurs pourraient remercier les artistes. J’ai associé dès lors Parsifal à un rituel singulier…tout a une fin.
Or, si les applaudissements même à Bayreuth sont devenus habituels, les artistes ne viennent jamais saluer au premier acte, et pour cette production, les artistes sont venus saluer à la fin du premier acte, manière de désacraliser l’œuvre et de lui donner un peu de « laïcisme » de l’installer dans la normalité en lui ôtant son aura mystique. La question de la modernité se pose en tous cas dans cette mise en scène qui la résout au troisième acte… Mais tout cela ne va quand même pas chercher bien loin.
Deuxième acte

Le deuxième acte semble un travail à la fois superficiel et inachevé, au contraire du premier, très soigné dans sa relative vacuité. Richard Jones cherche à identifier ce qui aujourd’hui représente le mal absolu que symbolise Klingsor. On avait avec Tcherniakov à Berlin identifié la pédophilie, ici, c’est la génétique et ses traficotages. Klingsor est généticien et travaille sur le maïs, symbole des manipulations des gènes (Monsanto, maïs transgénique) et cultive ses épis pour qu’ils fassent naître des êtres génétiquement prédestinés, les filles-fleurs (en l’occurrence des « filles-épi ») des sortes de mécaniques érotisées à défaut d’être sensuelles (il faut vraiment avoir envie ou sortir d’une longue abstinence). Le rideau s’ouvre donc sur un Klingsor soignant ses épis stimulés par un éclairage artificiel et utilisant un corps informe dans un bac de formol…En bref, on est dans le cabinet d’un Docteur Frankenstein d’aujourd’hui. Comme Richard Jones se souvient du livret, il revêt Klingsor d’une chasuble semblable à celle des chevaliers du Graal, mais de couleur orange associée traditionnellement à l’énergie et à la créativité…Son rapport à Kundry est contrasté parce que l’héroïne ironise sur son état : elle est un poil plus agressive envers lui que d’ordinaire. Le tableau des filles-fleurs est d’une mordante ironie (du moins on espère), des épis géants d’où émergent des êtres aux attributs féminins hyper-développés (seins, et le reste…) qui se caressent au rythme de la musique dans une chorégraphie assez ridicule, il faut bien hélas le dire. Mais le regard porté est sarcastique, distancié et la mise en scène assume le ridicule, relativise le sens de l’histoire et jette par contrecoup un regard aussi destructeur sur le monde du Graal auquel on ne croit pas plus : ce monde-là n’a aucune magie et alimente les plaisanteries du public à l’entracte : manière de nous dire que Parsifal, aujourd’hui c’est fini.

Après ce feu d’artifice transgénique (on se souviendra longtemps des filles-fleurs gesticulantes au corps hypertrophié en épi de maïs et aux vulves turgescentes) le reste de l’acte est d’une rare pauvreté, voire ennuyeux : le dialogue Kundry-Parsifal sur un banc comme un avatar du duo de Tristan (que le couple a chanté en mars dernier à Berlin, et avec quel relief !) vu par Wieland Wagner est comme vidé de sa substance. Kundry attifée d’abord comme une Marilyn Monroe au petit pied, dans une robe années 50 ((allusion à l’année 1958 inscrite sur les chasubles des chevaliers ?)) (image maternelle ?), passe de la mère à la femme, objet érotique en nuisette (comme chez Tcherniakov auquel très discrètement la mise en scène fait référence). Peu ou pas de sensualité, conduite d’acteur minimale (on tourne autour du banc), Richard Jones n’y croit pas et nous le fait sentir.

Quant à la scène finale avec Klingsor, elle est mal fichue et ridicule (la prise de la lance !!). On ose croire que c’est voulu.
L’image ultime cependant avec les plantes mortes comme passées au désherbant ou au Napalm et les trois personnages au centre dont Klingsor à la blessure ensanglantée (comme Amfortas) est un peu mieux trouvée.

Troisième acte
Le troisième acte nous renvoie au décor initial : pas de ruines, pas de murs fissurés, les fissures ici sont humaines : la violence entre les êtres s’est installée (comme chez Bieito), effet de l’anarchie au sommet et de l’abandon du pouvoir par Amfortas, effet surtout d’une société qui a perdu ses repères et ses buts. Les livres « Wort » trainent un peu partout, ouverts, abandonnés, Titurel est mort, au lit où il reposait se substitue un cercueil. L’enchantement du Vendredi Saint est un enchantement des âmes, et rien sur le plateau n’indique une quelconque nature, totalement absente de ce travail sauf par le maïs de l’acte II. On retrouve donc les scènes habituelles de toutes les mises en scène de Parsifal , mais débarrassées de leur effet visuel ou de leur sens, avec un résultat anecdotique et plat : on est loin de la vision d’apocalypse de Warlikowski, qui faisait tellement sens, voire de Herheim (avec la même idée de ruines du monde plus historiée et liée à l’Allemagne), ou de Schlingensief (Friedhof der Künste- cimetière des arts). Le livret est suivi scrupuleusement, mais on n’en dit rien. Parsifal va sauver un Amfortas (fabuleux Peter Mattei) traîné à la cérémonie du Graal comme un condamné traîné à l’échafaud. Amfortas est sauvé –effet de la lance, rapide et efficace‑, et va retrouver une Kundry qu’il va embrasser tendrement (exactement comme chez Tcherniakov où cependant le baiser est plus ardent…) et s’écrouler, pendant que Kundry va retrouver Parsifal, et sortir du champ, de l’espace clos du Graal, suivie par tous les chevaliers en cortège qui laissent leurs oripeaux (leurs tuniques) dans la salle des cérémonies et enfin vivre, dans la liberté de l’amour humain pendant que Gurnemanz reste seul avec le corps étendu d’Amfortas, symbole de « l’ancien monde » liquidé. Suivez mon regard…
Comme chez Götz Friedrich, en 1982, à Bayreuth, l’arrivée de Parsifal débloque une situation bloquée et un monde fossilisé, et Parsifal abandonne le monde du Graal en le laissant déserté (Chez Herheim, sa mission pacificatrice accomplie, il disparaissait aussi tandis que chez Tcherniakov, Parsifal part avec dans les bras le cadavre de Kundry) .
Parsifal est vu comme héros libérateur, y compris de la religion, comme un rénovateur qui se refuse à continuer d’assumer un ordre qui a été mis à mal par l’histoire. Tout cela a été bien développé par les dernières grandes mises en scènes de l’œuvre, et le travail de Richard Jones n’ajoute rien, ne donne aucune émotion particulière, et reste assez lourdement didactique ; on est loin de l’image « familiale » merveilleuse qui concluait la production Warlikowski. Tout cela reste superficiel : un habillage d’idées rebattues ailleurs, avec des moments ridicules et d’autres d’une banalité rare. Richard Jones comme apôtre de la superficialité insignifiante.
Une approche musicale très soignée mais peu implicante
Est-ce pour cette raison que l’approche de Philippe Jordan nous est apparue aussi soignée que superficielle ? Cette direction musicale particulièrement précise, très transparente, très ciselée n’arrive pourtant pas à emporter l’âme ni à donner une respiration à l’œuvre, sinon littérale, sauf à de rares moments un peu plus sentis du troisième acte, mais Wagner y aide beaucoup. Le deuxième acte plus dramatique, permet de donner plus de relief aux situations, mais le premier acte reste musicalement assez ennuyeux. Ce n’est pas une question de tempo (la durée des actes est habituelle) c’est une question de relief, de profondeur. C’est un travail de direction pointilleux, rigoureux, ce n’est évidemment pas un travail médiocre, mais c’est un travail qui semble si littéral qu’il finit par coller –volontairement ? – à la platitude du travail scénique, sans vrais accents, sans aspérités. On est surpris que cette approche ne laisse pas s’épanouir des couleurs et un lyrisme qu’un Boulez savait si bien mettre en valeur, même face à la mise en scène si particulière de Schlingensief. Une direction sans chatoyance, dont l’absence est si sensible au final qui semble presque expédié, sans jamais respirer quelque chose sinon de mystique, au moins de sensible : en ce sens effectivement Jordan rend compte en l’illustrant d’une conception scénique qui évite tout mysticisme ou toute transcendance. La conception singulièrement humaine du travail scénique semble déteindre sur une conception sans élévation de la direction musicale.
Philippe Jordan est un très bon chef qui ici ne nous parle pas vraiment, sans empathie, sans pathos, sans vraiment essayer de partager quelque chose ni s’engager pour nous convaincre ou nous emmener par la main. Une sorte d’objectivité qui confine au superficiel. Il nous livre une musique sans heurts, parfaitement exécutée, comme un meuble bien astiqué, extérieurement beau, mais qui laisse froid, voire indifférent et ne fait jamais entrevoir la moindre vibration.
Le chœur de l’Opéra national de Paris, dirigé par José Luis Basso qui a toujours été au rendez-vous de l’excellence, m’est apparu pour l’occasion un peu en deçà de ses habituelles prestations dans cette œuvre. D’une part, il est moins spectaculaire , mais on peut lier cela à la volonté du chef et du metteur en scène d’insister moins sur les aspects « mystiques » ou « grandioses » de l’œuvre que le chœur souvent sert si bien, d’autre part, de manière surprenante, quelques problèmes de justesse chez les pupitres féminins en fin de premier acte ont un peu nui à l’impression d’ensemble, si importante à ce moment-là ; de même le chœur final exécuté sans aucune scorie semblait là aussi manquer de cette invitation à la transcendance à laquelle on est accoutumé. Mais la fin particulièrement laïque (« jetons aux orties nos oripeaux et allons vivre l’amour au soleil ») justifie peut-être ce parti pris. Il s’ensuit que l’on reste un peu sur sa faim au niveau musical d’ensemble.
Une très grande distribution
Du côté du chant, il y a en revanche bien peu à reprocher ou regretter. Il est vrai que la distribution réunie à Paris est de celles qui aujourd’hui font référence dans les salles d’opéra du monde. Il faut souligner la grande homogénéité de l’ensemble, à commencer par les filles fleurs/maïs (Anna Siminska, Katharina Melnikova, Samantha Gossard,Tamara Banjesevic, Marie‑Luise Dressen, Anna Palimina) dont les voix claires séduisent plus que l’attitude ridicule qu’impose la mise en scène, mais aussi quelques rôles dits « de complément » , comme les deux « Knappen » de Michael Smallwood et Franz Gürtelschmied, plus en place que leurs collègues féminines Alisa Jordheim et Megan Marino, ou les deux Gralsritter de Luke Stroker et Gianluca Zampieri.
Reinhard Hagen, Titurel invisible mais sonore, a le relief voulu dans ce rôle de « Vox Dei » et quand il vient saluer, on s’aperçoit qu’il est proche du portrait qu’on en voit dans le décor…
Evghenyi Nikitin est Klingsor, dans lequel on l’a vu un mois et demi plus tôt à Baden-Baden. Il offre du personnage une prestation vocalement colorée, très précise dans les accents, avec un soin particulier au ton, nécessaire dans un rôle souvent mal distribué. Il reste que la voix n’a pas le volume qu’on attendrait et que la projection fait toujours défaut, ce qui dans cette salle difficile est très problématique. Revêtu d’une chasuble orange, imitée de celle des chevaliers du Graal, il officie seul, face à la Kundry sarcastique et incandescente d’Anja Kampe et face à ses fleurs de maïs. Le personnage aurait pu être plus fouillé, mais c’était trop demander au metteur en scène.
Sans doute le plus impressionnant du plateau est encore une fois Peter Mattei, dont on connaît l’Amfortas depuis l’étonnante prestation newyorkaise en 2013 (production François Girard, avec Daniele Gatti en fosse), où il stupéfia.
Il n’a rien perdu de ses qualités de phrasé, de sa manière de sculpter chaque parole, de la projeter aussi en rendant le texte d’une limpidité unique, avec ce style racé qui s’impose, presque liederistique, et magnifique aussi dans la manière dont il s’empare du personnage, en dépit de la pauvreté de la conduite d’acteurs de la part du metteur en scène. C’est une prestation immense qui n’a pas d’égal aujourd’hui, même si le marché nous offre plutôt de bons Amfortas.
Günther Groissböck était pour la première fois Gurnemanz. On connaît les qualités du chanteur, sa manière de dire un texte, le phrasé, la clarté de l’émission, on connaît aussi son aisance scénique (inimitable dans Ochs aujourd’hui). Tout en gardant ces qualités ici, il déçoit un peu parce qu’il n’arrive pas encore à donner à son chant et à son personnage une dimension, c’est notamment très sensible au troisième acte : les notes y sont, la musique aussi, le sens « derrière les yeux » pas vraiment. Il est vrai une fois de plus que la mise en scène l’affublant au premier acte d’un survêtement d’entraîneur d’équipe de foot et d’un blazer de défilé d’ouverture des jeux Olympiques au troisième n’aide pas à la profondeur mystique. Mais justement, Richard Jones refuse toute profondeur mystique, donnant à sa secte les gestes du mysticisme, l’apparence du mysticisme, mais sûrement pas l’engagement ni l’épaisseur. Du mysticisme Canada Dry…De ce point de vue, Groissböck est peut-être dans la ligne, car son Gurnemanz est relativement superficiel. Attendons d’autres productions…
Andreas Schager est désormais un Parsifal qui promène son rôle un peu partout, de Bayreuth à Berlin ; c’est sa première fois à Paris et son timbre lumineux, sa manière de poser la voix, son chant projeté (quelquefois crié naguère) font merveille dans une salle qui est faite pour lui (y sera-t-il Siegfried ?). Il s’est assagi depuis ses premiers Parsifal de jeune fou vocal et physique. S’il est très engagé en scène, il n’est pas toujours un acteur convaincant, sauf avec de vrais metteurs en scène comme Tcherniakov qui savent gérer ses mouvements et canaliser l’énergie, et malheureusement, il n’est pas très conduit ici. Il reste que ce Parsifal à la couleur héroïque et juvénile, direct et en rien torturé, reste un petit phénomène, même si on l’a entendu, à Berlin notamment, bien plus contrôlé (Erlöser…) et plus émouvant par ce contrôle même (mais il y avait dans la fosse un certain Barenboim).
Anja Kampe faisait aussi ses débuts dans Kundry. Autant la voix convainc dans une salle plus confinée comme le Schiller Theater ou même la Staatsoper Unter den Linden, autant dans le vaisseau bastillais, elle doit inévitablement forcer et la voix perd de son homogénéité, notamment dans les aigus dardés, puissants, mais peu liés aux phrases qui précèdent. Elle n’a pas la fluidité voulue dans un rôle qu’elle maîtrise pourtant et qu’elle a travaillé dans le détail avec Barenboim et Tcherniakov. Là encore, la manière dont la mise en scène la traite, avec ce costume un peu ridicule de Marilyn-maman vieillie, puis sa nuisette inutile puisque la mise en scène ne lui invente aucun geste ni aucune posture adaptée ou tant soit peu sensuelle. Elle n’a pas la sauvagerie voulue au premier acte, mais là où elle est encore la plus convaincante c’est plutôt face à Klingsor que face à Parsifal. On chipote, dira-t-on, mais on l’a entendue bien plus engagée et mieux guidée dans le rôle. Il reste qu’on aime, évidemment.
Au total, une soirée contrastée, scéniquement médiocre ( « du fumet, mais pas de rôti » diraient les italiens) musicalement de grande tenue, surtout par un plateau de très haut niveau, moins par une direction à laquelle il ne manque aucun bouton de guêtre, mais sans chaleur à exhaler.


Pas un mot à retrancher à votre critique.
Permettez moi d insister sur trois points.
Le travail de Jones est un typique produit Microsoft : copier coller.
On prend un élément des les dernières productions de parsifal dans le monde ces dernières vont années, on mélange et sans pudeur on fait un travail vide de sens. Il n'y a que la production de Girard pour le Met que je n ai pas retrouvé.
Autre point le théâtre de l opéra de Paris est exactement dans la même situation que la Scala à la fin de l ère Muti. Un directeur musical qui dirige tout à la perfection mais totalement vide de sensibilité , de couleurs sans mentionner de génie .
Moi aussi je fus gêné par les saluts des chanteurs à la fin du premier acte. Ce n est pas une question de passéisme, mais c est vider l oeuvre de son contenu émotionnel et mystique.
Vous vous souvenez aussi à Salzbourg il y a très longtemps où les femmes d un certain âge mettaient une mantille pour écouter le requiem de Verdi.…
A la fin de l opéra grâce à Jones, Kundry oublie de mourir et part bras dessus bras dessous en goguette avec Parsi et les chevaliers otent leurs déguisement chrétiens pour s en aller plus vite.
Tcherniakov à Berlin avait évacué toutes les scories chrétiennes mais avait atteint une grandeur sacrée incroyable… totalement absente à Paris
A Munich en juillet ?
Je vous trouve très sévère avec la direction de Jordan qui a fait un superbe travail avec l’orchestre.La production de Jones,assez convenable,n’efface pas celle de Warlikowski qu’il eût été préférable et moins coûteux de reprendre.Distribution exceptionnelle ( sauf Nikitin un peu en deçà).Quant aux applaudissements à la fin de l’acte 1,ils sont désormais acceptés à Bayreuth,alors…
Que voulez-vous, cette direction musicale ne me parle pas je n'y peux rien. Richard Jones n'a pas beaucoup d'intérêt dans une oeuvre bien servie par les metteurs en scène.
J'ai bien signalé les applaudissements du 1er acte désormais admis . Ce qui me surprend, c'est que les artistes viennent saluer, ça c'est inhabituel. Mais c'est un détail.