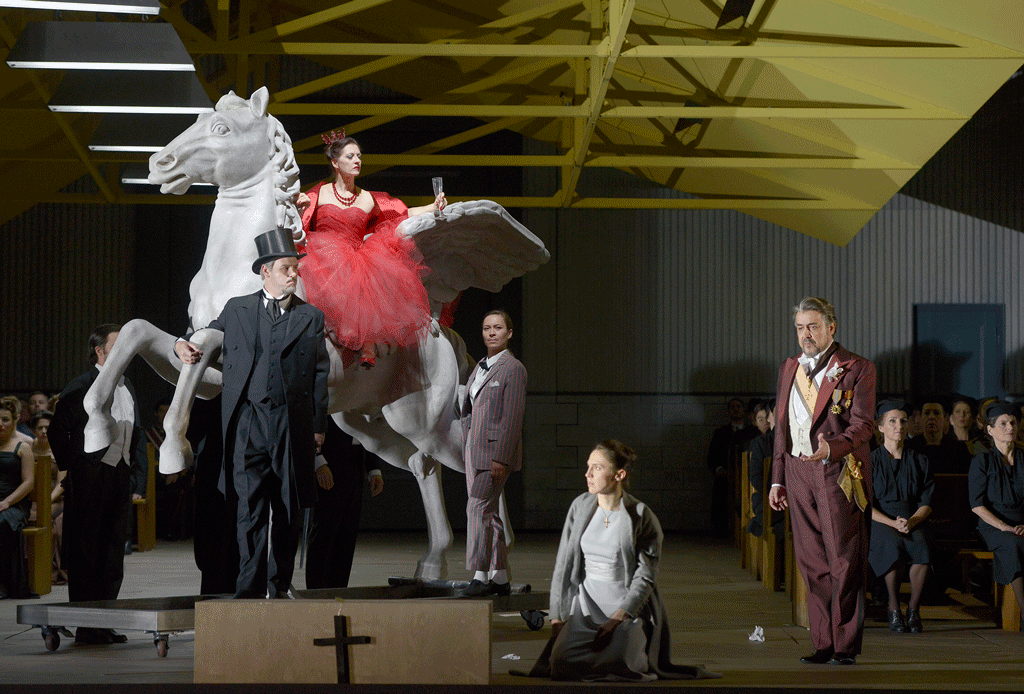
La production était attendue. Non seulement parce qu’après Dinorah et Vasco de Gama (L’Africaine), le petit monde lyrique berlinois et européen espérait Les Huguenots, qui est l’opéra le plus fameux du maître berlinois, mais aussi pour la prise de rôle de Juan Diego Flórez dans l’impossible Raoul de Nangis.
Belle idée de la part de la Deutsche Oper que ce cycle Meyerbeer, il est temps de réentendre celui qui fut le maître incontesté de la période romantique, ce berlinois installé à Paris qui partageait avec Rossini la gloire absolue de l’opéra. Car même si Rossini a arrêté de produire (Guillaume Tell est proposé en 1829) à peu près au moment où Meyerbeer connaissait la gloire universelle (Il crociato in Egitto est présenté à Paris en 1825, et le succès inouï, éclatant, définitif de Robert le Diable remonte à 1831), ils ont le même âge à six mois près, alors qu’on considère toujours Meyerbeer comme une sorte d’élève de Rossini sans doute aussi parce que, frappé par Tancredi, de 1816 à 1825, il compose pour l’Italie (Turin, Milan, Venise) et va jusqu’à italianiser son prénom en Giacomo.
Le spectateur du XXème siècle ne peut imaginer la gloire incroyable de Rossini sur les scènes d’opéras, bien après les créations de ses derniers titres : des saisons entières lui sont consacrées par les théâtres, notamment à la Scala qui est bien plus le théâtre de Rossini que celui de Verdi, et ce jusqu’au seuil de la seconde moitié du XIXème siècle.
Si la redécouverte de la musique de Meyerbeer stupéfie, c’est peut-être plus par les emprunts (le pillage) dont il a été l’objet : par Wagner bien sûr avec cet amour-haine qui l’a accompagné sa vie durant, mais aussi par Verdi, – et pas seulement le jeune Verdi. Jusqu’aux années 1860, il y a dans les opéras de Verdi des traces de Meyerbeer (dans Ballo in maschera, dans Don Carlos, dans La Forza del destino et naturellement dans Les Vêpres siciliennes) : le jeune loup italien et le jeune loup allemand louchaient vers le Pantocrator.
Meyerbeer a refait de l’opéra une grosse machine pour grande boutique, il en met plein les yeux, et plein les oreilles, il stupéfie, par les incroyables exigences de son chant, par les masses rassemblées en scène : il est le dernier avatar de l’opéra-spectacle tel qu’il a été proposé notamment à Paris depuis le XVIIIème siècle. Mais au-delà de la mode du Grand Opéra, une mode populaire et très médiatisée (si l’on peut utiliser ce vocable anachronique s’agissant du XIXème siècle) avec des sujets abordés plus sérieux qu’il n’y paraît de prime abord : Les Huguenots aborde le massacre de la Saint Barthélémy, Le Prophète la question des faux prophètes, des problématiques de tolérance et de liberté et surtout de religion. Le sens de l’œuvre demande une vraie réévaluation et notamment aussi certains livrets de Scribe.
La disparition des scènes de Meyerbeer est à mon avis due à deux facteurs :
- on l’a trop joué jusqu’au début du XXème siècle et « trop » signifie quelquefois "mal", et donc routine
- le passage du nazisme et de l’antisémitisme virulent, encouragé par les textes de Wagner adoré du régime, a sûrement aussi produit son effet après guerre : la vengeance posthume de Wagner
Alors ces Huguenots étaient bienvenus à Berlin car la production permet de vérifier la grande qualité de cette musique, son urgence, son lyrisme, l’élaboration très raffinée de certains moments et un incroyable savoir-faire (rien de péjoratif dans l’expression) pris à son maître Rossini. Comme Auber à l’époque ou comme Donizetti, mais aussi comme Offenbach plus tard en version pastiche, Rossini est dans toutes les têtes. Elle permet aussi de vérifier la volonté de Meyerbeer de travailler et sur la tolérance et sur la chose religieuse dans ses effets politiques (comme il le fera aussi pour Le Prophète) et dans une moindre mesure dans Robert le Diable. L'insertion dès l'ouverture du choral luthérien "Ein feste Burg ist unser Gott" marque cette volonté de placer un célébrissime choral en exergue, même si ce n'est pas très calviniste, et donc pas très huguenot. Mais l'opéra et l'oeuvre d'art transcendent.
Pour Les Huguenots, et en général le Grand Opéra, la recette est assez simple : il faut sur la scène les plus grands chanteurs, parce que c’est pour eux et seulement pour eux que ces opéras étaient écrits et créés : puissance, style, acrobaties vocales, ténors sollicités jusqu’à l’impossible. Il y a dans Les Huguenots deux sopranos, un mezzo travesti, un ténor, deux barytons, une basse, nécessairement tous de tout premier plan. C’est le pari tenté par la Deutsche Oper et c’est musicalement un pari gagné grâce à un plateau exceptionnel et une direction musicale d’une rare justesse et d’une particulière intelligence.
Plateau exceptionnel parce que y chacun est à sa place, les rôles de complément sont assurés avec justesse et vaillance par l’ensemble de la troupe, d'où émerge Derek Welton, le baryton-basse australien au timbre si velouté qui appartient à la troupe de Berlin, dans le rôle de Saint Bris, avec une diction exemplaire et une vraie présence. C’est une des voix les plus sûres de la maison, sans aucun doute un grand avenir. Son Saint Bris est impressionnant.
Le Nevers de Marc Barrard en constitue la figure antithétique : là où Saint Bris est impitoyable, Nevers montre humanité et noblesse : il le paiera. Dans le monde des guerres civiles, les âmes nobles survivent rarement. Le chant de Marc Barrard, avec sa diction impeccable – c’est le seul français de la distribution et cela s’entend -, et sa voix bien sonore et en même temps chaleureuse et ronde, est un chant coloré, très différencié par les accents et la personnalité de celui de Saint Bris. Sa prestation est remarquable, avec la voix qui convient. On aimerait le voir plus souvent sur les scènes internationales.
La jeune Irene Roberts est Urbain, le page confié à un travesti. Lointains héritiers de Cherubino, les pages travestis, ou plus généralement les rôles travestis sont relativement fréquents dans le Grand Opéra et ses déclinaisons, à commencer par Jemmy dans Guillaume Tell, mais aussi dans Benvenuto Cellini (Ascanio) dans Rienzi (Adriano), ou dans Don Carlo (Tebaldo), mais aussi dans Oscar de Ballo in maschera et même dans Siebel du Faust de Gounod. Irene Roberts (qui fait partie de l’excellente troupe de la Deutsche Oper) est remarquable dans le rôle, voix contrôlée, puissance, homogénéité, elle a une vraie présence. À suivre.
Marcel, rôle essentiel, celui de la conscience morale protestante, de la rigidité et de la fidélité, est confié à la basse croate – elle aussi fixe à la Deutsche Oper – Ante Jerkunica. Une voix impressionnante, profonde, au timbre magnifique. Quel atout pour la troupe ! Ce Marcel, qui triomphe auprès du public manque seulement un peu de couleur et d’accents : le chant est prodigieux, l’expression quelquefois un peu égale. Ante Jerkunica ne manquera pas de rôder le rôle et d’en approfondir l’interprétation.
Olesya Golovneva était Valentine. Les deux grands rôles féminins se partagent l’opéra, Marguerite dans la première partie et Valentine dans la deuxième. C’est un rôle de colorature dramatique et Golovneva chante souvent Traviata ou Lucia. Mais elle chante aussi Rusalka, Mathilde de Guillaume Tell, et même bientôt Elisabetta de Don Carlo, c’est dire l’étendue de la voix : à n’en point douter c’est une artiste de grand niveau : sa Valentine est d’une rare intensité, avec des qualités de contrôle et d’homogénéité dans toute la tessiture, avec un son sans scorie aucune ni aucune fêlure : c’est à fois impeccable techniquement et prodigieusement senti. Elle est largement au niveau de son partenaire, Juan Diego Flórez qui abordait l’impossible Raoul pour la première fois. L’impossible Raoul qu’un Gedda peut-être a vaincu : il ne faut pas seulement l’aigu, il faut la ligne, le style presque mozartien quelquefois, rossinien à d’autres. Il est clair que Flórez a les papiers en règle. Son Raoul est vocalement sans failles, bien que la voix évolue actuellement et abandonne les rôles qui firent sa gloire. Son quatrième acte (et le duo « Tu l’as dit… ») reste phénoménal, même si l’on peut préférer des interprétations plus suaves et un peu plus fines. Mais il faut aussi dans Raoul, une urgence et une intensité et une sensibilité qui manquent un peu à Flórez : il ne fut jamais un chanteur-acteur. Il reste en scène assez peu engagé, et confie l’ensemble du personnage à la prestation vocale : c’est insuffisant et manque d’incarnation véritable, il faut ici la performance et l’engagement, sa partenaire l’a, pas lui.
Enfin, Patrizia Ciofi est Marguerite. Un rôle qui fut de Joan Sutherland…La chanteuse italienne, qui reste l’une des très grandes références du chant italien aujourd’hui, n’a plus l’éclat et la sûreté d’antan, mais elle garde l’intelligence et la sensibilité. Ce qui frappe d’abord c’est qu’elle construit un vrai personnage, plein de relief, plein d’esprit. C’est à peu près avec Golovneva la seule du plateau à être pleinement ce qu’elle désire montrer du personnage, sa légèreté, son ironie, sa joie de vivre, et en même temps son courage et son humanité. C’est pour moi une très grande incarnation, et un art suprême du chant qui sait habilement masquer les quelques failles pour produire un feu d’artifice d’intelligence et de présence. Prodigieux, tout simplement : sa personnalité écrase le plateau, elle resplendit de mille feux.
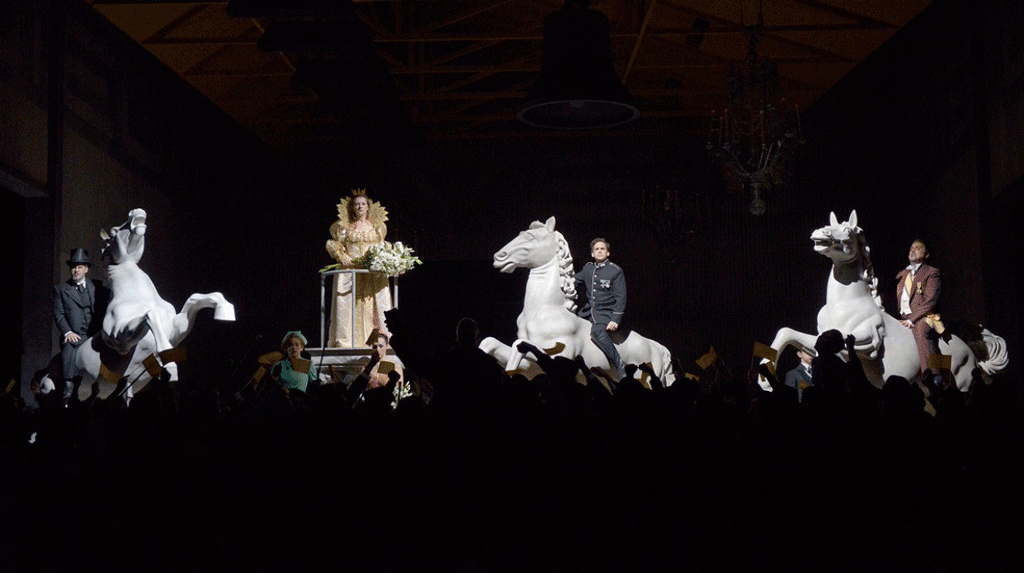 La Deutsche Oper a réuni là un plateau exceptionnel, et la troupe montre son niveau et son excellence : rares sont les théâtres qui peuvent réussir à afficher un plateau aussi sûr pour une œuvre aussi rare et aussi difficile.
La Deutsche Oper a réuni là un plateau exceptionnel, et la troupe montre son niveau et son excellence : rares sont les théâtres qui peuvent réussir à afficher un plateau aussi sûr pour une œuvre aussi rare et aussi difficile.
L’appel à David Alden pour la mise en scène se comprend dans la mesure où il est familier du répertoire du XIXème, avec une certaine distance qui permet d’aborder l’œuvre de manière légèrement décalée sans toujours froisser les sensibilités d’un public quelquefois conservateur. L’équipe a été huée à la première. Cela ne valait pas cette stupide dépense d’énergie.
Avec ses nombreux figurants, ses chœurs et sa distribution pléthorique, Les Huguenots est un « grand » spectacle. Alden fait du spectaculaire, mais avec son décorateur Giles Cadle qui enferme l’action dans le décor unique d’une sorte de hangar, il travaille sur des images, plus que sur une vraie dramaturgie : pas de direction d’acteurs notables, quelques moments spectaculaires, l’apparition des héros sur des chevaux de marbre, la scène initiale de Marguerite au bain, avec les apparitions au sommet du mur des courtisanes s’éventant, mais cela ne va quand même pas bien loin. Je me demande toujours si une reprise « historique » avec toiles peintes et effets d’optiques ne fonctionnerait pas mieux dans ce cas-là parce que le modernisme d’Alden est un peu limité et cache bien plutôt une certaine pauvreté conceptuelle.
 S’appuyant sur l’affirmation que le Grand Opéra est à la scène du XIXème ce que le musical de Broadway est à celle du XXIème, il utilise des trucs, chorégraphies, mouvements, gags du musical, notamment dans la première partie, un peu comme il l’avait fait dans son Ballo in maschera au MET il y a deux saisons. Bien sûr, il souligne ainsi l’hétérogénéité du genre, hérité du drame shakespearien, où se mélangent tragique et comique (c’est aussi le cas d’un Benvenuto Cellini par exemple de deux ans postérieur). Le problème c’est que la première partie, plus légère, et la deuxième partie, plus dramatique, n’ont plus de vrai lien sinon celui scénique du décor unique et qu’on passe de l’ironie et de la légèreté au tragique sans solution de continuité au risque de casser la cohérence. Si une Ciofi sait être et l’un et l’autre, ce n’est pas le cas d’un Flórez qui traverse imperturbablement de la même manière les deux ambiances. C’est théorisé dans le programme (Tragödie mit den Mitteln der Farce/tragédie avec les moyens de la farce), il n’est pas sûr que ce soit vraiment convaincant dans la mise en pratique. Une mise en scène discutable, malgré les tentatives d’actualisation (« Dieu le veut ») qui rapprochent de la vision du Prophète de Tobias Kratzer à Karlsruhe et qui marquent quelques traces des débats d’aujourd’hui sans vraiment que l’on en fasse grand-chose alors que le sujet l’appelle. Une mise en scène « toute à touches » sans vraie ligne.
S’appuyant sur l’affirmation que le Grand Opéra est à la scène du XIXème ce que le musical de Broadway est à celle du XXIème, il utilise des trucs, chorégraphies, mouvements, gags du musical, notamment dans la première partie, un peu comme il l’avait fait dans son Ballo in maschera au MET il y a deux saisons. Bien sûr, il souligne ainsi l’hétérogénéité du genre, hérité du drame shakespearien, où se mélangent tragique et comique (c’est aussi le cas d’un Benvenuto Cellini par exemple de deux ans postérieur). Le problème c’est que la première partie, plus légère, et la deuxième partie, plus dramatique, n’ont plus de vrai lien sinon celui scénique du décor unique et qu’on passe de l’ironie et de la légèreté au tragique sans solution de continuité au risque de casser la cohérence. Si une Ciofi sait être et l’un et l’autre, ce n’est pas le cas d’un Flórez qui traverse imperturbablement de la même manière les deux ambiances. C’est théorisé dans le programme (Tragödie mit den Mitteln der Farce/tragédie avec les moyens de la farce), il n’est pas sûr que ce soit vraiment convaincant dans la mise en pratique. Une mise en scène discutable, malgré les tentatives d’actualisation (« Dieu le veut ») qui rapprochent de la vision du Prophète de Tobias Kratzer à Karlsruhe et qui marquent quelques traces des débats d’aujourd’hui sans vraiment que l’on en fasse grand-chose alors que le sujet l’appelle. Une mise en scène « toute à touches » sans vraie ligne.
 Enfin tout cet édifice serait plus fragile sans le maître d’œuvre musical de cette nouvelle production, le chef Michele Mariotti qui se projette immédiatement comme le Prophète de Meyerbeer. On connaît la profonde connivence du chef italien avec la musique de Rossini tant il est lié à Pesaro. On connaît aussi sa manière élégante et souple d’aborder le répertoire romantique et les grands Verdi. On sait désormais qu’il est le meyerbeerien du moment.
Enfin tout cet édifice serait plus fragile sans le maître d’œuvre musical de cette nouvelle production, le chef Michele Mariotti qui se projette immédiatement comme le Prophète de Meyerbeer. On connaît la profonde connivence du chef italien avec la musique de Rossini tant il est lié à Pesaro. On connaît aussi sa manière élégante et souple d’aborder le répertoire romantique et les grands Verdi. On sait désormais qu’il est le meyerbeerien du moment.
Rappelons-nous qu’en Italie au XIXème, tout commence par Rossini, même si Meyerbeer écrit de la musique en français et crée pour l’opéra de Paris et la parenté Rossini-Meyerbeer favorise évidemment une option de direction qui évacue d’emblée tout ce que Meyerbeer en des mains plus lourdes pourrait avoir de fracassant. La direction de Mariotti rend justice à l’épaisseur de la partition, à la composition, aux délicatesses et aux trouvailles, c’est une véritable concertazione au sens italien du mot : mise en concert, mise ensemble, avec une mise en valeur des pupitres (et je ne parle pas de la viole d’amour de Katharina Dargel), notamment des bois et un usage très allégé et souple des cordes. Il en résulte tout au long de la lecture un raffinement étonnant et inattendu tant on associe Meyerbeer aux grosses machines. Jamais Mariotti ne couvre les voix, jamais il n’est écrasant, il accompagne le discours, avec légèreté quelquefois, avec finesse toujours, avec énergie aussi et une grande force dramatique. Il colle au drame. La différence notable avec Rossini, c’est qu’on a là un opéra bien plus long dont il faut maintenir la tension : Rossini a hérité de l’opera seria, Meyerbeer a appliqué les règles d’une dramaturgie shakespearienne, à la mode à l’époque et propose une variété de tons, dramatique, ironique, sarcastique qu’on ne trouve pas chez Rossini dans un même ouvrage. Mariotti, qui a dirigé Guillaume Tell, a l’endurance, et son quatrième acte est merveilleux de suavité et de sensibilité, mais il sait aussi traduire l’ironie des deux premiers actes.
Mais surtout, Mariotti prend en compte l’italianità structurelle de Meyerbeer, qui a vécu et créé pour l’Italie pendant une dizaine d’années (tous ses débuts) et pour qui Rossini est le maître. La musique des Huguenots n’est pas de la musique française, c’est la musique de presque toute l’Europe d’alors qui fait le lit d’une lignée Rossini, Auber, Meyerbeer : c’est là que Wagner va essayer de puiser le secret de l’opéra à succès (Liebesverbot, Rienzi). Michele Mariotti par l’intelligence de ses options, nous le rappelle. Il dirige Meyerbeer en tissant les filiations, mais en nous montrant aussi les singularités, par une direction d’une étonnante transparence et d’une fluidité qui rend la musique jamais heurtée, jamais brutale mais toujours dans la pulsion, toujours dans le rythme et qui produit une lectrue passionnante. Un travail de dentelle. Berlin retrouve Meyerbeer : à quand Paris ?

