
Les circonstances
Pour bien saisir le travail d’Andrea Moses, il faut rappeler que cette production a été créée les 3 et 4 octobre 2015 à l’occasion des vingt-cinq ans de la réunification allemande. C’est dire le symbole qu’elle porte. Et de fait la mise en scène d’Andrea Moses n’a rien de « bavarois », et Nürnberg n’y est qu’une marque de bière…
Ce travail essaie de montrer l’Allemagne du jour et sa diversité dans une ville de Berlin encore en (re)construction dont le Palais Impérial (alors en débat, aujourd’hui debout) s’affiche en fond de Festwiese. Ainsi nous présente-t-on une Allemagne à la fois réaliste et utopique, vue comme communauté qui accepte d’être gouvernée par les artistes et l’art…
Ce propos assez politique est conforme à l’idée que Barenboim porte, notamment en essayant de travailler au dialogue israélo-palestinien par la musique avec son WEDO ((West-Eastern Divan Orchestra)), faisant dialoguer les musiciens opposés par l’histoire grâce à l’art et la pratique artistique.
Pour marquer à la fois la musique, l’art et aussi sa carrière, Barenboim (en 2015 et encore aujourd’hui car ils sont tous encore présents ce soir) appelle dans le rôle de quelques « Meistersinger », ceux qui furent les maîtres du chant des cinquante dernières années : Siegfried Jerusalem (79ans), Olaf Bär (62 ans), Reiner Goldberg (80 ans), Graham Clark (78 ans) et Franz Mazura vétéran de 91 ans en 2015, de 95 ans cette année (fêtés d’ailleurs le 22 avril, son anniversaire, à l’occasion de la dernière représentation de la série).
Pour parfaire le tableau, Barenboim a fait sortir de sa retraite Matti Salminen (74 ans), qui a repris du service dans le rôle de Pogner, qui n’a rien d’épisodique, pour substituer le chanteur prévu, souffrant. On le sent, tout était prédisposé pour vivre encore l’émotion d’il y a quatre ans.
Au-delà de la géniale idée, enfin ces maîtres étaient caractérisés, individualisés et la distribution a mêlé les vétérans fort habilement à des débutants mais aussi quelques maîtres plus jeunes, voire très jeunes. Ainsi donc se trouvaient réunies sur la scène, plusieurs générations, unies sous la bannière allemande omniprésente, mais on a introduit cette année aussi un David noir, jeune artiste sud-africain, Siyabonga Maqungo, en troupe à Chemnitz, qui a remporté un triomphe.
L’œuvre allemande considérée comme la plus « identitaire » servie par les artistes les plus divers, voilà un joli pied de nez aux « identitaires » au mauvais sens du terme.
De même, lors du final du 2ème acte au milieu de la bagarre générale, un rabbin traverse la scène, l’air un peu inquiet et méfiant, et lors de la Festwiese, sont invités deux émirs, sans doute futurs financeurs de la fête folklorique, assis juste à côté des Maîtres dont l’un (Hans Foltz) leur traduit ce qui se passe.
Quelques questions posées par l’œuvre
Ce ne sont que quelques menus détails d’une mise en scène qui souligne les évolutions et les visions d’un aujourd’hui contrasté mais souriant : Hans Sachs cultive son herbe, les maîtres font de la pub pour chacune de leurs marques, le groupe des Lehrbuben (apprentis) du début du deuxième acte est un groupe de punks (costumes d'Adriana Braga-Peretzki ((Collaboratrice régulière de Frank Castorf, notamment dans le Ring de Bayreuth)) ), qui néanmoins danse comme leurs équivalents des siècles précédents (dans les versions de type « bavarois »).

Tout est construit aussi pour impliquer le public (entrées par la salle, préparation du premier acte pendant que les spectateurs prennent place, les acteurs-chanteurs eux aussi prennent place dans l’église, où est tendu un drapeau allemand omniprésent, ballons tricolores dans la salle au moment de la Festwiese. Rien de critique là-dedans, rien de caricatural, parce qu’y domine l’idée qu’on se sent bien dans cette Allemagne-là. L’image finale, où Sachs et Walther bras dessus bras dessous contemplent non plus le palais impérial des polémiques, mais une prairie verte et ouverte sur un ciel bleu, nous invite à rêver à la concorde.
Si le décor ( de Jan Pappelbaum) du premier acte est un lieu de culte, bientôt transformé en salle anonyme où les maîtres se réunissent, celui du deuxième acte est une terrasse d’immeuble, un de ces toits où l’on travaille l’été (on est à la veille de la Saint Jean, début de l’été), il fait doux, il fait bon il fait paix…

Le troisième acte nous place à l’étage en dessous, chez Sachs, sous un tableau de groupe du XVIe qu’on associe évidemment aux Maîtres Chanteurs et une grande bibliothèque remplie de partitions et de livres, deux lutrins, et des livres partout dispersés sur le sol. Hans Sachs est cordonnier et poète, comme il le dit, mais ici surtout un intellectuel sans cesse en recherche. Il n’y pas d’art sans travail, sans recherche : c’est bien tout le sens de l’œuvre, qui laisse à la fois Walther créer, mais en le contraignant à s’inscrire dans des formes. La poésie disait Pierre Jean Jouve « est une âme inaugurant une forme. » et c’est bien le travail auquel Sachs convie Walther, dans lequel la production du texte préalable à une musique est essentiel.
C’est d’ailleurs la question théorique centrale de l’œuvre que celle de l’adéquation du texte et de la musique, cause de l’échec de Beckmesser qui travaille sur un texte qui n’est pas de lui…et qui donc ne peut s’en souvenir, parce qu’impensé au moment de la composition musicale.
De plus nous sommes dans une comédie, où les dialogues s’avèrent essentiels (et de fait les jeux de mots sont fréquents ne serait-ce que dans l’exercice délicat de l’air de Beckmesser par rapport à l’air de Walther, où l’on pourrait jouer la comédie de Jean Tardieu, « un mot pour un autre ». Un u pour un ü et Blüte (floraison) devient Blut (sang) associé avec Duft (parfum) , et donc le parfum des fleurs devient odeur de sang… simple jeu d’une voyelle qui fait virer le poème de Beckmesser en vision surréaliste noire, mais presque une vision d'avenir… Et c’est tout l’art de Wagner que de proposer un poème éthéré conforme et un autre déglingué, mais plein de jeux de mots savants et d'assonances qui le font ressembler de loin au texte de Walther, mais sans un sens lisible et évident, presque au seuil du surréalisme, ce qui a fait ranger Beckmesser au rang des novateurs, des poètes de l'avenir dans la mise en scène si intelligente de Katharina Wagner à Bayreuth.
Die Meistersinger von Nürnberg est vraiment l’œuvre sans doute la plus emblématique de Richard Wagner où il expose sous la forme de la comédie l’essentiel de sa vision sur la liaison du texte et de la musique, mais aussi de ses utopies politiques. Et pour parler du texte, la comédie, où le texte est déterminant, fondateur, est la forme la plus adaptée. Le non germaniste peut écouter Tristan, Lohengrin, Parsifal, voire tout le Ring, sans vraiment connaître l’allemand. Pour Meistersinger, c’est plus difficile : et de fait, c’est souvent l’opéra dans lequel on a le plus de difficultés à rentrer à cause des longs exposés (David au premier acte) ou dialogues (notamment au troisième acte) qui semblent au départ autant de trous noirs. Celui qui aborde Meistersinger se raccroche au départ à l’ouverture, au final de l’acte II, au quintette et à la Festwiese, soit un peu plus d’une heure sur les 4h30 que dure l’ouvrage.
Mais une fois qu’on y entre vraiment, on découvre les merveilles d’une orchestration tressée sur le texte, les merveilles d’un texte à la fois joyeux et sérieux, et les merveilles d’une musique qui sans le texte souvent ne fonctionne pas tant l’interaction est déterminante, une musique étonnante, souriante ou mélancolique, quelquefois faussement pompeuse (il y a quelque chose de très discrètement ironique dans cette pompe bourgeoise qui imite la pompe aristocratique dans l’ouverture ou la Festwiese) et surtout, une musique qui n’abandonne jamais la bonhommie.
On a souvent associé Die Meistersinger von Nürnberg à ce qu’en ont fait les nazis, l’emblème d’un Deutschland uber alles qui vise à tout écraser sur son passage, d’une défense vigoureuse de la civilisation et de l’art allemands (discours final de Sachs). Bref, les dérives des lectures successives d’une œuvre née en 1868 qui devient un emblème de plus en plus politique durant le nazisme et jusqu’en 1944, seule œuvre jouée et autorisée à Bayreuth.
Bien sûr, cela laisse des traces, y compris dans l’histoire de Bayreuth, qui attend 1956 pour proposer la nouvelle production « Neues Bayreuth » de Wieland Wagner (scandale immense) et qui jusque-là avait repris grosso-modo la vieille production d’avant-guerre dans une mise en scène de Rudolf Hartmann. Bayreuth où seuls des membres de la famille Wagner (Wieland, Wolfgang, Katharina) avaient le monopole de la mise en scène jusqu’en 2017, où Barrie Kosky en propose une lecture décapante et terrible.
Que Die Meistersinger von Nürnberg soit une œuvre qui plus que toute autre, traite de l’Allemagne, personne ne le niera et c’est à cette aune-là qu’il faut lire le travail d’Andrea Moses, originaire de Dresde, et donc née en RDA en 1972, particulièrement sensible à la question d’une Allemagne réunifiée sous une lumière différente que celle du Reich.
Il est d’autant plus symbolique que Daniel Barenboim serve ce dessein, lui le juif qui a osé braver l’interdit wagnérien en Israël, et lui à qui les palestiniens ont offert un passeport palestinien. La vision politique très ouverte de Barenboim donne la primeur à l’humanisme et à l’art : sa passion pour Wagner qui marque toute sa carrière, son lien à Wilhelm Furtwängler montrent son désir de dépasser les idées reçues ou les fausses anathèmes. Les attaques dont il a été l’objet récemment sont pour moi assez téléguidées par ceux qui détestent le personnage et le symbole de la Berlin culturelle post-unité qu’il est devenu.
Enfin, mettre en vitrine ceux qui de l’Est, de l’Ouest, de l’étranger, ont symbolisé le chant allemand des cinquante dernières années – tous liés à lui, faisant de ces maîtres les vrais Meistersinger et non de simples rôles est un coup de génie. Car un des problèmes de la distribution des Meistersinger est justement de distribuer les Maîtres, rôles de complément par le volume de texte à chanter, mais rôle essentiel pour qui veut essayer d’individualiser chaque personnage et de lui donner un profil. Moses et Barenboim y réussissent grâce au concours des chanteurs mythiques des dernières années, qui y jouent presque leur propre rôle, Kosky d’une autre manière y a réussi à Bayreuth.

Une mise en scène sur l’Allemagne
Ainsi Andrea Moses fait une mise en scène sur l’Allemagne, sur ses symboles, sur ses débats, sur son évolution et sur sa modernité ; Elle répond aux deux questions : qui sont les Meistersinger du jour ? Et la réponse est donnée par la distribution, et que sont les Meistersinger von Nürnberg aujourd’hui ?
Il faut repartir de deux données pour comprendre son approche. D’une part une donnée qu’on oublie souvent qui est la date de création, 1868, à Munich. Soit en pleine affirmation d’une identité culturelle commune aux États allemands. Qu’en 1868, deux ans après Sadowa, il soit acquis que la Bavière a perdu la partie contre la Prusse est clair. Mais en Bavière règne pour Wagner un Roi « artiste », qui veut que l’art gouverne et détermine la politique (on peut le discuter certes, mais Wagner est pour le Roi Louis II l’artiste qui éclaire la route). Et c’est tout de même l’époque de la naissance de la nation allemande et de l’affirmation de son identité. Il n’y a pas à être étonné des discours de Sachs sur l’art allemand, ils s’expliquent par le contexte politique du temps, qui n’a rien de nazi…
D'autre part, les années 1990–2015 sont les années d’une reconstruction identitaire allemande, où ce qui unit doit prévaloir sur ce qui sépare. Ceux qui ont vécu cette période savent quelles oppositions sont nées entre Ossis et Wessis, ceux de l’Est et ceux de l’Ouest accusés de domination culturelle (tout le travail de Castorf à la Volksbühne traite de cela) ; et Berlin est un enjeu culturel essentiel. Que la capitale de l’Allemagne d’aujourd’hui soit redevenue ce symbole d’ouverture qu’elle a été avant le troisième Reich, notamment sous la république de Weimar, voire sous l’Etat prussien, bien plus ouvert qu’on ne le dit souvent , est évidemment un élément porteur de ce travail théâtral, qui à coup de clichés souriants, constitue l’image d’une Allemagne positive et pacifiste, un plaidoyer pour la tolérance dont même Christian Thielemann parle à propos des Meistersinger.
À tout cela s’ajoute, à la création en octobre 2015, l’arrivée d’un million de réfugiés syriens que l’Allemagne a accueillis l’été précédent, faisant de l’Allemagne l’un des pays les plus accueillants d’Europe, au risque (conscient) pour la chancelière Merkel de créer des remous politiques notables qui l’ont effectivement mise en difficulté.
Quand la production est créée, la question de l’accueil était au centre de l’actualité, et bien sûr la Staatsoper s’en est emparée, organisant des quêtes à la sortie du théâtre.
La question d’une Allemagne généreuse, accueillante, ouverte, syncrétique est donc au centre des préoccupations du moment et c’est cette Allemagne-là qu’Andrea Moses et Daniel Barenboim affichent et promeuvent, qui n’a rien d’un pays rabougri et peureux, mais au contraire ouvert, réuni et heureux.
Bien sûr à l’utopie nurembergeoise se substitue une utopie berlinoise, mais il reste que cette production est l’expression d’un bonheur d’être ensemble, tous différents et tous sous la bannière allemande, protectrice (y compris des amants qui flirtent) et chaleureuse, humaniste et artistique.
La République Fédérale est-elle cette république des artistes prônée par le texte, cette république platonicienne, île heureuse autour d’un monde en fusion. Évidemment pas, mais la force de ce spectacle dans toutes ses composantes est de le laisser croire, l’espace de ces 4h30 de bonheur, de sourire et d’espoir.
Ce cadre prend en compte aussi bien les espoirs de tous que quelques petits défauts : les maîtres sont des artisans commerçants qui sont autant de marques qui se promeuvent, on se permet bien des privautés pendant le service religieux initial (Walther et Eva en profitent joyeusement) et la modernité affichée conserve quand même la vision traditionnelle d’un Sachs cordonnier et tous les épisodes d’une production de type « bavarois », en ce sens, la même mise en scène pourrait s’inscrire à peu de frais dans la vision historicisante et pittoresque d’un Schenk au MET ; les personnages principaux gardent leur personnalité, il n’y a aucune prise de distance avec le livret, seule l’ambiance change, mais l’utopie reste plus ou moins la même. Aussi les détails modernistes (culture de cannabis, punks etc…) sont un habillage projetant l’intrigue aujourd’hui et amenant le spectateur à réfléchir sur la question posée par l’Allemagne actuelle, sans changer rien à l’intrigue ni au caractère des personnages.
Les protagonistes
Cette production doit énormément à Wolfgang Koch, un Sachs d’exception, dans une forme extraordinaire (après un passage à vide au moment du Fidelio munichois cet hiver) et cela mérite de s’y arrêter un peu.
Il y a deux Sachs incomparables aujourd’hui, Michael Volle et Wolfgang Koch qui exploitent et approfondissent deux facettes légèrement différentes du personnage. On pourrait ainsi le résumer, l’un, Koch, est un cordonnier-poète, et l’autre, Volle, est un poète-cordonnier. Volle se définit par un art suprême du dire et de la conversation, c’est d’abord un débatteur, un intellectuel, plus raffiné et un poil plus distant. Koch, c’est d’abord une boule d’humanité, un intuitif, qui s’est construit en autodidacte (dans cette production), et son personnage plonge dans le peuple, dont il est une émanation, et dont il représente l’humanité et le bon sens. Il est suprêmement bienveillant, mais aussi tendre et bourru, pudique et aussi réservé. On sait ce que Der Rosenkavalier doit à Meistersinger qui raconte la même histoire de renonciation de l’ancien face à la jeunesse et qui utilise des formes voisines (le quintette du troisième acte a inspiré le trio final du Rosenkavalier). Il y a chez le Sachs de Koch, quelque chose d’une une Maréchale qui serait issue du peuple, avec la même noblesse et la même pudeur. Le personnage est d’une rare justesse, avec en plus une voix, puissante et claire, un timbre chaud, une émission parfaite, un phrasé exemplaire. Sans parler de la diction si indispensable dans un rôle où la parole est déterminante. Et justement, chaque mot est pesé, chaque syllabe mastiquée, avec une variété de couleurs qui ne peut que provoquer l’admiration. Pour toutes ces raisons, Wolfgang Koch remplit la scène et remplit d’émotion le spectateur, il est l’interprète idéal de cette production qui fait de l’humanité et de la tendresse les moteurs de la performance.
Le Pogner surprise de Matti Salminen l’accompagne. Kwangchul Youn, qui était Pogner en 2015 devait reprendre le rôle, mais il a dû renoncer et Barenboim a appelé Salminen ou du moins il l’a fait sortir de sa retraite, pour être un « Meistersinger » de plus, lui qu’on a découvert remplaçant Ridderbusch dans Hunding dans la Walküre de Chéreau en 1978 et qui depuis a fait la carrière que l’on sait, élément de la grande lignée des basses finlandaises, de Martti Talvela à aujourd’hui Mika Kares.
Évidemment, la voix n’a plus le bronze d’antan, mais elle a tout le reste : le monologue final est à ce titre exceptionnel. Il y a là un sens de la couleur, du phrasé et encore un volume appréciable qui en remontre à bien des basses plus jeunes. Lui aussi comme les très grands, accorde au texte une importance primordiale, le poids , la couleur et la signification des mots apparaissent de manière stupéfiante, parce qu’il n’y a là rien de surfait, rien de surjoué, rien de maniéré, mais quelque chose de naturel qui s’accorde à merveille avec le Sachs de Koch. Salminen enrichit la représentation au point de lui donner sa lumière miraculeuse.
En 2015, Beckmesser était Markus Werba, c’est cette année Martin Gantner. Ce baryton à la riche carrière n’a jamais fait partie des stars, et pourtant, ses prestations sont toujours de grande qualité. Ce Beckmesser ne fait pas exception : son personnage n’a rien de caricatural. C’est évidemment un « traditionnaliste » (il revêt pour sa romance du deuxième acte le haut de chausses et l’habit du XVIe), plus pitoyable que ridicule dans la scène finale. Son chant est particulièrement efficace, la voix bien posée, bien projetée, l’expressivité au rendez-vous sans jamais tomber dans la caricature, avec un vrai souci de la couleur. Beckmesser doit être un magnifique chanteur (c’est un « Meister »), et en même temps afficher un style vieilli, que refusent Sachs et Walther : Gantner est vraiment très juste dans le personnage, évidemment jaloux, évidemment méfiant, évidemment perdant mais dans cette mise en scène, il fait aussi partie d’une humanité ordinaire, et ce Beckmesser là est à la hauteur des autres partenaires, il remporte un très grand succès parfaitement mérité.
David est ce jeune sud-africain Siyabonga Maqungo a été en troupe à Meiningen, et désormais à Chemnitz. La voix est inhabituelle pour David, car c’est une voix au timbre clair plutôt rossinien, voire mozartien, mais il s’en tire avec une belle expressivité et une présence scénique indéniable, dans son rôle de jeune apprenti gauche, maladroit et tendre à la fois.
Si bien qu’il remporte un très grand succès auprès du public et de fait, il est un David un peu hors normes mais qui cadre très bien et avec le sens de la production, et qui s’en sort très bien musicalement : il est rare d’avoir un David au timbre d’Almaviva, mais ça fonctionne…il est vrai que Wagner ne dédaignait pas Rossini.

Julia Kleiter reprend le rôle d’Eva qu’elle tenait en 2015 et dans laquelle on l’a revue à Munich avec Kirill Petrenko en septembre dernier. Une fois de plus on reconnaît la fraicheur du timbre, la clarté de l’émission, le sens de l’interprétation et l’attention au mot. La voix semble plus légère qu’elle n’est en réalité dans un rapport scène-salle qui lui convient très bien. De plus on la sent très à l’aise dans la mise en scène. Elle est sans conteste l’une des meilleures Eva sur le marché. Elles sont rares, les Eva incontestables, et c’est un rôle difficile à distribuer. Ce n’est un rôle pour voix légère (on voit la liste des grandes qui l’ont chanté de Gwyneth Jones à Anja Harteros), plus marquée qu’une Pamina (même si Kleiter est une grande Pamina…). J’ai dans mes souvenirs Lucia Popp qui avait une voix toute autre que légère et qui a fini Maréchale : elle fut la très grande Eva de l’après Janowitz.
Burkhard Fritz était Walther et on pouvait craindre beaucoup après avoir écouté son Parsifal catastrophique à Munich quelques semaines auparavant. Apparemment la santé était revenue, et la voix était en place. Certes, ce n’est pas un Walther de référence, mais il n’a pas démérité, notamment assumé crânement l’air final, et a fait beaucoup d’efforts visibles pour être dans le ton et la mise en scène (Vogt qui avait créé la mise en scène chantait Walther à Salzbourg et a chanté la Première, remplaçant Fritz encore souffrant)…Et le public a été chaleureux à son égard.
La Magdalene de Katharina Kammerloher, membre de la troupe de la Staatsoper, a bien assumé le rôle, qui n’est pas si évident, car il nécessite d’imposer une personnalité qui ne soit pas systématiquement dans l’ombre d’Eva, elle y a réussi et c’est heureux.
L’acoustique de la Staatsoper, le rapport entre le plateau et une salle aux dimensions moyennes de 1500 spectateurs dans sa nouvelle configuration permettent à des voix moyennes de mieux projeter et se faire entendre, et c’est une donnée importante pour les voix des maîtres, historiques ou non. Ces maîtres sont un mélange, là aussi symbolique de grandes voix d’antan et de jeunes voix en couveuse, et le mélange fluide permet à chacun d’afficher une personnalité et de dessiner un profil. Dans les jeunes, signalons Adam Kutny (Konrad Nachtigall) membre de l’Opéra Studio, les un peu moins jeunes Florian Hoffmann (Augustin Moser) et Arttu Kataja(Hermann Ortel) en troupe depuis plus d’une dizaine d’années, Jürgen Linn, un Kothner d’expérience qui a même Sachs dans son répertoire. Du côté des anciens, Franz Mazura (Hans Schwarz) a une telle personnalité, très bien valorisée par la mise en scène et soulignée par l’aura du personnage que la moindre de ses répliques ou le moindre de ses gestes fait rire la salle : on reconnaît là les artistes immenses. Graham Clark (Kunz Vogelgesang) a encore une incroyable projection qui fait que son timbre se reconnaît immédiatement dans les ensembles. Pour les autres, Jerusalem (Balthasar Zorn), Goldberg (Ulrich Eisslinger), Bär (Hans Foltz, qui traduit et explique aux émirs les détails de la Festswiese) les voir encore sur scène est un immense plaisir et une grande émotion. Soulignons enfin un autre très jeune membre du Studio, le Nachtwächter d’Erik Rosenius, jeune artiste suédois, qui fait entendre un timbre magnifique malgré un trac évident. C’est aussi un « effet Barenboïm » de laisser des jeunes s’imposer sur les plateaux et au pupitre : par exemple le jeune Thomas Guggeis, qui a pris Salomé au vol, remplaçant Dohnanyi est désormais affiché régulièrement comme chef à la Staatsoper.
Enfin, le chœur de la Staatsoper, dirigé par l’excellent Martin Wright donne aussi la preuve de son excellence et de sa ductilité, avec un final vraiment impressionnant.
À la tête d’une Staatskapelle Berlin en état de grâce (voilà les résultats de la maltraitance dont est accusé Barenboim…qui les fait systématiquement monter sur scène aux saluts pour montrer leurs blessures) dont il fait ressortir les qualités des cuivres impeccables, des bois extraordinaires qui sont particulièrement sollicités dans cette œuvre et des cordes virtuoses. Barenboim dirige avec une énergie marquée, moins chambriste qu’un Petrenko, son ouverture est spectaculaire de jeunesse, de vigueur, mais sans jamais ni se laisser complaire par la beauté du son, sans jamais étouffer le plateau, qui reste le fil conducteur de la soirée. Nous sommes à l’opposé d’une direction musicale « mise en scène », mais au contraire devant un travail d’une rare précision, un suivi très précis des chanteurs (il suffit de voir les regards fascinés des chanteurs vers le chef, y compris pendant l’ouverture à rideau ouvert), il y a là éclat, brillant, mais aussi fluidité et incroyable clarté et transparence. Dans cette salle, la fosse pourrait être envahissante, elle est avec Barenboim un merveilleux accompagnement. Pas de doute, il est ici le Boss, respecté, admiré, quelquefois un peu cabot, mais comme on lui pardonne !
La réussite de cette production tient au contexte, au chef, à l’idée de la mise en scène, et à une distribution étincelante par la grâce de Wolfgang Koch et Matti Salminen, et de tous les autres qui concourent chacun à faire de cette soirée un moment d’exception. Entre le Prokofiev de la vieille et cette soirée mémorable qui a mis le public en délire, c’est Berlin qui en cette période festivalière, nous a sans doute offert la fête la plus belle.
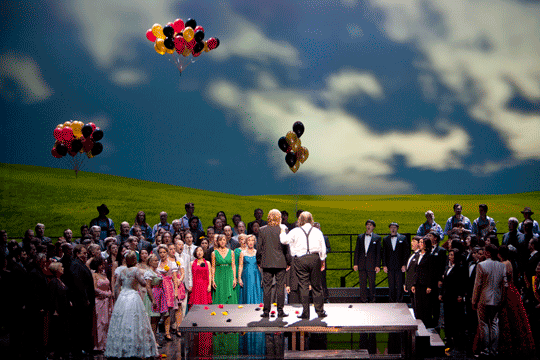

Cher Guy, c’est un texte excellent ! Sowohl, was die Kritik der Aufführung als auch, was deren Einbettung in die deutsche Geschichte angeht. Bravissimo !