
Fidelio ou la complexité
Cette production de Fidelio due à Calixto Bieito est déjà assez ancienne au répertoire de la Bayerische Staatsoper. C’est un opéra que tout théâtre en Allemagne doit avoir à son répertoire. Les deux dernières productions d’importance ont été celle de la Staatsoper de Berlin (automne 2016) sous la direction de Daniel Barenboim dans une production de Harry Kupfer qui n’avait pas beaucoup séduit et celle de George Delnon (janvier 2018) sous la direction de Kent Nagano qui n’a pas non plus convaincu. Mais existe-t-il une production de Fidelio qui soit satisfaisante ?
On a assez dit la difficulté d’un opéra qui a eu du mal à naître, et dont la construction reste peu convaincante, tant la dramaturgie du premier acte diffère de celle du second.
Au premier acte, l’exposition des personnages et des enjeux, au deuxième acte l’action. D’où aussi un style musical très contrasté, entre des survivances mozartiennes au I et d’autres plus cherubiniennes au II.
Aux origines de cette musique en effet, il y a les succès populaires de la fin du XVIIIe et notamment les fameuses pièces à sauvetage. Si quelques moments du premier acte tirent vers Die Zauberflöte, c’est évidemment parce que c’est dans son genre une pièce à sauvetage, mais la musique tire aussi vers Cherubini dont le plus grand succès de l’époque, Lodoiska((200 représentations sous la Révolution : on se demande ce qu’attend l’Opéra de Paris pour en proposer une grande version)), a été étudié par tous les compositeurs contemporains, et Beethoven le connaissait si bien qu’il le cite et lui emprunte quelques phrases. Si Lodoïska semble si beethovenienne, c’est qu’en fait Beethoven a été très cherubinien. Il convient de rendre à César ce qui appartient à César sans ôter à la musique de Beethoven son génie ni son originalité, évidemment.
Lorsque Beethoven entreprend la composition de son opéra, il choisit donc un thème encore à la mode qui a couru les dernières années du siècle précédent. Quand en 1814, il crée la version définitive, la mode en est peut-être passée.
Le livret est ainsi disparate, et Calixto Bieito – avait été abondamment hué à la création (2010)- sans renoncer au message humaniste de l’œuvre, a cherché à se libérer d’un livret bancale, notamment pour l’acte I, tout en proposant une vision d’ensemble unitaire.
La question dramaturgique en effet posée par l’œuvre est une différence marquée entre l’acte I qui sert d’exposition, pose les conditions du déroulement de l’acte II, installe le drame et les personnages, Rocco, Pizarro et Marzelline, dans un style assez souvent proche du Singspiel, notamment dans les relations entre Marzelline et Jaquino mais avec des moments hautement dramatiques (Abscheulicher…). Entre ces moments d’un drame « bourgeois » et la haute puissance dramatique du deuxième acte, entre un premier acte entrecoupé de dialogues qui cassent un peu le rythme, et un deuxième acte où la musique prime nettement sur les parties dialoguées, il y a pour un metteur en scène des contradictions à résoudre.
Le labyrinthe comme figure de la quête
Bieito part de l’idée centrale du livret qui est la « libération », l’aspiration à la liberté, mais constate en même temps que tous les personnages du premier acte sont dans une quête, notamment Fidelio certes, mais aussi Marzelline qui se rend compte qu’elle n’aime plus (l’a‑t‑elle jamais aimé ?) Jaquino et qui se fixe la conquête de Fidelio. Il n’établit pas de hiérarchie entre eux, chacun poursuivant sa quête. Ainsi, partant d’un texte de Jorge-Luis Borges sur le Labyrinthe, il imagine un espace mental labyrinthique dans lequel chaque personnage cherche sa voie (Rocco entre en scène en disant « Wo ist der Weg, ich kann den Weg nicht finden ! ((Où est le chemin, je ne peux trouver le chemin !)). Même Florestan (une doublure) apparaît au départ, se jetant d’un coin à l’autre du labyrinthe d’une manière sauvage.)
On connaît la fortune de l’image du Labyrinthe depuis l’antiquité et la légende du Minotaure, mais aussi la fascination pour cette forme à la fin du Moyen âge et à la Renaissance notamment dans l’art des jardins, une forme dans laquelle on rentre et où l’on perd tout sens de la direction et de l’orientation jusqu’à rester prisonnier (d’où l’idée de prison qui reste centrale mais élargie à la vie et au cosmos). Le Labyrinthe vu verticalement par le décor casse le sens et la pesanteur, et les personnages (il est exigé des chanteurs des efforts singuliers pour grimper d’un espace à l’autre, et Marzelline notamment chante en situation quelquefois acrobatique). Cette volonté de placer les personnages en apesanteur se lit aussi au début du second acte où des êtres suspendus semblent flotter au-dessus du labyrinthe désormais plus classiquement au sol, et non plus vertical (voir la photo de l’en-tête).
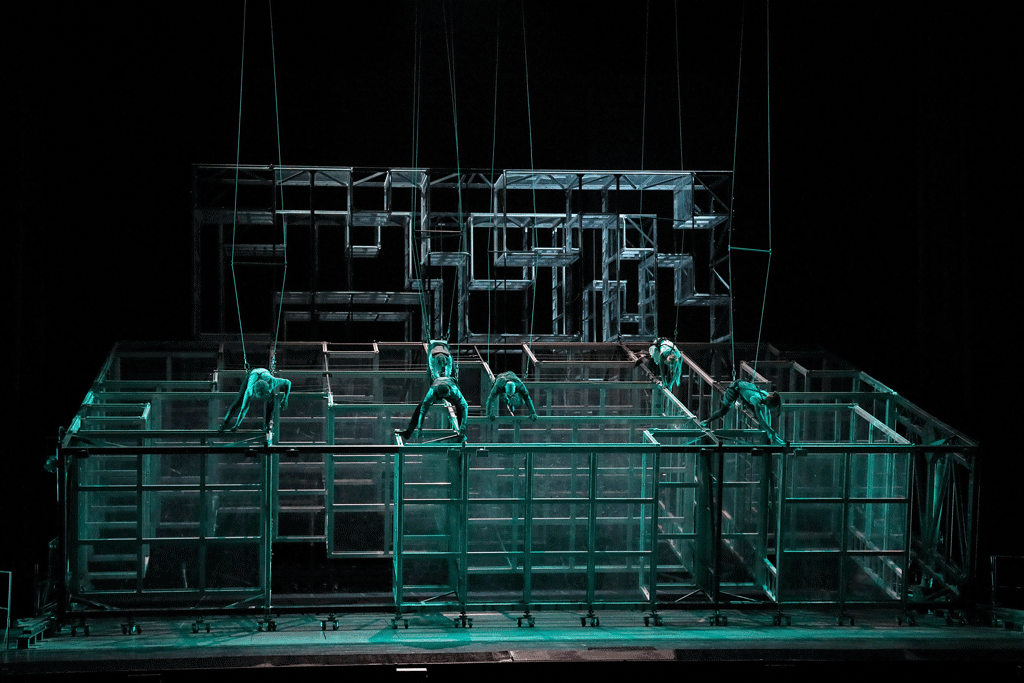
Suivant Borges, Calixto Bieito fait de cette image de labyrinthe à la fois une espérance, l’espoir d’un salut mais en même temps une figuration cosmique, voire métaphysique, replaçant la recherche du bonheur dans un contexte très illuministe.
Ainsi dans cette production le décor est-il lui-même l’outil de la quête. Un labyrinthe de plexiglas vu d’en haut et donc vertical pour le public construit par sa décoratrice Rebecca Ringst, et donc l’œuvre devient une totale abstraction où chacun cherche sa voie.
En même temps le premier acte libéré de son sujet peut devenir une entité expositive nouvelle, où chacun erre, et où la musique se déroule presque sans interruption dialoguée, mais interrompue de temps à autres par des textes de Jorge-Luis Borges qui font sens.
Ainsi au lieu de partir du livret original, tout en en respectant l’esprit, Bieito part de la signification de l’ensemble de l’œuvre, il part du discours habituel sur Fidelio (libération, revendication de liberté, arbitraire du pouvoir, enfermement) pour en faire une idée unique qui occupe les personnages, celle d’atteindre au bonheur (y compris Pizarro qui cherche à se libérer de Florestan), une idée évidemment héritée des Lumières ((voir à ce propos de Robert Mauzi : L'Idée du Bonheur au XVIIIe siècle, Paris, A.Colin, 1960)).
Un second acte qui est application concrète de la quête

Le deuxième acte est beaucoup plus « fidèle » à la lettre du livret : Florestan devient un symbole vivant de la quête abstraite posée initialement (le chœur des prisonniers qui chacun tiennent une photo de Florestan en est l’indice annonciateur au premier acte). Il est le fond du labyrinthe, il est le but poursuivi par Leonore, et le décor se place à l’horizontale, les personnages en émergent et évoluent essentiellement sur le proscenium. Nous retrouvons une vision plus traditionnelle, avec quelques variations : Leonore jette de l’acide à la tête de Pizarro pour le neutraliser, et Rocco prend la défense de la jeune femme presque immédiatement.
C’est le personnage de Florestan qui est plus en retrait, « ailleurs » en quelque sorte, il entre à son tour dans le labyrinthe, et disparaît momentanément, avec un air hagard comme si sa quête continuait.
Deux idées vont frapper ce second acte, et vont l’habiter :
- L’ouverture Leonore III ayant été jouée à la place de l’ouverture, la transition entre les deux parties de l’acte II est marquée, d’une manière sublime, par l’interprétation par un quatuor de l’adagio (raccourci) de l’op.132 en la mineur, on entend la musique et les musiciens descendent des cintres enfermés dans des cages, en une image très frappante, mais en même temps si la vue souligne l’enfermement, la musique qui s’en échappe est image d’absolue liberté, puisque le son passe la cage ((Il faut préciser que l’idée vient de la mise en scène de 2010 et n’est pas un ajout de la direction musicale de Kirill Petrenko)). Cette image à la fois mélancolique et sublime, optimiste malgré la situation d’enfermement, est sans doute la plus frappante de la production.
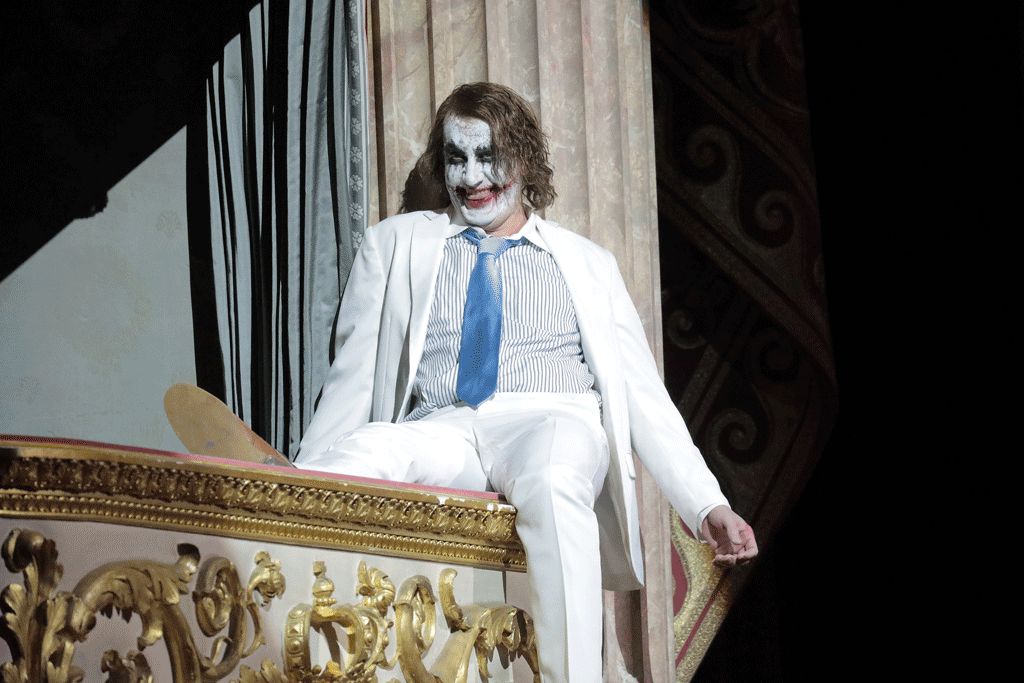
- Le ministre Don Fernando, pur Deus ex Machina, apparaît dans une loge d’avant-scène, hors plateau, sous les traits d’un Joker des jeux de cartes, personnage plutôt amusé, ironique (très bon Tareq Nazmi) , qui prend évidemment sa distance avec l’histoire, et qui va régler, tel un metteur en scène, les péripéties de la fin, pendant que le chœur se presse au proscenium. Cette très belle idée remet à distance et toute la fin, sans la remettre en question. Elle souligne seulement la nécessité de se conformer à la fin heureuse au happy end imposé par le genre : le chœur arbore, tout comme Florestan, une affichette où est inscrit le mot FREI (libre), là où le chœur des prisonniers arborait la photo de Florestan, en un geste obligatoire et convenu.
Les deux personnages principaux, Leonore et Florestan vont quitter leurs habits de prison (Florestan quitte son pyjama bleu ciel pour enfiler à vue des habits plus neutres et invisibles costume/cravate, et Leonore quitte ses habits d’homme pour une robe bleue pétrole qui affirme sa féminité reconquise. Pizzaro disparaît et les autres restent tels qu’en eux-mêmes, sans résolution. Le retour de Florestan et Leonore à la « normalité » et en quelque sorte à l’anonymat constitue aussi une vision ironique dont le monde se satisferait alors que l’image finale est la remise à la verticale du labyrinthe : la quête n’est pas finie…
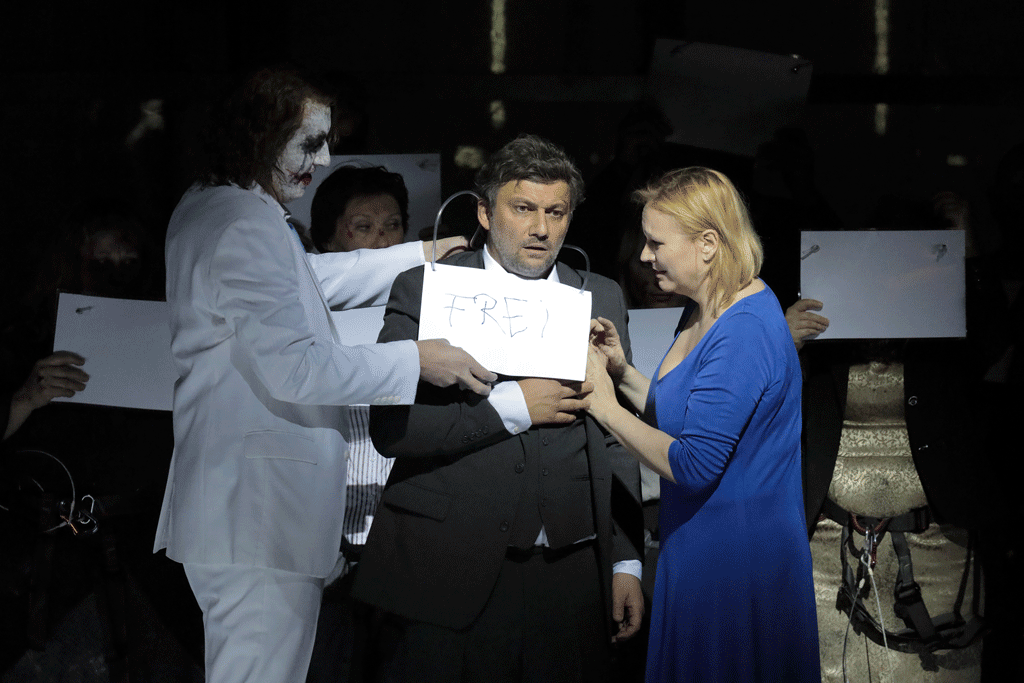
Alors que la première partie, par la construction que lui impose Bieito, est plus proche d’un oratorio que d’un opéra, où les personnages ne sont caractérisés de manière floue : c’est clair dans la relation du couple Jaquino/Marzelline avec un Jaquino perdu dans son labyrinthe, sans réelle issue, c’est clair aussi dans un ensemble où il n’y pas vraiment d’action. Rocco n’a plus rien du geôlier, mais plutôt une sorte de trafiquant avec ses lunettes, son costume gris et son attaché ‑case (plein de billets) qu’il serre précieusement contre lui et le chœur des prisonniers est fait non de forçats, mais d’hommes en costume gris presque anonymes qui brandissent une photo de Florestan, comme un peuple revendiquant son symbole libératoire. Les rôles sont transformés voire effacés, les fonctions symboliques restent. Et donc l’esprit de l’œuvre est respecté.
La question de la musique : les voix
La question de la musique comme élément de libération l’est un des points importants du spectacle, comme l’atteste la présence du quatuor en cage, qui devient symbole de liberté nous induit évidemment à considérer les aspects musicaux de ce Fidelio exceptionnel.
La distribution qui ailleurs serait digne de festival, est celle d’une représentation dite « de répertoire ».
Anja Kampe qui chante Léonore depuis plus d’une dizaine d’années (elle était alors un jeune espoir du chant et chantait la Léonore d’Abbado,) est très en voix avec des aigus triomphants, peut-être un peu trop dardés et un peu trop puissants, en dépit de la souplesse et d’une certaine douceur nécessaire à Leonore. Léonore n’est pas un soprano dramatique, mais une de ces voix hybrides impossibles à trouver sur le marché, parce que Beethoven ne sait pas toujours écrire pour les voix oscillant entre le lyrique et le colorature dramatique. Et Kampe chante certes en force mais pas toujours en souplesse. Il reste qu’elle est un magnifique personnage, engagé et radieux qui remplit la scène.
Jonas Kaufmann est un Florestan supérieur. Comme toujours, son « Gott » susurré qui monte en force est exceptionnel, il est le seul aujourd’hui à pouvoir le faire de cette manière tellement contrôlée. Dans ce rôle où il n’est pas sans rappeler Jon Vickers, le timbre semble moins sombre, moins « barytonnant » que d’habitude et la voix est claire, lumineuse, sûre (malgré un ou deux menus accidents). C’est un Florestan exemplaire, par le phrasé, par l’expression, par le contrôle, mais aussi par le charisme quasiment unique aujourd’hui. Il forme avec Anja Kampe un couple d’une fougue inouïe, presque idéal.
Günther Groissböck a acquis une maturité qui en fait l’une des basses de référence, vif, expressif, ciselant chaque mot parce que très soucieux de la diction et de la compréhension du texte, il offre de Rocco une image inhabituelle, mais la voix puissante, la projection, le jeu également en font un Rocco d’exception.

Wolfgang Koch a toujours lui aussi ce souci du texte et de la diction qui en font un des grands chanteurs du moment, mais il traverse une période un peu difficile, et la voix a perdu son éclat ; plus mate, elle projette moins, les graves sont détimbrés et les aigus ne sont projetés que partiellement, certains sortent, d’autres non. La prestation en Pizarro est nettement plus pâle que ce à quoi ce chanteur nous a habitués.
Manuel Günther remplace Dean Power dans Jaquino où dans cette mise en scène il est très présent, au premier acte, toujours à vue, toujours dans le labyrinthe. Le timbre est séduisant mais la voix manque peut-être un peu de puissance.
Enfin, Hanna-Elisabeth Müller est touchante dans Marzelline. La mise en scène l’oblige à des acrobaties et des équilibres instables dont elle se sort avec un certain cran. Les centres sont bien contrôlés, et c’est une artiste qui cherche à chanter avec un vrai style. Il reste que depuis quelques années les aigus sont moins contrôlés, plus métalliques et coupants, ce qui tranche avec la morbidezza des centres. Il en résulte un problème d’homogénéité qu’elle n’arrive pas à résoudre et c’est dommage. Mais elle reste une Marzelline présente, pleine de relief, très émouvante et très fraîche.
Quant à Tareq Nazmi, il est un Fernando "Joker" qui donne un relief inattendu au rôle, très réussi dans une partie habituellement attendue et sans saveur.
Au total, l’équipe de chanteurs répond à la précision pointilleuse de Petrenko et affiche dans l’ensemble un bel engagement, parfaitement en phase avec la mise en scène, mais aussi la direction musicale. Elle répond au défi, et reste elle-aussi l’artisan de cette réussite exceptionnelle.
Il n’y a pas de Fidelio sans un grand chœur, et le chœur de Munich, dirigé ici par Stellario Fagone, est exemplaire : le chœur des prisonniers dégage une rare émotion, ainsi que tout le final où avec une projection et un volume exceptionnels il suit le rythme imposé par le chef avec une précision et un engagement de tous les instants.
La question de la musique : la direction musicale
La musique de Beethoven dans cette œuvre est aussi stylistiquement hybride, avec des souvenirs des opéras comiques de la fin du XVIIIème, ce qui n’est pas sans conséquence sur la couleur vocale, très différente entre le premier et le deuxième acte. En évoquant Cherubini, dont le souvenir est omniprésent, en évoquant aussi Mozart (on entend la Flûte Enchantée), on évoque en même temps un style vocal qui n’a rien à voir avec l’héroïsme du deuxième acte, un style avec récitatifs, dialogues, agilités, ensembles, qui renvoie aux dernières années du siècle précédent et qui impose des choix de couleur et des techniques qu’on ne retrouve pas au deuxième acte. Il y a dans la première partie des moments d’une grande délicatesse (le quatuor est un moment littéralement miraculeux de retenue et d’émotion) et la direction doit rendre cette diversité-là.
C’est bien ce à quoi Petrenko répond, à la tête d’un orchestre lui aussi exemplaire, devenu le meilleur orchestre de fosse au monde aujourd’hui, et qui obéit au doigt et à l’œil à son chef. Chaque pupitre est mis en relief, avec des bois remarquables, avec des timbales spectaculaires, avec des cordes à la fois soyeuses et énergiques. On connaît la précision du chef et son souci de limpidité, qui illumine les partitions les plus connues. C’est ici le cas.
Cette direction est extraordinaire de ductilité. Avec deux manières différentes d’aborder la première et la seconde partie, il fait entendre une première partie ronde, aux échos mozartiens, on se surprend plusieurs fois à penser à la Flûte enchantée, dans une construction qui correspond à la mise en scène. Petrenko a toujours le souci de diriger en cohérence avec ce qui se passe sur le plateau, en donnant souvent à la musique une couleur d’oratorio, soignant les moments les plus lyriques (le quatuor…) demandant aux chanteurs d’aller au bout des possibles avec un chant totalement maîtrisé sur tout le spectre, en accompagnant avec une rondeur étonnante les moments les plus émouvants (le chœur des prisonniers), mais quand la musique se tend subitement on retrouve les contrastes, le côté incisif, les déchirures (dès l’ouverture Leonore III, impressionnante, mais aussi dans Abscheulicher…).
Le second acte, dont la mise en scène rompt avec l’ambiance presque métaphysique du premier acte, et retrouve avec l’ardeur beethovenienne, un déroulé plus conforme à ce que le spectateur attend, comme on l’a vu plus haut, et Kirill Petrenko impose une tension presque inédite : les premières mesures, qui précèdent l’air de Florestan (Gott), offrent une ambiance lourde, coupante, contrastée (impressionnants coup de timbales en incroyable crescendo) qui surprend par sa violence, et il y a dans tout l’acte une urgence qu’on a rarement entendue et qui laisse le spectateur « sonné » au baisser de rideau, après les dernières mesures explosives.
Seul moment suspendu, l’intervention du quatuor, sublime parenthèse qui est sans doute un climax, qui marque que Leonore a atteint son but et a reconquis son bonheur. Et ce quatuor sublime enfermé dans une cage n’est pas sans rappeler ce qu’on a appelé le « bonheur en prison » stendhalien, ce romancier si proche des Lumières et notamment de Rousseau.
Ainsi la musique transcende les murs.
L’explosion qui va soutenir la dernière scène avec le chœur au premier plan va donner à la musique cette liberté revendiquée par la mise en scène et déchainer l’enthousiasme face à un Fidelio qui est sans doute l’un des plus réussis des dernières années sinon la référence.

