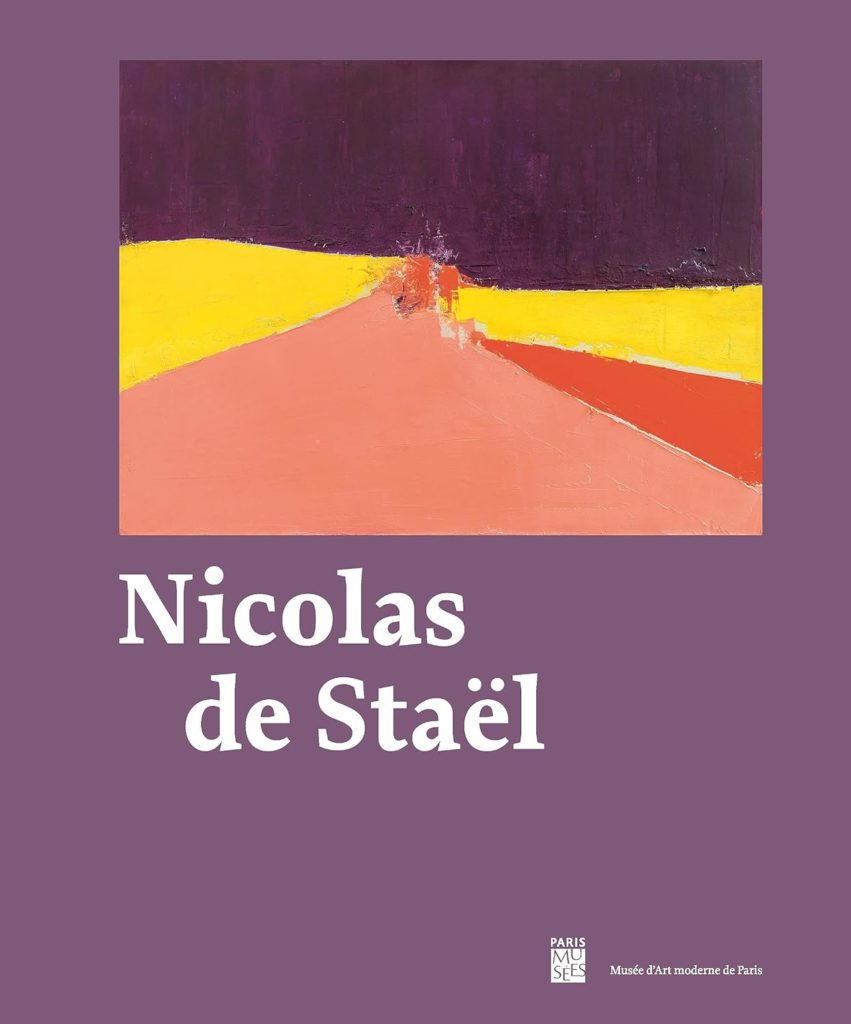Attendre 41 ans pour se suicider, c’est quasiment faire figure de patriarche par comparaison avec les plus illustres artistes maudits, très loin des 18 ans de Thomas Chatterton, et un peu plus tard que les 37 ans de Van Gogh. Nicolas de Staël s’est donné la mort alors qu’il était encore jeune et beau, et en plein succès. Une mort violente, qui plus est, puisqu’il s’est jeté de la terrasse de son atelier, le 16 mars 1955. Ce n’est pas faute d’avoir pu vendre ses œuvres que Nicolas de Staël jugeait la vie trop dure, mais plutôt parce qu’il était trop dur envers lui-même, parce qu’il plaçait la barre toujours plus haut, dans un souci constant de renouvellement et d’approfondissement. Un millier de toiles en une quinzaine d’années, et autant de dessins, c’est une production abondante et changeante : pour reprendre la formule des commissaires de l’exposition que présente cet automne le Musée d’Art moderne de Paris (et qui sera ensuite visible à la Fondation de l’Hermitage, à Lausanne), chacune des périodes de la maturité de Staël correspond environ à une année. Beaucoup de revirements, donc, beaucoup de changements de cap pour un artiste toujours plus exigeant envers lui-même.
Outre le mythe qu’il a contribué à créer en se suicidant, Nicolas de Staël pâtit aussi, semble-t-il, d’une réputation d’artiste trop facile, c’est-à-dire trop facile à aimer. A partir des années 1950, ses couleurs sont le plus souvent vives, éclatantes, presque à l’excès pour les toiles peintes en Sicile en 1953. Et puis l’œil parvient le plus souvent à y reconnaître quelque chose, paysage ou objet, ce qui rassure le profane en lui permettant de trouver un ancrage dans une réalité familière. Moderne mais accessible, l’étiquette est presque insultante pour les beaux esprits. Staël n’est pas celui par qui le scandale arrive, il ne provoque pas, ne cherche pas à épater le bourgeois. Aimable, l’œuvre de Staël est aimée, on en veut pour preuve le fait qu’un grand nombre de ses œuvres sont encore aujourd’hui en mains privées : qui ne voudrait, à condition d’en avoir les moyens, accrocher un Nicolas de Staël dans son salon ou sa salle à manger ?

La présente manifestation tente donc d’évoquer toute la diversité de l’artiste, en mettant en relief des aspects moins souvent abordés dans son œuvre, à commencer par la forte présence des dessins : environ soixante-dix sur les quelque deux cents pièces au catalogue. Evidemment, si l’on considère que la séduction des toiles de Staël tient en grande partie à ces couleurs mentionnées plus haut, on peut trouver ces œuvres graphiques moins attirantes. Elles sont au moins l’intérêt de nous ouvrir les coulisses de la création, avec les recherches préparatoires auxquelles se livrait le peintre. Elles montrent aussi une économie de trait qui pourrait rappeler Matisse, la sensualité en moins. Les compositions abstraites à l’encre de Chine ont peut-être plus de force immédiate. Dommage en tout cas que Staël ait peu pratiqué la gravure, car ses douze bois illustrant des poèmes de son ami René Char témoignent d’une belle maîtrise.
Le parcours suit la chronologie, la première salle résumant les tâtonnements d’un jeune homme qui voyage en Europe et au-delà (le Maroc sur les traces de Delacroix), et qui ne bascule dans l’abstraction qu’en 1942. Exposé à Paris au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il est aussitôt lancé, et c’est une carrière aussi brève qu’intense qui démarre alors. Les toiles sont très sombres, des hachures noires zébrant un fond presque aussi noir. L’énergie est indéniable, comme en témoigne « De la danse » (1946), et la palette s’éclaircit rapidement. Dès 1950, l’influence de Braque se manifeste à travers de grandes plages de couleur encore un peu sourde, mais au mouvement moins frénétique. Aux larges zones unies succède en 1951 la fragmentation en petits carrés, juxtaposés en des grilles plus ou moins bigarrées. Telle Ville blanche fait penser à l’émiettement d’une Vieira da Silva (à laquelle il avait rendu visite dans son atelier parisien dès 1938). L’artiste s’affranchit des contraintes de ces mosaïques avec la superbe Composition fond blanc, où des formes de tailles variées flottent librement à la surface de la toile, comme les nuages dans les nymphéas du dernier Monet.
Et c’est précisément vers le paysage que Staël s’oriente ensuite, tournant le dos à l’abstraction lorsqu’il multiplie les esquisses sur le motif, scènes de plage ou vues de ciel, petits formats sur carton exécutés dans diverses régions de France, Provence, Normandie ou banlieue parisienne. Dans son esprit, il ne peut s’agir que d’études préliminaires, avant la conception en atelier d’œuvres plus ambitieuses. C’est en 1952 qu’il reprend un sujet déjà traité quelques décennies plus tôt par Delaunay, Gleizes ou Lhote : le football, son travail autour de ce sujet étant résumé dans la grande toile intitulée Parc des Princes (vendue pour un prix record chez Christie’s en 2019), qui trouve un parfait équilibre dynamique entre stylisation des silhouettes et abstraction des grands aplats de couleur du fond.

Nicolas de Staël est aussi un mélomane, on s’en rend compte à travers un titre comme Les Indes galantes, qui renvoie évidemment au fastueux spectacle monté à l’Opéra de Paris en juin 1952 par Maurice Lehmann, ou L’Orchestre, évocation de la puissance d’une formation symphonique où l’on distingue une ou deux formes reconnaissables, mais où c’est avant tout la sensibilité de l’artiste qui se donne libre cours. De manière assez stupéfiante, à cette immense panneau (2m x 3,50m, comme Parc des Princes) répond sur le mur adjacent une toile tout aussi vaste, mais consacrée à un sujet bien plus modeste, Bouteilles dans l’atelier. La nature morte est un genre que Staël n’a cessé de pratiquer jusque dans les derniers mois de son parcours : cette scène de 1953 est sans doute la variation la plus monumentale sur un thème qui revient tout au long de l’exposition (bouquets de fleurs presque naïfs, parfois) et jusque dans les ultimes salles, avec ces réunions d’ustensiles et fruits cézanniens, cafetière et oranges, mais alignés et non plus disposés en un groupe pittoresque.
Autre sujet que l’on connaît moins : le traitement de la figure humaine (même si une exposition spécifique lui a été consacrée à Antibes en 2014). Le modèle féminin est ici privilégié, le peintre représentant avant tout sa muse du moment : dans sa magistrale Femme assise de 1953 les contours des jambes émergent d’une sorte de dissolution générale des formes, et l’on remarque plus loin les études de nus monochromes débouchant sur le radical Nu couché bleu (1955). Après les couleurs éblouissantes de la Sicile, verts, violets et jaunes presque criards, le paysage s’assagit un peu avec les marines réalisées autour d’Antibes. Pour un délicat Paysage sur fond rose de 1954, Staël utilise le motif des barques de pêche, dans des teintes délicieusement irréelles. Et c’est alors qu’il aspirait toujours plus à la transparence et à la fluidité que le peintre décida d’interrompre définitivement une trajectoire dont l’exposition du MAM rappelle combien elle fut exemplaire.
Catalogue dirigé par Charlotte Barat et Pierre Wat, 398 pages, 23,9 x 29,9 cm, Paris Musées, 2023