Dans la jeune histoire pollinienne à laquelle ma mémoire a accès (celle des dix dernières années, où je n’ai raté, sauf erreur, aucune apparition parisienne), Chopin a été le compositeur le plus sollicité : sept parties de concerts, avec celle de ce millésime, lui ont été consacrées – à Pleyel, un unique récital monographique ; un couplage avec Nono ; un autre avec Debussy (1er Livre des Préludes) ; et à la Philharmonie, un avec Boulez, l’autre avec Schumann, enfin celui-ci. Le programme de 2017 a pour principal attrait de proposer les deux ballades (3e et 4e) qui n’avaient pas été jouées à Paris par Pollini au XXIe siècle, sauf erreur (la 2ème ayant été programmée en 2009 et 2012, la 1ère en 2007 puis jouée chaque année en bis depuis 2011, sauf en 2012. Le reste de la partie chopinienne appartient aux terrains arpentés sans relâche dans le glorieux été indien du maestro. L’opus 27, qu’il a réenregistré après l’intégrale des nocturnes de 2005, avait déjà été proposé lors du splendide tutto-Chopin récital de 2011, tout comme le 1er Scherzo, également joué en 2009. Enfin, la Berceuse figurait pour la première fois au programme régulier, mais avait été donnée (et comment !) en bis en 2011. En dix ans Paris a donc pu entendre les opus 20, 23, 27, 28, 35, 38, 39, 45, 47, 52, 55, 57, 60 (et presque tout l’opus 25), mais pas encore, contrairement à d’autres villes à la même période, les opus 30, 31, 36 (hélas…), 59, 61, 62 ou 63. Et puis, reste pour tout aficionado des désirs encore insatisfaits : par exemple que Pollini remette enfin sur le métier deux chefs‑d’œuvre qui lui iraient comme un gant : la 3e Sonate, le 4e Scherzo et le 3e Impromptu…
L’été indien de Pollini pourrait avoir pour devise celle de Don Giovanni – Viva la liberta ! à laquelle le trio répond Siam grati a tanti segni di generosita ! Mais, outre qu’elle ne se consume que dans un don qui ne blesse personne, elle doit être complétée par celle de Brahms – Frei, aber Froh. En 2003, il déclarait dans un entretien à Libération vouloir jouer Chopin « avec plus de liberté » qu’auparavant. De fait, ce que l’on peut nommer le tournant, sinon la révolution du piano pollinien, s’est accompli dans les toutes premières années du siècle nouveau. Changer sa vision des choses à soixante ans est, pour un artiste, pour un interprète plus encore, un défi considérable. Pour un pianiste, le faire en remettant en danger les fondamentaux de sa technique et de son rapport à l’instrument est un tour de force auquel on ne connaît guère d’équivalent dans l’histoire des géants du piano (le rapport au son de Richter a sans doute évolué, mais un peu plus précocement dans sa carrière et de façon plus progressive). La quête du vibrato pianistique, de la plasticité d’un son vivant, d’une intégration organique de l’écoute harmonique, prend un sens musical et non simplement sensuel en rendant possible, plausible, un idéal furtwänglerien du rendu de la forme : un piano et un jeu de piano pour ainsi dire transcendantaux, générant une lecture radicalement singulière des textes à partir de l’expression de leurs propres conditions matérielles. Cette réforme radicale devait être totale, en incluant l’enjeu matériel de l’instrument, le Steinway préparé par Angelo Fabbrini, que je n’avais pas entendu de près depuis longtemps (et précisément, si comme tout grand pianiste Pollini gagne à être entendu en hauteur, peu autant que lui sont aussi intéressants à observer de près, pour admirer son jeu si économe de mouvements digitaux, et donc cette autre étonnante mécanique). Parmi la myriade de petits traits le distinguant délicatement des modèles standard, new-yorkais en particulier, il y a ce registre aigu à la projection plus réduite, incapable de claquement, mais capable de micro-variations dynamiques d’une extrême finesse, y compris et surtout avec la pédale forte. Et surtout, l’instrument semble au moins aussi responsable que Pollini de l’extraordinaire mélange de densité et de netteté dans l’opposition des registres (La Terrasse des audiences…)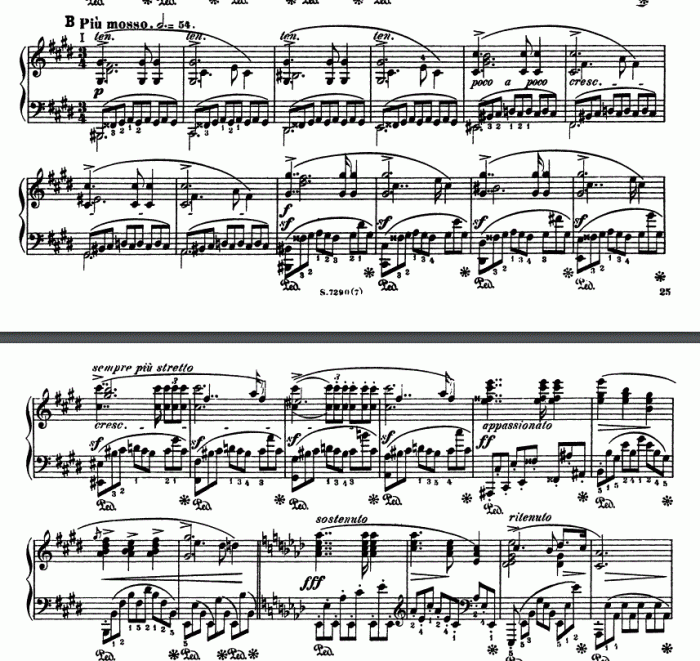
Ces vertus cardinales du Pollini des quinze dernières années sont celles qui illuminent tous ses enregistrements de cette période (au premier rang : les quatre concertos de Mozart avec le Wiener ; les opus 30 à 38 de Chopin ; les opus 2 de Beethoven), et les instantanés les plus miraculeux de ses récitals parisiens. Dans la partie Chopin de cette soirée, la seule ombre très relative est portée sur la ballade en la bémol, qui pourrait rester la seule des quatre, à ce jour, pour laquelle Pollini n’a pas encore trouvé le ton juste, ou plutôt, l’adéquation efficace entre la partition, sa structure ambigüe, incertaine, et le flux intégrateur de son jeu. La dimension organique, le jaillissement sauvage de l’idée musicale se refusent pour partie à cette partition où la ligne n’aime pas être directrice. Les besoins de clarté, d’aération de la texture, de retenu des silences, et d’un aspect versatile dans la conduite des voix sont autant de contradictions au moins partielles posées à ce piano et à cet esprit-là. La caractérisation rythmique de la seconde idée (le petit galop de cheval cher à Churchill et Moiseiwitsch) ne peut à la fois recevoir son rebond naturel et bénéficier, comme ici, du legato vibrato de Pollini. Rendons justice au fait que l’esprit, conquérant, comme le son chaleureux, surmontent au moins d’autres écueils sur lesquels se fracassent bien des interprètes : le risque de la préciosité, et l’absence de continuité. S’il est une chose que l’on ne peut jamais reprocher à Pollini, c’est de donner l’impression qu’une œuvre commence trois, cinq ou douze fois. De fait, cette 3e Ballade se compose d’un crescendo lyrique qui peut bien, après tout, tenir lieu de justification comme une autre pour la coda, dont les dimensions et l’emphase extravagantes en regard du matériau de départ ne paraissent guère crédibles sous d’autres doigts. C’est univoque, trop sans doute, mais au moins y a‑t‑il une voix qui parle. La trajectoire de caractérisation unique ne pose aucun problème dans la 4e Ballade. Torrentielle variation symphonique, processus d’expansion inexorable, elle bénéficie d’un Pollini royalement confiant en ses moyens, aussi propre qu’il est rugissant (le déploiement initial de la coda, dont l’étreinte a une puissance wagnérienne), aussi dense dans ses attaques qu’impressionnant d’assurance dans ses déplacements. Rarement l’a‑t‑on vu sur scène (sinon dans le concerto en ré mineur de Brahms, ou l’opus 110 de Beethoven) à ce point maître de tous les paramètres de l’instrument, harmonie, cantabile, dynamique, et rythme – on sous-estime, parce qu’il donne l’impression d’abolir la barre de mesure à la manière d’un grand chef, l’importance fondamentale de cette composante dans son jeu, alors qu’elle est la condition pour que celui-ci ne produise pas une sorte d’ondulation d’accords indifférents.
Les mêmes remarques s’appliquent au scherzo en si mineur, qui avait déçu à Pleyel il y a huit ans (forcé, plus raide et moins conduit à la fois), et où tout ici semble tomber lui sous les doigts et acquérir ainsi une évidence expressive confondante. Pollini a pu par le passé avoir tendance à presser la berceuse centrale comme par peur de sentimentalisme. Ce soir, il pressait, mettait dans les poignantes marches harmoniques ornementées une urgence peu commune (on en vient à penser à la folie d’Horowitz ici), mais avec une souplesse de battue, une liberté et une spontanéité de phrasé par lesquelles le sentiment ne pouvait être qu’aussi noble qu’abondant. « La » berceuse avait quant à elle déjà ébloui lors de l’inoubliable série de bis du récital Chopin de 2011, aux côtés de la 1e Ballade et de l’op. 10/12. Elle semble avoir acquis encore une densité supplémentaire, une dimension moderniste insolente (et sévère en même temps) sans rien céder du côté de la plénitude sonore. Certes, c’est peu intime, peu apaisé, et on s’y perd d’une autre façon que dans le vagabondage un peu évanescent auquel on est habitués : plutôt par le fait d’être tiré par une force dans des directions changeantes auxquelles est opposée la polarisation obstinée de la main gauche. Les jaillissements de la droite, où chaque note, y compris et surtout petite, a le poids suggestif d’un pôle tonal alternatif, projettent l’écoute dans le Debussy à venir, mais bien au-delà, dans l’écriture pianistique des cinquante dernières années, celle de Boulez au premier chef. Il va de soi que la même description pourrait valoir pour le nocturne en ré bémol, comme on l’a entendu ce soir, somptueux et à l’exact opposé de la vision absolument contemplative et complémentaire que nous offre régulièrement un des rares pianos aussi racés, celui de Leonskaja. Mais dans la Berceuse, les chromatismes prennent un autre sens que d’étirer ou ornementer le chemin d’un point au suivant ; les notes de passage cessent d’être des étrangers de passage dans la tonalité ; la tension se réfère certes à un pôle tonal, mais sans relations confirmant sa fonction. L’enjeu devient pour partie celui d’une étude de textures, traitant l’idée nue, au sens de Schoenberg : congédiée de toute représentation particulière.
Quant au nocturne en ut dièse mineur qui déflorait la soirée, il composait une rampe de lancement idéale pour ce pianiste qui nous a tant habitué à des entrées en matière fébriles, toujours aussi tracardes après 57 ans passées sur les plus grandes scènes du monde : forcé de commencer avec gravité et retenue, Pollini ne commettait par son pêché de survol comme dans le prélude dans la même tonalité qui ouvrait le récital de 2013. L’instabilité, inquiétante étrangeté de l’écriture même, avec son déplacement d’accent harmonique au sein de la mesure (pour emprunter les catégories de Schoenberg), est sévèrement mise en exergue, quand l’éruption lyrique centrale éblouit et bouleverse par sa plénitude de phrasé (car on peut phraser, et avec quelle intelligence, des octaves répétées, quand on joue aussi bien du piano sur un si bel instrument) et de son (cette main gauche qui roule sur du velours, mais gronde, et enfle sans fin). Cette senestre seigneuriale irradie à l’identique toute la seconde partie, que ce soit encore dans l’ondulation (Feux d’artifice), la tenue (Bruyères, S. Pickwick), le timbrage extrême (l’attaque de General Lavinne poussant l’instrument aux limites pour produire un éclat animal, carnassier), ou l’ostinato (La Puerta del Vino). Dans Ondine, et ses petites notes où rôde de nouveau le spectre prémonitoire de Boulez, on est saisi par la singularité et la richesse de timbre de chacun des registres, en particulier dans le motif où ils sont mus parallèlement, comme des apparitions d’un plain-chant fantôme ; le motif en notes répétées dans le haut-médium, d'ordinaire un peu compassé, décoratif, est comme une apparition venue d'un autre piano arrivant des coulisses. Il y a du théâtre dans ces tableaux dont le symbolisme nous a accoutumé à l'inertie. Canope impose une concentration d’écoute différente du cliché impressionniste charrié : le matériau prend ici et là un caractère troublant de récitatif, ou d'interlude orchestral. Le cahier file vite, comme à la parade diront les sceptiques, on s’en doute, mais sans rien de la relative superficialité qui grevait les Premier cahier en 2013 à Pleyel, et m’avait laissé frustré, et sur les souvenirs de récitals bien plus puissants et évocateurs de Lupu et Ciccolini. Le premier a donné une splendeur de Deuxième livre à Pleyel, mais qui pour moi cède, avec son extrême civilisation de caractères et son pianisme luxueux légèrement solipsiste, devant cette intégration magistralement cohérente de tous les gestes modernistes de Debussy, qui loin d'en compromettre la sensualité la provoque, l'exagère presque.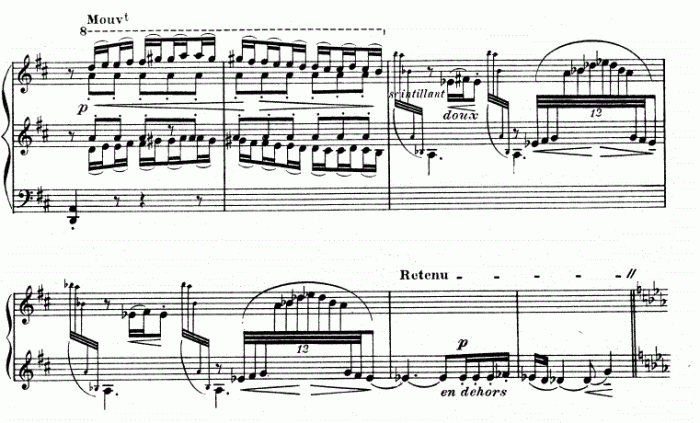
Pollini a poursuivi ce but durant son entière carrière, mais on voit enfin ce que son piano rénové apporte de radical à celui-ci, qu’Arrau ou Zimerman avaient pu approcher par leurs idéaux sonores et leur absence de sentimentalité, mais sans ni l’exigence de table rase, ni surtout l’urgence et la liberté de chant qui coule partout, tout le temps, dans les veines du Pollini d’aujourd’hui. Un 3e Scherzo un peu univoque mais avec bien plus de souffle qu’il y a quatre ans, une Cathédrale engloutie émaciée, débarrassée de sa pseudo-solennité, et une nouvelle ballade en sol mineur qui renouait avec le miracle de continuité et de maîtrise dans l’urgence de 2011 couronnent le festin du roi. Tout y a jailli d’une même source, qui avait le goût de l’originel. Tout y avait un sens. Tout montrait ce que c’est que jouer authentiquement la musique du passé, c’est-à-dire, à l’aune de celle du présent. Comme Dalhaus et Rosen y ont insisté, Beethoven a changé notre façon d’écouter Mozart, Schoenberg notre façon de jouer Beethoven, Boulez notre façon de comprendre Wagner, de faire chanter Chopin, de faire sonner Debussy, et c’est l’interprète qui le mieux écrit cette histoire in vivo.


