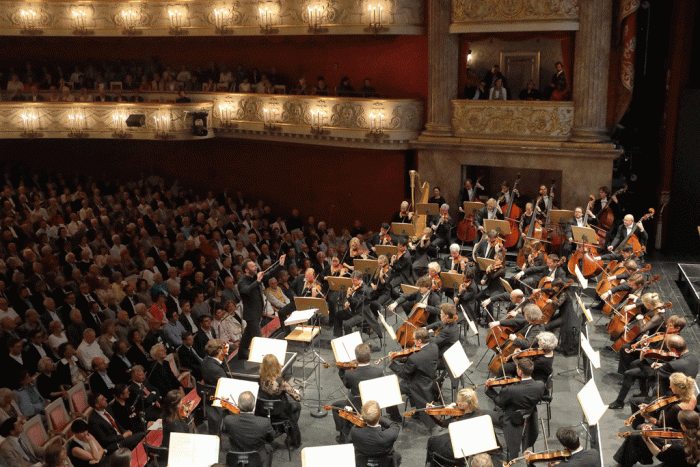Il y a entre Igor Levit, russe émigré en Allemagne en 1995 à l’âge de 8 ans, et Kirill Petrenko, russe émigré en Autriche en 1990 à l’âge de 18 ans, une fraternité de destins, et sans doute une entente humaine autant que musicale, même si Igor Levit est très engagé dans le débat public avec des idées très affirmées (à gauche), alors qu’on connaît la grande discrétion du futur chef des berlinois. Ces deux personnalités culturellement voisines rendent hommage ensemble à un autre émigré célèbre, le pianiste-compositeur Sergueï Rachmaninov. Ils auraient pu choisir un des concertos pour piano, ils ont préféré cette œuvre au thème fameux, particulièrement virtuose aussi bien pianistiquement qu’orchestralement, au tissage soliste-orchestre particulièrement serré, et qui exige une entente artistique parfaite entre chef et soliste. Des 24 variations de cette Rhapsodie se dégage une alternance de moments où le piano conduit, d’autres où c’est l’orchestre, d’autres enfin où les voix alternent, se mêlent y compris par des duos fusionnels et fulgurants d’instruments avec le piano, y compris des interventions du violon, qui est comme chacun sait, l’instrument originel pour lequel le Caprice n°24 de Paganini a été écrit et qui est la matrice des variations de Brahms, de Liszt, de Rachmaninov et de Lutoslawski.
Il y a entre Igor Levit, russe émigré en Allemagne en 1995 à l’âge de 8 ans, et Kirill Petrenko, russe émigré en Autriche en 1990 à l’âge de 18 ans, une fraternité de destins, et sans doute une entente humaine autant que musicale, même si Igor Levit est très engagé dans le débat public avec des idées très affirmées (à gauche), alors qu’on connaît la grande discrétion du futur chef des berlinois. Ces deux personnalités culturellement voisines rendent hommage ensemble à un autre émigré célèbre, le pianiste-compositeur Sergueï Rachmaninov. Ils auraient pu choisir un des concertos pour piano, ils ont préféré cette œuvre au thème fameux, particulièrement virtuose aussi bien pianistiquement qu’orchestralement, au tissage soliste-orchestre particulièrement serré, et qui exige une entente artistique parfaite entre chef et soliste. Des 24 variations de cette Rhapsodie se dégage une alternance de moments où le piano conduit, d’autres où c’est l’orchestre, d’autres enfin où les voix alternent, se mêlent y compris par des duos fusionnels et fulgurants d’instruments avec le piano, y compris des interventions du violon, qui est comme chacun sait, l’instrument originel pour lequel le Caprice n°24 de Paganini a été écrit et qui est la matrice des variations de Brahms, de Liszt, de Rachmaninov et de Lutoslawski.
L’œuvre est divisée plus ou moins en trois parties, ce qui la rapproche des mouvements d’un concerto.
Ce qui frappe dans l’interprétation entendue à Munich, c’est l’égale virtuosité de l’orchestre et du piano, dans un jeu de timbres très précis et parfaitement contrôlé. Il y a là énergie, précision, contrôle du volume au point de fusionner orchestre et piano, le piano devenant comme un instrument de l’orchestre, et une reprise vocale l’un l’autre qui stupéfie par sa fluidité, les 24 variations s’enchaînent, avec quelquefois un court silence à peine marqué.
Ce qui frappe e‑également, c’est, dans une pièce célèbre, qu’on peut interpréter de manière démonstrative, aucune volonté de démonstration ou de grandes envolées, mais au contraire une fluidité où l’on est stupéfait d’un toucher-effleurement qui produit cette fusion avec l’orchestre au point de faire disparaître le piano dans la masse orchestrale, et à d’autres moments le relief d'un rythme étourdissant, mais sans une mise en avant d’un ego pianistique destiné à stupéfier. C’est ce toucher qui m’a frappé, qui sert une conception musicale double et où l’on sent l’approche conjointe avec l’orchestre et le chef, une conception commune qui ne privilégie jamais l’effet, y compris (ou notamment) dans la fameuse variation XVIII, dont l’approche par Petrenko rappelle un peu son approche de l’adagietto de Mahler qu’on va entendre après, une approche sans pathos, sans excès, d’une extrême douceur, à la limite de l’ineffable quelquefois, mais en même temps énergique et contrastée.
Ce jeu des deux entités donne à l’ensemble de la pièce une incroyable cohésion où le piano ne semble jamais soliste, mais part de l’ensemble comme par touches impressionnistes, même si l'on ne peut que constater l’incroyable vélocité et la souplesse d’Igor Levit. La variation 19, en crescendo est un jeu entre piano et orchestre en dialogue, un orchestre dont les bois sonnent en telle « syntonie » avec le clavier quelquefois qu’on en reste éberlué avec des cordes très charnelles et suaves en même temps. On redécouvre dans une œuvre qu’on pensait un peu secondaire une construction subtile et un jeu des timbres incroyablement neuf. Une redécouverte, avec deux génies dont l’entente fait penser à une autre, celle d’Abbado et Pollini à laquelle on pense irrésistiblement, même si musicalement très éloignée. Il y a une confiance, une complicité visible lors de la mesure de fin, si discrète et si ironique au piano, lorsque Petrenko regarde, amusé, son partenaire.
Igor Levit donne alors un bis qui a surpris et emporté l’auditoire : la transcription pour piano par Liszt de la Liebestod de Tristan et Isolde de Wagner, dans le théâtre de la création, d’une telle délicatesse d’abord et d’une telle sensibilité qu’il nous en laisse complètement bouleversé. Usant toujours d’un toucher incroyablement léger, commençant presque en sourdine, une interprétation vibrante que j'avoue ne jamais avoir entendu avec une telle profondeur et une telle maîtrise, tant la pièce est difficile, avec une approche à la fois intimiste et éthérée, mais incroyablement dense relevant la complexité du morceau et les différentes voix concentrées . Inouï.
La Symphonie n°5 en do dièse mineur de Mahler est l’occasion pour le chef d’afficher un Mahler assez différent de l’habitude. Bien sûr, les qualités de l’orchestre (cuivres, bois, harpe) sont exaltées, même si les musiciens doivent être relativement épuisés après Tannhäuser le dimanche et un concert les lundi et mardi, notamment quand on devine les répétitions très précises et exigeantes du chef, qui tient tout sous contrôle. Si pendant le Tannhäuser il est intervenu auprès des violoncelles pendant un entracte, ici il semble que les cuivres aient un peu répété pendant l’entracte entre Rachmaninov et Mahler (la salle est toujours vidée aux entractes à Munich).
Alors on ne s’étendra pas sur la précision et la lisibilité, ni sur l’incroyable clarté de l’approche, pour envisager le Mahler éminemment dramatique de Petrenko (constaté aussi bien dans la 6ème que dans cette 5ème), dramatique mais acrobatique. avec des contrastes de rythme, de volume, des transitions d'une folle agilité Alors que dans Rachmaninov il était en phase avec le piano pour ne jamais jouer fortissimo une partition qui est si souvent abordée d’une manière démonstrative, dans Mahler Petrenko est peut-être plus énergique, sans jamais néanmoins être trop éclatant : il crée une tension, très forte, dès le début de l’appel de la Trauermarsch initiale, en commençant avec éclat, pour ensuite en un contraste saisissant atténuer le son presque en sourdine. L’orchestre le suit sans jamais être lourd. On avance au rythme sourd de la timbale, avec un orchestre retenu, voire suspendu en ce premier mouvement puis en contraste par l’intermède d’une grande violence. Le tempo brutalement se tend, avec une explosion des timbres proprement hallucinante. Le retour au thème initial avec sa couleur sombre, tendue au rythme des contrebasses, avec les échos aux cuivres d’une incroyable netteté, crée une ambiance particulièrement déchirée, sans vraie douceur : il y a là un Mahler en révolte, d’où la tendresse semble étouffée (sauf peut-être dans les toutes dernières mesures, proprement stupéfiantes du premier mouvement.
Deuxième mouvement haletant, explosif, au tempo très soutenu. Une version très offensive et très tendue là aussi. Petrenko n’hésite pas à heurter, à changer brutalement les rythmes, mais tout cela est complètement masqué par l’élan, par la projection instrumentale des bois, et l’incroyable souplesse des cordes, l’alternance des violons et des cordes graves, suspendue, qui chantent, et en même temps inquiétent (Stürmisch : tempétueux). Ce Mahler-là n’est pas sage, ni doux, ni métaphysique, il est presque rude, presque heurté, tragiquement humain.
Petrenko observe à la lettre les indications de la partition et interrompt fortement les deux premières parties, la première composée des deux premiers mouvements, puis le troisième, et enfin la dernière partie composée des deux derniers mouvements.
 l’étourdissant final du deuxième mouvement et après le long silence d’interruption le troisième (scherzo) très dansant, n’a pas forcément le côté grotesque ou amer de ces danses qui chez Mahler tirent vers le grinçant, voire le macabre ; Le cor très sollicité est remarquable. Le scherzo est plutôt ouvert, il n’a pas cette ironie marquée qu’on peut entendre quelquefois chez d’autres (Abbado), il est toujours aussi acrobatique musicalement, rythmé, mais joué volontairement très « premier degré », comme une respiration avant la partie finale. On connaît le goût de Petrenko pour les mouvements très dansés (son Rosenkavalier), et ici il laisse danser les violons avec des variations de volume, de couleurs étonnantes avec des pizzicati à faire rêver dans la deuxième partie (introduits par un cor qui est émerveillement), l’un des moments les plus extraordinaires de la symphonie. Et ce scherzo finit en tourbillon.
L’adagietto si fameux est ici pris à un tempo relativement rapide, pas du tout complaisant, ni sirupeux. Il n’y rien de sirupeux dans l’approche de Petrenko, mais on entend un adagietto au son plein, survivance d’un certain romantisme, non pas agressif, mais marqué, avec une épaisseur appuyée des cordes notables (seules jouent les cordes et la harpe). Un moment qui réussit à émouvoir sans « se laisser aller » à une lenteur calculée, tout en rendant une ambiance très contrastée avec ce qui précède : une approche très surprenante et très neuve, avec une respiration inattendue, mais aussi un sens du contrôle des volumes singulier entre les parties très contenues et les parties plus ouvertes. C’est un moment suspendu, certes, comme toujours, mais sans aucun mysticisme, comme si la musique à elle seule se justifiait : la clarté en est surprenante, notamment la présence très claire, très marquée de la harpe qui scande les différents moments. C’est plus rapide, mais c’en est pas moins retenu, avec une modulation des cordes dont l’appui varie, une incroyable douceur mais en même temps une vision plus large, comme si l’on commentait un paysage céleste. Jamais entendu cela ainsi. Nous sommes loin d’un Abbado pour qui la question de la souffrance chez Mahler était transcendante, quasi mystique, mais nous sommes évidemment touchés, atteints par une musique qui semble dire tout en elle-même, non sans une certaine simplicité (dernière mesure ineffable avec ce son qui s’efface jusqu’à l’inaudible).
Même sentiment de simplicité au début du rondo final, avec ces sons des bois qui se répondent avec une incroyable subtilité, puis la tension des cordes , même sur une mélodie plutôt joyeuse (le dernier mouvement d’un Mahler qui a écouté Die Meistersinger), puis avec la reprise du thème de l’adagietto dans un mouvement dansant très contrôlé, avec une variété de timbre d’une rare subtilité, que Petrenko, qui sait jouer forte, ne veut pas « emporté ». La deuxième partie n'est pas si éclatante, comme pourrait attendre, elle garde une once de retenue parce que Petrenko ne recherche pas l’éclat, il recherche d’abord une dynamique incroyable, une énergie implosive qui ne soit pas débordante, mais qui vous prenne de l’intérieur et qui vous entraîne. Ainsi du crescendo final qui tourbillonne, puis un retour à la retenue, à des sons légers, à peine perçus pour revenir à ce rondo joyeux qui chez Petrenko garde toujours un soupçon de tension, sans jamais un laisser aller des volumes et du jeu. Tout est parfaitement calibré, même les tutti du final et l’accélération, vive étourdissante, pris à un tempo à hurler finit presque à surprise, en un arrêt presque brutal comme pour dire, la fête est finie.
La fête, oui, parce que les deux parties de ce concert furent, chacune exceptionnelles, un prodigieux Rachmaninov, comme rarement on en peut entendre, et un Mahler dramatique, tendu, jamais froid, mais pas complaisant dans la douceur ou l’apitoiement. L’année prochaine ce sera la 7ème, encore plus tendue sans doute. Ce prodigieux technicien de l’orchestre qu'il est ne surjoue jamais, ne dit jamais que la musique. Et il dit le vrai.