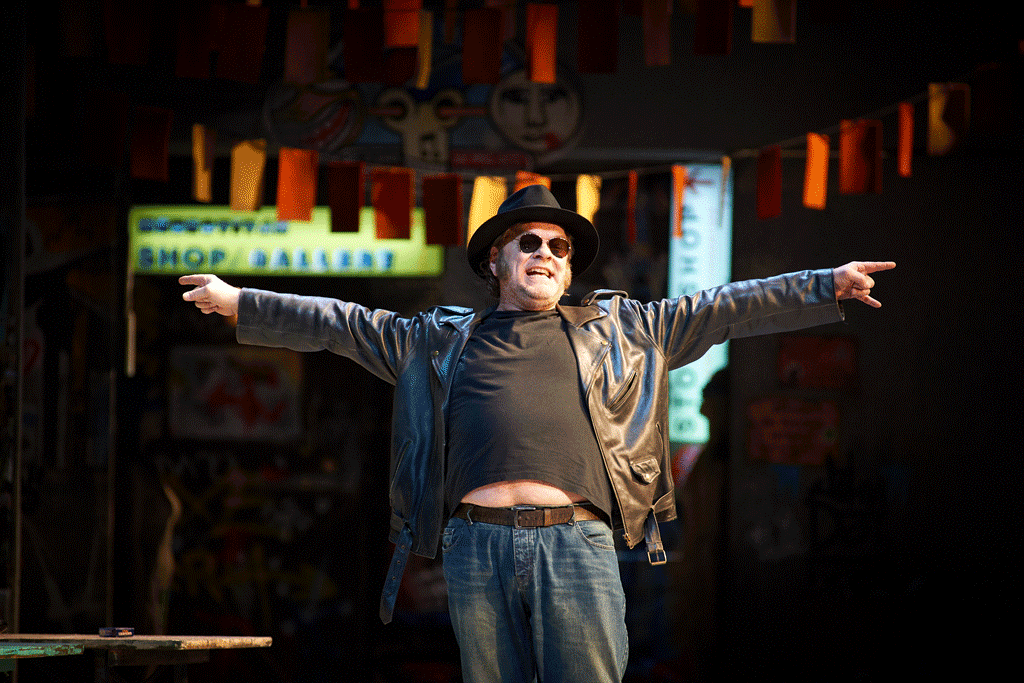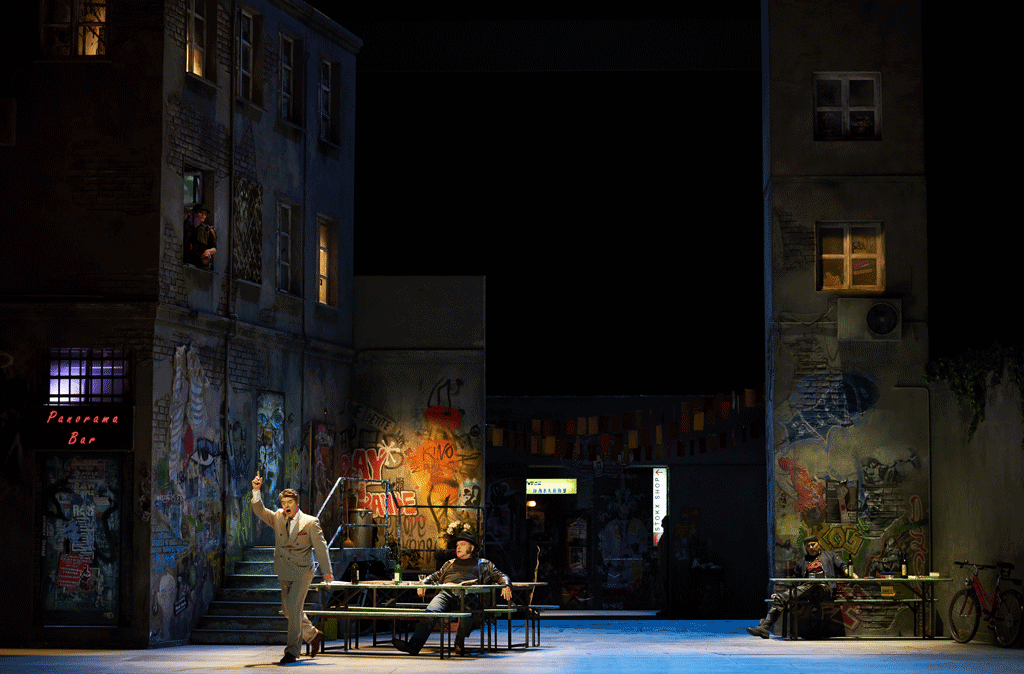
D'Abbado à Barenboim
Qu’il soit permis d’évoquer un souvenir : dans cette même salle il y a vingt ans, Claudio Abbado à la tête de la Staatskapelle Berlin dirigeait Falstaff avec Ruggero Raimondi dans une mise en scène de Jonathan Miller, peu après avoir annoncé sa décision de ne pas prolonger son contrat à la tête des Berliner Philharmoniker et recevait de la part du public berlinois une formidable ovation.
C’était une grande émotion de retrouver cette œuvre dans cette salle rénovée, et dans La production créée ce printemps reprise avec la même distribution, dirigée par Daniel Barenboim le maître des lieux, dernière grande figure historique éclairant la musique à Berlin, dans une œuvre qui ne fait pas partie de son répertoire habituel et avec une distribution aux couleurs latino-germaniques.
À la mise en scène, Mario Martone, l’un des trois metteurs en scène, qui avec Daniele Abbado et Damiano Michieletto partage le primat scénique en Italie. Les décors de Margherita Palli rappellent que cette décoratrice fut l’immense collaboratrice de bien des productions de Luca Ronconi. Les costumes sont signés Ursula Patzak, la chorégraphie Raffaella Giordano et les lumières Pasquale Mari.
Même couleur partagée dans la distribution, entre membres de la troupe de la Deutsche Staatsoper, une brochette de très bons chanteurs italiens, et pour couronner l’ensemble le grand Michael Volle (originaire de la Forêt Noire) dans le rôle-titre dans une forme éblouissante, ainsi que la jeune américaine Nadine Sierra teintée par son père de sang italien et sa mère de sang portugais.
De Wagner à Verdi
Falstaff est l’un des plus grands chefs d’œuvre de la musique d’opéra : on glose toujours sur l’extraordinaire jeunesse de cette musique composée par un homme de quatre-vingts ans, moins sur les parentés qui frappent : le travail sur les rapports du texte et de la musique par exemple : le livret de Boito qui fut un wagnérien notable, rappelle évidemment le Wagner des Meistersinger, non que le Maître ait copié l’autre Maître, mais il y a comme une rencontre autour d’un livret qui est presque lui-même musique, tant il chante, et tant le rythme de la parole colle, épouse, éclaire celui de la musique. Il y a là de la part de Verdi un travail d’orfèvrerie qui ne peut que faire écho à celui des Meistersinger. En outre avoir écouté Otello quelques semaines auparavant (et quel Otello !((à la Bayerische Staatsoper, dirigé par Kirill Petrenko))) aide à concentrer l’attention sur la parenté musicale des deux œuvres, et pas seulement la scène Iago-Cassio de l’acte III, mais il y a aussi comme des parentés thématiques, comme la jalousie caricaturale de Ford accompagnée d’une musique aux échos d’Otello, dans la caricature et le sarcasme évidemment : des parentés musicales qui se tissent entre le drame de l’extrême qu’est Otello et la comédie lyrique qu’est Falstaff. Falstaff est une comédie, certes, mais pas seulement tant il y a quelquefois les couleurs inquiètes du drame qui se profilent, d’autres fois le sarcasme, et enfin (au troisième acte) celui du mystère, les ambiances nocturnes qui rappellent un peu les ambiances du romantisme du début du XIXème. On trouve comme des échos de toute une tradition traités avec la distance et l’ironie voulues, mais aussi la part décisive de la modernité : il n’avait pas échappé à Verdi qu’était venu le temps d’un théâtre lyrique au discours continu créé ailleurs mais qui allait imprégner profondément toute la production italienne du temps, en ces mêmes années les drames véristes et pucciniens allaient proposer à la scène de nouvelles prosodies, de nouveaux rythmes et Falstaff (Manon Lescaut de Puccini est créé à Turin en février 1893, une semaine avant le chef d’œuvre de Verdi à la Scala) marque son territoire et ouvre sur les temps nouveaux.
La dramaturgie shakespearienne va aussi faciliter cette « théâtralisation » de l’univers lyrique de Verdi, déjà lors de son Macbeth, puis évidemment d’Otello, et enfin de Falstaff. Shakespeare est une garantie, une sécurité incroyable pour le librettiste, mais pas seulement, pour le compositeur se crée une dramaturgie musicale en pleine cohérence avec la dramaturgie théâtrale originelle.
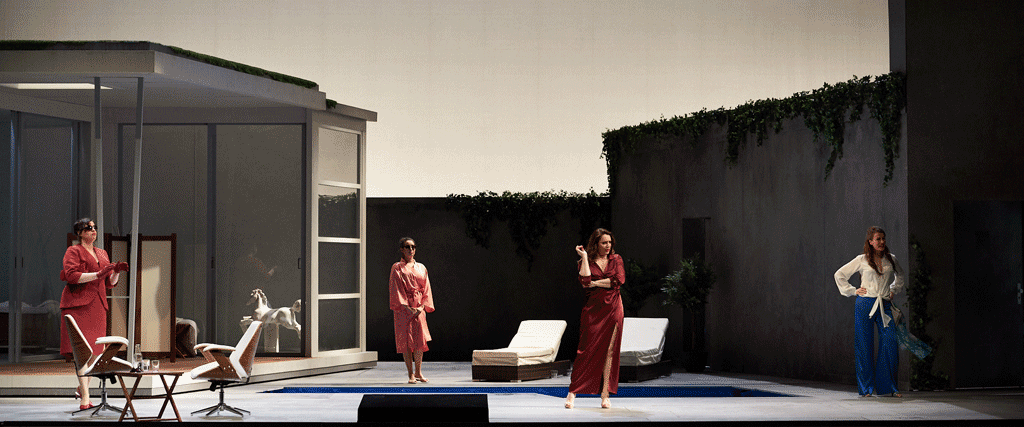
Une mise en scène bien faite, sans grande invention
Mario Martone ne prend pas de gants pour construire un Falstaff tant soit peu élégant ou au moins polysémique. Tout est au premier degré, avec le côté un peu insistant de celui qui veut provoquer les rires. L’idée de départ est une transposition : Falstaff est un vieux soixante-huitard qui vit dans une sorte de lieu alternatif, plein de marginaux au décor un peu décati tandis que celles qu’il essaie de contacter font partie d’une haute bourgeoisie un peu refermée sur elle-même.

Le décor de l’acte II est la terrasse d’un SPA pour dames et messieurs oisifs, où circulent des figurants en peignoir de bain, avec au milieu une magnifique piscine au bord de laquelle on bronze, et dans laquelle Nannetta et Fenton folâtrent dans un érotisme discret et radical-chic et à grande eau. Inévitable et attendu si le décor inclut une piscine. Mais bien entendu la corbeille à linge est bien présente et verse comme de juste dans la Tamise (?).

Le troisième acte se déroule dans un espace un peu abandonné qui tient de l’usine en friche, à l’intérieur de laquelle traînent des couples en goguette, une sorte de lieu louche de prostitution où s’aventurent mâles et femelles en proie au désir.
Toute cette transposition n’enlève rien à la trame traditionnelle, mais est assez bien faite, avec quelques gags qui font bien rire la salle (Quickly en moto par exemple). Martone n’a jamais été un metteur en scène inventif, mais un honnête artisan du théâtre qui fait passer un bon moment sans déranger. En ce sens cette production est une bonne pioche pour le théâtre de répertoire et peut rester à l’affiche un certain temps. Strehler en son temps en avait fait un livre d’images sublimes, et Carsen plus récemment en a livré une production qui reste actuellement la meilleure sur le marché. Martone ne bouleversera pas les classements.
Un ensemble musical aux éminentes qualités
Musicalement, l’ensemble se tient à un niveau très enviable, il est vrai que la distribution est particulièrement bien choisie et très équilibrée et qu’elle est soutenue par un orchestre au mieux de sa forme emportée par un Barenboim attentif aux contrastes et à la dynamique.
Jürgen Sacher (de la troupe de Hambourg) en Docteur Cajus installé, pas si ridicule – il n’a rien d’un barbon- mais simplement un peu trop mûr et sérieux pour la jeune Nannetta. Le chant est appliqué et solide, et les deux compères Bardolfo (Stephan Rügamer) et Pistola (Jan Martiník) très à l’aise, forment un couple de chanteurs de caractère bienvenu, plutôt traditionnel et qui remplit bien la scène.
Francesco Demuro chante son nième Fenton, avec ses qualités habituelles de style et de précision, et un souci marqué pour nuancer le chant. La voix convient parfaitement au rôle, elle n’est jamais aux limites (contrairement à son Adorno parisien).
Avec Nadine Sierra nous sommes à un autre niveau : on peut même dire que Nannetta est « au-dessous de ses moyens », désormais un rôle parfaitement exécuté, avec une voix mûre pour d’autres défis. Une voix d’une grande homogénéité, un timbre particulièrement séduisant et frais (qui rappelle Mirella Freni), maîtrisant tout le registre avec une rare sûreté, une jolie expressivité et une belle jeunesse. Elle a évidemment tout d’une grande, déjà.
Les trois dames sont chacune dans son genre particulièrement bienvenues, la Meg Page (le rôle le moins important des trois) de Katharina Kammerloher, de la troupe de la Staatsoper à son aise et de bonne facture, l’Alice Ford de Barbara Frittoli, un peu disparue des scènes récemment et qui revient en belle forme, avec un timbre mûri et une assise solide, plus expressif qu’à ses débuts et assez charnu. Elle est une Alice digne, bourgeoise, arrivée, et compose un beau personnage.
Daniela Barcellona est une Quickly peut-être un poil moins mûre et moins caricaturale que d’autres, son beau timbre sombre fait merveille et son aisance scénique fait le reste, elle est délurée, sans jamais abandonner une certaine dignité. C’est une Quickly plus « distinguée » que d’habitude et elle remplit la scène d’une vraie présence, dans un rôle auquel cette héroïne rossinienne née ne nous a pas habitués, mais qui montre ses qualités éminentes de phrasé et d’expression. Brava.
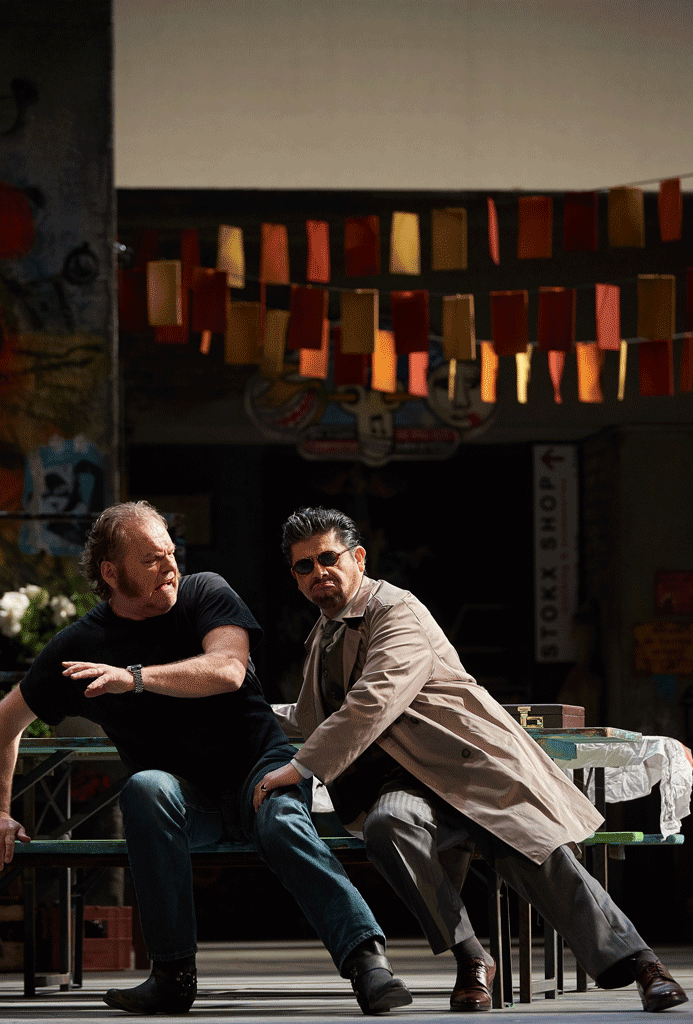
Alfredo Daza est Ford. Le baryton mexicain a fait partie de la troupe de la Staatsoper Berlin pendant plusieurs années et a assumé tous les grands rôles de baryton. Son Ford a la double qualité d’être solide au niveau du volume vocal, mais aussi très raffiné et très élégant dans le style, particulièrement contrôlé, avec un beau phrasé et une impeccable diction ainsi qu’un timbre velouté et séduisant. Belle composition en bourgeois jaloux, sans être caricatural.
Et Michael Volle est Falstaff, un rôle inévitable pour un baryton de sa trempe, qu’il a débuté en mars dernier dans cette production. Même si la voix dans les passages a quelques menus enrouements, elle reste totalement triomphante, avec des aigus somptueux et larges remplissant sans peine la salle et dominant l’orchestre, avec une aisance en scène confondante, sans jamais être lui non plus caricatural (il n’a pas son traditionnel ventre débordant). La diction est impeccable, même si le phrasé n’est pas vraiment italien (il manque quelque peu la vélocité du flux verbal que seuls les barytons italiens rompus à Verdi mais aussi à Rossini maîtrisent) et en bon Hans Sachs, Volle sait sculpter les paroles, nuancé chaque mot, respecter chaque inflexion, ce qui est indispensable pour Falstaff. Grand, évidemment.
Accompagné par un chœur à la couleur très lyrique (au troisième acte) préparé par le très expérimenté Martin Wright, la Staatskapelle Berlin se montre ductile à souhait, faisant émerger des pupitres somptueux (les bois), et montre une grande cohésion. C’est un des meilleurs orchestres de fosse qui puisse exister, au répertoire large, tant lyrique que symphonique grâce au rythme que Barenboïm lui impose. La direction du maître des lieux est très contrastée, raffinée souvent, explosive quelquefois, voire heurtée, mimant un peu les excès du rôle-titre, mais moins raffinée dans la manière de révéler la subtilité et la profondeur de l’écriture verdienne qu’avec d’autres chefs d’hier (Abbado ou Karajan) ou d’aujourd’hui (Gatti), il reste que pour la dynamique, pour la tension, pour le suivi du plateau, Barenboim est évidemment au sommet, même si au troisième acte on aurait peut-être souhaité quelque chose de plus rythmé, avec une musique qui palpite plus, au tempo un poil plus soutenu. N’importe, le résultat reste de grand niveau et c’est à une belle représentation de Falstaff que ces jours de fête nous invitent. Ils sont rares, les théâtres qui offrent un tel niveau ; elles sont rares, les villes qui ont une telle offre musicale.