 Pendant que s’installe le public, sur scène s’installent les clients d’un restaurant : le maître d’hôtel les accueille, les serveurs s’affairent, tendent le menu, attendent les commandes.
Pendant que s’installe le public, sur scène s’installent les clients d’un restaurant : le maître d’hôtel les accueille, les serveurs s’affairent, tendent le menu, attendent les commandes.
Le chef arrive, l’ouverture est lancée au rythme de ce ballet inattendu.
Dernière à s’installer, Konstanze attend, un peu agacée, et Belmonte qui arrive en retard lui fait une scène de jalousie parce qu’elle serait amoureuse de Pacha Selim (Man sagt du seist die Geliebte des Bassa !), de colère, Konstanze quitte la table et la salle.
La machine mise en scène par David Hermann est lancée, on est loin de la tradition et loin du sérail : David Hermann se confronte avec le livret de Gottlieb Stephanie le Jeune – difficile à mettre en scène par les temps qui courent – en évacuant d’abord le fatras turc et la pièce à sauvetage qui est derrière, par la totale suppression des dialogues (il n’en reste au bas mot que la phrase ci-dessus) qui portent toute l’intrigue dans l’œuvre de Mozart, pour ne garder que la musique : on découvre alors que les airs et les ensembles traduisent des inquiétudes, des angoisses, une mélancolie qu’on n’attendait pas.
Et c’est sur ces angoisses qu’il va travailler.
Au contraire de Wajdi Mouawad à l'Opéra de Lyon, qui en faisait le centre de son travail, David Hermann évacue l’utopie illuministe, qui pour lui ne correspond plus à l’époque (nous en faisons chaque jour la triste expérience), mais au contraire il monte dans notre société une angoisse structurelle dont Belmonte est l’indice. Car à travers le drame de la jalousie inextinguible qui affecte le rapport entre Belmonte et Konstanze (habile réutilisation de Martern aller Arten par exemple, adressé à Belmonte pour les avanies fait vivre à Konstanze), ce sont des images qui surgissent, dont on ne sait si elles sont réelles ou complètement fantasmées : la manière dont Belmonte lutte physiquement contre Selim, rôle muet, sorte d’obstacle permanent entre lui et l’aimée dont on ne sait s’il est suscité par sa peur ou s’il existe réellement comme fantôme obsessionnel de la chambre à coucher ; et Selim se relève sans cesse des coups violents que lui porte un Belmonte qui le voit partout, y compris dans le miroir de la coiffeuse.
A d’autres moments, Belmonte élargit son angoisse personnelle aux angoisses du jour : apparition dans le restaurant de femmes en burka, symbole de féminité mystérieuse et cachée, mais aussi d'éloignement homme/femme, monde de l’étrangeté pure : ces femmes invitent Belmonte à se joindre à elles pour observer comme autant de spectateurs-voyeurs, Konstanze et Selim un peu perdus et méditatifs dans une chambre apparaissant dans le mur, pendant que défile un texte en arabe que la folie des temps pourrait faire interpréter tout autrement que par le sens réel des paroles projetées : « C'est la maison de Pacha Selim ».
 Si le Sérail est présent, il l’est par cette allusion discrète à un Orient hostile et lointain, monde en noir (tout le décor est dominé par le blanc ou le violet, couleur de la robe de Konstanze et de la chambre à coucher), monde inversé, monde autre qui est celui qu’on ne veut pas voir ou qui se dérobe à nos yeux.
Si le Sérail est présent, il l’est par cette allusion discrète à un Orient hostile et lointain, monde en noir (tout le décor est dominé par le blanc ou le violet, couleur de la robe de Konstanze et de la chambre à coucher), monde inversé, monde autre qui est celui qu’on ne veut pas voir ou qui se dérobe à nos yeux.
Dans une telle dramaturgie, comment traiter Pedrillo et Blonde ? David Hermann part de deux postulats :
- D’une part dans le monde des comédies, les valets sont les doubles populaires ou gauchis des maîtres (voir le jeu Leporello/Don Giovanni) et c’est le cas chez Gottlieb Stephanie Le Jeune, où à leur niveau social, les valets vivent ce que les maîtres vivent : au trio Belmonte-Konstanze-Selim répond le trio Pedrillo-Blonde-Osmin.
- D’autre part les voix sont les mêmes ( Soprano et ténor), mais déclinées sur une couleur et une hauteur différente.
 David Hermann en tire alors les conséquences et fait de Pedrillo et Blonde des doubles du couple, un autre eux-mêmes, avec les désirs masqués des uns et des autres : une Konstanze grave et perturbée, et une Blonde-Konstanze mangée par le désir, un Belmonte torturé, mais essayant de dominer (mal) sa torture et un Pedrillo-Belmonte plus direct et moins complexe. C’est un jeu de Janus bi-frons entre les quatre/deux personnages qu’Hermann installe, sans compter qu‘il place parmi les clients qui dînent au restaurant un troisième couple identique à eux, muet, comme si la relation Belmonte-Konstanze se multipliait au miroir, comme si le monde était fait de Belmonte-Konstanze.
David Hermann en tire alors les conséquences et fait de Pedrillo et Blonde des doubles du couple, un autre eux-mêmes, avec les désirs masqués des uns et des autres : une Konstanze grave et perturbée, et une Blonde-Konstanze mangée par le désir, un Belmonte torturé, mais essayant de dominer (mal) sa torture et un Pedrillo-Belmonte plus direct et moins complexe. C’est un jeu de Janus bi-frons entre les quatre/deux personnages qu’Hermann installe, sans compter qu‘il place parmi les clients qui dînent au restaurant un troisième couple identique à eux, muet, comme si la relation Belmonte-Konstanze se multipliait au miroir, comme si le monde était fait de Belmonte-Konstanze.
Pour affirmer ces postulats très éloignés de l’histoire originale, mais pas forcément loin des airs chantés par les protagonistes, et pas si loin de leur nature, David Hermann et sa décoratrice Bettina Meyer ont conçu un espace sur plateau tournant, avec quatre ambiances : le restaurant avec sa niche ouvrant sur une chambre à coucher de Selim toute blanche et immaculée, mais ouvrant aussi (comme une boite à malices qui fait « cadre » accroché au mur) sur le décor baroque en toile peinte d’une ville orientale où Osmin va surprendre les femmes en train de fuir – on pourrait se croire chez Zabou Breitman dans la production parisienne – comme si la scène de l’évasion et le retour revenir l’opéra à sauvetage primitif était l'un des fantasmes possibles.
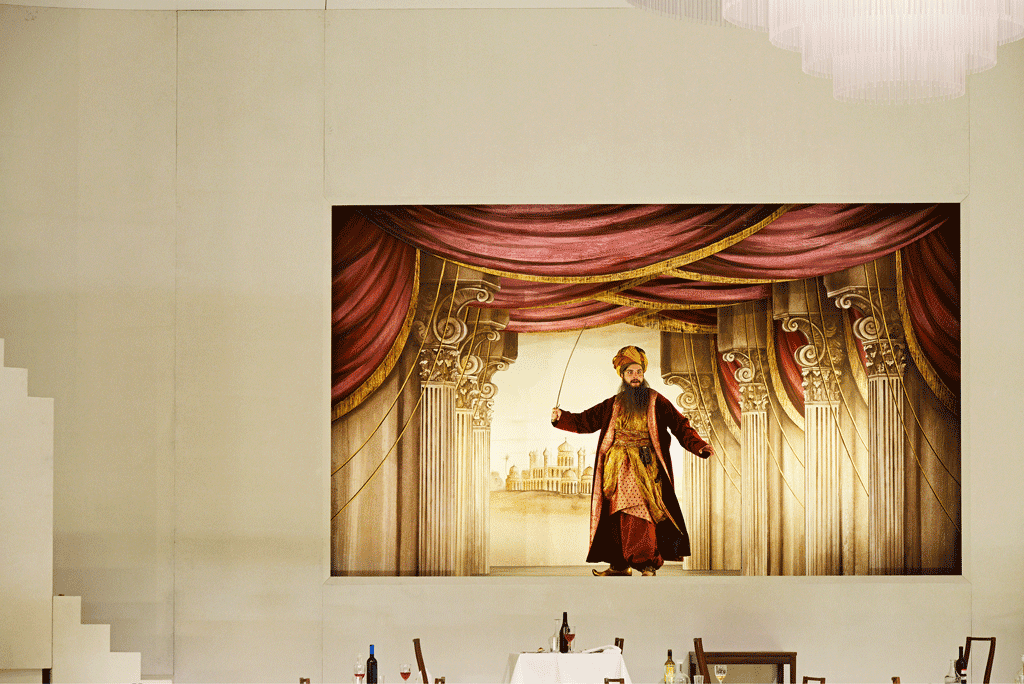
Le négatif du restaurant, tout blanc, de l’autre côté, c’est une chambre à coucher tout violet, lourde et angoissante, ouvrant sur une salle de bain : une chambre piège, où Belmonte arrive et voit dans son agitation permanente Konstanze dormir, puis Selim, puis Blonde-Konstanze. Un monde privé, monde non résolu, et donc monde étouffant.
Entre ces deux espaces opposés, deux espaces transitoriaux, l’un noir dont on ne fera ni ne verra grand-chose, où se distinguent le groupe des femmes en burka, ici un peu inutiles, l’angoisse fugace de Belmonte, l’autre un superbe corridor merveilleusement bien éclairé par Franck Evin, deux hauts murs entre lesquels le couple se croise, ou la silhouette de Belmonte erre. Images les unes et les autres fugitives et qui nous parlent d’interdit, d’obstacle et d’isolement.
Dans ce maelström de cauchemars, d’angoisses et d’espaces contradictoires, où est Osmin ? Et quel rôle a‑t‑il ? Il traverse les angoisses de Belmonte comme le mauvais rêve ou le mauvais génie, d’abord maître d’hôtel du restaurant, il est celui qui alimente la jalousie maladive du jeune homme, mais il est aussi l'Osmin traditionnel dans la scène où il découvre que les femmes vont fuir le palais. Il n’est pas la basse bouffe habituelle, mais un homme jeune qui semble manager les rêves et les fantasmes de Belmonte et l’emmener vers la violence. Kusej avait à Aix fait d’Osmin un monstre de Daech, Mouawad en faisait un amoureux sincère et déchiré : ici, c’est une sorte de Mephisto sans Faust, magnifiquement personnifié par Nahuel di Pierro, avec ses petits problèmes pas clairs lui aussi : la fameuse scène de l’ivresse se termine au lit…avec Pedrillo-Belmonte qui en le faisant boire, ne déclenche pas l’ivresse, mais le désir homosexuel.
C’est bien la complexité des réseaux de désir, fragments d’un désordre amoureux qui nous est donnée à voir, et la scène finale qu’on pensait résolution, revient à la scène initiale : malgré tout, Belmonte n’éteindra pas sa jalousie.
 Ce travail qui détourne l’histoire de l’opéra de Mozart est aussi l’histoire d’une aporie avouée : l’impossibilité dans le monde d’aujourd’hui de proposer tel quel le livret, sauf à une mascarade à la Breitman qui évite soigneusement et de fâcher, et de satisfaire. Aussi bien Kusej à Aix que Mouawad à Lyon, les deux mises en scènes les plus marquantes de l’œuvre ces dernières années, n’ont pas réussi à rendre cette complexité née de ce que les sociétés occidentales vivent aujourd’hui : l’un en faisait un drame noir à la limite du supportable qui renvoyait le pire au visage du spectateur, l’autre en donnait une vision plus positive, une image du droit imprescriptible à l’utopie malheureusement aussi peu adaptée aux sociétés du jour qui se choisissent Trump comme utopie du moment.
Ce travail qui détourne l’histoire de l’opéra de Mozart est aussi l’histoire d’une aporie avouée : l’impossibilité dans le monde d’aujourd’hui de proposer tel quel le livret, sauf à une mascarade à la Breitman qui évite soigneusement et de fâcher, et de satisfaire. Aussi bien Kusej à Aix que Mouawad à Lyon, les deux mises en scènes les plus marquantes de l’œuvre ces dernières années, n’ont pas réussi à rendre cette complexité née de ce que les sociétés occidentales vivent aujourd’hui : l’un en faisait un drame noir à la limite du supportable qui renvoyait le pire au visage du spectateur, l’autre en donnait une vision plus positive, une image du droit imprescriptible à l’utopie malheureusement aussi peu adaptée aux sociétés du jour qui se choisissent Trump comme utopie du moment.
Entre ces extrêmes, David Hermann choisit d’aller complètement ailleurs, utilisant la ressource musicale comme base exclusive, ajoutant des bruitages, battements, sons sourds entre chaque moment, et éliminant toute parole dans un travail assez virtuose et suffisamment cohérent pour emporter l’adhésion d’une très grande majorité du public..
L’engagement de l’équipe et la justesse des personnages, de tous les personnages, montre qu’il a su convaincre.
Olga Peretyatko, pour qui c’est une prise de rôle, est une Konstanze déjà mûre et lasse, très spectaculaire vocalement, mais peut-être pas toujours convaincante stylistiquement. Une voix magnifiquement ductile, de jolies inflexions, une aisance scénique confondante, des vocalises réussies, mais qui ne vont pas jusqu’à provoquer l’émotion : dans cette dramaturgie, c’est plutôt une victime mais suffisamment ambiguë pour que s’installe une distance entre elle et nous. Pour Belmonte comme pour le spectateur, elle reste un mystère et son chant moins engagé n’est pas loin de le traduire.
Pavol Breslik est le personnage principal, le Belmonte torturé et destructeur, jeune homme ombrageux et insupportable, qui a d’abord une énorme qualité scénique et vocale : le naturel. Aucun apprêt dans le chant, et un jeu direct et très prenant. Il n’a absolument pas la maniera de certains Belmonte, c'est-à-dire un style un peu artificiel qui privilégierait le chant et non le personnage. La ligne est impeccable, le style remarquable sans être jamais impersonnel ou artificiel, le soin donné à la couleur notable, l’interprétation très prenante, une suavité et une clarté de timbre d’autant plus marquées que son double, Michael Laurenz en Pedrillo, est tout à l’opposé : la voix est plus puissante, plus marquée, plus directe aussi, ce double est moins ombrageux, plus fort, il est tout ce que Belmonte n’ose pas être et qui fait lutte en lui. Plus contrôlé peut-être qu’à Lyon où il était aussi Pedrillo, Michael Laurenz est un double autre, un double qui ne serait pas un clone : deux couleurs, deux styles, deux ténors, un Janus-Belmonte qui n’est jamais là où on l’attend ni le voudrait.
 La jeune canadienne Claire de Sévigné, avec sa voix fraiche, sa belle tenue de scène, fait une entrée remarquée dans le rôle de Blonde, en étant membre non de la troupe, mais du Studio : les aigus sont atteints et corrects, et elle a une assurance réelle tout à fait nécessaire dans le rôle qu’on veut lui faire jouer (magnifique dans Welche Wonne, welche Lust, un des rares moments amusants de la mise en scène ), c’est une chanteuse à suivre, qui a de la ressource.
La jeune canadienne Claire de Sévigné, avec sa voix fraiche, sa belle tenue de scène, fait une entrée remarquée dans le rôle de Blonde, en étant membre non de la troupe, mais du Studio : les aigus sont atteints et corrects, et elle a une assurance réelle tout à fait nécessaire dans le rôle qu’on veut lui faire jouer (magnifique dans Welche Wonne, welche Lust, un des rares moments amusants de la mise en scène ), c’est une chanteuse à suivre, qui a de la ressource.
J’ai dit toute l’ambiguïté de Nahuel di Pierro dans Osmin, un Osmin inquiétant, un personnage sans doute projection des angoisses de Belmonte, sans doute aussi le personnage le plus complexe dans cette comédie à trois personnages (Osmin, Belmonte, Konstanze) et trois ombres (avec Blonde-Konstanze, Pedrillo-Belmonte, et Selim le muet dont on ne saura jamais s’il existe ou non (joué avec cette noblesse détachée très singulière et assez fascinante par Sam Louwick).
Si le timbre est plus clair que ceux des Osmin qu’on connaît, il est aussi plus jeune, mais la voix descend très bas : l’acteur est en tout cas remarquable, et il rend Osmin, souvent tout d’une pièce, d’une rare ambiguïté qui inquiète et laisse perplexe, comme si il tirait les ficelles de cette nouvelle intrigue, une sorte de Jimini-cricket malfaisant de l’ensemble de l'histoire : il réussit même – par la grâce de la mise en scène – à détourner la fameuse scène du vin (ob ichs wage ? ob ich trinke ?) où il ose avec Pedrillo bien plus que boire…Personnage très fort en scène, très marquant, négatif et violent (comme chez Kusej, il est profilé musulman radical, c’est marqué, mais bref), mais en même temps il n’est pas jamais vraiment antipathique : en cela il est méphistophélique.
Comme souvent dans les grandes maisons, chœurs et figurants sont très naturels avec un vrai relief pour certains figurants , qu’on pourrait appeler des figures et le chœur dans les rares moments où il apparaît, est impeccable de précision et de justesse.
Dans la fosse, ce n’est pas le Philharmonia Zürich, mais l’Orchestra La Scintilla, sa formation baroque qui en est dérivée. Le chef prévu et annoncé était Theodor Currentzis, qui comme ça lui arrive quelquefois, il a annulé, remplacé par un tout jeune chef russe de 28 ans, Maxim Emilyanychev, qui surprend par le rythme qu’il impose, qui marque un écart marqué entre des parties très rapides et d’autres bien plus lentes, et quelquefois là où on ne les attend pas. Même contraste dans les volumes, avec des parties presque susurrées et d’autres assénées, faisant penser avec l’utilisation des percussions ou du Glockenspiel, à l’accompagnement d’un numéro de cirque. – rien de négatif dans cette observation : le son est plus sec, les rythmes plus serrés, mais tout cela palpite, c’est vivant, c’est très présent et donne à l’ensemble une tout autre impression qu’un Mozart sucré ou trop élégant : nous sommes dans la dragée au poivre, dans l’acéré, l’aigre doux, sur le fil d’un rasoir périlleux.
C’est très inattendu, car le son n’a rien à voir avec l’habitude, mais colle parfaitement à une action acide. Il n’y a rien de rond, mais du tranchant et du tranché, rien d’élégant, mais du rêche : le son baroque assez inattendu dans une œuvre si consensuelle fait au contraire dissension, et c’est prodigieusement intéressant de conjuguer une mise en scène et une direction qui vont résolument ailleurs et surtout pas là où on attend. Tout est discutable, mais comme c’est bien trouvé !
Cette production a fait l’objet d’une soirée au Théâtre des Champs Elysées début novembre, mais en version concertante. Les spectateurs présents n’ont pas su les choses auxquelles ils avaient échappé : il vaut mieux cent fois qu’ils ne les aient point connues ((la citation est adaptée de Jean-Jacques Rousseau, Confessions Livre VIII)).

