
Luk Perceval
Luk Perceval n’est pas le perdreau de l’année. C’est au contraire un des hommes de théâtre les plus en vue depuis plus de vingt ans, et l’un des piliers de la scène flamande, dont on sait qu’elle est l’une des plus actives et des plus inventives en Europe, qu’Aviel Cahn si attentif à la dramaturgie et qui a passé dix ans à Anvers, l’ait côtoyé et connaisse celui qui a fondé en 1997 le Toneelhuis d’Anvers n’a évidemment rien d‘étonnant. Perceval a mis en scène à Anvers, au Festival de Salzbourg, il a codirigé la Schaubühne de Berlin, dirigé le Thalia Theater de Hambourg, il est actuellement metteur en scène attaché au NTGent, le théâtre municipal de Gand, dirigé par Milo Rau, qui est aujourd’hui avec le Toneelhuis d’Anvers l’institution la plus importante de Flandre et l’une des plus stimulantes d’Europe. Il faut rappeler ces éléments qui montrent l’importance de Luk Perceval dans le théâtre européen. Qu’il soit un metteur en scène discuté, qui ne laisse jamais indifférent, est une preuve de plus de l’intérêt à le voir invité à Genève.
Une logique de programmation
Le deuxième élément qui me paraît essentiel, est la manière dont Aviel Cahn a conduit jusqu’ici cette première année, alternant des productions très contemporaines (Les Indes galantes, Einstein on the beach, avec une Aida et un Orfeo (des spectacles importés) plutôt traditionnels. Avec cette production de Die Entführung aus dem Serail, il propose une vision particulière d’une œuvre du répertoire, un Mozart qui plus est, qui semble avoir heurté un certain public.
Pourtant, personne n’était pris en traitre : d’une part, l’appel à Luk Perceval ne pouvait laisser croire à un Mozart traditionnel ou plan-plan comme certains l’aiment, par ailleurs, il était clair qu’il s’agissait d’un travail de réécriture du livret de Johann Gottlieb Stephanie puisque les textes parlés du Singspiel seraient remplacés par des textes adaptés du roman de Aslı Erdoğan Le Mandarin miraculeux (Mucizevi Mandarin) par Luk Perceval lui-même.
Turquie-Europe, un long fleuve pas toujours tranquille
L’appel à Aslı Erdoğan ne saurait être non plus seulement dû à la situation particulière de cette romancière emprisonnée en Turquie plusieurs mois en 2016, pour avoir défendu les droits des femmes et notamment le droit à l’expression des kurdes et exprimé ses craintes par rapport à la réduction des libertés publiques en Turquie et qui vit actuellement en exil en Allemagne. En effet, son roman, Le Mandarin miraculeux (Mucizevi Mandarin) se passe à Genève, où elle a vécu quand elle a travaillé au CERN, en tant que physicienne. C’est donc un texte écrit par une exilée turque sur l’histoire d’une femme turque à Genève qui évoque un amour perdu, et qui se retrouve dans la solitude et la marginalité (elle est aussi borgne), et son roman est d’une certaine manière une situation inverse de l’opéra de Mozart, où les européens sont isolés dans un univers turc. Ici la femme abandonnée est turque et « prisonnière » d’un univers européen.
Dans les deux cas, il s’agit d’un croisement entre la Turquie et l’Europe, une thématique que la littérature et la culture européennes ont porté depuis le XVIIe, mais que la Turquie porte aussi à l’inverse. Si la Turquie fascine et effraie l’Europe (n’oublions pas que les Turcs ont failli prendre Vienne en 1683), l’inverse est aussi vrai : la culture européenne a depuis longtemps fasciné les classes aisées turques et le pouvoir, l’art européen et notamment la peinture sont objets de débats à la cour du Sultan (voir le beau roman de Ohran Pamuk, Mon nom est Rouge que chacun devrait avoir dans sa bibliothèque). Aussi ces échanges avec la Turquie sont-ils des éléments permanents de la culture en Europe, et les palinodies autour de l’adhésion de la Turquie à l’Union Européenne qui alimentent encore notre vie internationale, sont aussi une preuve que cette fascination/répulsion mutuelle existe encore. D’ailleurs, Frank Castorf dans son récent Bajazet créé à Vidy-Lausanne évoque lui aussi la question turque et ces relations croisées.
Et comme on les comprend ! la Turquie d’aujourd’hui est aussi le pays de nombreuses légendes ou sites qui fondent la culture et l’histoire grecques et donc nos racines culturelles, Troie, Trébizonde, Halicarnasse, Pergame, Ephèse, sans parler de Byzantium/Constantinople/Istanbul, qui fut capitale d’un empire romain et qui reste siège de l’orthodoxie. La Turquie fut part naturelle du bassin méditerranéen et des origines de notre culture. Que les Ottomans musulmans aient pu la conquérir au XVème siècle n’enlève rien à cette histoire : ils accueillirent les juifs chassés d’Espagne, ils gardèrent en leur sein une forte communauté grecque jusqu’au XXe siècle. Les vicissitudes de l’histoire, la grande catastrophe (Μικρασιατική Καταστροφή) qui chassa les grecs d’Asie mineure ait eu lieu (sans parler du génocide arménien) peut renforcer les problèmes et les ressentiments, mais difficilement effacer le tissage culturel qui marque les frontières orientales de l’Europe, même si ce sont des blessures profondes ; la Grèce d’aujourd’hui, et les Balkans gardent aussi des traces importantes dans la langue, l’architecture, la cuisine de la présence turque séculaire…et l’obsession protectionniste hongroise n’empêchera pas Budapest d’avoir été un temps une ville turque dont elle garde des traces que nous visitons aujourd’hui..
Le choix de retravailler Die Entführung aus dem Serail qui est trace de ces échanges, de cette curiosité, de cette présence culturelle dans un sens inverse du livret d’origine, en inversant la situation, mais en gardant l’idée de solitude et d’exil est un choix d’autant plus intéressant qu’Aslı Erdoğan a vécu à Genève, et que l’opération conçue par Aviel Cahn et réalisée par Luk Perceval ne manque pas de panache, ni d’inventivité.
Un genre bien identifié : la pièce à sauvetage
Certes, Die Entführung aus dem Serail, n’est pas seulement un témoignage des relations entre Turquie et Europe (d’autant plus vives dans la ville de sa création, à Vienne, un siècle après un siège dont le souvenir est encore vivace et que le livret cherche en quelque sorte à exorciser), mais c’est aussi le témoignage d’un genre qui va faire florès à la fin du XVIIIe, dans le théâtre et la littérature, qui est le roman à sauvetage, dont on va avoir trace jusqu’à Fidelio (1814). Le roman à sauvetage c’est schématiquement parlant une jeune fille enfermée par un méchant dans un lieu isolé et entre des murs épais, et un prince amoureux qui finit par la libérer en neutralisant le méchant (autre exemple, Die Zauberflöte). Sauf que chez Mozart, c’est le « méchant » qui n’est pas si méchant et qui par sa noblesse libère lui-même les prisonniers, allégorie illuministe du souverain clément qu’on retrouve aussi bien dans Die Zauberflöte que dans La Clemenza di Tito. Avec la différence importante que dans Die Entführung aus dem Serail, le souverain ne chante pas mais parle, et mène le jeu dramatique. Ce schéma a inspiré de nombreux metteurs en scène récemment, politique moyen-orientale et islam oblige, car après avoir été un peu négligé par les grands théâtres, Die Entführung aus dem Serail est revenu sur les scènes internationales.
Dans le travail de Luk Perceval, le Pacha Selim moderne (le président de la Turquie Erdoğan) est absent, mais pèse sur l’ambiance, exactement comme le Sultan Amurat-Mourad pèse dans le Bajazet de Racine, d’où la couleur sombre du texte, qui mêle circonstances politiques lointaines mais pesantes, et destins individuels ravagés. Car on sait depuis Stendhal que les destins individuels sont étroitement liés à la situation politique (les grandes âmes stendhaliennes peuvent-elles vivre dans le monde de la restauration post-napoléonienne ?). C’est pourquoi on ne s’étonnera pas de la fin amère sans le chant triomphant de janissaires, qui sonnerait singulièrement grinçant et paradoxal dans cette version.
Il s’agit donc rien moins que de montrer que la musique de Mozart peut s’adapter à ce texte nouveau, en français, pendant que le texte chanté le sera en allemand. Ainsi donc nous nous trouvons face à un texte traduit en français d’une romancière turque qui s’insère dans un opéra écrit par un autrichien sur un livret en allemand, mis en scène par un metteur en scène belge flamand. Si l’on voulait montrer ce que veut dire culture européenne, à Genève, où siègent les Nations Unies et tant de structures internationales, on ne s’y prendrait pas mieux et déjà cet effort syncrétique constitue un clin d’œil.
Une vision nouvelle
L’autre série de remarques concerne la transformation de l’opéra, le soir où j’assistai à la représentation, un cri de douleur fusa du fond du théâtre « nous voulons Mozart ». Pourtant Mozart était là, avec sa musique, avec un orchestre d’ailleurs très en forme. Certes ni l’histoire ni le texte habituel n’étaient là. Hormis ce que nous avons écrit plus haut sur les choix politiques et théâtraux d’Aviel Cahn, l’opéra de Mozart est un Singspiel (jeu dramatique chanté) un genre qui a fait le lit plus tard de l’opérette, à une époque où les tripatouillages de textes, et même de musique n’étaient pas rares : ils étaient même pratique habituelle. Le Singspiel est conduit par les dialogues qui font avancer l’action. Cela signifie que vous changez le livret ou le texte de base et vous transformez totalement l’action, le chant prenant alors une couleur différente, avec la même musique.
Nous sommes à une époque où au nom de l’Art, du respect du compositeur, de ses intentions (à conditions de les connaître : il y a toujours des spirites qui sont en contact direct avec les intentions du compositeur, heureux intimes de Mozart) l’œuvre est sacralisée et installée dans sa gangue de plâtre ou son tombeau marmoréen : on n’y touche pas sous peine de sacrilège, de blasphème et dans le cas présent de Mozarticide. Quand on voit qu’un livret a pu être utilisé au XVIIIe pour plusieurs opéras d’auteurs différents, que les musiques étaient arrangées par et pour les chanteurs, que des airs étrangers à l’œuvre étaient introduits et que ces jeux ont continué jusqu’au milieu du XIXe, notre sacralisation fait sourire.
Dans un théâtre de répertoire comme Zurich par exemple, ou Munich, il faut évidemment un Entführung aus dem Serail « authentique » c’est à dire appuyé sur le texte original, abstraction faite de la mise en scène, parce que la production est destinée à durer des années (ici le Nationatheater Mannheim est un des coproducteurs et c'est un théâtre de troupe néanmoins…). Dans un théâtre de type stagione comme Genève, qui vise à présenter une production dans sa singularité, sans plus la reprendre avant plusieurs années, le but visé est non pas l’œuvre simple, mais la production comme « fin en soi », à laquelle dans le cas présent concourent aussi des acteurs qui ont appris un texte spécifique et qui en système de répertoire, pourraient difficilement revenir à Zurich ad hoc de ci de là.
Il y a dans la programmation d’un théâtre en système stagione l’idée que la saison doit être éclectique dans ses choix de titres, mais aussi dans sa manière de les aborder, tantôt traditionnelle, tantôt expérimentale, tantôt contemporaine, de manière à offrir au public une diversité de genres et d’approches et en même temps le former, l’éduquer, l’amener à approfondir sa connaissance des possibles de l’œuvre. En ce sens le choix d’Aviel Cahn correspond à ce que doit être une saison dans une salle comme Genève. Il a déjà offert quatre ou cinq productions de styles très différents qui ont fait discuter. Et celle-ci encore plus, puisqu’elle a fait polémique, ce qui est toujours bon pour un théâtre parce que la polémique témoigne d’une vivacité du lieu.
La production de Luk Perceval
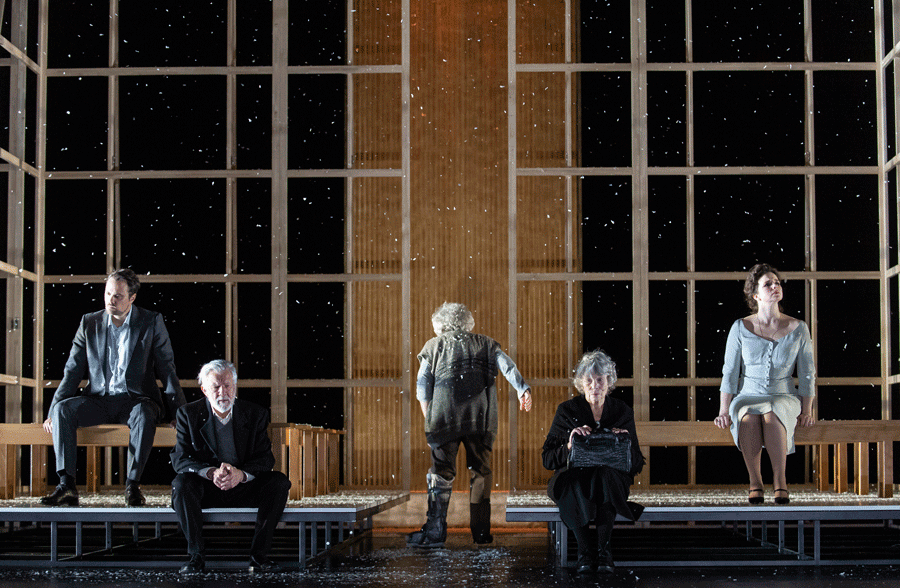
La réussite d’une telle opération dépend évidemment de la qualité de la production présentée. Encore faut-il que l’expérience tentée ici, qui est hardie, vaille le déplacement et surtout vaille la machine importante mise en place, réécriture, doublage des chanteurs par des acteurs, alternance français-allemand et surtout statut de la musique. Soyons clairs : un Entführung aus dem Serail illuministe, qu’on a vu des dizaines de fois sur le théâtre, avec une aimable turquerie, vaut-il nouvelle production ? Dans ce cas mieux vaut louer à la Scala la production Strehler, la plus poétique et intelligente dans le genre. Et le tour est joué…Aviel Cahn propose une nouvelle expérience, et cela se défend, même si cela peut aussi être discuté, mais sur le fond, par sur la forme superficielle d’un « nous voulons Mozart »…(variante genevoise de « c’est Mozart qu’on assassine »).
La mise en scène de Luk Perceval, bien éclairée par le programme (nous vérifions une fois de plus combien les nouveaux programmes concoctés par le Grand Théâtre permettent au spectateur d’être guidé et de trouver les réponses à ses interrogations) a posé sous une lumière nouvelle le Singspiel et a éliminé tout ce qui pouvait faire sourire dans l’original et les airs n’ont forcément plus le rôle de renforcer les dialogues ou de les illustrer, ils prennent une valence sombre et mélancolique et surtout sont rejetés dans le souvenir des acteurs qui doublent les chanteurs, qui sont leurs doubles âgés, comme si leur regard amer sur la ville et sur les gens prenaient une couleur d’autant plus sombre que les airs chantés évoquent un « vert paradis d’amours enfantines » qui finit dans l’amertume et les ravages de la vieillesse. Ici les regards se croisent, les jeunes se projettent dans un futur incertain, les vieux se regardent avoir été, avec amertume, et chacun se croise, s'aime, se réconforte, en des rencontres de soi avec soi qui ne sont pas dénuées de profondeur.
Là aussi, rien de neuf sous le soleil : Cosi fan tutte est passé pour une comédie légère et une farce et aujourd’hui cela devient le plus souvent une œuvre mélancolique, pour ne pas dire dramatique (voir le production de Christophe Honoré à Aix).
Les textes de Aslı Erdoğan sont très bien choisis pour leur dureté, leur tristesse, qui racontent des histoires d’aujourd’hui, et un regard sur les illusions et les réalités d’une ville grise et sinistre (Genève est habillée pour l’hiver) qui imprègnent la méditation de l’héroïne. Perceval construit autour d’un décor unique de Philipp Bussmann très bien conçu (une sorte de cage ajourée abstraite qui tourne sur elle-même et permet des scènes de foule tout comme des scènes intimes) une dramaturgie chorégraphique (chorégraphie de Ted Stoffer) assez subtile, faite de mouvements d’une foule qui passe, laissant les solistes souvent seuls, seuls dans la foule, marchant à rebours, avec des éclairages splendides de Mark Van Denesse. Les belles images ne sont pas rares, comme l’entrée du Pacha (qui n’existe pas) marquée par un défilé joyeux de drapeaux blancs, comme une manifestation, comme ces cortèges médiévaux, également variation sur la vie de la ville
Le transfert peut fonctionner, selon la dramaturgie précise de Luc Joosten : la ville grise, les gens qui courent, les manifestants, un lointain Pacha Selim qui ressemble bien à l’Erdoğan homonyme de la romancière avec qui elle n’a rien à voir, un pacha lointain et un Osmin vieilli, sur un fauteuil roulant, vulgaire et violent, qui hait le monde désormais, quand son double chanteur est encore jeune et vigoureux. C’est encore une fois un jeu entre l’être et l’avoir été, mais en même temps, la musique de Mozart, isolée du contexte des dialogues originaux, prend une autre couleur, et propose une œuvre autre, sur laquelle avec l’accord du chef Fabio Biondi on se risque même au mélologue (une forme fréquente au XVIIIe, entre théâtre et opéra, dont Rousseau usa) où les paroles mordent sur la musique (ce qui a choqué, évidemment, oser mordre sur Mozart et on modifie la conclusion en introduisant un Lied mélancolique « Ich würd’ auf meinem Pfad » (K.390) sur un texte de Johann Timotheus Hermes composé dans les mêmes années que L’enlèvement au sérail
Alors certes tout l’aspect illuministe et optimiste est effacé, mais quand on lit les airs-même écrits par Mozart, ils ne sont pas tous souriants ni pleins d’espoir (« Martern aller Arten », l’air de référence de Konstanze, en est un exemple).
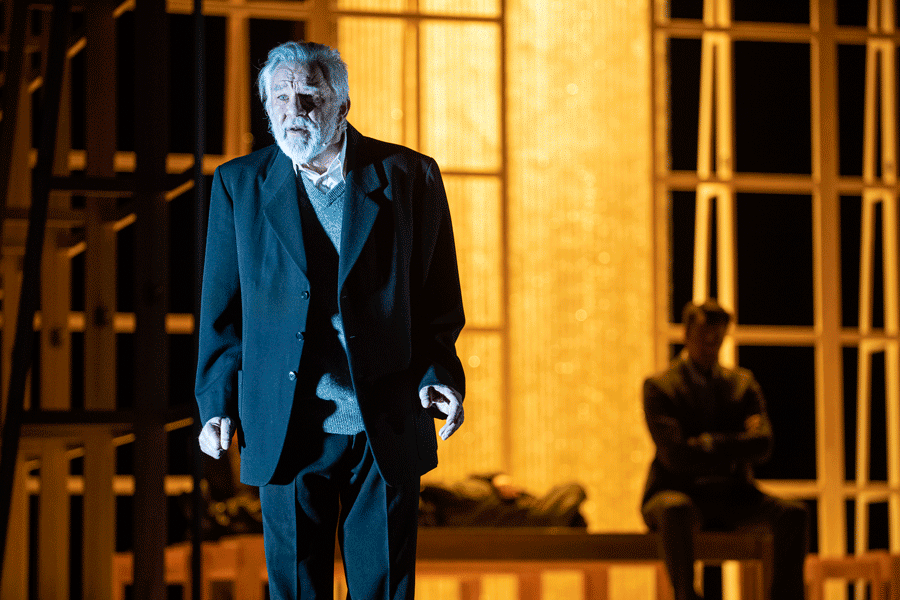
Quel est l’effet produit pour le spectateur : dans l’ensemble, le travail de mise en scène va valoriser le travail du groupe d’acteurs, absolument remarquables : c’est eux qui séduisent et qui portent cette valorisation du jeu dramatique et qui font que ce Singspiel est d’abord Spiel avant d’être Sing (jeu avant d’être chant), aussi bien l’Osmin déglingué (mais ne l’est-il pas non plus chez Mozart, au point que Martin Kusej dans sa mise en scène aixoise si décriée réussit à un assassin de Daech, et que Gottlieb Stephanie en fait un musulman élastique, notamment par rapport aux vertus de l’alcool et du sexe…), joué par Patrice Luc Doumeyrou avec ses excès et la gêne qu’il provoque, particulièrement émouvant aussi le Belmonte vieilli de Joris Bultynck et la Blonde de Iris Tenge, sans oublier la douce Konstanze viellie et émouvante de Françoise Vercruyssen. Ce sont eux qui mènent l’action, la danse, la trame, la production et qui défendent avec cran et panache le texte de Aslı Erdoğan.
Avec un écueil cependant, l’alternance dialogues/musique n’a pas la fluidité de la version originale (d’une part on n’est pas habitué au texte, et d’autre part, il y a deux langues différentes) et le mouvement dramatique finit par faire un peu système, et se répéter. Mais c’est aussi peut-être l’effet induit du choix de suppression des entractes…
Et la musique ?
Le deuxième effet de cette mise en scène et de cette approche singulière, c’est que loin de l’étouffer, elle rend la musique de Mozart bien plus forte, et bien plus problématique.D’abord, on se rend compte de l’extrême difficulté des airs : la pauvre Konstanze est terriblement servie par Mozart, mais aussi Belmonte : on oublie souvent que Belmonte n’est pas un aimable ténor léger, car qui commence avec Belmonte finit par Titus chez Mozart et abordera Lohengrin plus tard (voir une carrière à la Gösta Winbergh), un chemin parfaitement balisé.
Cette difficulté des airs d’une certaine manière est un peu atténuée dans la version originale, on sourit, c’est léger, c’est Mozart bonbonnière. Dans la version Perceval qui exige du public une attention plus grande aux textes (bien plus longs et difficiles, voulue sans entracte pour accentuer l’effet dramatique et la concentration), les airs chantés deviennent presque (et c’est un écueil) des « pezzi chiusi », un peu fermés sur eux-mêmes, dans la mesure aussi où les chanteurs ne sont pas les acteurs et qu’il y a donc malgré les efforts pour que tous « communiquent » entre eux deux univers différents, et donc qu’il y a une concentration nouvelle sur le chant. On se rend compte immédiatement que ce chant-là demande des chanteurs rompus à l’exercice.
La dictribution
Or et c’est là sans doute le point plus discutable de la soirée, la distribution réunie, respectable et sans accrocs, ne répond pas à l’exigence. Elle témoigne aussi que le chant mozartien en ce moment n’est pas à son zénith. Ce sont dans l’ensemble des voix honnêtes, mais qui ne répondent pas aux exigences en termes techniques et en termes interprétatifs. Dans une version de ce type, on demande aux chanteurs de presque chanter « comme un Lied » c’est à dire de créer par leur chant et par leurs airs un univers singulier, une couleur singulière, une profondeur qu’aucun ne réussit à esquisser. On les excusera parce que pour la plupart, c’est une prise de rôle et que des chanteurs jeunes et frais, pouvaient ainsi répondre en écho aux comédiens plutôt murs et expérimentés : leur chant assez superficiel dans l’interprétation peut se justifier par rapport aux paroles amères des comédiens.
Il reste que, au-delà même de la distribution réunie, il y a en ce moment une pauvreté interprétative dans le chant mozartien que je trouve inquiétante. L’épaisseur de la musique et du signifié chez Mozart n’est pas rendue par le marché actuel, même si on voit plus souvent des œuvres plus rares il y quelques années comme Idomeneo par exemple. Mais, même si ces Mozart peuvent être bien chantés, j’ai des difficultés à identifier des Konstanze de référence, des comtesses extraordinaires ou des Donna Anna chavirantes. J’ai au contraire l’impression d’un chant interchangeable. Il y a quelques exceptions (les Figaro ou Leporello d’un Alex Exposito par exemple), mais le paysage ne me paraît pas vraiment excitant.

Alors, au-delà des prises de rôle, Olga Pudova a les notes, et aussi quelquefois l'intensité, mais a‑t‑elle le corps, c’est à dire, la personnalité, la profondeur, la grandeur du personnage : c’est une prise de rôle, et le chemin est devant elle, mais on aimerait plus d’engagement dans le chant, même si c’est une belle artiste.
Julien Behr est un Belmonte très professionnel, élégant, à la voix bien projetée, c’est aussi une voix intéressante avec un timbre velouté. Est-il néanmoins pleinement entré dans le rôle, avec sa poésie mais aussi son énergie, son « héroïsme » ? Pas encore tout à fait, il reste un peu extérieur et peut-être souffre plus qu’un autre de la production et de l’exposition différente des personnages.

C’est étrangement avec le couple « léger » que les choses sont mieux assises. Comme souvent dans ce type d’œuvre et notamment plus tard dans les opérettes, il y a un couple « sérieux » et un couple « léger », comme pour Tamino/Pamina et Papageno/Papagena.
Nous avons écouté depuis le début de saison la jeune Claire de Sévigné, convaincante à chaque fois et tout particulièrement dans cette production dont elle épouse les contours, c’est peut-être celle qui apparaît la moins gênée et la plus en phase avec le propos, malgré de menus problèmes techniques. Très à l’aise en somme…à suivre.
Denzil Delaere est sans doute de tous le plus convaincant : il propose un Pedrillo agile, très en place, et ses airs « Frisch zum Kampfe » et « Im Mohrenland… » dans des styles très différents, montrent les facettes du personnage et la capacité de ce jeune chanteur à tracer justement un univers, à partir de quelques mots et quelques inflexions. Il faut suivre attentivement cette jeune carrière, sans nul doute.
Nahuel di Pierro était le plus « ancien » de la distribution, c’est un chanteur qu’on voit désormais sur de nombreuses scènes, très à l’aise, au timbre jeune et clair, et souvent convaincant. Il l’est ici un peu moins, c’est un Osmin avec aigus, mais sans beaucoup de grave, et pour un rôle dont la signature sont les notes graves, c’est un peu problématique (je me souviens toujours de Kurt Moll dans ce rôle avec un certain Karl Böhm en fosse à paris dans les années 70 du siècle dernier…). Dans la production cela passe parce que l’Osmin acteur est très puissant dans son personnage ; mais l’Osmin chanteur manque quand même un peu de consistance.
Chœur et orchestre
Le chœur intervient de manière très limitée mais s’en tire de manière respectable.
Fabio Biondi a abandonné sa formation Europa Galante pour mener l’aventure avec l’orchestre de la Suisse Romande. Il faut d’abord souligner qu’ici, le chef a travaillé en accord avec le metteur en scène pour faire mordre le texte quelquefois sur la musique selon le principe du mélologue, et pour changer la fin. Une production est en effet toujours le résultat de la rencontre entre chef et metteur en scène (même si ce n’est pas toujours vérifié…). Il conduit l’orchestre avec un tempo mesuré, sans aspérités, veillant à créer une unité d’ambiance avec le plateau et le propos des textes ; il en résulte une version évidemment moins pétillante que ce à quoi on est habitué, avec moins de couleurs, mais l’orchestre s’en tire avec tous les honneurs, avec des sonorités qui confinent quelquefois à la tradition baroque et donc la rencontre Biondi/OSR a fonctionné.

Éloge de la complexité
Une telle entreprise est un éloge à la complexité. Elle montre en même temps par ses choix dramaturgiques, mais aussi par le choix de l'auteur et des textes, la complexité initiale de l'œuvre, au carrefour d'idées, de traditions, d'une histoire européenne dont nous vivons encore les soubresauts aujourd'hui et que des metteurs en scène récents de cet opéra ont déjà souligné.
Il n’est pas inutile que cette complexité contraigne le spectateur à prendre du recul, à chercher « ce qu’il y a derrière les yeux », et à méditer après le spectacle, une attitude brechtienne en quelque sorte bien plus riche qu'une attitude de simple consommation "toccata e fuga" d'un Mozart-bonbon où l'on ira seulement chercher ses propres habitudes. Il y a dans cette production une incontestable réussite théâtrale et un pari osé par le Grand Théâtre qui lui fait honneur. Pour ma part, la discussion porterait bien plus sur le plateau que sur les choix scéniques. Le plateau reflète un peu les problèmes qu’il y a à distribuer Mozart de manière convaincante. On n’est plus à l’époque où on savait reconnaître une distribution « mozartienne ». Aujourd’hui, l’abondance de productions baroques fait que l’on passe de l’un à l’autre, sans toujours une claire adaptation au style. J’avoue que les chanteurs « mozartiens » me manquent, je n’arrive plus à les reconnaître. Par bonheur je pense reconnaître les productions intelligentes et celle-ci en est une.

