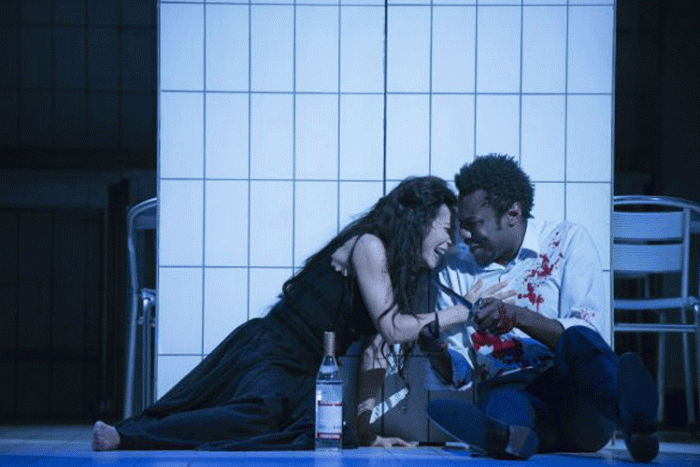On les voit apparaître, se faufilant hors du rideau de scène alors que les derniers spectateurs prennent place à l’Odéon-théâtre de l’Europe. Des carreaux de céramique blancs qui parquettent le sol. Cliniques. Ordonnés. Très peu écossais. Et qui laissent présager d'une déterritorialisation moderne de la tragédie Macbéthienne. Et tandis que le téléphone d’une lycéenne maladroite du 1er balcon évite miraculeusement la tête d’un spectateur de la corbeille, on attend le lever du rideau et le vrai jeu de massacre promis par ce texte, maudit, écrit par Shakespeare au début du XVII siècle : l’escalade meurtrière de Macbeth jusqu’au trône d’Ecosse.

Les trois sorcières (Virginie COLEMYN, Boutaïna EL FEKKAK, Alison VALENCE), en haillons et gravides ici, semblent faire peu de cas des deux cadavres au sol, garrulant d’incompréhensibles incantations. « Le laid est beau, le beau est laid : Embrumons-nous dans l’air épais ». On n’est plus près d’Hocus Pocus, film kitsch des années 1990 que des brumes écossaises, pourtant projetées dans un geste lourdement illustratif. Des murs au sol, les carreaux blancs courent bien sur toute la surface du plateau seulement trouée par deux béances vitrées. Avant qu’à la fin des babils des trois harpies, posées sur un pot (de chambre ?), ils ne s’éventrent et ne découvrent l’intérieur rocailleux et fastueux de la salle à manger du roi Duncan (Christophe BRAULT). La famille royale festoie et ces technocrates en costumes se réjouissent de la victoire et du courage de ses généraux, Macbeth et Banquo (David CLAVEL), contre leurs ennemis norvégiens. C’est alors aux deux compères d’apparaître… En treillis (l’habit comme appartenance de classe… On a vu plus novateur). En mode G.I. Joe, face aux sorcières gouailleuses qui leur détaillent leur feuille de route des deux prochaines heures : l’un sera roi (« Macbeth qui plus tard sera roi »), l’autre enfantera des rois (« de toi naîtra des rois »). Ces sorcières qui sont pour le metteur en scène, Stéphane BRAUNSCHWEIG, « bien commodes pour se débarrasser des désirs sombres que l’on porte en soi » (livret) le sont aussi, on le découvrira, pour expurger tout mystère à la mise en scène.
Est-ce la nouvelle traduction du texte par Daniel LOAYZA et Stéphane BRAUNSCHWEIG, ripolinée par des ajouts contemporanéisés, qui ne donne plus à entendre la langue de Shakespeare ? Ou est-elle seulement corsetée dans cette mise en scène étriquée et ramassée dans des décors pesamment signifiants ? « Ce carrelage, blanc, basique, quinze sur quinze (rectangulaire dans Macbeth, ndlr) est quelque chose, je crois, qui fait vraiment partie de notre mémoire collective, on ne s'en rend pas compte, mais c'est un matériau que tout le monde connaît au XXe siècle, que tout le monde a rencontré ou rencontrera dans sa vie, simplement pour un séjour dans un hôpital. » rappelait l’artiste Jean-Pierre RAYNAUD, connu pour son utilisation de ce matériau et pour son container zero exposé à Beaubourg.

Et devant le vide, on en vient à se poser des questions franchement inutiles et à essayer de débusquer des idées dans des détails qui devraient rester, eux, insignifiants. Adama DIOP, un fidèle de la troupe de Julien Gosselin, campe un Macbeth primesautier, à peine audible par moments, outrancièrement nerveux dans l’ostentation des tics faciaux ou de mains. On pense à quelque dictateur africain mais, surtout, on ne croit jamais au couple diabolique qu’il forme avec Chloé REJON plus classique dans son jeu, mais qui échoue à donner toute la densité dramatique à sa Lady Macbeth, notamment lors de la scène des terreurs nocturnes, qui s’évanouit (dans l’oubli) comme un songe.
« J’ai beau me raccrocher à la confortable idée que « tout est vanité », j’ai besoin quand même de m’entendre avec cette Lady Macbeth dont j’ai hérité par mégarde » écrivait Maria CASARES à Albert CAMUS en mars 1954, preuve s’il en était de la difficulté de la partition et de la nécessité d’injecter de la mesure à ce rôle, monstrueux par nature mais plus complexe qu’il n’y paraît. Dommage que Stéphane BRAUNSCHWEIG qu’on a connu plus délicat appuie sur l’un des mystères de la pièce : la maternité « avortée » de Lady Macbeth (« j’ai donné le sein, je sais comme il est tendre d’aimer l’enfant qui tète »). Le texte bourré d’allusions suffisait à caresser le non-dit. La grossesse des trois sorcières exhibe ce mystère sans rien y apporter de nouveau et le thème de l’absence d’héritiers (« couronne sans fruits », « stérilité », « hors lignage »), présent dans le texte, apparaît dès lors comme exagéré, presque factice car trop agité.
Irrémédiablement, l’ensemble pâtit de ce manque de cruauté, de ce « théâtre où des images physiques violentes broient et hypnotisent la sensibilité du spectateur » prophétisé par Antonin Artaud (Le Théâtre et son double, 1938). Or existe-t-il meilleur étendard à cette déclinaison théâtrale que ce Macbeth, marqué par la fatalité et la destinée ? Malgré l’effort de toilettage et d’éclairage original du texte, la mise en scène manque cruellement d’ambition. Un comble quand on veut exp(l)oser la folie du couple Macbeth. Même les moments cathartiques comme la mort du roi Duncan se jouent dans le hors-champ, ce qui ne serait pas une mauvaise idée si d’autres scènes fortes existaient. On découvre un mythe passé à la lessiveuse vaudevillesque.

Ici une Lady Macbeth dans sa petite robe noire, en transe, surprise en pleine séance masturbatoire par son mari. Là ce portier au nez sale (Christophe BRAULT qui joue aussi Duncan et d’autres personnages) qui ergote sur le Brexit ou sur la BCE, frelatant et singeant la folie ambiante qui avait déjà du mal à infuser. Enfin les trois sorcières qui mettent bas – la dimension animale de l’événement semble revendiquée – en fredonnant une comptine grivoise ou l’opposition au thane de Cawdor devenu roi qui s’organise du haut de la corbeille. Finalement, Stéphane BRAUNSCHWEIG ne va au bout ni de sa lecture psychologisante de l’œuvre (la stérilité du couple dont découleraient toutes les atrocités) ni d’une mise en scène, classique, de la férocité du texte. Restent une soupe, fadasse, et un spectateur frustré.
Durée estimée 2h45 – entracte compris