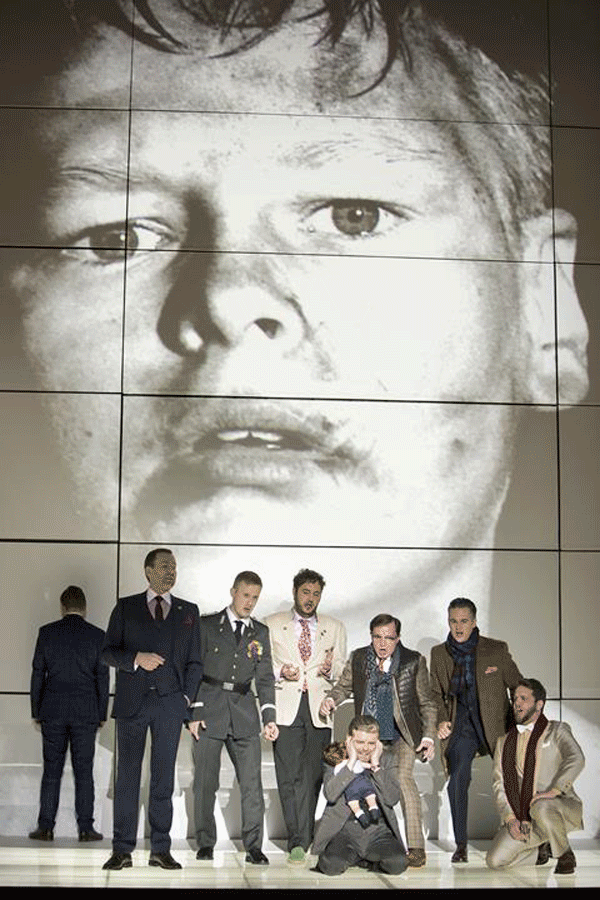 Un livret au sens détourné par Bieito
Un livret au sens détourné par Bieito
Le livret de Die Gezeichneten, du compositeur lui-même (à la mode wagnérienne) prend sa source dans une pièce de Frank Wedekind, Hidalla oder Sein und Haben (Hidalla ou être et avoir) de 1904. L’histoire, pas vraiment évidente, se situe dans la Gênes de la Renaissance où Alviano Salvago, un homme riche d’une laideur repoussante créé en compensation une île à la beauté féérique dont les hommes de la cour et les riches génois ont fait un lieu de stupre, puisqu’ils y entraînent des jeunes filles qu’ils ont enlevées pour servir à leur plaisir. Le propos de Bieito s’appuie sur ce qu’on estime aujourd’hui LE mal, et remplace les jeunes filles par des enfants, et l’Elysium devient le lieu de la pédophilie organisée au profit des puissants de la ville.
La tête d’un enfant blond sur l’écran accueille les spectateurs qui entrent dans la salle, et ce procédé ainsi que certains gestes ou certaines images vont installer un malaise que quelques spectateurs ont bien du mal à réprimer.
Le travail de Bieito dont la réputation s’est construite par le scandale provoqué par certaines productions, marquée par leur violence (Die Soldaten, Zurich et Berlin), par leur proximité avec une actualité très dure comme les attentats de la gare d’Atocha dans Don Carlos à Bâle, où l’exposé de nudités masculines à profusion (Armida à Berlin). Ce n’est évidemment pas exhaustif, mais aussi bien dans Lear à Paris que dans La Juive à Munich, voire dans son magnifique Tannhäuser à Anvers, l’univers de Bieito semble évoluer, même si la dénonciation des violences du pouvoir reste un élément structurant de son théâtre (voir son Otello à Bâle et Hambourg). Ce qui caractérise son travail c’est toujours une très grande rigueur dans la lecture du livret, qui justifient toutes les options, même quand il tire un peu loin les logiques.
Dans Die Gezeichneten, dont le sujet pourrait permettre à peu près tout, ce qui intéresse Bieito, c’est d’abord évidemment la violence de la classe dominante et une déréliction qui atteint l’ensemble des personnages. Une violence que tout spectateur ressent, mais qui n’est pas démonstrative, très peu de sang en scène, absence totale de scènes de violence démonstrative, et une première partie qui se déroule sur le proscenium, avec des personnages qui bougent peu, fixes, en ligne, avec des entrées et sorties latérales. Le décor de cette première partie est un grand mur de panneaux blancs sur lesquels se projettent diverses images (vidéo de Sarah Derendinger) qui alimentent l’imaginaire du spectateur, une grande roue de parc d’attraction, la bouche d’un monstre de train fantôme dans laquelle des rails s’engouffrent, et quelques photos d’enfants.
Des images qui glacent
Sur scène, les choses sont tenues à distance : les personnages en costume trois pièces, bien propres sur eux, sont alignés, Alviano, est traité à l’inverse du livret qui montre une laideur repoussante dans une âme noble : chez Bieito donc, Alviano n’a pas la laideur attendue : cette laideur se réfugie dans l’âme peut-être atteint du complexe de Peter Pan ( qui consiste grosso modo à ne pas vouloir sortir di monde de l’enfance) at qui ne cesse de se réprimer, regarde par exemple un gamin blond qui s’éloigne et qui le soumet à la torture du désir, quelques enfants munis de chapeaux pointus de carnaval l’entourent et le regardent recevoir un paquet cadeau (une poupée de petit garçon) et rient, comme si tout cela était léger et amusant (un peu l’acte II du Parsifal de Tcherniakov) , quelques adultes entraînent les enfants en coulisses en leur masquant les yeux…Évidemment, cette manière de tout suggérer fait appel à l’imaginaire du spectateur, et porte à une situation proche de l’insupportable par la tension qu’elle crée.
 Toute la première partie (Acte I et II) se déroule donc devant cette paroi blanche, au plus près des spectateurs, l’espace bouché (décor de Rebecca Ringst) contribue évidemment à renforcer l’aspect irrespirable de l’air que Bieito distille très lentement et qui fait ressentir d’autant plus fortement une musique qui reste chaleureuse et chatoyante. Entre la chaleur musicale et la scène glaçante, une tension supplémentaire se crée.
Toute la première partie (Acte I et II) se déroule donc devant cette paroi blanche, au plus près des spectateurs, l’espace bouché (décor de Rebecca Ringst) contribue évidemment à renforcer l’aspect irrespirable de l’air que Bieito distille très lentement et qui fait ressentir d’autant plus fortement une musique qui reste chaleureuse et chatoyante. Entre la chaleur musicale et la scène glaçante, une tension supplémentaire se crée.
Beauté du Laid, laideur du Beau
Le deuxième acte est le moment où Carlotta peint Alviano . C’est la deuxième thématique lourde de l’œuvre celle des rapports de l’art à la laideur : Carlotta, fille du Podestat Lodovico Nardi, a remarqué un jour Alviano et a cru voir en lui la beauté cachée de son âme (toujours la thématique platonicienne de la Caverne – cette caverne qu’est aussi l’Elysium entre ombres et réalité. Le dialogue s’engage pour que Carlotta puisse faire le portrait d’Alviano en faisant ressortir son âme. Le jeu de Bieito dans cette scène consiste plus en une sorte de révélation psychanalytique. Carlotta, qui est fille du Podestat Nardi qu’elle embrasse au passage sur les lèvres au premier acte fut sans doute la première victime du système pédophile et incestueux (tout est possible dès lors que les interdits ont sauté sur l’Elysium) et le portrait d’Alviano est en réalité une silhouette qu’elle dessine sur un des panneaux blancs en arrachant peu à peu – et avec difficulté – des bouts du panneau en contreplaqué : plus elle comprend qu’Alviano cache une âme noire (il a créé l’Elysium, tel un Klingsor émasculé qui s’interdit l’amour des enfants, mais le procure aux autres en créant un pédoparadis) plus elle va le pousser dans ses retranchements, telle Kundry, jusqu’à revêtir les oripeaux de bambin victime, petit short bleu et chemisette bleu-ciel, la sublime Ausrine Stundyte au physique assez menu relevant parfaitement ce défi-là. Du même coup, le duo révèle une similitude avec le duo Kundry-Parsifal où Kundry-Carlotta séduit Alviano-Parsifal, avec la différence notable que ce Parsifal là est à la fois Parsifal et Klingsor. Dans le monde de Bieito, pas de place pour une quelconque ingénuité. Le fameux baiser de la mère et de la femme devenant l’apparence infantile de Carlotta, qui ainsi réussit à percer Alviano.
Le portrait terminé est un trou dans la paroi dans lequel passent Alviano et Carlotta, paroi qui masque l’Elysium et ses merveilles, l’Elysium et ses plaisirs, la caverne et ses ombres sans lumière.
 Bieito évacue tout ce que l’action peut avoir d’anecdotique pour se concentrer sur la psychologie et les replis des âmes des personnages. On regarde ces deux premiers actes avec une sorte de fascination morbide qui laisse de côté l’intrigue, par ailleurs moins intéressante que la situation elle-même révélée par le livret.
Bieito évacue tout ce que l’action peut avoir d’anecdotique pour se concentrer sur la psychologie et les replis des âmes des personnages. On regarde ces deux premiers actes avec une sorte de fascination morbide qui laisse de côté l’intrigue, par ailleurs moins intéressante que la situation elle-même révélée par le livret.
Troisième pôle de cette première partie, le personnage de Vitelozzo Tamare dont la singularité apparaît immédiatement, quand tous sont en rang d’oignon face au public le long du proscenium, Tamare, dos au public, est comme collé à la paroi blanche. Le rabatteur officiel de cette société, âme damnée du duc Adorno fournit– selon le livret- les jeunes filles à consommer, dans un Elysium qui n’est autre qu’un Moloch à qui l’on offre des vierges. Il est donc le rabatteur des enfants dans la mise en scène de Bieito. Mais d’emblée, sa singularité se fait jour : le personnage est évidemment cynique et sans foi, mais il montre en même temps une fragilité voire une sensibilité qui en fait une sorte de héros contradictoire, d’une terrifiante humanité, le monstre à aimer qui serait en quelque sorte la beauté du diable. Michael Nagy dans cette personnification du diable amoureux (il aime Carlotta) est vraiment époustouflant.
Ainsi Bieito met-il tout en place en cette première partie qui est révélateur de tout ce qui qu’on veut cacher. On comprend le décor fermé, on comprend les signes plus que les gestes : ici toute évidence n’est qu’intuition de l’évidence, on comprend que dans cette société qui avance masquée, comme cette paroi blanche qui masque un Elysium encore mystérieux, simplement évoqué par quelques images ou quelques attitudes. Le masque est percé et va laisser passer Carlotta et Alviano. Mais la discussion sur la peinture, et la révélation de l’âme est évidemment aussi discussion esthétique : Bieito n’évacue pas la question de l’art, mais la place là où elle doit être : l’art – révélation du beau- peut-il représenter le laid, le monstrueux : la laideur comme suprême état de la beauté. Baudelaire écrit les « Fleurs du Mal » au sens propre pour faire voir le beau du laid, ce que Rimbaud traitera aussi dans un poème comme la Venus Anadyomène.
Cette question est ici centrale et se confronte à l’état extrême de la laideur morale : ce qu’est Alviano : l’art peut-il en faire de la beauté ? C’est un débat esthétique déjà ancien, mais qui prend ici corps (au sens propre et figuré). Et lorsque Carlotta a saisi Alviano dans sa laideur, elle s’en désintéresse : ce n’est pas un amour physique qu’elle recherche. Et donc Bieito va ainsi justifier son attirance vers Tamare dans la deuxième partie, non comme un retournement, mais comme révélation. Par le choix de Carlotta, Tamare et Alviano, qui sont deux soleils noirs de la Gênes mythique de Schreker deviennent presque antagonistes par nature, non parce que l’un est bon et l’autre méchant, mais parce que l’un est un monstre (Alviano) et l’autre un humain (Tamare).
Jeux d’enfants, jeux interdits
L’effroyable jeu va se révéler au troisième acte, plus de cloison, nous sommes de plain-pied avec l’intérieur de l’Elysium, mais d’abord une lumière si crue qu’elle empêche de tout voir. Le fond du décor est une grille, comme une grille de prison, à l’intérieur de laquelle, disparue la lumière crue qui aveugle au lever de rideau affichant au néon « Elysium », se trouvent une masse de jouets géants, ours en peluche, héros de mangas, et un petit train d’enfants qui tourne de manière obsessionnelle, avec une locomotive qui crache de la vapeur, comme sur certains jouets.
La première image, Carlotta traîne avec elle un ours en peluche géant qu’elle va besogner avec des mouvements divers dans la salle : Ausrine Stundyte dégage une force érotique dérangeante pour certains spectateurs, et dans cet espace , le jardin merveilleux est un espace qui rapprocherait du monde de Lewis Carroll. Mais la merveille est cauchemar. Cauchemar pour Alviano qui, tout à son obsession et à son désir réprimé, est assis dans le dernier wagon du petit train pendant qu’au premier wagon est assis l’enfant blond du premier acte. Cauchemar pour Carlotta, qui a fini de révéler l’Alviano réel et effrayant, dont on comprend qu’il est le moteur de cet Elysium royaume de la pédophilie, cauchemar pour Tarare, vers qui se tourne Carlotta pour s’unir à elle dans une étreinte désespérée. Dans ce jardin effroyable qui est prison et où le monde de l’enfance, à la fois gigantesque et effrayant avec ses ours en peluche géants pendus aux cintres, n’est qu’un monde de mort, la mort qui circule dans la désespérance des personnages et leur tension, dans cet espace peu à peu envahi par les cadavres d’enfants mêlés aux jouets, et par l’extrême désespérance qui se dégage de cette course à l’abîme qui est plaisir et épouvante.
La mise en scène de Calixto Bieito est presque insoutenable, tant elle parle au spectateur sans jamais rien montrer mais en suggérant jusqu’à l’impensable, jusqu’à l’insupportable. Elle fait partie de ces travaux du metteur en scène espagnol qui vont jusqu’au bout d’une logique avec une rigueur implacable, sans aucune concession. Bieito entre chirurgicalement dans une des horreurs de toujours – la pédophilie a toujours existé, voire souvent tolérée – mais devenue aujourd’hui partout et à tous niveaux dénoncée. Du même coup, alors que le livret semble souvent improbable et avoir perdu aujourd’hui de sa force suggestive l’œuvre de Schreker avec cette clef-là prend une actualité qui lui donne un relief inattendu et une vérité paralysante.
Une direction musicale exemplaire
À ce travail glacial fait contraste une musique dont la chatoyance étonne, avec ses couleurs post-romantiques, son expressivité et le débordement sonore et instrumental aux échos symbolistes que Klemperer appelait "Inflationsmusik". La baguette de Stefan Soltesz fait émerger et ressortir une richesse, une chaleur et une rondeur qui lui rendent un lyrisme vraiment extraordinaire. Ce lyrisme (stupéfiant prélude !) se heurte aussi lui aussi au mur clinique de la première partie, comme s’il était seulement une illusion accompagnant l’enfer.
Stefan Soltesz exalte dans cette musique, certes le lyrisme, mais aussi les multiples couleurs avec des scintillements et ses reflets, ses multiples niveaux et lui donne aussi cohérence et rigueur. L’orchestre de la Komische Oper lui répond avec un engagement et une précision exemplaires, chez tous les pupitres, sans scories, sans aucune erreur, sans décalage, sans jamais écraser par le volume et soutenant toujours une distribution elle aussi exemplaire et un beau chœur dirigé par David Cavelius. Cette approche musicale de l’œuvre de Schreker est l’une des plus convaincantes parmi les productions de ces dernières années ou de ces derniers mois. Pourrais-je ajouter qu'elle cadre à merveille avec l'esthétique de la salle dont le volume convient parfaitement à l'oeuvre.
Une distribution de haut niveau
La distribution est de haut niveau, faite de membres de l’excellente troupe de la Komische Oper et du studio, et de chanteurs invités parmi les plus convaincants et les plus engagés du marché lyrique. Jens Larsen est un imposant Podestà, avec sa voix profonde et sonore, et sa présence imposante sur scène, on reconnaît aussi Ivan Turšič (Menaldo Negroni), Tom Erik Lie (Michelotto Cibo), le Pietro de Christoph Späth et la Martuccia vive et sonore de Christiane Oertel, et les jeunes membres du studio Samuli Taskinen (Pietro Calvi), Katarzyna Wlodarczyk (Ginevra Scotti), Emil Lawecki (Jüngling). La distribution (une vingtaine de personnes) est abondante et montre l’effort important de la maison autour d’une production emblématique au rapport qualité prix impensable ailleurs (76 Euros le prix maximum, et nombre de places inférieures à 50 Euros).
Du côté des rôles principaux, Joachim Goltz est un Duc Adorno à la voix chaude, bien posée et projetée, et une vraie présence, tout en distance et en insinuations, avec un vrai style et un souci manifeste du texte, et une élégance glacée qui tranche avec son âme damnée torturée Tamare.
Peter Hoare, qu’on a vu dans Die Soldaten (Desportes) du même Bieito à Zurich ou à Lyon dans Lady Macbeth de Mzensk (Zinovyi), est un des bons ténors de caractère du moment, sachant parfaitement sculpter chaque mot, avec un soin notable à la couleur. Le rôle d’Alviano n’est pas un rôle de caractère, et dans cette mise en scène, il est plutôt un personnage torturé, à la limite tragique, entre ses désirs pédophiles réprimés, son amour pour Carlotta, sa perversion qui l’a amené à créer l’Elysium pour couvrir les pires des turpitudes. Il est une âme noire découverte par Carlotta, et non ce héros du bonheur qu’on voit quelquefois dans d’autres mises en scène : il est ici un monstre pris en étau. Peter Hoare n’a peut-être pas avec toutes ses qualités techniques le format vocal du rôle, notamment dans la partie finale où la voix ne résiste pas au volume de l’orchestre. Il reste néanmoins un grand Alviano, très différent et particulièrement présent en scène, plein de relief et de profondeur, qui sert parfaitement une mise en scène qui remet en question toute la tradition de l’œuvre, la transformant en conte cruel, voire au-delà de la cruauté.
Deux personnalités d’exception
Ausrine Stundyte, c’est toujours un personnage et une voix, quel que soit le rôle affronté : c’est ce qui fait la singularité d’une artiste qu’on emploie désormais systématiquement dans les rôles difficiles qui exigent un engagement scénique audacieux et une voix d’un métal impressionnant.
Une fois de plus, sa présence scénique est particulièrement forte, et elle sait donner toutes les facettes du personnage à la fois fragile et désespéré. Durant la longue scène du portrait, elle se fait tour à tour distante, séductrice, presque câline pour deviner l’âme d’Alviano. Quand elle comprend, elle s’habille en petit garçon, manière de capturer ses goûts, son âme et la nature réelle du personnage, il sera temps alors de l’entraîner derrière la paroi, en passant par le trou formé par son portrait, pour arriver dans l’Elysium qu’il s’est interdit à lui-même. Insinuante, douce, contrôlant la voix d’une manière impressionnante, avec une émission parfaite et des aigus dardés, sans failles, à part quelques sons métalliques en deuxième partie où elle fatigue visiblement. La chanteuse est un phénomène dont il est difficile d’affirmer qu’il sera durable, tant l’engagement de l’artiste est aussi consomption, tant elle dérange, tant elle envahit la scène tout autant que son volume vocal envahit la salle. Beaucoup plus torturée au troisième acte, elle se donne à Tamare avec l’énergie du désespoir, de celle qui est malade du cœur (sans doute au propre et au figuré) et donc sur un fil, de celle qui fut prise dans sa jeunesse et qui n’arrive pas à se libérer d’une douleur qui renaît avec le désir. Interdite de don de l’âme, mais autorisée seulement au don du corps. Brûlante et lacérante.
Tout aussi engagé en scène, et tout aussi ambigu, le Tamare de Michael Nagy est l’un des plus grands qu’il m’ait été donné de voir dans cette œuvre et l’une des personnifications les plus accomplies : comme souvent, il faut dans ce personnage un chanteur qui sache incarner, qui soit doué d’un jeu et d’une présence incontestables, c’était le cas de Maltman à Munich. Nagy a ici à la fois le côté pervers et dangereux, mais aussi dans la seconde partie les aspects torturés – en cela il est un miroir des tortures de Carlotta, mais il a ensuite dans la voix et dans l’allure une sorte de douceur et de tendresse qui transpirent, superbement affichées qui contribuent à complexifier encore le personnage et en faire le centre de la trame, à chaque moment plus fragilisé. Cette fêlure, Nagy la porte jusque dans la voix, parfaitement adaptée au volume de la Komische Oper, avec une magnifique diction (c’est un chanteur d’oratorio et de Lied notable), et un soin vraiment prodigieux donné aux accents, à l’expression, soit une priorité au texte telle qu’il domine vraiment l’ensemble de la distribution en portant le personnage à l’incandescence tout autant qu’à la déchéance sublime. Il y a là non seulement une performance, mais le rendu d’une épaisseur humaine rare sur une scène.
Conclusion
Musicalement sans faille aucune, emportée par une direction attentive, lyrique, rassurante en quelque sorte au regard de ce qu’on voit et soutenue par une distribution de haut niveau dominée par deux personnalités d’exception, cette production méritait un travail de grand niveau et Calixto Bieito signe là une de ses mises en scène les plus glaçantes et les plus rigoureuses, ne laissant aucune ouverture, aucune issue, et décrivant de manière clinique un système qui finit par engloutir tous les personnages dans cet enfer qui se voulait Eden.
L’utilisation d’un groupe d’enfants comme figurants, avec leurs visages à la fois angéliques et quelquefois ambigus, beauté des anges et beauté du diable, renforce le malaise créé dans le public parce qu’il n’existe nulle part de l’innocence dans ce travail, qui nous livre un enfer universel, un « affreux soleil noir d’où rayonne la nuit »(( Victor Hugo, Les contemplations)).

