
Le concert intitulé « L'affaire Vivaldi : de et avec Federico Maria Sardelli », offert le 8 février 2025 par l'Accademia Filarmonica di Messina – qui honore ainsi au mieux sa mission culturelle et musicale -, n'est pas une soirée musicale comme les autres : sur le papier, cela ressemblerait à un concert normal consacré à la musique de Vivaldi, mais l'exécution contient une lecture, qui contient à son tour un monologue théâtral, qui contient une narration historique passionnante comme un roman policier, qui contient enfin une lectio magistralis sur ce que peut signifier l'interprétation musicale, en particulier celle historiquement informée. La surprise ici est en effet que la musique jouée n'est pas contenue dans le spectacle, comme un élément central, mais au contraire se révèle comme le véritable contenant dont les composants individuels, les aspects progressivement explicités au cours du spectacle, constituent les couches d'une précieuse sédimentation interne, le mystère tant défendu.
Connaissant Federico Maria Sardelli, l'un de nos artistes les plus représentatifs et les plus appréciés dans le monde, tout cela était prévisible. Sardelli, originaire de Livourne et donc anticonformiste par définition et par vocation, ne se consacre pas seulement à la musique : il est peintre, écrivain, essayiste, humoriste ; c'est donc un artiste complet qui résume en une seule personnalité le spectre expressif de diverses disciplines artistiques. En cela, le maître de Livourne semble confirmer l'intuition de Schumann (qui représente alors la position de toute la Romantik), selon laquelle une même activité créatrice peut s'incarner indifféremment dans une matière ou une autre, car le Beau, en définitive, n'est qu'un seul et les différents domaines de l'art communiquent entre eux en ce qu'ils se réfèrent à une seule Idée.

Mais la polyvalence dont il a fait preuve jusqu'à présent ne suffit pas encore : lors de la soirée à Messine, Sardelli se révèle également acteur, en ce sens que la lecture de passages de son « Affare Vivaldi » (Sellerio 2015, traduit de l’italien par Martine Legein sous le titre « L’affaire Vivaldi », Van Dieren Editeur, 2022 ) demande et peut-être impose une dramatisation adéquate qui donne corps aux gestes, aux phrases, aux humeurs et aux émotions intenses de ses personnages.
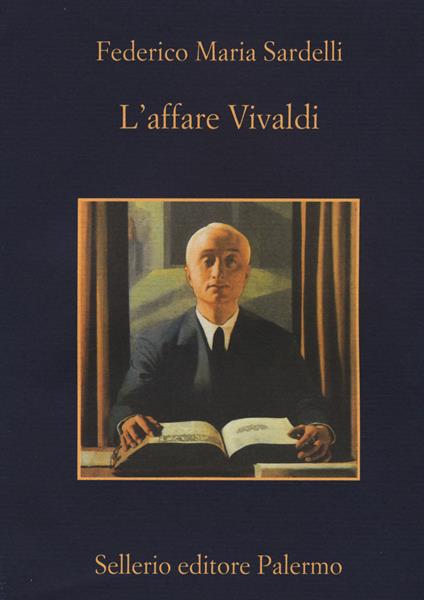
Le chef d'orchestre et flûtiste ne recule donc pas, même face à la représentation scénique de la douleur déchirante et des supplications inutiles de l'un des protagonistes de son polar historique face à la mort de son fils nouveau-né : Sardelli quitte son rôle de narrateur-philologue-chef d'orchestre et entre dans la peau de Roberto Foà pour interpréter en personne sa grande douleur. On pourrait penser ici à un coup de théâtre facile, à la conscience qu'a Sardelli de l'effet que la douleur ne manque jamais de produire sur scène, mais il y a autre chose. En évoquant la mort d'un enfant et la douleur d'un père, Sardelli met en scène le grand thème du baroque tout entier : celui de la mort aux mille visages comme limite tragique de la vie. Cependant, comme le montre le mythe d'Orphée, seule la musique est autorisée à franchir cette frontière pour ensuite revenir miraculeusement en arrière : ainsi, l'histoire des deux enfants Mauro Foà et Renzo Giordano morts prématurément (nous sommes dans les années 1920, lorsque la mortalité infantile est encore malheureusement fréquente), incite deux pères juifs, Roberto Foà et Filippo Giordano, déchirés par leur perte, à financer en leur mémoire la récupération des manuscrits de Vivaldi, alors que celui-ci avait déjà pris le chemin de l'Ombra.
 En racontant l'histoire de la récupération heureuse de l'immense héritage de Vivaldi, Sardelli évoque de manière très appropriée l'image du manuscrit musical, qui a besoin d'être exécuté pour reprendre vie et qui conserve, comme un écrin, la pensée musicale d'un compositeur parfois disparu depuis des siècles. Celui du corpus vivaldien n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de la vie téméraire des manuscrits musicaux, qui font souvent face à des parcours historiques accidentés et à des risques de toutes sortes pour arriver jusqu'à nous : si seulement nous connaissions mieux les événements de la « tradition » – c'est-à-dire, en philologie, la transmission historique d'un texte –, nous aborderions l'exécution musicale avec plus de respect pour le texte qui nous est parvenu après mille difficultés, et avec gratitude pour la chance imméritée dont nous jouissons lorsque nous le trouvons devant nous sur le pupitre. Le mystère du legs de Vivaldi est cependant, en ce sens, si particulier qu'il mérite le roman historique L'Affaire Vivaldi que Sardelli lui a consacré. Dans ce volume, l'histoire rocambolesque du legs de Vivaldi, qui passe de Venise à Gênes de manière fortuite, jusqu'à ce qu'il arrive dans un monastère salésien du Piémont au milieu des années 1920, est reconstituée à l'aide d'une documentation historique exemplaire. C'est là que le premier coup de chance (pour nous tous qui pouvons écouter la musique de Vivaldi) se produit : deux chercheurs, Alberto Gentili et Luigi Torri, comprennent l'énormité de ce qu'ils ont devant eux et se lancent dans une bataille pleine de rebondissements pour acquérir l'ensemble du répertoire de Vivaldi, divisé en deux parties par des successions compliquées, pour la Bibliothèque de Turin. Le corpus est réuni à la fin des années 1920 et le grand musicologue juif Gentili commence son catalogage en vue de la publication. Mais ce sont les années du fascisme : en 1938, les infâmes lois raciales sont promulguées et Gentili est privé de sa chaire (la première en Italie consacrée à la musicologie) à l'Université de Turin. Sardelli a raison de rappeler que peu de ses collègues et étudiants qui suivaient ses cours lui ont serré la main par solidarité ; et il a également raison de rappeler que le compositeur du régime Alfredo Casella s'est approprié sans scrupules les recherches de Gentili (entre-temps réfugié à l'étranger), s'attribuant le mérite de la redécouverte de Vivaldi.
En racontant l'histoire de la récupération heureuse de l'immense héritage de Vivaldi, Sardelli évoque de manière très appropriée l'image du manuscrit musical, qui a besoin d'être exécuté pour reprendre vie et qui conserve, comme un écrin, la pensée musicale d'un compositeur parfois disparu depuis des siècles. Celui du corpus vivaldien n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de la vie téméraire des manuscrits musicaux, qui font souvent face à des parcours historiques accidentés et à des risques de toutes sortes pour arriver jusqu'à nous : si seulement nous connaissions mieux les événements de la « tradition » – c'est-à-dire, en philologie, la transmission historique d'un texte –, nous aborderions l'exécution musicale avec plus de respect pour le texte qui nous est parvenu après mille difficultés, et avec gratitude pour la chance imméritée dont nous jouissons lorsque nous le trouvons devant nous sur le pupitre. Le mystère du legs de Vivaldi est cependant, en ce sens, si particulier qu'il mérite le roman historique L'Affaire Vivaldi que Sardelli lui a consacré. Dans ce volume, l'histoire rocambolesque du legs de Vivaldi, qui passe de Venise à Gênes de manière fortuite, jusqu'à ce qu'il arrive dans un monastère salésien du Piémont au milieu des années 1920, est reconstituée à l'aide d'une documentation historique exemplaire. C'est là que le premier coup de chance (pour nous tous qui pouvons écouter la musique de Vivaldi) se produit : deux chercheurs, Alberto Gentili et Luigi Torri, comprennent l'énormité de ce qu'ils ont devant eux et se lancent dans une bataille pleine de rebondissements pour acquérir l'ensemble du répertoire de Vivaldi, divisé en deux parties par des successions compliquées, pour la Bibliothèque de Turin. Le corpus est réuni à la fin des années 1920 et le grand musicologue juif Gentili commence son catalogage en vue de la publication. Mais ce sont les années du fascisme : en 1938, les infâmes lois raciales sont promulguées et Gentili est privé de sa chaire (la première en Italie consacrée à la musicologie) à l'Université de Turin. Sardelli a raison de rappeler que peu de ses collègues et étudiants qui suivaient ses cours lui ont serré la main par solidarité ; et il a également raison de rappeler que le compositeur du régime Alfredo Casella s'est approprié sans scrupules les recherches de Gentili (entre-temps réfugié à l'étranger), s'attribuant le mérite de la redécouverte de Vivaldi.
Le reste n'est que musique : le concert propose de merveilleux morceaux de Vivaldi, rarement entendus. Dans un entretien accordé à Silvia D'Anzelmo pour Quinte parallele, Sardelli a déclaré, de manière tout à fait compréhensible, qu'il avait tendance « à éviter d'interpréter les œuvres les plus connues, comme Les Saisons de Vivaldi, car elles sont désormais usées par les interprétations, dénaturées au point d'être méconnaissables. Tous les ouvrages les plus célèbres subissent ce traitement et finissent par ne plus rien nous dire, ils sont inaudibles ». C'est pourquoi, ajoute Sardelli, ils devraient « être laissés en sommeil pendant de nombreuses années avant d'être abordés à nouveau ». Impeccable, même si l'on peut prévoir le déluge d'exécutions des Saisons de Vivaldi pour le prochain anniversaire en 2028.
Avec le répertoire baroque tardif (non seulement Vivaldi, mais aussi Händel et Lully, que Sardelli juge à juste titre « négligé de manière incompréhensible »), il y a cependant le dilemme de l'approche d'exécution : informée ou non informée ? L'Ensemble Modo Antiquo (fondé par Sardelli en 1987) a interprété à Messine le Concerto en ré mineur RV 813, la Sonate en sol majeur RV 820, In memoria eterna (tirée de Beatus Vir, RV 795 dans sa version instrumentale), le Concerto en ré majeur RV 818 « pour Anna Maria », et enfin la Symphonie n° 1 de l'opéra « Il Farnace », RV 711‑D. Les membres de l'ensemble – Federico Guglielmo, violon solo ; Stefano Bruni et Raffaele Tiseo, violons ; Pasquale Lepore, alto ; Bettina Hoffmann, violoncelle ; Nicola Domeniconi, contrebasse ; Gianluca Geremia, théorbe, Sardelli, flûte – adoptent un diapason plus bas de 440 Hz, jouent avec des cordes baroques, même s'ils ne les tiennent pas à la manière baroque (c'est-à-dire plus près du centre de l'archet) ; Bettina Hoffmann utilise un violoncelle sans talon, tenant l'instrument entre ses jambes comme il était d'usage ; le théorbe réalise la basse continue ; personne n'utilise le vibrato ; Sardelli lui-même joue de la flûte traversière. On pourrait donc en conclure qu'il s'agit d'une « interprétation historiquement informée ». Cependant, l'effet n'est pas celui habituel avec ce type d'interprétation d'un son « exotique » – bien que reconnu, avec un effort culturel, comme approprié au répertoire – dans lequel la « fidélité », la reconstitution du Ur-Ton, est privilégiée par rapport à une interprétation musicale vivante et engageante. Ce n'est pas le cas de l'Ensemble Modo Antiquo : les sublimes pages de Vivaldi sont restituées avec un tel naturel et une telle adhésion aux principes de sa poétique qu'elles laissent derrière elles tout académisme philologique, tout dogme étranger à la logique musicale, toute diatribe étouffante sur les matériaux, les instruments, les effets, le style. Sardelli montre qu'il considère la reconstitution de la pratique historique, sous ses différents aspects, comme un simple moyen qui doit être transcendé par l'expression musicale, qui reste le but d'une interprétation digne de ce nom. Ainsi, ses gestes de direction restituent avec une fidélité supérieure l'univers de Vivaldi, faisant vivre l'intensité désespérée et les éclats descriptifs de cette musique avec des gestes qui évoquent tour à tour une vague, un frémissement, une plainte, un fracas soudain, une lueur d'espoir. Dans les mailles de la narration, Sardelli enfile également une véritable perle de compréhension pour le monde plein de charme du baroque tardif qui semble en équilibre au bord de la modernisation des Lumières, pas si sûr de croire à la promesse de sorts magnifiques et pleins de progrès réservés à l'humanité ou à l'imposante accumulation de deuils et de contradictions du siècle qui vient de s'écouler. En parlant de la musique de Vivaldi, Sardelli la qualifie de « sereine et dramatique » : impossible de mieux la définir.

