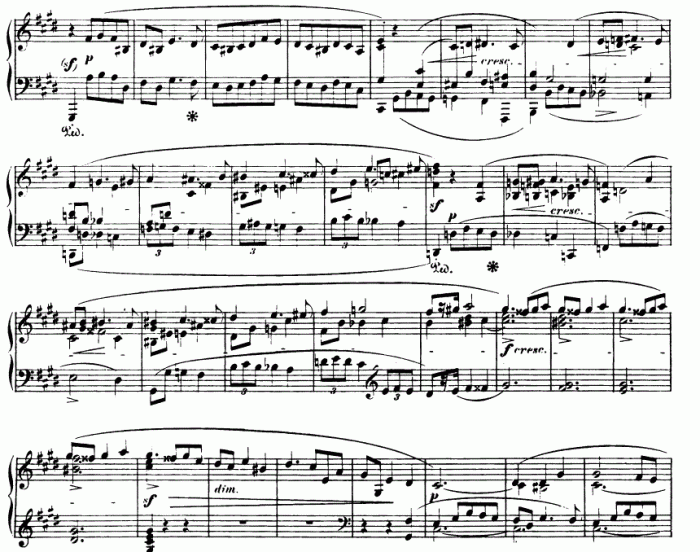A deux égards, le programme de ce millésime était de nature à mettre Lugansky en danger. Dans la mesure où celui-ci ne pouvait s’appuyer pour au moins une partie sur une architecture dans laquelle mettre à profit son intelligence de la structure de long terme – typiquement, une sonate de Rachmaninov ou de Prokofiev ; et par ailleurs, dans la mesure où l’absence totale de Rachmaninov dans ses programmes est rare, et qu’il est fréquent que cette situation paraisse le déstabiliser. Pour autant, il n’y avait rien que du familier dans ce couplage, même si le cycle de Tchaikovsky a été moins souvent arpenté dans son intégralité par Lugansky ces dernières années. La partie Chopin convoquait des piliers de son répertoire (opus 52 et 60 surtout), que le public français a pu entendre a plusieurs reprises déjà. On garde notamment le souvenir d’une Barcarolle particulièrement souveraine dans son équilibre agogique, harmonique, et avec cantabile rarement consenti sous ces mains, en mai 2012 en ces mêmes lieux. On pourrait simplement rapprocher ces deux exécutions, et mesurer ce qui depuis quelques années semble au mieux une remise en question, au pire une crise qu’on espère passagère dans le rapport à l’instrument de ce pianiste si vanté pour une technique en acier et dont la fiabilité tient beaucoup à son caractère d’horlogerie gestuelle fine, sensible aux moindres dérèglements, aux plus petites tensions mentales ou physiques – on a beaucoup plus passé sous silence ce qui, à nos yeux, fait tout le prix de cet artiste : l’entièreté et la cohérence stylistique, l’intelligence du fait musical valorisé pour lui-même et sans apparat psychologique, et l’humanité fragile, la pudeur, la beauté morale non puritaine. Seulement, si l’esprit semble être resté intact après tant d’années à parcourir les mêmes salles avec les mêmes œuvres (et on sera le dernier à en faire le reproche), il y a cette impression récurrente depuis quatre ou cinq ans que quelque chose dans la sonorité s’est asséché et durci, et que même les soirs où brûlent l’envie et l’engagement, l’intensité s’obtient au prix d’une incarnation de cette dureté, que les grands doigts charnus de Lugansky parviennent moins qu’avant à prévenir. Certes, parce qu’il a ces « mains de pianistes » qui n’en sont donc pas, il n’a jamais eu la chaleur de timbre, la rondeur et le rebond innés d’autres tauliers de sa génération, les meilleurs chopiniens actuels du reste, que sont Berezovsky, Skanavi et Andsnes ; mais il a toujours su compenser par une application, admirable, esthète en soi, au geste juste, à l’amorti, à une discipline extrême de la décontraction, donnant à la liberté et au souffle la beauté de la chose conquise et méritée.
Dans ce récital, il y a eu de ces moments de quasi-saturation de timbre, où transparaissait franchement la tension musculaire, et presque le parasitage exercé sur la conduite musicale. En particulier dans la partie estivale des Saisons : y compris la barcarolle, dépourvue de chant, frustrée de longueur de phrase. C’est aussi que la probité de Lugansky l’empêche ici de recourir aux artifices classiques des faiseurs – timbrage grossier de la voix haute, rubato salonard, intimisme dynamique forcé. Perce-neige souffre des mêmes affres physiques mais est davantage rédimé par le perfectionnisme moral, par la persistance, même dans la grisaille sonore, du sens du grand style, de l’économie d’effets et du phrasé juste, minimal. On peut en dire de même de Décembre, drapé dans sa pudique bienveillance, mais moins de Janvier, Octobre ou Novembre, qui appellent davantage une main, une magie, une souplesse transcendante, celles de Pletnev par exemple. Au terme du cycle, on a encore retrouvé le compagnon familier de dizaines de belles soirées, mais toujours pas son piano.
Sur le strict plan de la qualité de son, la partie chopinienne n’aura pas été plus convaincante, mais au moins aura montré autre chose : une volonté de dépasser cela, de trouver autre chose par la prise de risque, plus discursive que technique. Et si la Polonaise-fantaisie est de facture stylistique ordinaire, alternant de la façon la plus courante immobilité, appels militaires et confidence musardantes, la radicalité des oppositions d’épisodes surprend de la part de Lugansky, que l’on a bien sûr connu davantage dans l’understatement, ou plus exactement attaché à un art consommé de la caractérisation distanciée, élevant l’accent, le phrasé, le rubato à un stade de symbolisation. Ici, le geste est plus direct, presque bousculé dans une coda où l’aristocrate se met en danger. La Barcarolle aussi cherche, et trouve parfois des déséquilibres stimulants, dans une optique bien moins épurée, au lyrisme plus émacié qu’il y a quelques années. Il est dommage que la tendance de la main gauche à détimbrer, et une relative confusion, obscurcisse la récapitulation finale, intelligemment préparée. La ballade en fa mineur présente les mêmes traits : Lugansky y a toujours refusé l’élégance comme fin en soi, et recherché la clarté d’articulation à grande échelle. Il tente ici de souligner césures, tension et détente avec un surcroît, par rapport à l’habitude, de poigne, ou de virilité. Le son s’incarne ici et là par-delà la dureté, vibre malgré le manque de projection, se fait cramoisi mais au moins expressif ; le discours se tient orgueilleusement debout, le sens comme méta-théâtral de la prosodie mélodique le soutient toujours. Là encore, seul le manque d’intelligibilité vient entamer la crédibilité de l’ensemble, dans de dernières pages volcaniques mais polyphoniquement écrasées.
De façon inattendue, c’est dans la sélection de mazurkas que s’affirme cette quête d’un nouveau feu sacré, et de transmutation d’une matière sonore défaillante en flamme vaillante. Le sens rhétorique de Lugansky, qui donne de la grandeur aux petites formes denses (les mélodies oubliées de Medtner, les études-tableaux de Rachmaninov), celui que l’on a souvent vu briller dans la valse op. 64 n°2, trouve ici de quoi faire. C’est dans un autre chef d’œuvre en do dièse mineur, l’opus 50 n°3, que s’affirme au mieux cette éloquence plus mordante, presque méchante du Lugansky en mue. Il est fait droit, sinon à tous, au moins à une bonne part des sortilèges venimeux d’une partition qui compte parmi les plus difficiles à conduire et les plus impitoyablement violentes, émotionnellement, de Chopin. L’engagement et la dignité mâles de Lugansky y emportent l’adhésion, car le piano, s’il demeure d’un gris austère, est ici discipliné, tenu à la clarté, jusque dans la redoutable progression finale, impeccablement directive, inexorable mais sans brutalité, ni mutation forcée en un poème de Scriabine (ce qui était le pêché d’hybris d’un Sokolov il y a peu). Dans la nostalgie désespérée des ornements de l’op. 30 n°3 aussi, ce piano assombri et tendu parvient à une forme de parlando forçant l’écoute tout en préservant le sens de la retenue, la hauteur de propos – une manière nouvelle, moins faite de grâce que de sévérité, qui faisait déjà l’intérêt de certains de ses Schubert ou de ses Franck récents. Son étude op. 10 n°8, toujours impeccable, a néanmoins moins de chien, d’aisance et de galbe qu’auparavant. En revanche, son Mendelssohn, ici l’op. 67 n°2 (qu’il alterne depuis quelques temps en bis avec l'op. 85 n°4) continue de s’approfondir, et de montrer combien ce musicien sait le sérieux et la portée de cette musique ainsi que de la tradition d’interprétation dont il pourrait, devrait être le dépositaire. Un autre enjeu évident du devenir de Lugansky est le développement de son répertoire, qu’il n’a jusqu’ici que timidement étendu aux aires germaniques. Ses dernières explorations schubertiennes ont montré quelques promesses, mais s’il en est bien une où l’on ne demande qu’à le suivre, c’est du côté de Mendelssohn.