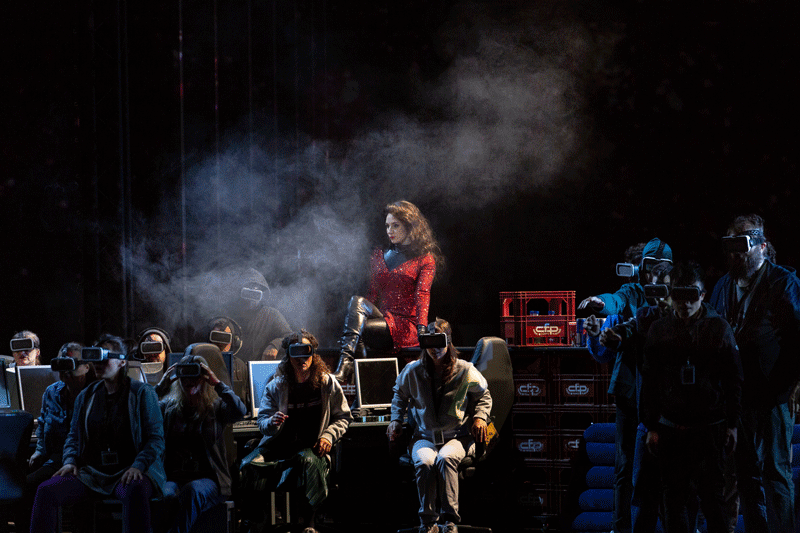La simplicité étant un choix bien peu rationnel quand on peut faire compliqué, les architectes de l’auditorium ((Arquitectonica (Miami) et Bougeault–Walgenwitz (Dijon), assistés de Richard Martinet (Paris) )) ont conçu leur bâtiment comme un piano sous lequel passe la rue et le tram. On entre à l’opéra par un long escalier mécanique pour accéder au hall d’entrée, qui passe justement au-dessus des voies de circulation. Un genre de passerelle autoroutière qui remplace Autogrill par Opéra… Au pied de l'escalator , une petite affichette toute simple, mais particulièrement significative à mes yeux, annonce qu’en raison de la forte demande, il ne sera pas mis en vente de places à tarif réduit (10€). Il y à Dijon paraît-il (on moins son directeur l’affirmait-il sur les ondes) chaque soir des billets en vente à prix réduit…chaque soir ? non, la preuve en est ce soir. Les billets à prix réduit de 10€ n'existent donc qu’en fonction des invendus, et donc rapportent au théâtre qui sans cela resterait avec des places inoccupées, mais ils disparaissent si comme ce soir, le théâtre est plein. Il n’y a donc là rien d’une politique « sociale » d’accessibilité à l’opéra. C’est le genre d’entourloupe qui a le don de m’agacer, qui fait prendre pour générosité sociale ce qui n’est qu’une forme de braderie. Détestable. Certes, les opéras sont accessibles aux scolaires à des prix politiques, mais les maisons reçoivent pour cela des subventions et doivent répondre à un cahier des charges. Pour ces billets à prix réduits, ce sont des choix de billetterie, et donc du management de la maison. Les billets à 10€, miroir aux alouettes…
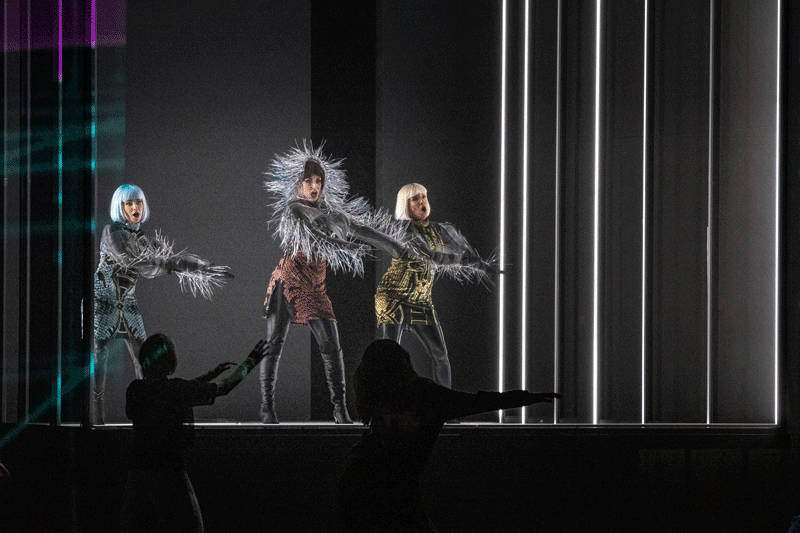
Miroir aux alouettes aussi la Carmen-avatar que suscite une Micaela amoureuse pour son gick de Don José, surveillant d’une sorte d’internet-café, et d’avatar en avatar, Don José va vraiment tomber amoureux de cette Carmen qui n’est que l’avatar de Micaela .
Florentine Klepper veut souligner deux points, d’une part l’invasion du virtuel dans la société, et notamment dans sa jeunesse, un virtuel qui fait préférer les écrans au réel. C’est à la fois banal, on l’entend dire sur toutes les ondes et on le voit à chaque instant, et symptomatique d’une société où la question de la relation à l’autre (centrale dans Carmen où Carmen est la gitane, « l’autre détestable ») est devenue perturbante et perturbée. D’autre part, plus conforme et habituel, les héros comme Carmen ou Don Giovanni sont souvent vus comme des projections de ceux qui en sont leurs victimes, le personnage perdant toute réalité pour devenir un objet de passion singulier et obsessionnel.
Par ailleurs, en acceptant de faire Carmen, Florentine Klepper a bien dû se demander quoi faire avec une histoire aussi rebattue, et cette histoire d’avatar pouvait être très bienvenue, c’est moderne, c’est jeune, c’est d’aujourd’hui, et on peut la combiner avec des constructions en abyme, du théâtre dans le théâtre, escales par lequel passe ce parcours du Tendre numérique pas si neuf. De Florentine Klepper, j’ai vu il y a quelques années une Arabella d’une rare platitude au Festival de Pâques de Salzbourg : avec Thielemann dans la fosse et un public qui a payé bonbon, pas question d’y rêver à une Arabella (Renée Fleming)-Lara Croft…mais à Dijon…
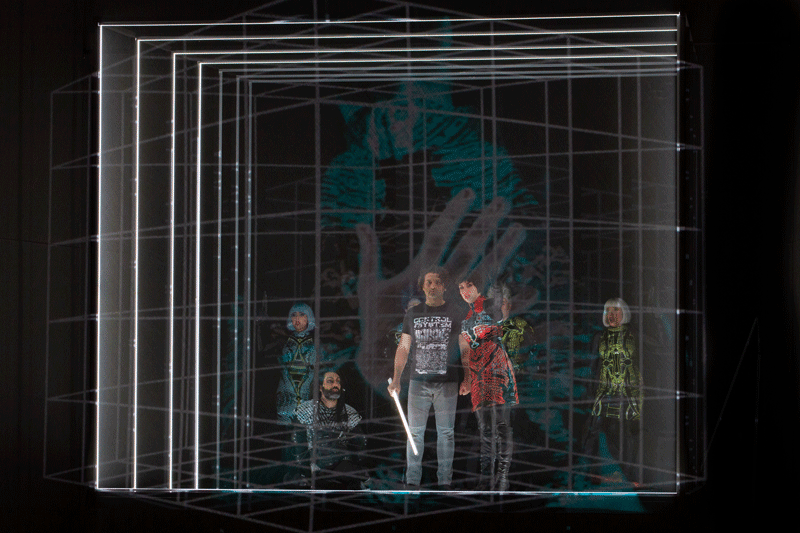
Trêve d’ironie, l’idée de départ n’en est pas si absurde. On s’esbaudirait de Don José en clinique psychatrique chez Tcherniakov (à Aix) et pas de ce Don José en addict de réalité virtuelle chez Klepper ? Ce n’est pas l’idée elle-même qui fait problème, mais les procédés utilisés pour la réaliser. Il s’agit évidemment et une fois de plus de transposer ; à la place où « chacun passe et chacun va » se substitue un internet-café, aux soldats qui montent la garde, des employés chargés de gérer le matériel et de canaliser les clients, le tout dans un univers d’écrans, de projections, de messages échangés via WhatsApp ou messenger.
Une fois qu’on a transposé, il reste à tisser une cohérence entre texte existant et livret, et le scénario qu’on veut lui plaquer. Et c’est bien là que les choses coincent, notamment dans la première partie.
C’est en effet le revers de la médaille que d’installer une dramaturgie nouvelle, appuyée sur une lecture qui transpose le livret dans une situation particulière. Il faut tenir la distance, affirmer une logique et surtout montrer que le livret résiste à ce nettoyage. Bien sûr les dialogues originaux – qui ne sont pas une œuvre d’art – étaient en large décalage avec l’option choisie et il a fallu les changer, en mimant le langage d’aujourd’hui pour faire actuel et en lui donnant une vacuité dont on se demande si elle est voulue pour souligner la médiocrité des personnages dans leur ensemble. Bien sûr aussi les paroles des parties chantées, notamment dans les deux premiers actes, sont elles aussi en décalage avec la situation installée, mais cela marche difficilement au début, où la lecture scénique est confuse, allusive, avec les soldats devenus surveillants d’internet-café, et la foule devenue l’ensemble des clients. Ainsi les enfants de la garde montante envahissant le café et regardent fascinés les écrans ne se justifient-ils pas vraiment dans cette nouvelle dramaturgie : Florentine Klepper fait comme elle peut pour donner de la logique et justifier ses options. Mais c’est tiré par les cheveux et quand même bien faible avec les nombreuses coupures dans texte et musique qui en sont la conséquence inévitable.
Claire en revanche la manière dont Micaela fait surgir l’avatar de Carmen, pour devenir celle qu’elle ne sera jamais et en même temps essayer de re-séduire un Don José plus occupé de ses écrans que de sa « fiancée », ou de la fiancée qu’on essaie de lui imposer. Pour que ce soit clair pour tous, Micaela munie de son casque et des capteurs sur les mains fait les gestes que Carmen-avatar reproduit dans la habanera. Mais les gestes des deux ne sont pas synchrones c’est approximatif et devient un peu ridicule. À moins que l’avatar se libérant des gestes de son original n’affirme ainsi son autonomie.

Mêmes problèmes au deuxième acte, où l’auberge de Lillas Pastia est tout naturellement l’internet-café et où la danse Les tringles des sistres tintaient et le quintette se déroulent sur un écran géant, sorte de théâtre dans le théâtre qu’on reverra jusqu’à la fin, manière de revenir à quelque chose de plus traditionnel, et de reconnaître aussi le côté aporétique de l’option choisie. Seulement, à la fin du deuxième acte, tous les clients du café se scannent et deviennent leurs avatars, ce qui rend le troisième acte entièrement « virtuel » et donc foncièrement traditionnel (on abandonne le jeu réel virtuel pour séjourner dans le virtuel) : on retrouve l’histoire éternelle de Carmen, y compris avec un taureau virtuel sauf que les « coups de navaja » deviennent des coups de sabre laser, Lara Croft au pays de Star Wars…A la fin seulement, Don José repartant voir sa mère sort du virtuel pour se traîner vers le réel.

Un réel qui à l’inverse du troisième marque le quatrième acte. Don José est en couple avec Micaela, et il s’ennuie : Micaela amène un lit d’appoint, et commence une pantomime grotesque (c’est voulu) où Micaela demande à Don José à l’aider à faire le lit. Dieu que le quotidien est ennuyeux ! se dit Don José qui va finir par enfiler son casque et vivre le duo final avec Carmen et tuer Carmen, tuer l’avatar pour en finir avec sa « double » vie, mais quand il revient au réel, Micaela est partie, mais sans doute pas définitivement (le spectateur est libre de choisir)…
Ce dernier acte pour concentrer mieux le drame, se déroule musicalement sans le quadrille initial, coupé (surprenant eu égard à la célébrité de la pièce), la pantomime initiale alors se serait trop traînée avec le quadrille dont on n’avait pas besoin pour cette dramaturgie. Il se déroule aussi, et ça c’est une idée intéressante, avec les deux seuls personnages de Micaela et Don José : chœur, personnages, fête sont invisibles, dernière le rideau, et donc le pittoresque hispanisant est complètement effacé. Seul le duo est conservé, en virtuel et dans la scène-écran virtuel qu’on a vue depuis l’acte II.
Comme on l’a écrit plus haut, l’idée initiale est défendable, elle fait partie de ces idées qui essaient de replacer le drame de Carmen dans un contexte différent, en isolant (un peu comme chez Tcherniakov) le personnage de Don José, vu ici comme un médiocre, sans richesse intérieure, vide et cherchant à remplir ce vide par le virtuel, seule solution face à une vie sans saveur qui pour en chercher un peu s’invente en plus l’avatar d’Escamillo et mettre ainsi un peu de sel dans sa fade existence et vivre au moins dans le virtuel une vie triomphale. Ainsi aussi bien Micaela que Don José sont-ils mus par le même désir d’ailleurs et donc ne sont pas vraiment faits l’un pour l’autre : ils s’organisent des super(?) vies et plus dure est la chute. Que Klepper veuille avertir des dangers du virtuel, de son côté addictif et épidémique, c’est clair, mais cela tombe à mon avis souvent un peu à plat, parce qu’elle ne réussit pas à porter la cohérence du projet à bonne fin, notamment dans les deux premiers actes difficilement lisibles
Une idée m’a séduit, dans l’air des cartes, quand Carmen‑l’avatar va chercher les cartes sur les genoux de Micaela‑l’original qui a enfilé son casque, où Micaela apparaît comme le metteur en scène de cette histoire, celle qui condamne à mort son avatar trop envahissant. Mais dans l’ensemble mise en scène laisse beaucoup de doutes même si la réalisation technique complexe est convaincante, avec de jolis effets vidéo entre les projections (la cage) et les personnages réels.
Les choses sont également très contrastées musicalement. Il est surprenant que Georgy Vassiliev, malade toute la semaine précédente, n’ait pas été remplacé : sur tout le marché européen serait-il si difficile de trouver un Don José ? C’est possible…on se souvient qu’il n’y a pas si longtemps l’Opéra de Paris dans la même difficulté n’avait trouvé qu’un Don José qui connaissait le rôle certes, mais en allemand et nous avions eu une Carmen dialoguant avec un Don José germanophone…pas étonnant qu’ils ne se comprissent pas !
Et puis pour cette dernière représentation, Micaela (Elena Galitskaia) est à son tour tombée malade, mais elle a été remplacée par Anna-Catherine Gillet qui chantait le rôle en fosse tandis que Galitskaia en scène le mimait et se chargeait des dialogues parlés.
Il est donc a priori difficile de juger du ténor, assez vaillant et courageux pour affronter le rôle dans des conditions difficiles pour lui. Et de fait, si on entend un beau timbre, quelques aigus bien placés et réussis qui nous font regretter son état vocal, les passages et le registre central sont problématiques, la voix bouge : à l’évidence il serait mieux au fond de son lit. Mais le public fort justement et gentiment le gratifie d’applaudissements nourris. Il est allé cahin-caha jusqu’au bout sans trop ternir l’ensemble, et c’est tout à son crédit
La chance de la soirée c’est la présence en fosse d’Anna-Catherine Gillet, qui chante une Micaela proprement phénoménale. On s’en est aperçu dès le premier acte mais c’est au troisième qu’elle a ébloui par un « je dis que rien ne m’épouvante » qui a littéralement magnétisé le public. Placée dans la fosse, mais à la vue du public côté jardin, elle dépassait de la tête et du buste et pendant qu’elle chantait tout le public n’avait plus d’yeux que pour elle, pendant que ce qui se passait en scène n’intéressait plus personne. Magie de l’Opéra…Gillet a donné une prestation intense, au phrasé parfait, avec un aigu lumineux et même déchirant, un volume frappant, mais aussi une capacité de contrôle et d’émettre aussi des murmures parfaitement dominés. Sans aucun doute la Micaela qui nous manquait. Ce fut l’étoile piraculeuse de la soirée.
Antoinette Dennefeld est une Carmen somptueuse. Sa prise de rôle est vraiment réussie, même si la mise en scène ne la sert pas vraiment. Chantant la habanera dans une robe rouge comme Micaela, mais d’un rouge « augmenté » par les paillettes, une sorte de Micaela puissance 2 qu’on a déjà évoquée, elle est ensuite clairement identifiée (costumes de Adriane Westerbarkey) dans une combinaison à la Lara Croft, avec des personnages qui semblent sortis d’un jeu vidéo. Autrement dit au pittoresque gitano-hispanique traditionnel répond un nouveau pittoresque de jeux vidéo. Hum.
La mezzo française montre une belle personnalité en scène, et une voix charnue, puissante, expressive qui s’impose. Avec un bel air des cartes, très senti, très intense, et un dernier acte réussi malgré une très légère fatigue. Un rôle se mûrit d’étape en étape, et c’est déjà une Carmen imposante, qui se taille un vrai triomphe mérité.
Déception pour l’Escamillo de David Bizic, un rôle pour lequel il est demandé (il le chantera encore cet été à Macerata), la voix est projetée, la diction est très correcte, avec des notes hautes souvent réussies (notamment à l’acte III, plus convaincant que le II), mais le timbre est un peu opaque pour un rôle aussi m’as-tu vu. Il y a dans Escamillo un côté brillant en toc qu’il ne réussit pas à traduire dans son approche (on a toujours dans l’oreille Ruggero Raimondi bluffant il y a des décennies). Escamillo est plus complexe à interpréter, c’est le personnage superficiel qui doit emporter l’adhésion immédiate par son côté rutilant. À cet Escamillo manque ce côté exagéré. Il est trop normal. Mais il reste un chanteur solide.
Tous les rôles de complément sont bien tenus, un signe du soin avec lequel la distribution a été composée, à commencer par la Mercedes de Yete Queiroz et la Frasquita de Norma Nahoun qui sont une paire vraiment engagée, brillante, calibrée, avec une Frasquita aux beaux aigus, et pour les deux un très joli quintette avec le Dancaïre de Kaëlig Boché et le Remendado de Enguerrand de Hys. Même homogénéité chez Moralès (Sévag Tachdjian) et Zuniga (Aimery Lefevre). Au total une distribution qui, malgré les malades, est vraiment honorable.
De même le chœur de l’Opéra de Dijon, dirigé par Anass Ismat et la Maîtrise de Dijon, sont-ils valeureux, mais gênés sans doute par une direction musicale pas toujours précise dans ses indications.
Adrien Perruchon qui commence sa carrière arrive précédé d’une bonne réputation, mais il n’a pas encore l’expérience voulue pour maîtriser les masses du plateau, un plateau qu’il suit (dans le quintette plutôt réussi à l’orchestre et dans la cohérence plateau-fosse) par intermittence, et les décalages innombrables au premier acte entre fosse, chœur et maîtrise en deviennent gênants. Les enfants dans la garde montante, tout occupés à jouer (la mise en scène leur demande des gestes confus et désordonnés, là où habituellement ils regardent le chef en rang d’oignon) ont des difficultés dans le suivi de la battue, il en résulte quelques cafouillages. De même sent-on les problèmes de mise en place (compréhensibles d’ailleurs vu la situation) dans le duo Don José / Micaela du premier acte avec un Don José sur scène à cour et une Micaela qui chante en fosse à jardin. Ces questions techniques évoquées, Adrien Perruchon recherche des sons nouveaux, avec de longs silences, un rythme tantôt très lent, puis (trop) rapide, avec des réussites cependant notamment dans le pur lyrisme. Sa direction efface souvent les aspérités, arrondit les angles, abuse un peu trop du rubato et tout cela reste trop « chaloupé » sans vraie ligne ni fermeté. On a l’impression qu’il s’essaie à des effets sans toujours des égards pour le chant, et même si on entend une personnalité, on n’arrive pas encore à être convaincu. L’orchestre de Dijon-Bourgogne quant à lui montre une belle maîtrise, notamment dans une très solide petite harmonie.
Au total, une soirée à succès mais qui à part les rôles de complément et les deux principales parties féminines n’arrive jamais à convaincre tout à fait, ni d’ailleurs à décevoir totalement, comme si on était au milieu du gué. La mise en scène laisse beaucoup de doutes même si la réalisation technique complexe est convaincante, avec de jolis effets vidéo entre les projections (la cage) et les personnages réels ; on sort néanmoins avec la faim.