Instituer le pays fertile
Il y avait quelque chose d’intrinsèquement stimulant dans la conjonction, en 24 heures, du 40e anniversaire de l’Intercontemporain, fêté sous forme rétrospective, et de la première commémoration planifiée de la disparition de Boulez suivant celle, improvisée et réussie à la Philharmonie trois semaines après sa mort). Stimulant et risqué, car à valeur de test. Une question essentielle : quel serait le climat, le ressenti d’ensemble de ces soirées ? Quel public viendrait remplir la petit puis la grande salle « Pierre Boulez » d’une Philharmonie désormais achevée, et unifiée sous l’emblème de l’icône instituée (à moins que ce ne soit l’institution iconique, et la nuance n’est pas que rhétorique) de la musique du second XXe siècle ? Parlons un peu des faits, d’abord, pour revenir à ces questions plus tard.
Quel panorama de la musique d’aujourd’hui nous donnait à voir et entendre la soirée-marathon du 17 mars, conçue par les flûtistes Sophie Cherrier et Emmanuelle Ophèle ? Le choix de jouer 24 pièces de 24 compositeurs, équitablement réparties sur un peu plus de trois heures, est un bon compromis, plus proche, certes d’une volonté synoptique que d’une grand’messe de canonisation, qui se serait limitée, par exemple, à quatre ou cinq œuvres de Stockhausen (qui ne sera pas joué du tout, finalement), Ligeti, Xenakis et Boulez. Naturellement, la part belle est faite aux extraits d’œuvres plus ou moins vastes, dont le choix de prélèvement peut être débattu à l’infini. L’ordre retenu correspond à l’âge des partitions et non de leurs auteurs, ce qui ne va pas sans provoquer quelques frottements amusants.
La gageure de l’exercice commande pernicieusement de regarder ce qui manque. Outre Stockhausen (dont Gruppen est néanmoins rappelé dans un des petits documentaires diffusés aux changements de plateaux, aux côtés d’œuvres d’autres grandes figures omises : Daugherty, Crumb…), on remarque l’absence de grandes figures de la génération Boulez – on comprends que les concepteurs du programme n’aient pas voulu augmenter la difficulté en intégrant les compositeurs nés il y a plus d’un siècle. Pour mémoire et sans préjuger d’une malveillance peu probable, citons les plus importants des centaines de compositeurs (677 exactement, dont 2817 œuvres ont été jouées, d’après le site créé pour l’occasion, au répertoire de l’EIC : Maderna, Scelsi, Nono, Manzoni ou Scriarrino, Babbitt, Feldmann, Wuorinen ou Ferneyhough, Maxwell Davis, Knussen, Henze ou Abrahamsen, Holliger, Maxwell Davis, Levinas ou Kyburz, Takemitsu, Kagel ou Borowski, Hosokawa, Dillon ou Lindberg (ces trois derniers, notamment, seront mis à l’honneur par l’EIC la saison prochaine).
La question d’un excès d’homogénéité esthétique (même si entre la génération de Carter et celle de Robin, il ne saurait en être question) est posée, et, au vu des omissions, celle de son caractère voulu. La programmation peut paraître aussi exagérément franco-centrée, en particulier s’agissant des œuvres des vingt dernières années. On ne saurait reprocher à l’EIC d’évacuer un certain nombre de compositeurs qu’il a certes joués à un moment ou à un autre, mais dont l’évolution esthétique a rompu, non avec de quelconques dogmes, mais avec un certain esprit liant création, innovation et arrimage aux imaginaires techno-progressistes contemporains, esprit avec lequel l’EIC et les institutions bouléziennes en général sont à prendre ou à laisser. Il fallait sans doute accepter, dans ce contexte forcément familial, que priorité fût donnée à des compositeurs avec lesquels la collaboration a été régulière et les relations approfondies. Enfin, était affirmée la diversité des formations et la volonté de valoriser certains solistes : par exemple le tout jeune et impressionnant Martin Adamek à la clarinette, dans Gra de Carter, une des deux œuvres de la soirée (avec Gejagte Form de Rihm) dédiées à Lutoslawski.

La marque d’une majorité des partitions adoptées au cours des trente dernières années par l’EIC et remises sur scène pour cette occasion est sans doute la confluence, génératrice d’un courant plus ou moins vivace, de deux grandes rivières dont la séparation était aussi théorique que stylistique : la sérielle et la spectrale/électroacoustique. Stricto sensu, il y a longtemps que plus aucune des deux ne coule dans son lit originel. Des compositeurs nés dans les années 50 et 60 comme Dusapin, Rihm, Manoury, Benjamin et à présent Pintscher ont digéré tout cela en retirant, semble-t-il, une sorte de substance technique et conceptuelle commune, dont la destinée était inscrite dans l’œuvre de Webern comme dans celle de Varèse : une libre (mais sophistiquée) organisation de matériau pouvant (et souvent devant) être conjointement définie par les facteurs traditionnels (rythme, harmonie) et les paramètres survalorisés de la modernité (hauteur, timbre/texture, dynamique). Reste l’enjeu essentiel : une maîtrise grandissante dans le paramétrage multiple permet-elle de dépasser le problème de l’intelligibilité et de l’expressivité du langage, et l’impossibilité de « recommencer » d’une façon originale le geste d’un Ligeti ou d’un Boulez ? Voit-on se dessiner sur ces quatre décennies, qui furent au fond de réception avant d’être de création (comme la génération « romantique » dut d’abord faire face au legs beethovénien comme problème, ou cadeau empoisonné) des solutions nouvelles pour faire parler, discourir la musique, par-delà les notes d’intentions imbitables et les concepts générateurs, et l’académisme parfois palpable et presque assumé de certaines soirées de l’EIC ?
 La musique pour ensemble ou orchestre est sans doute celle qui peine le plus à se dépêtrer de ces difficultés, et qui, le plus souvent, a besoin pour produire une impression un tant soit peu durable, de se montrer le plus directement possible impressionnante, comme l’est le « Totem » conclusif des Fragments pour un portrait de Manoury. Pour autant, l’œuvre entière se réécoute-t-elle volontiers ? Ce n’est, comme pour la pièce choisie de Rihm, pas certain, au contraire des Three Inventions de Benjamin, dont la place au répertoire apparaît à présent privilégiée et garantie pour l’avenir (c’était au moins sa quatrième exécution parisienne par l'EIC en dix ans), pour d’excellentes raisons : ici, même sans la théâtrale et foudroyante conclusion de l’œuvre, ou les solos furieux des bois de la seconde invention, l’autorité et la familiarité de l’œuvre rayonnent dès le tissage introductif, dont la finesse poétique ressentie est inversement proportionnelle à la complication de la partition – une leçon pour tous nos contemporains, qui loin de trahir l’esprit de Boulez ou de Xenakis traduit au mieux ce qui est peut-être le plus précieux dans leur héritage : le goût des jeux de pures surfaces sonores, mais des jeux qui nous parlent. Le solo de bugle, au profil mélodique si caractéristique (ci-dessus) est impeccable et, comme dans Viola, viola, Written on Skin, Duo, etc., s’affirme le talent encore plus rare du compositeur britannique, qui est celui du dessin mélodique long, la science du réarrangement d’une idée simple en une multitude de combinaisons ramenées à une cohérence expressive claire. Le public confirme le statut déjà presque classique de la pièce en lui réservant un accueil chaleureux. Comme le soulignait le contrebassiste de l'ensemble dans l'un des petits films agrémentant la soirée, approfondir la fréquentations de certaines oeuvres est un luxe nécessaire : montrer la diversité, du moins la vivacité du paysage contemporain, est un noble projet, qui ne prend sens que si la profusion sert de terreau à l'érection de monuments, d'institutions de piliers d'un répertoire.
La musique pour ensemble ou orchestre est sans doute celle qui peine le plus à se dépêtrer de ces difficultés, et qui, le plus souvent, a besoin pour produire une impression un tant soit peu durable, de se montrer le plus directement possible impressionnante, comme l’est le « Totem » conclusif des Fragments pour un portrait de Manoury. Pour autant, l’œuvre entière se réécoute-t-elle volontiers ? Ce n’est, comme pour la pièce choisie de Rihm, pas certain, au contraire des Three Inventions de Benjamin, dont la place au répertoire apparaît à présent privilégiée et garantie pour l’avenir (c’était au moins sa quatrième exécution parisienne par l'EIC en dix ans), pour d’excellentes raisons : ici, même sans la théâtrale et foudroyante conclusion de l’œuvre, ou les solos furieux des bois de la seconde invention, l’autorité et la familiarité de l’œuvre rayonnent dès le tissage introductif, dont la finesse poétique ressentie est inversement proportionnelle à la complication de la partition – une leçon pour tous nos contemporains, qui loin de trahir l’esprit de Boulez ou de Xenakis traduit au mieux ce qui est peut-être le plus précieux dans leur héritage : le goût des jeux de pures surfaces sonores, mais des jeux qui nous parlent. Le solo de bugle, au profil mélodique si caractéristique (ci-dessus) est impeccable et, comme dans Viola, viola, Written on Skin, Duo, etc., s’affirme le talent encore plus rare du compositeur britannique, qui est celui du dessin mélodique long, la science du réarrangement d’une idée simple en une multitude de combinaisons ramenées à une cohérence expressive claire. Le public confirme le statut déjà presque classique de la pièce en lui réservant un accueil chaleureux. Comme le soulignait le contrebassiste de l'ensemble dans l'un des petits films agrémentant la soirée, approfondir la fréquentations de certaines oeuvres est un luxe nécessaire : montrer la diversité, du moins la vivacité du paysage contemporain, est un noble projet, qui ne prend sens que si la profusion sert de terreau à l'érection de monuments, d'institutions de piliers d'un répertoire.
Dirigé par le compositeur, le Tactus de Dalbavie, et ses procédés de tension/détente plastiques systématiques à base de notes répétées et de variations dynamiques ultra-rapides, pâtit de passer juste derrière et d’être suivi par une pièce soliste du maître du phrasé de long terme – Carter. A mes yeux, c’est un des versants stériles de la production de notre époque qui est ici montré, la part infertile, académique, des leçons bouléziennes. Une autre, dont on ne saurait discuter la prévalence et la pertinence objective, est le spectacle électro-saturé de Yann Robin, plus que jamais chef de file reconnu de l’esthétique du vacarme cinématographique, qui a le mérite de distraire et, éventuellement, d’amuser, la présence rendue plausible par la clarinette contrebasse amplifiée d’un tyrannosaurus rex porte de Pantin étant du plus bel effet hollywoodo-situationniste. Plus sérieusement, on ne saurait nier que, delà la personnalité de Robin, cette esthétique et plus généralement le couplage d’instruments novateurs avec un traitement technologique au goût du jour (mais à la vitesse où cette technologie change…) soit légitime, en ce qu’il y a toujours une partie de la musique novatrice qui reflète l’esprit novateur de son époque. Et notre esprit novateur, progressiste, à défaut d’idéaux intellectuels, spirituels ou politiques dont on ne serait blasés et revenus, est, incontestablement, technophile fanatisé.
Le problème sérieux n’est pas celui-ci, mais réside dans des interrogations latérales, qui valaient dès les premières créations de l’IRCAM : Une bonne musique ne doit-elle pouvoir s’apprécier même en n’aimant pas son époque et l’esprit de celle-ci ? Et une variante pratique : si cette musique est à prendre au sérieux et exprime quelque chose de notre rapport au monde, elle réussit au moins en un point : elle montre un homme – l’interprète, ici le clarinettiste – adjudant de la machine (et non l'inverse), artiste peut-être mais pris dans le machinisme, à l’image de nos vies réglées par les mails professionnels et les applis pratiques et de loisirs. C'est certainement une image fidèle de l'époque rendue en action sonore. Mais est-on bien sûr que la musique savante écrite peut persister dans l’histoire sans relation interprétative vraiment libre, c’est-à-dire indépendante de l’emprise technologique ? Quid de la relation à la part la plus éclairée (et nécessaire) du public, s’il n’est plus possible d’imaginer de pratique d’une partition nouvelle en amateur ? Kurtág plus que tout autre sans doute a fourni une réponse convaincante en créant un répertoire instrumental entièrement appropriable par les amateurs et les pédagogues, et pas que pour le piano, comme le montre le choix judicieux du játékok pour alto. Le bon trompettiste peut jouer pour le plaisir le solo de bugle de Benjamin. Même Dialogue de l’ombre double de Boulez peut être joué indépendamment de son dispositif, pour le plaisir domestique, par un bon clarinettiste. On peine à deviner l’intérêt qu’il y aurait à en faire autant avec Art of Metal II.
Les mauvais préjugés peuvent néanmoins être battus en brèche. L’extrait de quatuor de jeunesse d’Ivan Fedele fait une impression qui, à défaut d’originalité, est celle d’une musique écrite pour discourir, plutôt que méta-écrite pour hyper-discourir, par exemple, a contrario de rencontres précédentes avec ce compositeur qui m’avaient laissé plus que perplexe. Il est cependant un peu dommage que le quatuor n’ait pas eu davantage de place que cet unique moment de la soirée – Dusapin ou Rihm, notamment, auraient pu être mieux valorisés si l’on avait puisé dans leurs considérables contributions à ce répertoire. Grisey, dont l’ombre esthétique plane avec une prégnance insoupçonnée sur cette programmation, est servi par une exécution belle quoi que presque placide du quatrième des Espaces acoustiques. Boulez y était plus mordant. Mais peut-être n’était-ce pas nécessaire. Très subjectivement, on aurait préféré entendre le début de Vortex Temporum, un des rares marqueurs d’une époque dont le profil sonore inouï ne perd rien de sa singularité qui demeure reconnaissable en quelques secondes, à l’instar des Webern et Varèse les plus forts.

La première des Etudes pour piano d’Unsuk Chin, joué avec une maîtrise appréciable de l’intelligibilité du mouvement harmonique par Dimitri Vassiliakis, est une belle découverte : la compositrice coréenne revisite avec sérieux et réussite l’exercice de la construction virtuose sur un cheminement en do, dans une veine micropolyphonique ligetienne qu’elle s’est habilement appropriée. A son tour, Sébastien Vichard fait forte impression (ce sera encore le cas le lendemain dans Sur Incises) avec le percussionniste Gilles Durot dans l’hommage à Grisey de Philippe Hurel, autre moment marquant de la soirée, dont on regrette simplement qu’il se soit limité à la première des quatre pièces, les deux dernières étant particulièrement belles. Mantovani et Pintscher se passent un relai final en dirigeant l’un après l’autre leur musique, dont la dimension de synthèse au terme de cette remémoration rejaillit en valorisant à l’excès leur caractère obligé, du moins conventionnel. Pour le Bereshit de l'actuel patron de l'EIC, le recul et la réécoute manquent trop, et surtout, il ne semble pas que la partition se prête bien à la découpe. Il ne fait guère de doute que Streets aussi a acquis sa place durable au répertoire, mais quelle place ? Il faut du conventionnel pour faire tenir un style, mais il faut un style pour… Les esprits sont-ils là ? Derrière le bruissement cinématographique et le spectacle plastique, un idéal esthétique supérieur se devine-t-il ? L’esprit de la réception, est, au moins, sympathique et détendu. Un public souriant et débonnaire fait sans broncher la queue durant plus d’une demi-heure à la mi-temps du match pour se voir remettre un cornet de frites et une boisson offerte par la maison (l’Ensemble). Les joueurs viennent deviser avec leurs supporters. Il y a de l’entre-soi, pas de snobisme. L'esprit pionnier, flatté par les brèves de documentaire diffusées aux changements de plateaux (Villeurbane, Stockhausen contre le périph à la Cité U, le court-circuit à la carrière Boulbon…), s'est mué depuis longtemps en art bourgeois installé, mais l'esprit dévot ou précieux ne l'a pas emporté pour autant.
L'entrée en immortalité
Le retour aux origines du lendemain signe l’entrée définitive de Boulez en sainteté artistique. Non qu’il ait jamais été franchement diabolisé, singulièrement eu égard aux institutions au sens le plus publiciste du terme. Mais esthétiquement, intellectuellement, socialement, le combat pro domo et mundo a cessé une fois pour toutes, pas tant avec la mort qu’avec le parachèvement institutionnel et matériel qui a presque coïncidé avec elle. Peut-être, aussi, faute de combattants – ou étant entendue la faiblesse disproportionnée des opposants. Nous y voilà donc. La Philharmonie enfin entière, son navire amiral rebaptisé Grande Salle Pierre Boulez, la (re)découverte de sa musique dans des conditions optimales devant un public renouvelé (quarante ans de moyenne d’âge peut-être, en tout cas moins que la veille où se partageaient les souvenirs de famille), impressionné et enthousiaste comme on l’est face à un classique lors d’une première rencontre en salle.
Au préalable, l’invocation des mânes germaniques fondateurs avait presque convaincu. La première symphonie de chambre démarre timidement, en particulier aux cordes, et singulièrement au violon. La soirée précédente s’était terminée à minuit passé, il est vrai. Les bois, ensemble et intenses, compensent. Pintscher, économe mais pas indifférent, cultive en s’appuyant sur les conditions acoustiques un son d’ensemble délicat, semblant, comme il l’indique dans un entretien récent, rechercher un espace d’écoute plus libre (quitte à être moins précis) pour ses musiciens, et un trait plus joueur, plus élégant. La volonté de faire viennois se voit, encore trop pour paraître réalisée et que la souplesse agogique se ressente vraiment. Le Sehr langsam tient très bien par sa seule beauté plastique, grâce aux superbes clarinettes et une précision d’équilibre des accords rendant justice au miracle de ces pages. La progression cumulative finale et la coda sont fermement tenues mais manquent tout de même d’implication dynamique, notamment aux cors. Webern, de manière prévisible, reçoit un traitement irréprochable, exemplaire, y compris de la part de la soprano Yereeh Suh, plus à l’aise semble-t-il dans l’air et la végétation raréfiés, notamment des opus 15 (superbes) et des rares opus 18, que dans la forêt vierge et vivace de Pli selon pli. L’EIC brille de tous ses feux dans le Concerto, et surtout dans les Cinq pièces, qui lui va comme un gant, en particulier l’onirisme toujours inouï de ma troisième, prélude idéal à l’écoute « magique » qui allait suivre provoquée par la rencontre de cette musique, de ces musiciens, et de ce lieu.
Après Dérives 2 (par Barenboim), Rituel (par Eötvös), Pli selon pli, une partie des notations pour orchestre, Dialogue, Messagesquisse (le tout par l’EIC), et en attendant Répons, voici enfin venu le tour de Sur Incises de passer au révélateur nouveau de la grande salle, deux semaines après que Barenboim a – magnifiquement – conclu le concert d’inauguration de l’autre Salle Boulez, à Berlin. Il est possible que ce fût, de toutes, l’œuvre qui bénéficia le plus radicalement de l’invitation à s’exprimer dans l’intime vastitude de la Philharmonie. Le recul et les possibilités de comparaison avec les nombreuses salles où l’œuvre a été jouée depuis 1995 manquent, certes, mais je ne crois pas trop m’avancer en affirmant qu’au moins en France, cette partition avait bien besoin pour être reçue dans sa pleine mesure d’être jouée dans ces volumes et une résonance de cette qualité-là. Une précision dans le rendu global importe davantage qu’une précision analytique ici, le monde inventé par Boulez dans Sur Incises reposant davantage sur des jeux de continuités, de prolongements d’aspects variés de sonorités cousines. Sur le plan de la seule surface matérielle, il semble si évident que la pièce doit être écoutée, respirée dans ce genre de salle plutôt que dans des lieux plus exigus et sèchement analytiques, que l’on se demande si l’on ne pourrait, contre l’habitude et en l’absence d’indications définitives, tenter de retirer les couvercles aux trois pianos – ne serait-ce que pour voir.
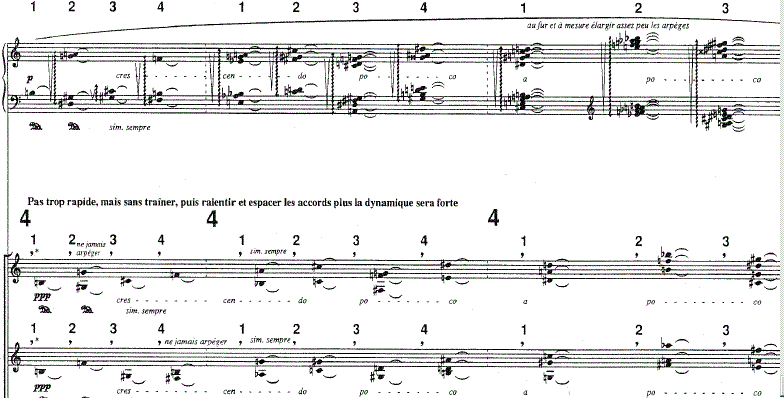 La fusion des timbres dans les cascades de traits brillants et mitraillages d’accords répétés aux neuf instruments ne sature jamais l’espace auditif, et s’opère donc vraiment, en un fondu, un lié iridescent qui permet à l’oreille de se concentrer sur l’essentiel : le discours. Un genre de variations pour notre temps, basé sur l’altération des points de vue (son idée génératrice étant, d'ailleurs, un changement de point de vue sur une musique préexistante), et la marge d’invention que dans son enfer micromécanique à haute précision la partition laisse, comme dans la dernière page, au libre traitement des interprètes. Rien de ceci n’est d’une originalité particulière eu égard aux voies ouvertes bien plus tôt pour Boulez, mais ce qui est frappant dans ces conditions d’exécution et d’écoute est que la musique s’entend soudainement comme économe de moyen, et comme terriblement efficace : le découpage cristallin des sections ressort si bien que, plutôt qu'un continuum de climats, on se dit que c'est une sorte de musique de scène ou un ballet qui a été projeté par le compositeur. L’impression parfois irritante, qui pouvait prévaloir dans certaines auditions, d’un sensualisme ayant lui-même pour finalité, disparaît au profit d’une sensualité au geste, aux courbes stylisées, permise par la suppression d’un inconfort d’écoute superflu. La possibilité, donnée par le cumul de la familiarisation et des conditions acoustiques, de suivre un mouvement discursif d’ensemble, donne un relief plus singulier aux moments de respiration le plus intimes, où la poésie se fait jour par la suspension du mouvement perpétuel. Paradoxalement, chez Boulez, l’attention aux notes (et non seulement aux hauteurs) est stimulée par l’arrêt du mouvement, celui-ci restant d’abord sculpture du son. Au repos, l’effet de contraste génère de saisissantes intensités expressives, de phrasé comme naturalisé, affleurant de l’immobilisation de la circulation de timbres, faisant apparaître le cadre d’une klangfarbenharmonie : comme dans le dialogue tout simple, niché au coeur de l’œuvre, entre le premier piano (où officie dignement comme depuis la création le taulier Vassiliakis) et les vibraphones. Ce passage, parmi d'autres, étant fascinant à entendre à la suite de l’ensemble berlinois de Barenboim, où le poste de piano central était tenu, d’une façon si différente, par l’excellent Denis Kozhukin. Le long silence qui suit l’œuvre est suggéré par Pintscher mais pas commandé, puisque l’œuvre doit, pour ainsi dire, se terminer deux fois, par l’arrêt de sa direction puis la déambulation libre finale qui s’éteint, en quelque sorte, au hasard des pianistes. C’est surtout qu’on ne sentait pas d’impatience particulière que cela se termine, et que l’émotion sincère des musiciens à l’exécution de Mémoriale la veille semblait, cette fois, présente en salle également.
La fusion des timbres dans les cascades de traits brillants et mitraillages d’accords répétés aux neuf instruments ne sature jamais l’espace auditif, et s’opère donc vraiment, en un fondu, un lié iridescent qui permet à l’oreille de se concentrer sur l’essentiel : le discours. Un genre de variations pour notre temps, basé sur l’altération des points de vue (son idée génératrice étant, d'ailleurs, un changement de point de vue sur une musique préexistante), et la marge d’invention que dans son enfer micromécanique à haute précision la partition laisse, comme dans la dernière page, au libre traitement des interprètes. Rien de ceci n’est d’une originalité particulière eu égard aux voies ouvertes bien plus tôt pour Boulez, mais ce qui est frappant dans ces conditions d’exécution et d’écoute est que la musique s’entend soudainement comme économe de moyen, et comme terriblement efficace : le découpage cristallin des sections ressort si bien que, plutôt qu'un continuum de climats, on se dit que c'est une sorte de musique de scène ou un ballet qui a été projeté par le compositeur. L’impression parfois irritante, qui pouvait prévaloir dans certaines auditions, d’un sensualisme ayant lui-même pour finalité, disparaît au profit d’une sensualité au geste, aux courbes stylisées, permise par la suppression d’un inconfort d’écoute superflu. La possibilité, donnée par le cumul de la familiarisation et des conditions acoustiques, de suivre un mouvement discursif d’ensemble, donne un relief plus singulier aux moments de respiration le plus intimes, où la poésie se fait jour par la suspension du mouvement perpétuel. Paradoxalement, chez Boulez, l’attention aux notes (et non seulement aux hauteurs) est stimulée par l’arrêt du mouvement, celui-ci restant d’abord sculpture du son. Au repos, l’effet de contraste génère de saisissantes intensités expressives, de phrasé comme naturalisé, affleurant de l’immobilisation de la circulation de timbres, faisant apparaître le cadre d’une klangfarbenharmonie : comme dans le dialogue tout simple, niché au coeur de l’œuvre, entre le premier piano (où officie dignement comme depuis la création le taulier Vassiliakis) et les vibraphones. Ce passage, parmi d'autres, étant fascinant à entendre à la suite de l’ensemble berlinois de Barenboim, où le poste de piano central était tenu, d’une façon si différente, par l’excellent Denis Kozhukin. Le long silence qui suit l’œuvre est suggéré par Pintscher mais pas commandé, puisque l’œuvre doit, pour ainsi dire, se terminer deux fois, par l’arrêt de sa direction puis la déambulation libre finale qui s’éteint, en quelque sorte, au hasard des pianistes. C’est surtout qu’on ne sentait pas d’impatience particulière que cela se termine, et que l’émotion sincère des musiciens à l’exécution de Mémoriale la veille semblait, cette fois, présente en salle également.
On voit se dessiner sur scène la grande ligne de force réflexive qui traverse l’œuvre – théorique, mais aussi pratique – de Charles Rosen, celle reliant par-delà les conditions sociales si différentes l’enjeu de l’exigence quant à la modernité, de Mozart à Boulez. Cette ligne est le canon – titre, entre autres, d’un des articles compilés dans son ultime ouvrage, Freedom and the Arts, et repris comme thème de variations dans les mélanges que lui offrirent ses collègues pour son 80e anniversaire. Le thème du canon, si j’ose dire, est l’immortalité – à l’échelle modeste d’une civilisation, s’entend. Comment devient-on immortel ? est l’interrogation éponyme d’une des conférences recueillies dans Aux Confins du sens. Cette question est inséparable d’une autre : La musique classique a‑t‑elle un avenir ? qui est quant à elle posée en titre d’un article paru dans la New York Review of Books en 2001 puis dans Le Débat l’année suivante. Simplifiée à l’extrême, sa pensée relie les deux sujets de la sorte : la compréhension du comment (un artiste est canonisé) répond celle du pourquoi (perpétuer une tradition musicale savante et écrite, et l’interpréter, ce qui suppose que la musique soit interprétable, appropriable à son état brut de texte à déchiffrer et faire parler). La réponse à la première question git dans les linéaments des rapports entretenus par les interprètes et compositeurs avec leurs contemporains et leurs immédiats prédécesseurs : un compositeur devient immortel parce que de son vivant et dans sa postérité immédiate il est canonisé comme tel par des pairs au rayonnement décisif. Autrement dit tout se joue toujours dans l’instant (et la surface plutôt que la profondeur) et non dans l’écriture et le supposé « jugement » de l’histoire, qui arrivent toujours trop tard. Ce qui entre dans l’histoire crée sa propre liturgie, dans la musique savante occidentale comme dans d’autres domaines ou sous d’autres latitudes culturelles. 2400 personnes écoutant dans un silence recueilli Sur Incises témoignent de cette cristallisation du mouvement historique, de ce basculement dans l’immortalité, doublé ici de l'affirmation que oui, cette musique ne s'exécute pas seulement, mais s'interprète, et que même il y aura une forme de progrès dans l'interprétation, si davantage de pianistes du calibre d'un Kozhukin s'en emparent demain.
Le critique, même contemporain, et même enthousiaste reste perpétuellement en retard sur ce processus, et participe quant à lui de la réception interprétative une fois le canon donné – il glose, comme il peut. Une liturgie, pour continuer de se propager et se perpétuer, a besoin de séduire, au-delà de la stricte communauté des croyants. Personnellement, je n’ai jamais été un croyant dans les avant-gardes (et encore moins dans les arrières, d’ailleurs), celle de Boulez ou une autre, par manque d’appétence pour le monde contemporain dans son ensemble. Mais il faut le reconnaître : une belle liturgie, comme les Sur Incises berlinois et parisiens conjugués, avec entre deux le concile symbolique de la contemporanéité apostolique (presque) unie (par le cornet de frites), produit ses effets, de droit et de cœur, bien au-delà des vrais fidèles, et c'est ce qui la rend civilisatrice. On se convertit, et si on ne se convertit pas, on admire la foi à l’œuvre, ce qui revient au même, à un changement de point de vue sur la vie, ou sur l'art. Tant qu’il y en a, l’aventure éphémère de la musique savante écrite, lue et interprétée peut se poursuivre un peu.


Faut-il goûter l'ironie de la fin de l'article ? Faire de l'adoration aveugle du Dieu-compositeur (auto-proclamé, dans ce cas) l'alpha et l'omega de la musique savante, c'est très certainement une description juste de l'état actuel de cette dernière, mais cela signifie aussi qu'elle n'a plus rien de savant, et n'est plus au mieux que politique, au pire que nihiliste. Pour la civilisation, on repassera.
Bonjour,
l'ironie que vous voyez dépend un peu du crédit (si j'osais : du caractère fiduciaire) que vous accordez à la part institutionnelle, non justitifiable et en un certain sens arbitraire, du canon esthétique dans l'histoire.
De fait, je suis désolé de vous décevoir, mais cette conclusion sur la liturgie n'est pas ironique. En revanche, je ne crois pas qu'il en procède forcément une adoration aveugle d'un Dieu-compositeur. Que l'on se réfère ou non à une esthétique du génie, d'ailleurs, ça ne fait pas différence ici. La considération d'un statut plus ou moins ordinaire ou extraordinaire du créateur n'est pas, il me semble, décisive pour décrire le fait esthétique institutionnel.
Ce qui me semble plus intéressant et problématique, en revanche, est la dialectique, au sein de celui-ci, entre art officiel et art rebelle, entre académisme et subversion, qui est au coeur du parcours de Boulez, mais qui est aussi, vous me l'accorderez, au coeur de ceux d'un grand nombre de créateurs canoniques dans l'histoire, et de leurs réceptions.
Enfin, vous mettez face à un problème bien douloureux : s'il ne peut y avoir d'institutionnalité (auto-proclamée ou proclamée par un tiers, quelle importance ?) artistique que nihiliste, que reste-t-il pour rendre compte des valeurs, sinon une approche scientiste dont on sait les ravages contemporains sur la civilisation musicale ?
Naturellement, il n'est pas possible d'approfondir ces questions difficiles dans le format de ces commentaires.
Merci de votre lecture.
Bien cordialement
S'agissant du crédit que j'accorde à la "part institutionnelle […] du canon esthétique dans l'histoire", vous l'aurez deviné : absolument aucun. Le canon esthétique de la musique savante est avant tout une belle histoire, malléable selon l'époque et les humeurs du moment, qu'un corps social constitué se raconte. Cela ne signifie pas pour autant que les compositeurs qui en font partie ne méritent pas leur place, mais il ne faut pas en faire autre chose que ce qu'il est : un mensonge utile.
Le problème de Boulez, et de quelques autres de sa génération, c'est que, contrairement aux "autres créateurs canoniques de l'histoire", ils ont fait de la dialectique que vous décrivez non plus une contingence subie, mais un geste esthético-politique nécessaire. Ils se la sont arrogés de force. Ils se sont vus institutionnalisés avant de devenir de grands compositeurs, détruisant de fait toute la légitimité de l'institution. En ce sens, l'oeuvre de Boulez, ce ne sont pas ses pièces musicales, mais ce moment que vous décrivez, qui est l'aboutissement téléologique de plus de 50 ans de constructions intellectuelles et manigances politiques dont le but était de remodeler l'institution de telle manière à ce qu'elle puisse le considérer comme un "grand compositeur", avec comme principalement armes le négationnisme le plus fragrant, la mauvaise foi et la censure par la brutalité intellectuelle : une bande de singes, de sbires et d'idiots utiles, qui se perd dans la contemplation dévote d'une pièce médiocre, comparable à des milliers d'autres qui n'auront jamais le centième de son audience.
L'institutionnalisation de Boulez est le dernier clou sur le cercueil du canon, et si ce dernier est consubstantiel à la musique savante, c'est également la mort de celle-ci qu'elle signe. Effectivement, le combat est terminé, mais les vainqueurs ne sont pas toujours ceux qui méritaient la victoire.
Si c'est dans cette abjection qu'il faut trouver des "valeurs", je vous les laisse bien volontiers. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que ces gens se prennent le plus souvent pour des intellectuels, des gens cultivés, des savants, au-dessus des masses ignares et superstitieuses… Je veux bien accorder cela à Boulez : il a de l'humour, même mort, et il s'est bien foutu de la gueule de tout le monde.
Quant au "problème bien douloureux", ce n'en est un que dans la perspective dogmatique univoque du canon. La mort de Dieu n'est une douleur que si l'on croit en lui.
C'est toujours ceux qui n'ont rien compris qui expliquent à ceux qui ont compris qu'il n'y a rien à comprendre.