
Le ton est donné, dans un espace à peu près nu et noir, pratiquement sans aucun objet, nous sommes à la fois dans la caricature (perruques outrageusement exagérées, maquillages clownesques à la Ubu) quelquefois dans la farce, et souvent dans la musique et le mouvement, ce Tartuffe sera drôlerie ou ne sera pas et reposera sur le seul jeu, ou ne sera pas.
Madame Pernelle, Elmire et Mariane sont assez caricaturales, mais Cléante (joué par une actrice) est dans cette adaptation à la fois Cléante, mais aussi le Damis de l’original (une sorte de jeune Chérubin plus agité que raisonneur ou raisonnable) et Valère l’amant de Mariane : Rolf Alme a voulu dans son Cléante un condensé des trois rôles qui effectivement au regard de l’essentiel jouent plutôt les utilités.
Dorine est jouée par un homme, assez désopilant, Espen Hana, et c’est en l’occurrence une femme à barbe, quelquefois au clavier électronique : elle/il fait chanter et danser les autres.
Seuls sont identifiables Orgon, très traditionnel (on le reconnaît immédiatement) et Tartuffe (Anders Dale) , lui aussi identifiable avec le physique et la voix du rôle.

La mise en scène est structurée en numéros plus qu’en scènes, et chaque numéro est accompagné du chœur des autres acteurs qui expriment leurs étonnement par des Ah ! et des Oh !, dans un mouvement assez proche quelquefois de l'expressionisme brechtien, à d’autres de la bande dessinée, pendant que sur l’écran vidéo apparaissent soit les acteurs en gros plan qui vont volontairement se fixer sous la caméra en interagissant avec ce qui se passe sur le théâtre, soit des images, croix, textes en arabe (l’intolérance et la dictature religieuse sont de toutes les religions). Il n’y a pas d’autres personnages, l’exempt par exemple n’apparaît pas et c’est Cléante (décidément le rôle à tout faire) qui apporte la solution et sauve la famille in extremis.
Entre musique, et quelques esquisses de pas de danse, c’est un Tartuffe rythmé et vif qui est ici présenté où l’essentiel du message est donné. Toute la partie du discours de l’exempt, si important pour l’analyse du sens de la pièce qui doit son existence à Louis XIV, mais aussi pour l’analyse de l’absolutisme, comme dispensateur de biens et évergète, peut intéresser un public français théoriquement familier de son histoire, moins un public norvégien qui devrait pour saisie entrer au plus profond du texte. En revanche, est très bien vue la question de la famille, de l’absolutisme du père (sorte d’antithèse de celle du Roi) : Orgon est le modèle du mauvais pouvoir, incapable de distinguer le bien du mal et l’être de l’apparence, incapable de lire la caverne platonicienne autrement que par les ombres. La famille est cette sorte de noyau soudé qui se désagrège en devenant ridicule sous les coups de boutoir de Tartuffe.
Sans rentrer dans les détails de la pièce, Rolf Alme rend visible le sens des grandes scènes : la fameuse scène de la table est vraiment très bien réglée sans table : Orgon y voit tout sans vraiment voir, mais ne réagit que lorsqu’il entend Tartuffe le railler. La fascination et le fanatisme refusent les évidences, notamment quand elles ne vous concernent pas directement.
Excellente dans cette perspective de faire des deux personnages un peu extérieurs, Cléante (qui condense donc Damis et Valère, mais aussi l’exempt) et Dorine des facilitateurs : l’un est une femme qui joue un homme, l’autre un homme qui joue une femme, dans un jeu de symétrie qui fait aussi sauter les genres, jeu visuellement désopilant aussi, avec un Cléante fluet et adolescent, une Dorine plus âgée, imposante et massive et tous deux au centre de la crise.
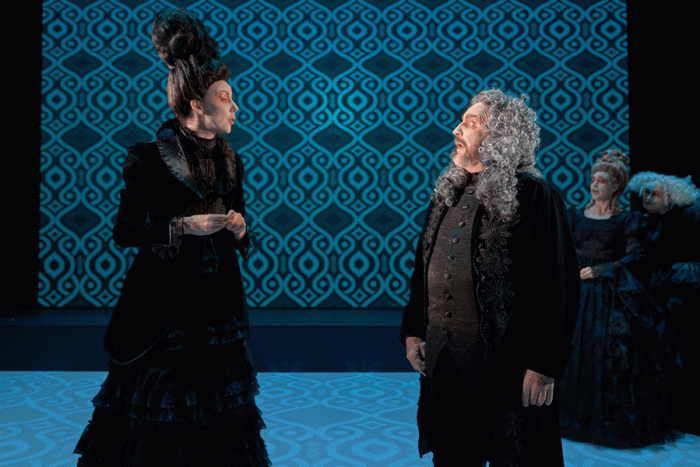
Dans ce paysage plutôt décalé mais cohérent, Tartuffe comme Orgon sont les personnages les plus proches de l’original moliéresque : Orgon est plus âgé, plus père au sens traditionnel du terme, pas vraiment ridicule et plutôt inquiétant parce que presque inexistant, et Tartuffe est le personnage à la voix insinuante, très expressive, légèrement maniérée, qui sue la fausseté et la duplicité, sans jamais exagérer. Il a une couleur à la Michel Aumont. Ainsi ces deux personnages « normaux » eu regard au rapport au texte de Molière, rejettent la famille dans l’agitation stérile et la caricature, voire la bande dessinée, du moins au regard des costumes : Mariane et Elmire sont physiquement presque interchangeables.

Dans les performances d’acteur, l’Elmire de Ragnhild Tysse est remarquable, parce qu’elle joue à la fois l’excès et la caricature (la scène avec Tartuffe est une scène de gag), mais en même temps l’autorité voire la tendresse. On a souvent des Elmire un peu distanciées, ici on a une Elmire engagée avec efficacité dans le jeu, vive, presque clownesque quelquefois et ça fonctionne. La (le) Dorine de Espen Hana est aussi d’une grande drôlerie, et d’une belle justesse. L’ensemble de la compagnie est engagé, vif, rythmé, et rend particulièrement efficace le travail.
On a tendance à surinterpréter Molière dans le sens du drame aujourd’hui, notamment les grandes comédies. Avec son adaptation, Rolf Alme montre un Tartuffe autre, pas joyeux en soi, mais plutôt un Tartuffe d’apocalypse joyeuse, très décalé par rapport à l’habitude, qui tire vers l'expressionnisme, qui fonctionne et qui vit. Bien sûr, le discours politique longuement expliqué dans le programme existe, mais c’est plutôt la fonction des vidéos, moins interactives qu’illustratrices, de montrer le texte sous-jacent d’une lecture contemporaine et sans doute aussi les textes rajoutés par Alme, mais c’est tout sauf démonstratif.
Cette troupe norvégienne a fait vivre Molière, à sa manière particulièrement jubilatoire, dans une dénonciation très joyeuse des faux culs de tous ordres. On a aimé.

