 Cette nouvelle production de The Beggar’s Opera présentée à Spolète dans la mise en scène de Robert Carsen est un projet qui a fait remonter à la mémoire des productions magnifiques qui, il y a quelques décennies, étaient la marque du Festival des Deux Mondes.
Cette nouvelle production de The Beggar’s Opera présentée à Spolète dans la mise en scène de Robert Carsen est un projet qui a fait remonter à la mémoire des productions magnifiques qui, il y a quelques décennies, étaient la marque du Festival des Deux Mondes.
The Beggar’s Opera (l’Opéra des Gueux) apparut en Angleterre en 1728, avec un texte de John Gay et de Johann Christoph Pepusch. Dans l’histoire de la musique, l’œuvre est considérée comme le premier ballad opera, c’est à dire le premier opéra-comique en langue anglaise, comme en France l’opéra-comique et en Allemagne le Singspiel, contrepoint à l’opéra-bouffe italien qui étendait sa domination sur toute l’Europe du XVIIIe. Toutes ces formes se ressemblaient, et se propageaient dans un circuit mineur et périphérique, pendant longtemps considéré comme inférieures au plus prestigieux opera seria. Elles proposaient des arguments comiques, de vie quotidienne, de mœurs, ou d’actualité, selon le bon vouloir de la censure ; la grande différence était que dans l’opéra-bouffe à l’italienne les dialogues étaient insérés dans les récitatifs, entre les airs alors que dans les autres formes nationales, les dialogues étaient parlés et faisaient liaison entre les parties chantées.
La production est née d’une grande coproduction qui, outre Spolète et les théâtres d’Édimbourg, Genève, Luxembourg, est relayée en France par un grand nombre de villes et de théâtres. Elle a été crée avec grand succès aux Bouffes du Nord au printemps dernier. Il est d’ailleurs singulier que la prochaine longue tournée ne touche pas l’Angleterre (Édimbourg est en Écosse), alors que tous les interprètes sont de langue anglaise, et que le spectacle offre, en anglais, une vision sarcastique de la politique britannique actuelle.
Le moteur de cette production comme on l’a dit, est le metteur en scène canadien Robert Carsen, qui a commencé justement il y a quarante ans sa carrière internationale à Spolète, comme assistant de Gian Carlo Menotti. Pour marquer l’occasion d’un peu de solennité, le directeur artistique du Festival, Giorgio Ferrara, a remis à Carsen le Prix Carispo, offert par la Cassa di Risparmio di Spoleto.

On le sait, Robert Carsen est aujourd’hui l’un des metteurs en scène d’opéra les plus demandés et acclamés. Et c’est sa patte géniale qui est à la base de ce spectacle exceptionnel. Dans le texte original, John Gay fustigeait l’immoralité, l’avidité, le cynisme et les injustices de son époque, vues du point de vue des mendiants et de tous ceux qui sont rejetés en général, dans une satire grinçante articulée autour de criminels, prostituées, fonctionnaires malhonnêtes de la Londres de 1728.
Les musiques, assemblées à l’époque par Johann Christoph Pepusch étaient faites de ballades et chansons populaires revisitées, et truffées de pages et d’extraits d’opéras de Purcell ou de Händel, alors très en vogue dans la capitale britannique. De fait, The Beggar’s Opera n’est pas à proprement parler un opéra, mais un pastis d’une soixantaine de morceaux intercalés, certains très connus à l’époque, d’autres pris à des compositeurs à succès. En tous cas, le spectacle connut immédiatement une énorme faveur auprès du public, non seulement parce qu’il est bien construit, mais aussi parce qu’il se moque sur un ton transgressif des abus et de l’arrogance que beaucoup subissaient ou connaissaient. Un succès qui sur presque trois siècles a alimenté un nombre infini d’adaptations, dont la plus connue est L’Opéra de quat’sous de Brecht et Weill.
Pour cette version moderne, Carsen, avec Ian Burton, a tout d’abord réécrit les dialogues en les recréant ex-nihilo. Un choix décisif, parce que le texte original était conçu pour les spectateurs et la société de l’époque, avec des sous-entendus et des allusions à la réalité d’alors, qu’il nous serait impossible de saisir aujourd’hui. Et d’éventuels soucis philologiques ne seraient que d’inutiles caprices. L’actuelle réécriture au contraire est fondamentale pour adapter les contenus à notre époque, dans le respect de l’esprit corrosif des blagues originales.
 Pour la partie musicale, Carsen s’est adressé aux musiciens des Arts Florissants (rien moins !), dont une dizaine sont présents sur scène, installés dans un coin du plateau et eux aussi en habits casual ou punk, voire jeans en lambeaux, comme les autres interprètes. Et le célèbre ensemble, grâce à sa profonde connaissance de la musique de cette époque, à ses capacités à l’exécuter et à improviser de manière inspirée, sait faire palpiter la musique à chaque représentation de manière créative.
Pour la partie musicale, Carsen s’est adressé aux musiciens des Arts Florissants (rien moins !), dont une dizaine sont présents sur scène, installés dans un coin du plateau et eux aussi en habits casual ou punk, voire jeans en lambeaux, comme les autres interprètes. Et le célèbre ensemble, grâce à sa profonde connaissance de la musique de cette époque, à ses capacités à l’exécuter et à improviser de manière inspirée, sait faire palpiter la musique à chaque représentation de manière créative.
 L’installation scénique est remarquable – de James Brandily, avec de beaux costumes de Petra Reinhardt et la très vive chorégraphie de Rebecca Howell – dans son essentialité fonctionnelle. Un énorme mur de boites en carton, dans lequel s’ouvrent tantôt des chambres, tantôt des portes ; en carton aussi le bar et l’échafaud du gibet. C’est dans ce décor minimaliste que se déroule toute l’action, qui dans la version Carsen voit Macheath (Benjamin Purkiss), le protagoniste, délinquant invétéré, à la fin l’emporter et devenir membre du gouvernement avec d’autres du même acabit. Et qui veut comprendre comprenne…
L’installation scénique est remarquable – de James Brandily, avec de beaux costumes de Petra Reinhardt et la très vive chorégraphie de Rebecca Howell – dans son essentialité fonctionnelle. Un énorme mur de boites en carton, dans lequel s’ouvrent tantôt des chambres, tantôt des portes ; en carton aussi le bar et l’échafaud du gibet. C’est dans ce décor minimaliste que se déroule toute l’action, qui dans la version Carsen voit Macheath (Benjamin Purkiss), le protagoniste, délinquant invétéré, à la fin l’emporter et devenir membre du gouvernement avec d’autres du même acabit. Et qui veut comprendre comprenne…
Si bien que l’expression récurrente, dans la bouche de différents personnages est-elle « Et moi qu’est-ce que j’y gagne ? ». De fait il y aussi le Ministre des « affaires malhonnêtes » ; et du ministre de la culture il est dit « de toute manière il ne compte pas ». Et plein de blagues sur les horribles chaussures jaunes du Premier Ministre Theresa May, sur le Brexit, sur les smartphones, les Rolex et la cocaïne.
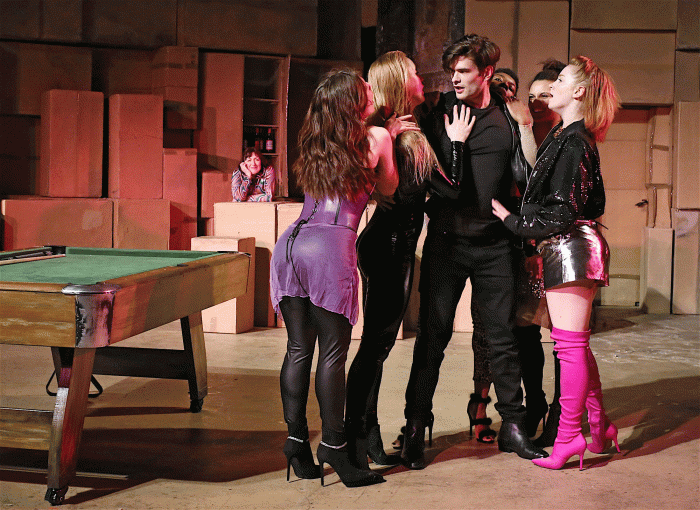
Ainsi Macheath le scélérat, de profession maquereau, peut séduire aussi bien Polly (Kate Better), fille du financier louche Peachum (Robert Burt), que Lucy (Olivia Brereton), fille du chef de la police Lockit (Kraig Thornber), corrompu et sniffeur. Et il promet le mariage à toutes les deux. À la fin les parents malhonnêtes réussissent à le faire arrêter et conduire à la pendaison. C’est là où intervient la trouvaille irrésistible des deux amoureuses qui, embrassant le condamné la corde au cou, se font un selfie avec lui tout sourire. Happy end, comme on l’a dit, avec inversion des rôles après plus d’une heure de spectacle totalement fou et à ne pas rater. Succès et longs applaudissements enthousiastes ; aussi pour le talent de cette extraordinaire troupe qui, avec ses sweats à capuches et ses jeans déchirés, selon les habitudes anglo-saxonnes sait aussi bien jouer, chanter que danser et quelquefois faire des acrobaties. C’est pourquoi tous méritent d’être cités : Beverley Klein (Mrs. Peachum), Emma Kate Nelson (Jenny Diver), Sean Lopeman (Filch/Manuel), Gavin Wilkinson (Matt), Taite-Elliot Drew (Jack/guardia carceraria), Wayne Fitzsimmons (Robin), Dominic Owen (Harry), Natasha Leaver (Molly), Emily Dunn (Betty), Louise Dalton (Suky) Jocelyn Prah (Dolly).

