Hambourg comme fil rouge assez ténu et molto agitato comme caractère, c’est le défi auquel a été soumis le metteur en scène berlinois, un défi assez aisé à relever, tant il est le maître d’un hétéroclite qui fait sens, et des histoires à tiroirs. Quelle parenté entre les Nouvelles aventures de Ligeti et la cantate profane Aci, Galatea e Polifemo de Händel ? Ou entre les Vier Gesänge de Brahms et Die Sieben Todsünden de Kurt Weill ? Ce qui est commun c’est évidemment le spectacle qu’en fait Frank Castorf, que d’aucuns en France ont considéré comme une pochade de circonstance indigne d’un déplacement à Hambourg.
Le choix de Georges Delnon est la prudence, et ce spectacle donné sans entracte, qui joue à fond la carte sanitaire avec distanciation des musiciens et des chanteurs et large espace scénique a la fascination de l’inattendu. Aleksandar Denić n’a pas construit ses habituels décors « Frankenstein » (ces monstres géniaux sur tournette faits de bric et de broc), mais quelques éléments, quelques objets, dans l’immense espace de la scène de la Staatsoper vide (une scène castorfienne vide… On rêve…) profonde de soixante mètres puisque l’arrière scène a été exceptionnellement ouverte et donnant sur les premiers espaces des coulisses utilisés dans la vidéo.
Les relations hommes-femmes, la violence, l’expérience de la limite sont lues au double prisme de Kurt Weill, Die Sieben Todsünden (les Sept Péchés Capitaux) et de Quentin Tarentino (Reservoir Dogs), pour le reste, Frank Castorf alterne scènes en direct et visions en vidéo-directe gérées par son vidéaste-magicien Andreas Deinert. Et le titre du spectacle lui-même, Molto agitato, tout en étant rappel de Ligeti, se réfère aussi au monde de Castorf, structurellement molto agitato.
Autre défi : le temps. Il est ramassé et réduit à deux heures, ce qui est chez Castorf tout aussi rare. Il est vrai qu’il réussit à allonger de vingt grosses minutes le temps musical (d’une heure quarante).
Nous avons souligné la relation à Hambourg des quatre compositeurs convoqués, nous pourrions aussi évoquer l’histoire de Kent Nagano, qui a dirigé l’œuvre de Kurt Weill à l’Opéra de Lyon dans une chorégraphie de Maguy Marin en 1987 et l’a enregistrée avec les forces de Lyon et Teresa Stratas chez Erato.
Nous sommes dans ce spectacle à la frontière de tous les genres, frontière de la voix avec Ligeti, mais aussi Brahms, tel qu’interprété par Matthias Klink, frontière du chanteur-acteur avec Georg Nigl phénoménal dans son remake de Tarantino, mais aussi avec l’extraordinaire Valery Tscheplanowa dans les sept péchés capitaux qui chante, parle, danse et ensorcèle le public, frontière des genres entre cinéma, cinéma d’animation, opéra, théâtre, ballet, mais aussi récital. Une soirée border line où l’on passe indifféremment de l’un à l’autre, musicalement et visuellement : voilà ce que Castorf dans sa première mise en scène à la Staatsoper de Hambourg a concocté avec Kent Nagano.
La musique en effet n’est pas en reste : les effectifs sont en mode molto agitato également : l’orchestre passe de 8 musiciens pour Ligeti à 15 pour Händel et 17 pour Weill et disparaît au profit du piano pour Brahms, sans parler du patchwork de styles, on passe du XVIIIe au contemporain (enfin, à peu près puisque les pièces de Ligeti sont de 1965) et à chaque fois c’est l’expérience d’une limite qui est offerte. Bien évidemment, c’est habituel chez Castorf, certains spectateurs n’en peuvent plus très vite et quittent la salle (leur rentrée à l’opéra après 6 mois est foutue…) mais la grande majorité a accueilli avec sympathie le spectacle et l’effort, souligné par Georges Delnon dans un discours initial plein d’humour où il souligne que l’opéra rouvre après 176 jours, 20 heures et environ 7 minutes exactement.
Tout commence par Händel, et par L’arrivée de la reine de Saba, troisième partie de son oratorio Solomon où Nagano donne une couleur incisive et glaciale, sans aucune concession stylistique au baroque – ou du moins à ce qu’on considère comme style baroque chez les amateurs. Volontairement sans doute : dans un tel spectacle, aucune volute n’est permise où il doit y avoir perméabilité entre le style musical et le style scénique. Nagano est d’ailleurs parfaitement disponible pour le voyage en Castorfie. C’est un Händel inhabituel pour un spectacle hors des normes, comme la période que nous vivons.
Commencer par La reine de Saba, avec ses richesses débordantes « avec des chameaux portant des épices, et beaucoup d’or et de pierres précieuses » dit d’elle la Bible lors de son voyage à Jerusalem qui va se ranger à la sagesse de Salomon, et finir par l’a‑morale et la puissance américaine qui détruit les individus, c’est montrer un parcours jalonné des thématiques chères à Castorf sur le monde détruit par le capitalisme aveugle, symbolisé par le drapeau américain énorme fait de lumières clinquantes des revues de Music-Hall, et plus discrètement, comme une sorte de litote visuelle par l’habituel frigo Coca Cola, très loin au fond de la scène et encore plus discrètement par une minuscule bouteille de Coca pratiquement invisible posée sur l'immensité de la scène au premier plan. De Saba à Coca.
Justement, cette musique de Händel ouvrait ironiquement le spectacle de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Londres en 2012, avec un James Bond (Daniel Craig) qui allait chercher la reine à Buckingham Palace pour l’amener à la cérémonie, et qui lui répondait un drôlatique « Good Evening, Mr Bond ! », avant que le retentisse la musique de Händel. Elisabeth II aux Olympiades ou L’arrivée de la reine de Saba.
Castorf essaie de montrer par son ironie habituelle, à travers ce spectacle et ses divers morceaux que le patchwork apparent cache les relations empreintes de violence entre les êtres, engendrées par la volonté de puissance ou l’appât du gain, dans un monde marqué par la morale capitaliste et surtout l’influence des Etats Unis, vu comme univers sans foi ni loi sinon celle du plus fort, une sorte d’état sauvage d’aujourd’hui.
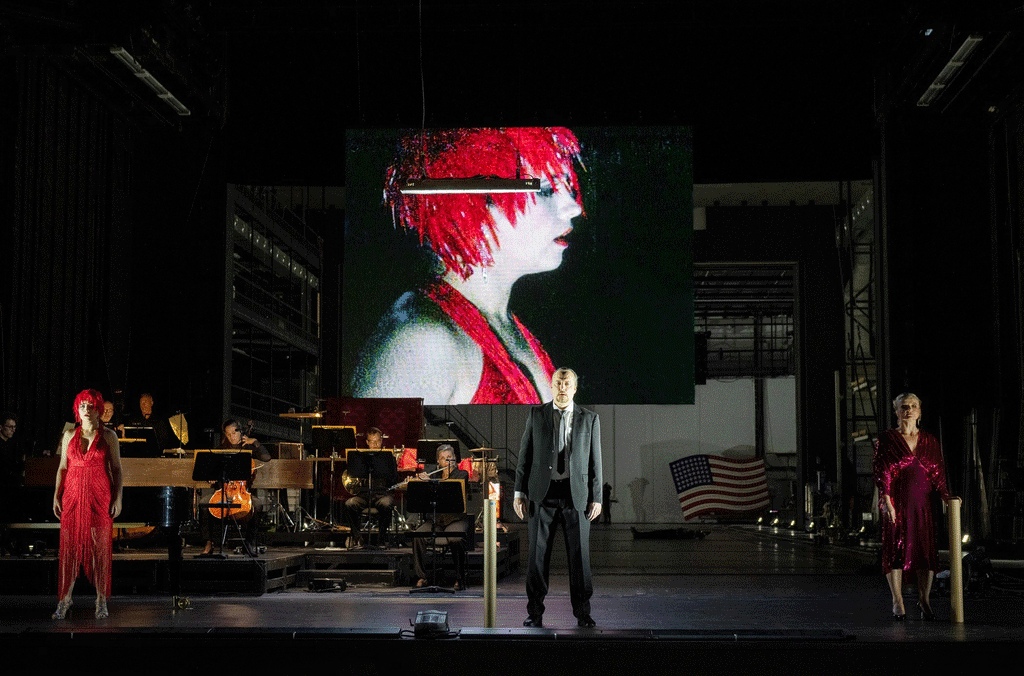
Une lecture idéologique qui arrive à détruire la parole (Ligeti, Nouvelles aventures), dans une exhibition qui semble issue d’un Music-Hall par la présence d’un orchestre de huit musiciens sur scène amené par un praticable, par le clinquant des costumes et par un chant qui semble construit pour se désagréger ou du moins où la parole laisse place aux affects, et seulement aux affects : pas d’action, pas de texte, mais tout de même du théâtre répondant à ce que Ligeti voulait : "d'éliminer la couche purement sémantique du langage humain et de ne travailler qu'avec les couches musicales et affectives du langage". On est sur les traces d’un Verlaine, mais aussi sur une narration sans paroles qui au-delà de l’ironie conduit à l’effroi et à la solitude structurelle des destins humains. Et les acteurs-chanteurs, Katharina Konradi, Jana Kurucovà et Georg Nigl sont tout à fait saisissants dans cette performance à la fois étourdissante et tragique. La présence de la vidéo, permanente donne paradoxalement une étrange intimité à ces scènes, que l’isolement des spectateurs tous séparés dans ce vaste espace mais aussi des chanteurs et de musiciens en scène renforce par l’impression oxymorique d’un isolement de chacun et en même temps d’une proximité : nous sommes tous seuls et loin, mais par cela même si proches les uns des autres.
La solitude dans un monde offert aux violences relationnelles et à l’absence d’humanité, voilà ce que va construire le discours de Castorf, à travers ses images qui commencent toujours d’une manière rassurante ou ironique et qui évoluent vers la noirceur, le sang, l’inhumanité. Et le tout sur un rythme de plus en plus soutenu, sans transition d’un morceau à l’autre mais sans jamais avoir l’impression de rupture. La présence de ce plateau nu devient alors cette image du désert humain qui est une lecture crue, mais pas si éloignée de la vérité du monde d’aujourd’hui.

L’enchainement avec les Vier Gesänge op.43 de Brahms où l’orchestre de Ligeti est remplacé par le piano ( Rupert Burleigh) et par le soliste (justement, on passe à la solitude du soliste et de l’instrument) Matthias Klink est aussi un travail emblématique sur la théâtralisation de la musique et du récital, si ritualisé ordinairement qui devient une chute dans la désespérance et la solitude notamment « Ich schell mein Horn in's Jammerthal » (je sonne du cor dans le val de la plainte) avec une mise en place particulièrement expressionniste dans le geste et le mouvement, en complète rupture avec le genre du récital. Une théâtralisation qui se mesure aussi à la mise en place : des quatre chants de Brahms on en entend trois chantés par Matthias Klink, le quatrième « Das Lied von Herrn von Falkenstein », l’histoire d’une jeune fille qui veut libérer son ami prisonnier et demande au maître (von Falkenstein ) sa libération d’une tour où il pourrit est rejeté à plus tard et sera chanté de manière hypertendue et angoissante par Georg Nigl accompagnant les extraits de textes et du film Réservoir Dogs de Quentin Tarantino, scènes de torture sanglantes dans un entrepôt puis un remake stupéfiant avec Georg Nigl (à la place de Harvey Keitel) qui torture une femme : tandis que sur scène sur un calicot l’actrice Valery Tscheplanowa écrit « Sex and Lies » en lettres rouges. Juste avant les Sept péchés capitaux de Kurt Weill, Castorf avait déjà installé une ambiance à la limite du supportable.

Mais entre ces scènes de grande violence visuelle et théâtrale s’est interposée la cantate profane de Händel Aci, Galatea e Polifemo (1708) composée par Händel à Naples. Dans la fosse, Kent Nagano continue de donner à son Händel une couleur acide, qui semble en contradiction avec la projection sur écran d’un dessin animé souriant qui raconte l’histoire : un monde idyllique de nymphes et naïades, une vision d’Eden non dépourvue d’humour, on se prend à sourire, quelques gloussements en salle. Mais l’histoire – parfaitement racontée sur l’écran, bascule en un bain de sang lorsqu’Acis est tué par Polyphème, avec un fleuve de sang qui coule sous le rocher qui a écrasé Acis. De ce fleuve de sang naît le ruisseau que Galatée suscite.
Une fois encore sang et amour, sang et sexe se croisent se tressent et se vivent et du même coup la musique acide, incisive, métallique de Nagano en fosse se justifie par le propos : il y a là une cohérence avec l’histoire racontée : ces extraits sont tous tirés vers l’amertume, la déconstruction, la violence des ruptures et oppositions. Castorf et Nagano jouent sur ce clavier-là, et Castorf joue aussi sur l’espace théâtral dont on voit l'invisible (avec d'ailleurs tout au fond un étrange squelette, corps d'homme tête de cheval, reste de monstruosité mythologique), et les coulisses où les chanteurs se réfugient, comme si le théâtre était monde, ou totalité, où tout est représentation au sens de Schopenhauer.

Les quatre chanteurs sont de très haut niveau, les deux voix féminines appartiennent à la troupe de Hamburg, Jana Jurucovà, belle voix profonde et Katharina Konradi magnifique (dans Händel, mais aussi dans Ligeti), Matthias Klink est la voix brahmsienne, entre autres, et chante ces trois Lieder avec engagement et un soin tout particulier à la couleur, vu la mise en scène qu’il doit porter (il est affublé d’un drôle de chapeau qui rappelle de loin le Narrenhut, le chapeau de fou qu’on porte au carnaval). Encore plus engagé scéniquement et vocalement, Georg Nigl est exceptionnel, dans Ligeti bien sûr, mais aussi dans le dernier Lied de Brahms évoqué plus haut Das Lied von Herrn von Falkenstein et surtout dans son profil de personnage tarantinien tellement incarné qu’on s’y croirait : cette voix habituée aux brusques changements de couleurs, de volumes, de registres et d’univers, ce personnage incroyable acteur constitue pour l’ensemble du spectacle un des deux grands piliers.
Mais c’est clairement la dernière partie qui donne à cette construction tout son sens et sa valence, Die sieben Todsünden de Kurt Weill, est un ballet chanté sur un texte de Brecht qui évoque les tribulations d’une jeune femme, Anna et de sa sœur, sorte d'image de la bonne conscience chantée par une seule et même chanteuse, à travers 7 villes des Etats-Unis pour essayer de faire fortune sur l’injonction de leur famille et qui se heurte aux sept péchés capitaux. Destin de femme dans un pays capitaliste en proie à la violence et à l’écrasement de tout sentiment, comme Mahagonny était l’histoire d’un destin d’homme. Les deux Anna, celle qui traverse le pays et sa sœur, une bonne conscience assez tolérante qui sait fermer les yeux quand il faut, sont victimes du système, de la religion, du monde ambiant et d’une famille moralement pas très recommandable (normalement un quatuor masculin pour mieux asseoir l’opposition des sexes, mais ici un quatuor mixte, pour mieux montrer que tout est à mettre dans le même sac). L’actrice Valery Tscheplanowa en Anna est fabuleuse aussi bien par le chant, le geste, le mouvement, la diction, l’expression : elle est la lumière de la représentation, son autre pilier avec Nigl et remporte un triomphe mérité. Quant à Nagano, il accompagne au millimètre cette performance, dans un répertoire familier, tantôt avec ironie, tantôt glacial et effilé, tantôt lyrique : une immense interprétation qui colle avec une justesse toute particulière à la mise en scène.

Évidemment placé au terme du voyage, le ballet, discrètement réglé comme une mini-revue ; les costumes d’Adriana Braga Peretzki, toujours clinquants et toujours réussis, nous induisent toujours à penser à cet univers, mâtiné de revue Ziegfeld et de Carnaval de Rio (Adriana Braga Peretzki est brésilienne), avec le jeu entre coulisses où se trouve la famille, cachée mais présente, et Anna en représentation permanente comme offerte au monde, aux spectateurs, aux autres dans cet espace immense scandé par Coca Cola, symbole permanent de ce capitalisme états-unien qui a perverti le monde (entre frigo-Coca à l’arrière-plan, presque invisible et bouteille de Coca au premier plan, presque invisible aussi, comme si Anna était une marionnette maniée par des forces cachées, famille, religion et capitalisme.

Signalons pour finir que la même année, en 1933, Otto Dix montrait les Sept péchés capitaux dans un style vaguement médiéval (au Musée de Karlsruhe) : l’époque – et l’année, montrait à la fois la fin d’un monde, sa perversion et évidemment sa perdition : on sait ce qu’il en est advenu : la montée des totalitarismes provient toujours d’un monde polarisé notamment par la violence.
Le drapeau américain géant et éclairé n’est qu’une représentation clinquante et factice, lumières d’un Music-Hall funeste, tandis que la vraie bannière étoilée est brûlée.
Bien sûr on pourra rétorquer que le discours de Castorf se répète, mais c’est un des principes de son théâtre que de toujours partir de la même donnée, pour montrer à travers les œuvres – et ici Kurt Weill et Brecht (mais aussi, on l’a vu Otto Dix) tiennent exactement le même discours – un univers où la petit bourgeoisie américaine affirme des valeurs pré-fascistes… Et la situation politique actuelle ne les contredira pas . Le théâtre contre les valeurs des petits-blancs, le théâtre comme antidote, ce qui est aussi prémonitoire en temps de pandémie : que les théâtres aient été fermés puis ignorés durant des mois est aussi un signe non négligeable des sociétés qui régissent le monde. Il ne faudra jamais oublier que Ecole, Universités et Culture ont été les victimes de la pandémie – et du regard porté sur elle.
L’originalité tient dans ce que Castorf et son équipe (avec un Denić minimaliste!) où une fois de plus ont brillé ses vidéastes (Andreas Deinert comme toujours exceptionnel, mais aussi Cathrin Krottenthaler et Severin Renke) et son éclairagiste magicien Lothar Baumgarte qui donne à l'espace scénique l'irréalité d'un espace mental ont réussi à donner cohérence à ce discours à travers quatre œuvres radicalement différentes, parce que Nagano a réussi aussi par son implication musicale à donner cette couleur, y compris à la musique de Händel. Le théâtre, comme réponse à la violence de la morale petite bourgeoise, et à la complaisance dans la violence comme réponse unique à tout, y compris à l’amour : si Dieu est amour, il engendre aussi le fanatisme et son cortège de violences, depuis des siècles, ainsi l’appel à Tarantino est ici emblématique.
Aussi bien cette ouverture de saison trouve là son plein sens : il y a les pandémies sanitaires et les autres pandémies subreptices qui dévorent notre civilisation et notre culture, et pour Castorf, qui dénonce la mise au pas de la population au nom de sa santé, ce sont les mêmes : mortifères.
Trailer du spectacle (sur le site de la Hamburgische Staatsoper):
