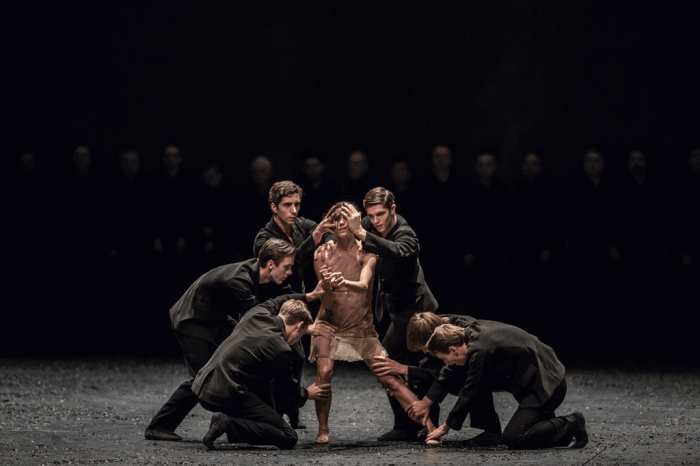Une gageure : proposer une „Gesamtkunswerk“ autour du Requiem de Verdi, faite de ballet et de mise en scène avec un chœur et des solistes en mouvement. C’est l’un des sommets de la saison zurichoise, qui excite tellement la curiosité qu’ARTE l’a proposé le 18 décembre dernier.
Coproduction entre l’Opernhaus Zürich et le Ballett Zürich, le spectacle est pour les uns un ballet, et pour les autres un oratorio en mouvement. De toute manière, la distribution vocale à elle seule justifierait le déplacement, y compris sous forme d’oratorio traditionnel, composée de Krassimira Stoyanova, Francesco Meli, Veronica Simeoni et Georg Zeppenfeld, et c’est elle qui assure les 10 représentations.
La mise en danse d’oratorios n’est pas nouvelle, ni même la mise en théâtre : récemment par exemple Peter Sellars s’est attaqué aux Passions de Bach avec Sir Simon Rattle. Mais, et c’est paradoxal, la Messa da Requiem, retenue la plus « opératique » des messes, n’a pas fait l’objet d’une mise en scène, dans mon souvenir du moins.
C’est désormais chose faite à Zurich, avec un spectacle qui réunit l’ensemble de la troupe, orchestre, chœur et ballet, et quatre des plus grands chanteurs du moment : les saluts sont d’ailleurs habilement organisés pour ne pas valoriser les uns plutôt que les autres, et les solistes-chanteurs viennent individuellement saluer au milieu des solistes-danseurs : c’est une proposition hardie que Christian Spuck, le chorégraphe-directeur du ballet de Zurich, a mis en scène ici.
Le décor de Christian Schmidt est assez simple, une boite grise, immense, à l’intérieur de laquelle se meuvent le chœur, le ballet, les solistes, l’espace central est laissé le plus souvent libre pour les évolutions du ballet. Cette boite est un piège qui va se refermer à la dernière image assez forte, celle du libera me où le toit écrase tous ce beau monde dans la mort inévitable.
Les questions à se poser sont assez simples : une telle entreprise est-elle nécessaire ? Est-ce un oratorio mis en scène ? Est-ce un ballet sur une musique d’oratorio ? Après avoir vu le spectacle, les questions restent pour moi sans réponse. Une telle entreprise, mobilisant tant d’artistes, doit viser à augmenter l’émotion que l’œuvre nue développe par elle-même, et donc il faut observer le potentiel d’émotion véhiculé par le spectacle.
Je ne suis pas un spécialiste du ballet loin de là, mais il me semble qu’on n’a pas toujours un spectacle syncrétique où se mêlent ballet et chant, chœur et danseurs, mais plutôt deux spectacles parallèles où les choses se mêlent avec difficulté, au-delà de la qualité des uns et des autres. Jouer le jeu de l’œuvre globale réclame un effort singulier pour l’habitué des voix, et surtout de ces voix-là.
Les solistes sont aussi sollicités et esquissent (pas autant que dans Les Indes Galantes de Sidi Larbi Cherkaoui à Munich, ni dans le Tannhäuser de Sasha Waltz à Berlin), il y a des moments justes, notamment le Salva me, sans doute le moment visuel le plus fort pour moi.
Fabio Luisi et Christian Spuck se défendent d’avoir voulu pour l’un faire un opéra, pour l’autre raconter une histoire : Fabio Luisi ne met pas sur le même plan la théâtralité et le sens dramatique de Verdi dans son Requiem, et la réalisation d’un opéra : Verdi utilise le texte traditionnel de la Messe de Requiem (très souvent encore aujourd’hui exécutée à San Marco de Milan où elle a été créée), et la force dramatique vient de ce que Verdi en fait une interrogation angoissée et lyrique sur le passage dans l’au-delà : il en fait une œuvre d’angoisse collective, impliquant et les forces musicales qui l’exécutent, et les spectateurs qui l’écoutent : rarement œuvre ne fut plus cathartique que cette Messa da Requiem.
Il s’agit donc d’une représentation concrète d’une successions de passages abstraits, une traduction de l’abstrait, et en mouvement, et en danse : laissant à plus qualifié le soin de commenter les parties dansées, je voudrais néanmoins souligner que certains moments m’ont particulièrement frappé : le Lacrimosa, sublime musique dont on ne sait si elle est plus forte dans la Messa da Requiem ou dans le Don Carlos auquel elle a été prise avec Alexander Jones, Katia Khamzina, William Moore et Katia Wünsche. Toutes les interventions de William Moore sont d’ailleurs frappantes par leur force dramatique intérieure (Requiem, Dies Irae, Lux aeterna).
Mais je confesse que quelquefois les interventions du ballet me restent extérieures, tant la musique prévaut. En revanche, je trouve particulièrement réussi dans ce travail, la chorégraphie du chœur et ses mouvements : c’est flagrant dans le Dies Irae où chœur, solistes et danseurs se mêlent dans un impressionnant ensemble d’une force incroyable, avec un sentiment d’écrasement et de proximité qui frappe dans cette salle ; même impression dans le Salva me avec un arrêt sur image fascinant.
Plus généralement, les mouvements combinés des solistes et du chœur sont très réussis et contribuent à renforcer l’émotion diffusée par le spectacle.
Car ce qui étonne, notamment pour un profane en chorégraphie, c’est qu’après le premier moment de distance, on finit par s’accoutumer et le spectacle finit par fasciner. La musique est tellement familière, qu’on entre sans peine dans l’ensemble : et la force d’émotion est intacte.
Fabio Luisi dirige avec une vraie force et en même temps sans jamais faire des effets : c’est une grande qualité de ce chef de ne jamais chercher à mettre en avant les parties orchestrales, mais à essayer de faire ce que les italiens appellent une concertazione : c’est à dire une combinatoire de tous les éléments, en soignant particulièrement les volumes. Luisi est un de ces chefs qui est pour un orchestre une bénédiction : c’est un chef de qualité, mais qui ne cherche pas à « imposer » : ce qu’il fait est juste, comme on l’attend. Certains lui reprochent un manque de personnalité dans l’approche des œuvres, je ne suis pas vraiment d’accord. Lorsqu’il remplaça Levine au MET dans le Ring, il fit vraiment entendre une autre musique : le public tellement habitué aux Wagner de Levine a été surpris par cette approche plus légère, plus lyrique aussi.
C’est aussi le chef juste pour une pareille entreprise : sa longue expérience des scènes, des plateaux de toutes sortes, le rendent parfaitement adaptable et sûr dans n’importe quelle circonstance pour les solistes et les masses qu’il accompagne..
 Il y a une belle différence sonore entre un Requiem avec orchestre sur scène et un Requiem avec orchestre en fosse. Sur scène, l’orchestre est incontestablement, et notamment dans cette œuvre, un protagoniste avec un chef démiurge : l’œuvre le demande.
Il y a une belle différence sonore entre un Requiem avec orchestre sur scène et un Requiem avec orchestre en fosse. Sur scène, l’orchestre est incontestablement, et notamment dans cette œuvre, un protagoniste avec un chef démiurge : l’œuvre le demande.
En fosse, tout est relativisé, les équilibres entre solistes et chœur, l’éloignement, les mouvements, font que l’œuvre ne sonne plus tout à fait comme on a l’habitude. Et c’est passionnant à écouter : le chœur (magnifiquement préparé par Marcovalerio Marletta) est en vedette, mais les solistes ne sonnent plus au milieu de l’orchestre, mais au milieu de la scène dans un dispositif où ils sont mobiles, où leurs mouvements font image et aussi font sens, où ils se mêlent au chœur ou aux danseurs. Luisi a su parfaitement saisir cette notable différence, et mettre en valeur et son orchestre, vraiment magnifique, mais surtout les voix, pour les rendre protagonistes : Francesco Meli ou Krassimira Stoyanova chantant au milieu de l’espace seul, ou en marchant, avec une gestuelle minimale, mais une présence décuplée, c’est beaucoup plus impressionnant encore qu’en soliste au milieu des musiciens et du chœur. C’est sans doute par des images de ce type que le spectateur est conquis. L’acoustique de la salle favorise cette expansion naturelle du son. Le rapport scène salle est toujours favorable à la voix à Zürich, et sans doute plus en disposition « opéra » qu’en disposition « oratorio », ce qui donne à l’ensemble un son inhabituel, y compris par les mouvements du chœur qui en accentuent d’une certaine façon la puissance, comme si cela donnait un élan supplémentaire.
Les quatre solistes se meuvent, s’assoient, participent à quelques mouvements de groupe, et cette différence fait entendre les voix différemment, et donne une couleur différente à l’œuvre : rien que par ces différences, l’expérience de ce Requiem est intéressante. Non pas un opéra, mais du théâtre, une sorte de théâtre de l’abstraction, qui ne laisse jamais la tension retomber.
Veronica Simeoni chante la partie de mezzo, la voix, sans être d’un volume exceptionnel, est marquée, posée, et la couleur est belle. Dans l’ensemble des solistes, c’est peut-être elle qui est le plus en retrait, mais la prestation est notable, honorable, et le texte bien dit – diction claire et belle expressivité (notamment dans son intervention au moment du lacrimosa).
 Francesco Meli est toujours passionnant à entendre ; comme Stoyanova, il a une culture belcantiste qui donne à son chant un raffinement et une assise exceptionnels. Chaque mot est sculpté, d’une incroyable clarté, et la ligne de chant est toujours impeccable. Son ingemisco est anthologique à ce titre. C’est la perfection du chant italien comme on aimerait en entendre plus souvent aujourd’hui. Il me fait de plus en plus – y compris physiquement, penser à José Carreras…
Francesco Meli est toujours passionnant à entendre ; comme Stoyanova, il a une culture belcantiste qui donne à son chant un raffinement et une assise exceptionnels. Chaque mot est sculpté, d’une incroyable clarté, et la ligne de chant est toujours impeccable. Son ingemisco est anthologique à ce titre. C’est la perfection du chant italien comme on aimerait en entendre plus souvent aujourd’hui. Il me fait de plus en plus – y compris physiquement, penser à José Carreras…
Mais étrangement son timbre s’est un peu obscurci, avec des aigus mieux négociés et plus sûrs ; il n’avait pas le timbre solaire qu’on lui connaît, mais peut-être n’était-ce ni le lieu ni l’occasion. La voix était colorée juste ce qu’il fallait pour un Requiem, dirons-nous.
Krassimira Stoyanova est elle aussi issue d’une école belcantiste où tout est contrôle, et tout est couleur. Il y a des moments proprement séraphiques (l’Agnus Dei !) et en même temps d’une insondable tristesse. Elle a su donner cette expression très profonde à son chant. Son libera me à ce titre a certes l’urgence, mais presque une résignation en arrière-plan. Sans vouloir faire de mauvais de jeu de mot et parler de « profondeur de chant », c’est pourtant ce qui m’a interpellé dans sa prestation d’une profondeur inattendue, comme une méditation. C’est aussi cette voix sans faille, où chaque détail est dessiné, où les ombres et les lumières alternent qui est étonnante. À l’opposé d’une Harteros, tragique et urgente, Stoyanova exprime maturité, résignation, et c’est tout aussi prodigieux.
Georg Zeppenfeld surprend, stupéfie, éblouit. Son timbre, on le sait, est plutôt plus clair que les basses habituelles, notamment dans cette partie, mais il a toutes les notes y compris les plus graves. Comme Stoyanova, et aussi comme Meli, il est d’abord doué d’un art du dire le mot d’une telle clarté qu’on reste stupéfait de la perfection de chaque expression, dite avec des couleurs légèrement différentes. Il ne fait pas résonner la voix, il lui suffit de dire, dans la simplicité, sans surjouer, sans proférer : son mors stupebit est un modèle de naturel, de fluidité, de simple émotion. Peut-être ce soir, des quatre solistes tous exceptionnels, il le fut un peu plus, il entra dans l’œuvre pour nous en exprimer la substantificque moëlle. La présence vocale impressionnante, la tenue hypercontrôlée, l’absence totale de manière ou de jeu intempestif en ont fait la référence qu’on emporterait dans l’île déserte.
Une soirée étrange et fascinante, où la musique traduite en mouvement et en gestes, la musique chorégraphiée qui surprend au départ et dérange même, finit par composer ce tout, cette Gesamtkunstwerk qui est le but de l’entreprise. On regarde sans voir, on voit sans regarder, on se laisse aller à être envahi d’émotions diverses…et puis il y a eu Zeppenfeld…