Samson et Dalila était prévu par son auteur à l’origine comme un oratorio, vu le sujet biblique et les retrouvailles du monde musical avec Bach, dans le sillon de Mendelssohn. C’est devenu un opéra, représenté pour la première fois à Weimar sous l’impulsion de Liszt en 1877. Il faudra attendre 1890 pour que Samson et Dalila soit créé à Rouen d’abord, puis à Paris, et pas à l’Opéra, mais à l’Eden, l’ancêtre de l’actuel théâtre de l’Athénée. C’est en 1892 que Samson et Dalila entrera à l’Opéra. Est-ce pour punir Saint-Saëns d’avoir laissé créer son œuvre en Allemagne, sept ans après la débâcle. Pour mémoire, Lohengrin en version de concert a été créé en France en 1887 à l’Eden, et en 1891 à l’opéra : L’opéra de Richard Wagner a eu les honneurs des scènes parisiennes avant l’œuvre de Saint-Saëns. C’est assez étonnant.
À Strasbourg, elle est donnée en version allemande pour la première fois le 15 avril 1900. Il est amusant de constater d’ailleurs que trois des plus grands opéras du répertoire français, Les Troyens (Karlsruhe), Samson et Dalila (Weimar), Werther (Vienne) ont été créés en territoire de langue allemande… Comme quoi l’opéra est bien un art international, et « identitaire » par accident ou pour raisons politiques.
On doit féliciter l’Opéra National du Rhin d’avoir maintenu à l’affiche cette production lourde, malgré les restrictions actuelles et la joie des spectateurs était visible.
À l’Opéra de Paris, Samson et Dalila a fait l’objet de trois productions depuis 1975, la première en 1975 (Mise en scène Jacques Dupont) reprise quatre saisons, la seconde en 1991 (Pier Luigi Pizzi), et la dernière en 2016 (Damiano Michieletto), c’est assez peu pour un pilier du répertoire.
Il est vrai aussi qu’il faut un mezzo de poids (on n’en manque pas et on n’en a jamais manqué) et un ténor dramatique, Domingo, Vickers l’ont chanté, aujourd’hui c’est Aleksandr Antonenko qui s’en est fait une spécialité. Mais sans doute l’œuvre, surtout connue par l’air de Dalila « Mon cœur s’ouvre à ta voix » que tous les très grands mezzos ont chanté au moins en récital, intéresse moins aujourd'hui.
Pour ma part ma plus grande soirée fut viennoise, en 1990, dans une mise en scène de Götz Friedrich avec Agnès Baltsa, Placido Domingo, Alain Fondary et en fosse Georges Prêtre, que j’entendis plusieurs fois aussi à Paris et mon plus grand Samson en absolu fut Jon Vickers.
L’œuvre ne fait pas partie de mon Panthéon, mais depuis 1990, je l’avais laissée reposer dans mes souvenirs, si l’on excepte une soirée genevoise il y a quelques années. Cette soirée strasbourgeoise a ravivé des souvenirs, en soulignant aussi combien l’œuvre est ingrate à mettre en scène et difficile à chanter.
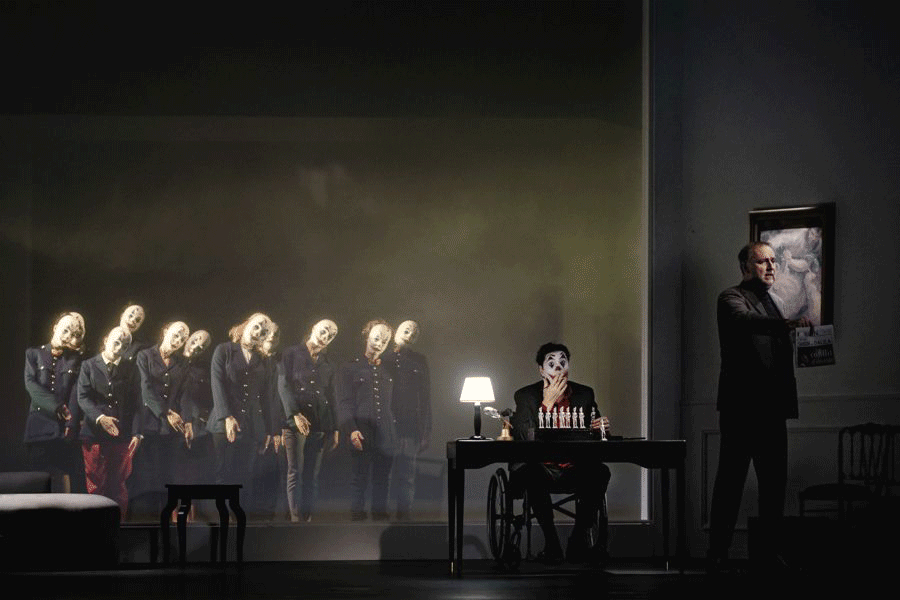
La mise en scène de Marie-Eve Signeyrole actualise l’histoire biblique en la transformant en une sorte de clone d’une série TV d’aujourd’hui, d'ailleurs, chaque acte est doté d'un titre “Le duel”, “Le secret”, “La chute” comme des épisodes, et elle transforme les rôles des personnages : Dagon n’est plus le Dieu des Philistins mais un leader politique en campagne, Le Grand-Prêtre de Dagon devient son conseiller le plus proche et Dalila sa directrice de campagne. Face à ce parti (conservateur, bien entendu), les insurgés menés par Samson, en fauteuil, maquillé en joker ou en clown.
Sauf qu’il y a une aventure entre Dalila et Samson, qui trouble évidemment le jeu.
Le tout se déroule dans une structure tournante uniformément blanche qui laisse voir tous les espaces dans lesquels se déroule l’intrigue, et ceux qu’on ne voit pas apparaissent en vidéo en prise directe. L’ensemble est bien construit, rigoureux et clair grâce au décor ingénieux de Fabien Teigné. La vidéo qui agrandit l’espace en multipliant les points de vue, se concentre aussi – et surtout- autour des personnages, vus en gros plan.
En conséquence, la mise en scène se construit en montrant deux groupes opposés de manière caricaturale ou à la manière d'une BD : la mise en scène évoque les droites dures, le populisme, et les regards que ces droites portent sur les oppositions, d’où une lecture possible du masque porté par Samson, vu comme Le Joker, avec son côté maléfique et inquiétant, un personnage un peu mystérieux dont l’ascendant sur les foules inquiète. Ce masque, là réside le secret de Samson selon Signeyrole : le masque cache le visage et donc la réalité du personnage. Au-delà du joker, il est aussi un masque de clown, dérisoire et triste.

La révélation du deuxième acte à Dalila est alors celle de son vrai visage, Samson enlève le masque ("Bas les masques!") une sorte de suprême don d’amour, conscient et confiant dans la mesure où le livret de Ferdinand Lemaire ne révèle rien du secret de Samson, et reste assez réservé sur l’histoire biblique. Samson, dont la situation d’handicapé multiplie la force et sa prise sur ses compagnons par le discours, possède la force de la parole, outil politique s’il en est, qui emporte la foule et la pousse à la révolte du premier acte.
D’un côté une machine huilée pour vaincre, de l’autre un désordre d’autant plus inquiétant qu’il est évidemment inattendu. Cette parole directe qui touche les cœurs s’oppose à la parole préparée, ciselée, de l’adversaire Dagon, dont on prépare les discours qu’on voit à la vidéo, des discours mimés qu’ironiquement on n’entend pas. On en voit simplement la mise en scène.
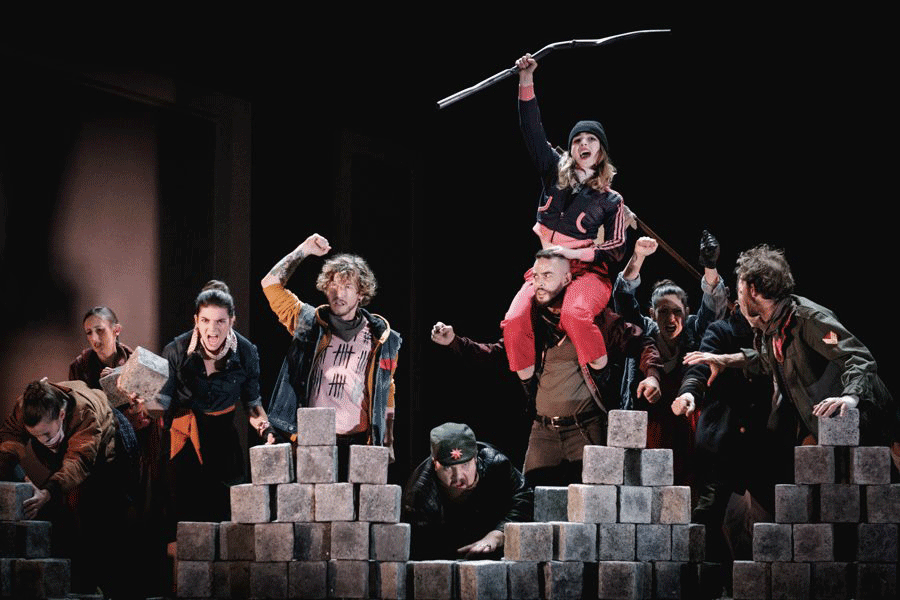
Signeyrole oppose deux « mises en scène », celle de la droite autoritaire, dont on voit aujourd’hui toutes les manifestations dans le monde, et celle d’un peuple d’où émerge un tribun, seul, comme sont émergées des figures des différents soulèvement populaires des dix dernières années, que ce soit dans les pays arabes, en Ukraine ou en Belarus, ou plus près de chez nous, chez les Gilets jaunes. Combat d’un establishment installé au rituel consommé face à un peuple qui n’en peut plus de se voir confisquer le pouvoir. Profitant du fait que derrière les conflits religieux avancent toujours masqués des enjeux politiques – c’est vérifiable à chaque moment de l’histoire, Signeyrole s’est emparée de Samson et Dalila de Saint-Saëns pour en faire un emblème d’enjeux qui dépassent largement la période de sa création, encore que le XIXe – et notamment les révolutions de 1848 et ce qui s’ensuivit- soit lui aussi riche d’exemples.

Dernière idée séduisante, le final où le temple ne s’écroule pas mais tombent du ciel des plumes sur la fête des conservateurs après leur victoire, gâchée et détruite par l’énergie retrouvée de Samson qui galvanise le peuple (en l’occurrence ici les serviteurs du repas et de la fête). Dagon au final apparaît avec du goudron et des plumes, reste de la torture médiévale qui consistait à indiquer ainsi le trouble-fête, le ridiculiser et le contraindre à laisser la place et quitter la ville. C’est une torture ancienne, typiquement populaire, issue des révoltes contre les pouvoirs et elle s’applique ici de manière très adaptée avec la pointe d’ironie qui laisse un doute sur la suite. On sait ce qu’ont donné aux États Unis les manifestations des insurgés de Wall Street…
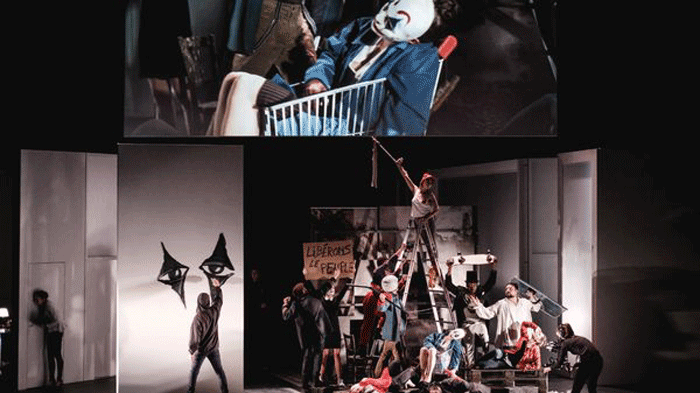
Transposer les rôles et la trame dans une situation plus proche de nous n’est pas nouveau et justement, cette mise en scène n’est pas neuve dans son idée ou son propos, ni même par ses aspects techniques, par exemple la vidéo utilisée à la Cyril Teste, mais aussi à la mode Castorf, c’est à dire une mode née au milieu des années 90…. Bien des metteurs en scène utilisent aujourd’hui la vidéo, de manière plus ou moins similaire à de rares exceptions près, là où les vidéos ou les « images animées » font référence aussi culturelle et où elles ont une vraie fonction dramaturgique : ce n’est pas le cas ici où elle est essentiellement illustrative. Elle anime, elle distrait, elle complète, mais elle ne crée rien et ne rajoute rien au propos. Ainsi donc ce travail apparaît rigoureux la ligne est respectée, sans incohérences, les scènes sont bien construites et les personnages très dessinés. C’est de ce côté que peut-être le travail est le plus intéressant. Dagon avec son vague physique de colonel grec ((Les Colonels grecs, issus du coup d’État de 1967)), interprété avec beaucoup d’efficacité par le comédien Alain Weber, et tout autour de lui une technostructure où sont caricaturés les costumes gris, les cravates, les dossiers. Ce pourrait être d’ailleurs aussi bien une ambiance de grande entreprise…Il est vrai que les deux vont bien ensemble. De l’autre côté la même caricature du « peuple », vu comme l’autre, le masqué, l’ennemi, ce lui qui détruit l’ordre et le bel ordonnancement de la « compétence », un peu comme étaient vus comme des caricature les communistes ou les cégétistes il y a une trentaine d’années.
Dans cette perspective très politique, la relation entre Samson et Dalila sonne étrangement improbable alors qu’elle est constitutive de l’histoire biblique : le désir détourne de l’adoration divine et de l’obéissance et Samson s’est détourné de Dieu qui à son tour l’abandonne.
Marie-Eve Signeyrole y voit la relation de deux êtres déchirés, qui s’aiment et se désirent, mais qui ce faisant trahissent leur milieu et leurs convictions : ainsi Dalila ne serait pas la femme monstrueuse et duplice, mais elle aussi une sorte d’héroïne tragique coincée entre le choix de classe et celui du cœur. On serait presque au seuil de la tragédie classique. C’est sans doute la plus grande trouvaille de cette mise en scène que de faire de Dalila non pas une figure de la méchante, voire du « mal », au sens où depuis le péché originel, le mal vient de la femme, mais une figure de l’ambiguïté, du déchirement, qui reste sincère, quelle que soit sa posture. Une figure de ce « je t’aime je te tue » au total assez traditionnelle, mais assez juste aussi. Autre figure que celle qui met l’amour en face d’autres données : les origines, les opinions, les contextes du monde ; ce sont des situations très habituelles aujourd’hui qui peuvent conduire à la destruction du couple, à la fin de la relation amoureuse. Il y a chez la Dalila de Signeyrole, plus intéressante à mon avis que la figure de Samson, cette volonté de nuire pour détruire ce qu’elle adore et ainsi aller jusqu’au bout de son choix, malgré les hésitations, malgré les éventuelles repentances. Dans la scène de la Bacchanale à l’acte III où Samson est raillé, bousculé, torturé moralement et physiquement, elle reste en retrait, enfermée en elle-même : elle a fait son choix, elle l’assume, mais elle n’efface rien du passé.
Samson est un personnage lui aussi complexe, qui dissimule son être sous le masque du joker ou du clown, selon qu’on le considère, un masque qui est aussi l’apanage traditionnel du théâtre depuis les origines, un maque qu’on utilise aussi dans les manifestations, et évidemment plus récemment dans notre protocole sanitaire où de nombreux commentateurs ont disserté sur la privation des traits, des expressions du sourire. Un personnage qui se livre, ou du moins qui livre son désir et son corps mais pas son identité profonde avec une relation à Dalila qui ne peut être totale ou accomplie (sinon physiquement) tant qu’il ne se révèle pas. Et en même temps, la révélation au deuxième acte est la fin de l’amour et donc la mort, comme si après un sommet, ne peut que venir la retombée, la chute. Il n’y a plus rien après qu’on se soit totalement offert, plus d’ascension possible : on est au seuil de Tristan.
Et en même temps, il apparaît moins tacticien que Dalila, moins déchiré peut-être, un peu plus monolithique.
Reste le troisième personnage, le Grand Prêtre de Dagon devenu conseiller politique du leader Dagon, dévoré par l’ambition et soucieux de gagner les élections quoi qu’il en coûte. Image du cadre sans scrupule, du politicien qui fait feu de tout bois, et qui rencontre une Dalila en proie au doute et aux contradictions pour la convaincre. L’incarnation qu’en donne Jean-Sébastien Bou est souveraine, voix bien projeté, émission impeccable, diction d’une grande clarté avec une expressivité exceptionnelle, tant les mots sont sculptés : Jean Sébastien Bou s’ajoute avec bonheur à la théorie des grands barytons français qui incarnèrent le rôle, à commencer par l’immense Ernest Blanc qui fut mon premier Grand Prêtre à Garnier en 1975.
Patrick Bolleire quant à lui est particulièrement émouvant dans le personnage épisodique d’Abimelech, qui disparaît au premier acte après un des beaux airs de la partition dans lequel il est convaincant, comme souvent. Voilà un chanteur qui ne déçoit jamais dans ses apparitions.

Massimo Giordano fait sonner une voix puissante dans ce personnage très spécial de Samson dans cette mise en scène. Très engagé, bon comédien, quelquefois même émouvant, il privilégie un chant ouvert et puissant, au détriment de la subtilité. En ce sens, c’est l’exact opposé du chant de Jean-Sébastien Bou. Dès que le texte nécessite plus d’intériorité et de lyrisme, la voix accuse des limites et des fragilités, voire une certaine instabilité. L’air de la meule son monologue du troisième acte, n’est pas totalement convaincant, – il faut dire aussi qu'il le chante dans une posture difficile qui l'empêche de prendre appui- au contraire de toute sa dernière scène, magnifiquement interprétée.
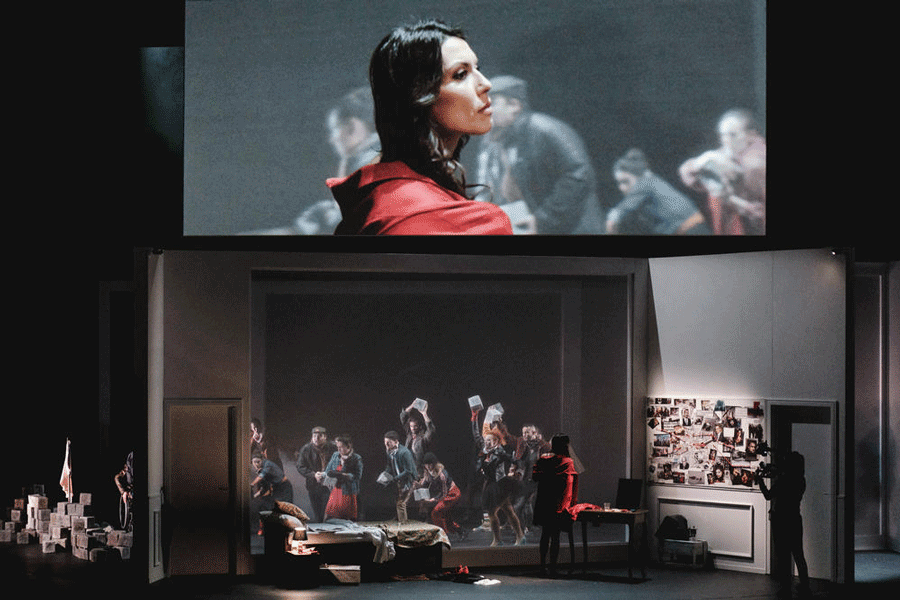
Enfin, Katarina Bradić n’est pas une Dalila au format vocal habituel, ni une Cossotto, ni une Rashvelishvili, mais elle est la Dalila voulue par cette mise en scène, très engagée, très crédible, avec une émission qui convient à cet opéra-série TV. Elle joue ce qu’elle dit avec une étonnante vérité. Bien sûr, le grave manque un peu de profondeur, au contraire de l’aigu, bien dominé, et d’un vrai respect du texte et de ses possibles ; la voix soigne les couleurs, reste toujours expressive et le timbre est velouté. Cette Dalila n’est pas biblique ni mythique, elle est moderne d’allure et de style, dans l’ordinaire de ce qu’on imagine des femmes puissantes, pour reprendre le titre d’un ouvrage récent. À ce personnage ne peut correspondre une Dalila traditionnelle. Elle ne l’est pas, elle conduit le personnage vers autre chose, lui donnant des horizons nouveaux ; cette chanteuse, plutôt habituée aux rôles baroques (Bradamante par exemple), donne ici une vision convaincante intelligente et neuve.
Le chœur dirigé par Alessandro Zuppardo n’apparaît jamais en scène, Covid oblige, mais il n’est ni en coulisse, ni dans une salle attenante : il est dans la salle, aux étages supérieurs, ce qui lui confère la présence nécessaire, et qui permet aussi une plus grande liberté à la mise en scène pour gérer les mouvements. C’est une solution à laquelle d’autres pourraient penser pour monter des opéras où le chœur est important. Vu sa position, on eût pu craindre des décalages qui par bonheur ne se produisent pas ou très peu.
Reste l’orchestre, en l’occurrence l’Orchestre Symphonique de Mulhouse : pour les mêmes raisons sanitaires, on a dû réduire drastiquement l’effectif et jouer une version redimensionnée. C’est sans doute là que les choses déçoivent un peu. La richesse de l’instrumentation de l’œuvre de Saint-Saëns procure un son particulièrement charnu et coloré d’une puissance marquée. Ici cela sonne au départ surtout un peu décharné et sans grande couleur, avec des cordes grêles et un tantinet trop incisives et du coup, les parties plus spectaculaires semblent sonner plus (trop) fortes mais pas puissantes, et cela fait décalage par rapport à ce qu’on entend et qu’on voit. Prévu au Printemps dernier, ce Samson et Dalila a vu le jour à ce prix. On ne fera donc pas la fine bouche et on donnera crédit à Ariane Matiakh d’avoir maintenu la tension et la cohérence de l’ensemble dans des conditions délicates.
Au total, un spectacle qui tient largement la route, sans être révolutionnaire et qui permet de donner à cette œuvre d’autres horizons, dans une interprétation musicale globalement solide : le succès auprès du public, frustré depuis des mois et ravi, n’est pas là pour nous démentir.


Quelle horreur ! Quelle vision étriquée, laide, bête et sinistre, pour un des plus grands chefs d'œuvres de l histoire de l'opéra et pour une partition sublime. Pauvre St Saens ! Lui, passionné par l Orient, il doit se retourner dans sa tombe 😞👎🤬