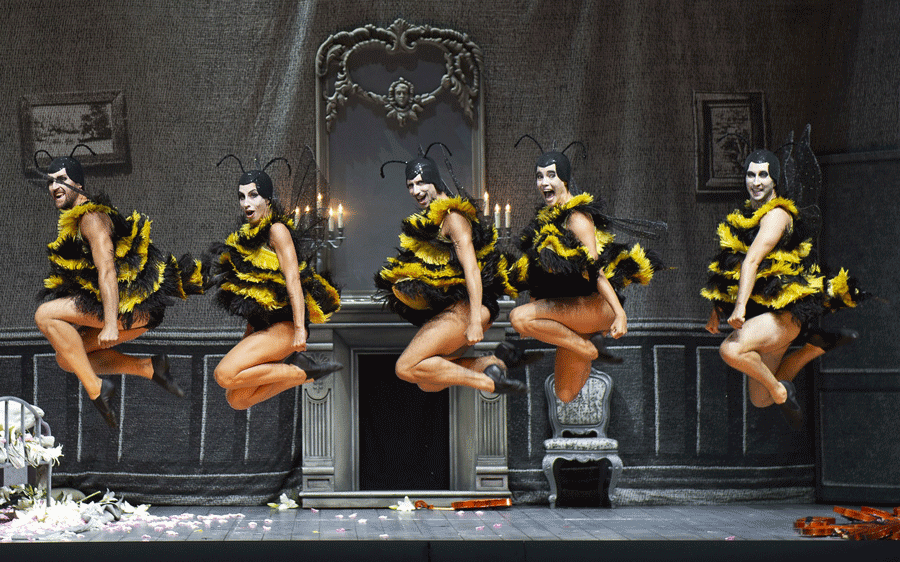
En décidant de donner la version originale française, le Festival a contraint Barrie Kosky à résoudre la question de la langue. C’est probablement ce qui a décidé des heurts et malheurs d’une production très efficace certes, mais qui jamais n’atteint le délire des grandes opérettes que Kosky met en scène à la Komische Oper. Cependant, la mécanique théâtrale est parfaitement au point, c’est même génialement fait, parce que Kosky sait gérer les situations, sait conduire les acteurs, sait animer un groupe et faire danser les pierres (ce qui dans Orphée, est la moindre des choses). Et le public fait un triomphe.
Et pourtant quelque chose ne fonctionne pas tout à fait, et l’amorce qui devrait faire exploser le feu d’artifice prend l’eau. Et c’est à mon avis d’abord à cause de la question de la langue.
Les amateurs d’opéra français sont réputés être très sourcilleux sur l’articulation et la compréhension du français, mais il ne s’agit pas (tout à fait) de cela. Toute langue bien chantée et articulée rejaillit sur l’ensemble de la ligne de l’œuvre, mais chez Offenbach et dans l’opérette en général c’est encore plus sensible, parce que outre la question des dialogues, magnifiquement résolue quant à elle à Salzbourg, on le verra, le chant doit être clair et compréhensible, parce que les textes ont du sens, sont remplis d’allusions et de jeux de mots, et exigent donc d’être dits de manière expressive, avec un phrasé particulier qui puisse au moins faire ressentir, à défaut de faire comprendre, là où il y a quelque chose de particulier à transmettre, que ce soit du jeu, de l’humour, de l’expression ou de la couleur. Or, dans cette production, la langue est si peu compréhensible, si peu claire chez certains qu’on reconnaît à peine les mots et qu’on suit le surtitrage en anglais ou allemand pour saisir…
C’est difficilement acceptable de la part d’un Festival comme Salzbourg. Il paraît d’ailleurs que Médée, autre opéra en français présenté cette saison, était encore moins compréhensible.
Un texte mal dit et mal phrasé, c’est évidemment une perte pour l’ensemble des rythmes et donc pour l’ensemble de la production.
Dans le cas présent, c’est très surprenant et très regrettable. L’opérette (même si Offenbach a appelé son Orphée aux Enfers « Opéra Bouffe ») exige un texte dit clairement qui soit totalement compréhensible : le texte de l’opérette doit être immédiatement et directement accessible pour faire effet. On se demande dans ce cas si une version en allemand n’eût pas été préférable…ou s’il ne fallait pas une distribution bien plus francophone (la seule française est Léa Desandre dans un rôle assez mineur).
En revanche, la question des dialogues a été magnifiquement résolue par Barrie Kosky, puisque les dialogues sont comme doublés par l’acteur-chanteur Max Hopp, inconnu du public d’opéra, mais bien connu à la Komische Oper de Berlin. Il y fait en John Styx, l’assistant de Pluton, une démonstration époustouflante, doublant les dialogues et les alimentant de bruitages délirants, en situation, des pas, du liquide qui coule etc…ce qui met le public en joie. Il ouvre par un doublage de la déclaration liminaire de l’Opinion Publique (Anne Sofie von Otter) dite en suédois, langue maternelle de la chanteuse. Elle aurait évidemment pu la dire en allemand, car cette magnifique chanteuse de Lied sait ce que diction veut dire, mais ça aurait cassé la loi instaurée du doublage. Cette introduction permet de saisir immédiatement ce qui va se passer et la scène initiale avec Eurydice devient à cet égard encore plus désopilante parce que Max Hopp double et joue, mais il oriente aussi vers le nœud de l’intrigue. Max Hopp est absolument irrésistible, c’est le maître absolu de la soirée.
Donc, la folie-Offenbach est à la fois stimulée par Max Hopp (seul professionnel authentique du genre de l’opérette), et freinée par des textes chantés incompréhensibles comme si l’arc bandait sans jamais se lâcher.
On peut d’ailleurs penser que les artistes n’ont pu apprendre suffisamment le texte français pour le reproduire, le déglutir, le mâcher en ayant l’expressivité et la clarté voulues. Rares sont ceux qui sont un peu plus clairs (Joel Prieto, peut-être, mais le rôle d’Orphée est si réduit Marcel Beekman pour sûr et Martin Winkler aussi…)

Les parties chantées ne collent donc pas toujours à la couleur Offenbach, et la jeune américaine Kathryn Lewek, Eurydice pétillante, explosive et très à l’aise en scène, très juste dans son rôle de femme en cours de libération puis complètement libéré, en pâtit évidemment, son jeu effervescent ne rythmant jamais le texte français, et sa voix, très à l’aise à l’aigu, se contentant de montées démonstratives peu liées au texte réel souvent disparu corps et bien dans une bouillie sonore.
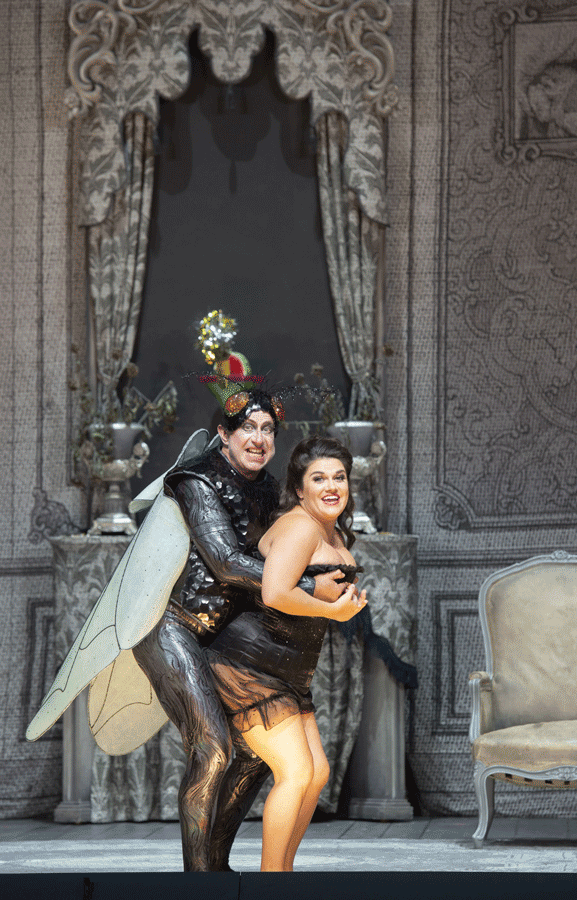
On chante donc comme à l’opéra (et encore, les très grands chanteurs savent rendre le texte clair) sans jamais trop faire cas de ce qu’on dit. Seuls Marcel Beekman, Pluton très drôle, et aussi Martin Winkler malgré une voix un peu vieillie, réussit en Jupiter à être vraiment expressif et faire ressentir quelque chose du texte ((Rétrospectivement on regrette qu’il n’ait pu être l’Alberich de Castorf à Bayreuth après 2014)), notamment dans la scène délirante (dans l’acte II) de Jupiter déguisé en mouche cherchant à séduire Eurydice.
Du coup, et peut-être plus dans la première partie, le rythme s’en ressent, le liant nécessaire n’étant pas toujours au rendez-vous. Barrie Kosky semble être resté prisonnier de l’œuvre, ne la projetant pas ailleurs comme il le fit dans d’autres opérettes, n’utilisant pas vraiment la force satirique du texte d’Offenbach, même s’il exploite la veine de la soif érotique insatiable de ces dieux, demi-dieux et mortels, c’est à dire de notre monde en folie.

On sait en effet comment Offenbach utilise la mythologie pour ironiser sur des situations du monde dans lequel il évoluait, c’est aussi le cas dans La Belle Hélène, beaucoup plus politique. Certains critiques du temps lui ont d’ailleurs reproché cette atteinte à une mythologie gréco-romaine habituellement sacralisée. Dans Orphée aux Enfers, il inverse tous les caractères du mythe, aussi bien la vision des Enfers, que celle d’Orphée et Eurydice. Cela suppose aussi que son public ait une culture classique solide pour bien comprendre les jeux et les allusions. Cela donne aussi une idée du public du temps, plutôt bourgeois et éduqué.
Cela indique aussi la place d’une culture classique qui était largement digérée par l’époque, moins digérée aujourd’hui aujourd’hui où l’éducation n’affronte la culture classique et les connaissances de l’antiquité que de manière très incidente.
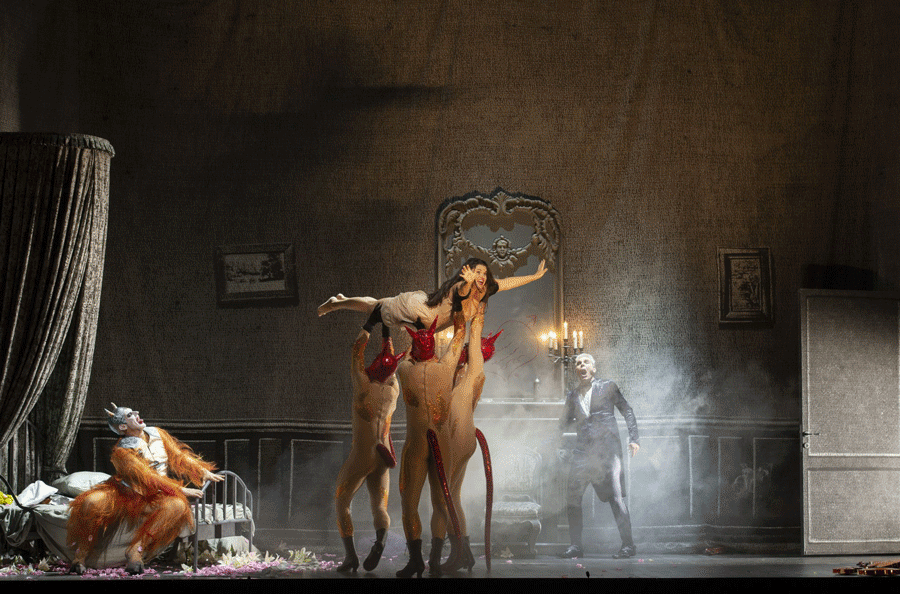
Mythe renversé signifie que si dans le mythe, Orphée et Eurydice s’aiment et qu’Orphée est inconsolable, chez Offenbach le couple bat de l’aile et Orphée est parfaitement heureux de la disparition d’Eurydice, qui vole vers l'Enfer avec plaisir, d’où le rôle de l’Opinion Publique, garante à la fois des « bonnes » mœurs, et de la cohérence de l’histoire : il faut pour les regards du monde respecter les exigences de la légende, et donc qu’Orphée descende aux Enfers. Chez Kosky, « L’Opinion Publique » est un rigide pasteur protestant, et ainsi il vise aussi les hypocrisies de la religion, qui n’est que garante des apparences.
D’autres inversions aussi. L’Olympe d’Offenbach est un lieu où l’on s’ennuie « mortellement », et c’est Pluton qui s’amuse comme un petit fou en séduisant sous les traits du berger Aristée une Eurydice qui ne demande que ça. Et il l'enlève pour l’emmener aux Enfers, où en revanche on s’amuse, prenant à revers les visions infernales qu’Homère et Virgile, puis Dante nous ont transmises. Il inverse par là toute une tradition littéraire qui règne depuis des millénaires.
Et cette inversion fit des petits : on sait qu’un cabaret nommé « L’Enfer » vit le jour en 1892 au 34 boulevard de Clichy (vite transféré au 53), et on peut supposer que la vision d’Offenbach d’un Enfer où l’on s’amuse n’y est pas étrangère. L’intelligence de Kosky est de relier cet Enfer à la vision de l’Enfer chrétien, qui ne punit pas seulement les méchants, mais aussi ceux qui eurent une attitude contraire aux « bonnes » mœurs (que porte l’Opinion Publique). N’oublions pas la présence dans l’Enfer de Dante aussi bien d’un GiannI Schicchi que d’une Francesca da Rimini coupable d’adultère.
En présentant l’Enfer comme un lieu de plaisir, Offenbach fait un pied de nez aux culs serrés, et donc Kosky s’en donne à cœur joie, montrant l’envers de cette médaille…conforme à tout prendre à de nombreuses histoires mythologiques, où les Dieux eux aussi s’en donnaient à cœur joie. Jupiter-Zeus lui-même ne savait plus où donner de la tête, entre Leda, Ganymède, Europe et les autres.
Donc Kosky est paillard, ce qui est joyeux, mais frôlant le vulgaire, ce qui n’est pas son habitude, et qui veut sans doute dire quelque chose du monde d’aujourd’hui, utilisant aussi les principes du vaudeville à la Feydeau (cache sous le lit), c’est à dire utilisant les genres mêmes qui naquirent à l’époque. Le décor initial est d’ailleurs l’espace clos d’une chambre à coucher avec tous les outils du vaudeville : la cheminée, l’armoire, le lit. Les idées sont bonnes, évidemment, mais la manière dont elles sont menées ne va pas tout à fait jusqu’au bout.
L’idée est aussi sans doute de donner l’idée d’un spectacle populaire dans une salle populaire et un peu décrépite du Paris d’alors (cadre de scène un peu défraîchi avec une peinture qui s’écaille), montrant non les bas-fonds, mais une ambiance d’un Paris presque interlope, un Paris qui s’amuse et qui vit une sorte de liberté sexuelle débridée, mais là-aussi il ne pousse pas la logique jusqu’au bout.
Orphée aux Enfers, créé en 1858, est la première production mythique des Bouffes Parisiens, sans doute une réponse bouffonne au cœur d’un Second Empire encore autoritaire avec une impératrice très catholique mais un Empereur connu pour ses frasques. Ainsi de Junon et Jupiter…
Elle fut transformée en 4 actes en 1874 (pour le théâtre de la Gaîté), la période n’était franchement plus la même et il fallait s’amuser pour oublier la défaite. La production salzbourgeoise mêle les deux versions et suit l’édition critique de Jean-Christophe Keck.
Paris s’amuse, notamment boulevard de Clichy où bien avant l’«Enfer » va naître en 1869 le « Moulin-Rouge », le célèbre cabaret dont la danse emblématique est le French Cancan, sur la musique de l’Orphée aux Enfers d’Offenbach.
Symbole du « gai Paris », Orphée aux Enfers ne va peut-être pas assez loin à Salzbourg, comme si Kosky avait travaillé pour le public international et anonyme du festival, et avait érodé quelque peu sa force subversive, comme s’il fallait juste faire des provocations souriantes sans conséquences (avec quelques faux zizis et foufounes en folie), qui ne choquent ni les uns ni les autres. Il propose au fond une vision très conforme de l’œuvre d’Offenbach, comme le montre son French Cancan, très attendu et si peu inattendu.
On ne peut que penser à l’inverse, à l’extrême inventivité d’un Marthaler, aussi bien dans sa fameuse Vie Parisienne (à quand une reprise ?) à la Volksbühne de Berlin qu’à ses Contes d’Hoffmann doux amers de Madrid, où Anne Sofie von Otter faisait une incarnation fabuleuse du rôle de la Muse.
Est-ce cette attente d’une mise en scène à casser les murs devenue mise en scène seulement brillante qui ne ferait pas de mal à une mouche (où à une guêpe, vu le ballet des guêpes…) qui aboutit à une déception ? Kosky nous a habitués à mieux, et même plus clair : la mise en scène ne clarifie pas toujours les situations, un spectateur qui ne connaîtrait pas l’intrigue aurait peut-être un peu de mal à en suivre la logique : la scène de l’Olympe mort d’ennui (quand l’Enfer vit de folie) dans sa fixité, dans sa rigidité bourgeoise est bien construite, mais sa fluidité fait défaut (encore un problème de texte), même si la révolte des Dieux est très bien menée. Les scènes finales après le Cancan restent peu claires, sans doute encore à cause du texte, par exemple la reconquête de sa liberté par une Eurydice devenue Bacchante, et donc libérée des assauts de Pluton et Jupiter, enfin libre de son corps et de ses désirs.
Évidemment, malgré tout, le spectacle garde des qualités éminentes, avec de jolies idées. L’entrée d’Orphée jouant au violon le chœur des pèlerins de Tannhäuser ne peut être un hasard, la saison même où à Bayreuth naissait un Tannhäuser qui a déchaîné les passions ; l’armoire qui vomit des dizaines de violons obsessionnels qui ont achevé de détruire le couple Orphée et Eurydice est une autre jolie idée.

Orphée (ici en frac, comme les solistes de la tradition) est celui qui par sa musique déchirante fait peut-être fondre les pierres, mais pousse Eurydice à fuir… Autre idée bienvenue, le diablotin géant cycliste au deuxième acte qui, en roi de la pédale, fait tourner la machine à folies.
Les ballets et les épisodes chorégraphiés sont délirants à souhait et parfaitement réglés par Otto Pichler , le chorégraphe habituel de Kosky, avec son utilisation indifférente de danseurs et danseuses, là où l’on attend des danseuses (comme dans Die Perlen von Cleopatra) et en particulier dans le French Cancan. Toutes les scènes gouvernées par Max Hopp sont de grandes réussites, grâce à la personnalité et à l’initiative de l’acteur qui gouverne totalement le plateau.
On ne peut donc qu’apprécier les rouages impeccables de la machine théâtrale, et en cela Kosky est un maître, on ne peut que reprocher que cette machine tourne un peu au tape à l’œil, mais sans plus : pour une fois, ce qu’il y a devant les yeux fait bien peu voir derrière les yeux.
Musicalement, la plus grande réussite réside dans la fosse, où Enrique Mazzola (cet italien qui ne dirige à peu près jamais en Italie) a cherché à montrer tout ce qu’il y a de composé dans cette musique : les parties plus douces et plus lyriques sont étonnantes, car elles renvoient à un tout autre univers que celui de l’opérette, elle renvoient à certains moments de belcanto, elles ont même quelque chose de tendu, comme si sous le rire ce cachait quelque chose de plus profond : Mazzola fait voir par sa direction ce qu’il peut y avoir derrière les yeux de cette musique. On sait qu’Offenbach a puisé beaucoup de ses mélodies (la barcarolle des Contes d’Hoffmann par exemple) dans sa culture de Kantor de synagogue, mais il a puisé les formes dans la tradition des formes opératiques du premier XIXe siècle, Rossini, belcanto, Grand Opéra. On peut même dire qu’il était plus le petit Rossini des Champs Elysées que le petit Mozart des Champs Elysées, expression trouvée par Rossini qui se souvenait sans doute qu’on l’avait appelé lui-même le Mozart italien. Ainsi les premières mesures de l’ouverture ne laissent pas imaginer quelle œuvre délirante va suivre, elles ont quelque chose de particulièrement nostalgique, jouées en plus par les bois des Wiener Philharmoniker particulièrement inspirés et des cordes légères. Enrique Mazzola est à l’aise dans ce type de répertoire du XIXe ; il a dirigé beaucoup de Bel Canto et du Grand Opéra (on se souvient du Prophète à la Deutsche Oper Berlin, et il va y diriger Dinorah, du même Meyerbeer au printemps 2020). Il dirige Offenbach avec un grand raffinement, sans jamais exagérer les effets, sans jamais de vulgarités ou de facilités, utilisant à fond les possibilités infinies des Wiener Philharmoniker.

C’est sans doute la surprise la plus agréable de la soirée, qui fait découvrir un art de l’écriture souvent négligé et qui place Offenbach parmi les grands compositeurs du XIXe et rend d’autant plus incompréhensible l’absence de vraies célébrations en France. On pourrait y voir trop de raffinement et pas assez de folie débridée, ce serait une erreur : Mazzola sait aussi accompagner avec vigueur les scènes de folie infernale. L’Enfer (scénique) est pavé de bonnes (et belles) intentions (de la fosse) …
Du côté de la distribution, le Festival de Salzbourg eût pu faire un effort pour élaborer une distribution plus au fait de ce style ou de la langue. Il reste que l’ensemble est très honorable.

Aristée (Marcel Beekman) l'apiculteur au milieu de ses ouvrièresKathryn Lewek est une Eurydice scéniquement désopilante, très engagée, qui joue très librement de son corps dans son rôle de femme libérée, et prête à tout pour échapper à son mari : les costumes de Victoria Behr le soulignent avec un grain de malignité. Le chant est cependant gouverné de manière assez caricaturale, utilisant à plein ses qualités à l’aigu et souvent au suraigu (un peu crié cependant) de la jeune colorature, mais sans aucun phrasé français : on ne comprend rien du texte chanté comme dans une langue anonyme et cela finit par nuire, y compris à la caractérisation du personnage, un peu hystérisé du même coup, alors qu’elle est une rouée…
Joel Prieto est un Orphée agréable, pour un rôle assez réduit et finalement assez secondaire, la diction est un peu plus claire, le jeu est engagé lui-aussi, mais il reste un Orphée joli mais fade (peut-il en être autrement dans une œuvre où Orphée doit être ennuyeux ?).

Marcel Beekman (Pluton/Aristée) est sans doute le seul qui ait un vrai phrasé et qui soit compréhensible dans son chant. Sa culture de ténor de caractère (un type vocal qui doit par force jouer sur le texte et la couleur), sa culture de ténor de chant baroque (Platée…) également au style très contrôlé, tout cela contribue à en faire l’un des éléments les plus engagés de la production, scéniquement et surtout stylistiquement. Son entrée en apiculteur au premier acte avec le ballet qui s’ensuit est particulièrement réussie.
Martin Winkler, Jupiter est scéniquement très à l’aise et désopilant dans son double jeu de roi des Dieux qui doit donner l’exemple (lui aussi pressé par l’Opinion Publique), mais qui n’en pense ni n’en fait pas moins. Le duo de la mouche (acte II) est l’un des moments les plus drôles de la soirée, il y montre un français relativement compréhensible, avec des variations notables de couleur, et un sens aigu de la caricature, avec un accompagnement à l’orchestre particulièrement soigné (imitations du bourdonnement, un peu comme dans les dessins animés) ; c’est ici une des scènes les mieux construites de la production.

Nadine Weissmann ici totalement à contre-emploi, est un Cupidon assez à l’aise sur le plateau : sa scène de l’acte II (allons mes fins limiers…lorsqu’on veut attirer l’alouette, on fait briller un miroir à ses yeux) est très bien réglée et chorégraphiée, le chant est relativement clair, plus à l’aise dans le grave profond qu’à l’aigu un tantinet court, mais la composition est respectable, même si on la sent moins habituée à ce type de rôle débridé (on est très loin d’Erda…).
Les autres rôles sont épisodiques essentiellement développés dans le tableau de l’Olympe où chaque Dieu a son mot, mais tous bien tenus, à commencer par la fraîche Venus de Léa Desandre (délicieuse dans Je suis Vénus et mon amour a fait l’école buissonnière), et la Junon affirmée de Frances Pappas, mais aussi la jolie Diane de Vasilisa Berzhanskaya, le Mars de Rafal Pawnuk et le Mercure de Peter Renz, lui aussi droit venu de la Komische Oper, tout comme l'excellent Vocalconsort Berlin, ici ne charge des parties chorales, qui travaille notamment avec la Komische Oper sur certaines productions.

Gardons pour la fin les mets de choix, Anne Sofie von Otter dans le rôle rabat-joie de l’Opinion Publique, à qui la production réserve un Lied (un peu comme dans les Nozze di Figaro de Loy à Munich), un Lied d’Offenbach en ouverture de l’acte II, sur les paroles de Théophile Gautier Dites la jeune belle où voulez-vous aller ? écrit en 1852 où l’on remarque encore les qualités de phrasé et d’expression de la grande mélodiste qu’elle reste. Dans ce personnage rigide de l’Opinion Publique, d’autant plus rigide dans son rôle de religieux sourcilleux sur les règles et le respect des apparences, elle montre une distance, un sens de l’humour, une aisance comme toujours remarquables.
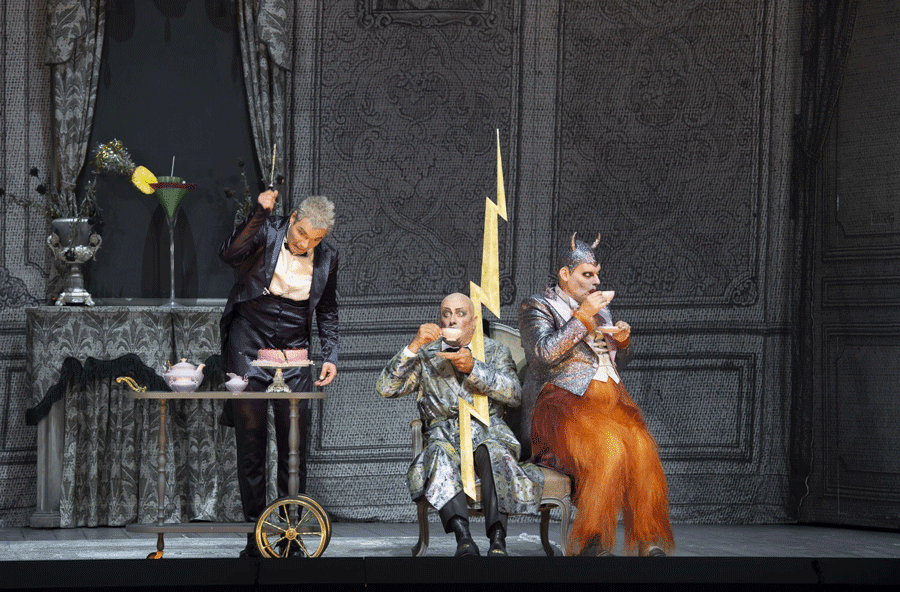
Enfin, Max Hopp. Toute la production repose sur ses capacités d’acteur, de chanteur, de mime, de phraseur : il remplit la scène à lui seul, c’est la seule vraie originalité et vraie trouvaille de Kosky dans une mise en scène au total assez sage et c’est une immense réussite comme en témoigne aussi son triomphe final. On l’a vu à la Komische Oper très émouvant dans le rôle deTevje d’Anatevka, un peu fou dans Eine frau die weiss was sie will, il fut aussi le professeur Higgins dans My fair Lady, c’est un pilier du genre, complètement protéiforme. Immense acteur qui habite la scène qu’il tient littéralement à bout de bras. Mais il sait aussi chanter de manière élégante, voire émouvante et son air Als ich einst Prinz war von Arkadien, traduction de Quand j’étais roi de Béotie est un exemple de diction, de phrasé, de douceur et de grande justesse.
Au sortir de la représentation, c’est lui qui en est la trace essentielle, et qui contribue aux meilleurs moments de cet Orphée aux Enfers, si attendu. On eût aimé que pour le reste les fruits passent un petit peu mieux la promesse des fleurs, mais ce ne fut pas tout à fait le cas, même si le spectacle tient grandement la route puisqu’il a triomphé, à guichets fermés pour les sept représentations (si l’on comprend la générale, désormais accessible) et qu’on sort tout de même très heureux.

Il y a en septembre a l'opéra de Bordeaux une nouvelle production des Contes, dirigée par Minkowski et dans l'édition intégrale de Kech. Et Bordeaux avait donné Offenbach déjà les deux saisons passées