
L'essentiel de ce Tristan, son rythme intérieur, tient à l'adéquation voulue et revendiquée avec les décors très graphiques de Frank Philippe Schlöβmann – eux-mêmes inspirés des Carceri d’invenzione de Piranèse et des jeux d’optiques de Maurits Cornelis Escher (voir notre article de l'an dernier). Ce grand tableau vivant présente l'avantage de rendre immédiatement compréhensible l’incommunicabilité qui sépare les deux personnages au premier acte, pris dans un désordre complexe d’escaliers qui n'aboutissent souvent qu'à des impasses. Le problème se trouve au niveau de la direction d'acteurs, engluée dans le rapport esthétique de personnages réduits à l'état de détails dans une vaste étendue picturale. On bouge peu dans Tristan et particulièrement dans celui-ci, contraignant le spectateur à contempler faute de carburant intellectuel qui le pousserait vers l'analyse.
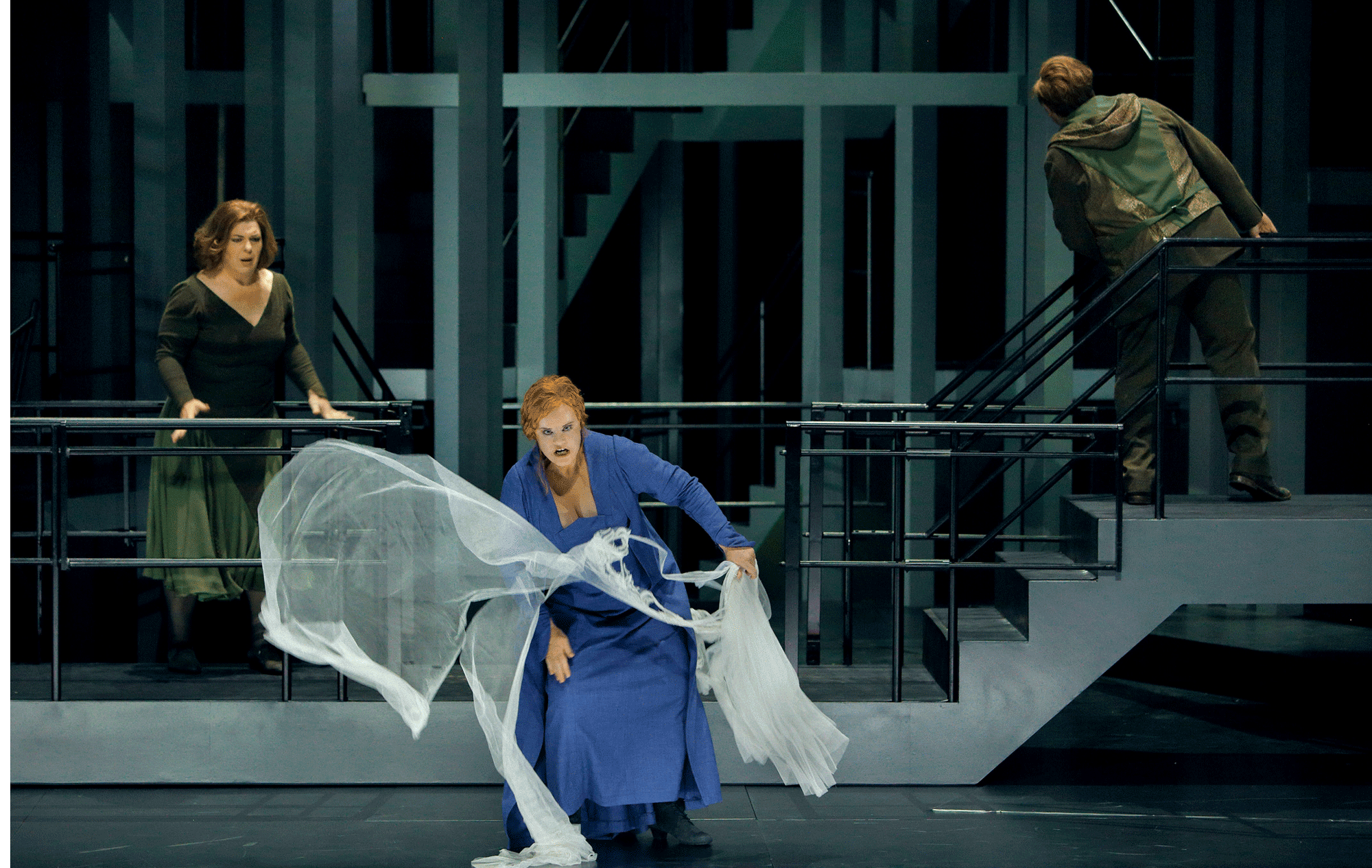
Dans cet univers quasi immobile, il n'est pas difficile de constater que tout se joue autour d'Isolde, maîtresse dominante qui prend les devants et commande à un Tristan souvent interdit et passif. Seul l'ultime geste de Marke dans la conclusion pourra surprendre, en faisant de l'héroïne rebelle, une victime finalement réduite à la soumission. Pour l'heure, les personnages sont assis sur les escaliers, les jambes dans le vide et chantant comme s'ils étaient déjà ailleurs. La scène du philtre est l'aboutissement d'un long et lent ballet au cours duquel les corps s'effleurent, l'étreinte se refuse tandis qu'il versent ensemble le précieux contenu sur leurs deux mains enlacées, comme pour les fusionner. Brangäne et Kurwenal sont un peu les oubliés de cette scénographie. Ils passent tout le premier acte à surjouer leur impuissance, tantôt se lamentant, tantôt tentant de récupérer des fragments de ce voile de tulle qu'Isolde déchire en mille morceaux, jusqu'à ce qu'il ne reste que la couronne, ultime et froid symbole qui atteste du rang social de sa propriétaire.
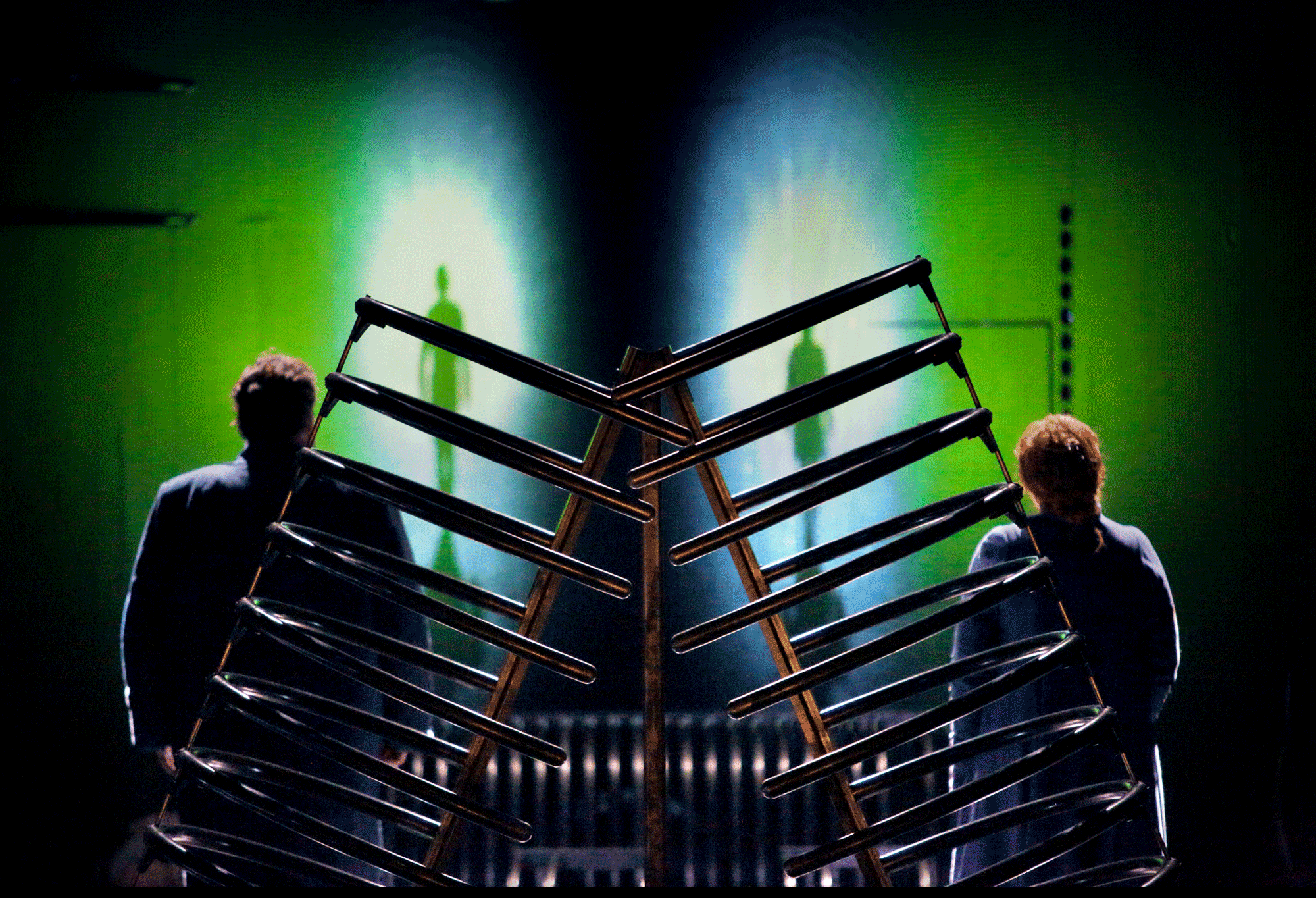
La prison du deuxième acte rappelle les expérimentations des rats de laboratoire du Lohengrin de Hans Neuenfels. Même couleur jaune canari chez Marke et sa troupe de laborantins sadiques qui braquent des projecteurs sur les quatre victimes. On peine à se distraire de l'effondrement (bruyant) des cerceaux métalliques que l'on tente en vain d'escalader ou bien de l'étrange cage mobile aux faux airs de garage à vélo qui se redresse et finit par constituer une colonne centrale dans la scène du duo d'amour. Tristan et Isolde essaient de se réfugier sous une toile de tente, accrochant par en dessous des lumignons en forme d'étoiles en guise de voûte céleste. Belle réussite en revanche : la vibration lumineuse du reflet des amants sur le fond du décor, tandis que la scénographie prend le risque de leur faire chanter le duo dos au public.
L'acte III débutera dans une atmosphère de brouillard glacé avec, à cour, le cercle des derniers fidèles de Tristan veillant sur leur maître étendu au sol. On pense aux contrejours de Georges de la Tour et la manière des peintres flamands dans l'art de saisir l'air marin qui crée une forme de gaze autour des personnages. Les apparitions hallucinées d'Isolde dans une série de prismes qui s'éclairent et disparaissent, nous aurons paru cette année plutôt comme une franche réussite dont l'effet disparaîtra avec l'irruption de Marke et sa troupe dans une scène entre western et théâtre de boulevard. Avec le geste de Marke interrompant la Liebestod pour emporter Isolde telle un trophée de chasse, c'est une forme de retour à la réalité qui frustre le spectateur bercé par la vibration de l'espace et le dépouillement du décor.

Excessivement exposée les années précédentes, la voix de Petra Lang semble de toute évidence avoir trouvé cette année un équilibre meilleur. Certes, les tensions sont toujours présentes et peinent à faire oublier que ce rôle est gagné de haute lutte, avec des moyens pas toujours superlatifs. La bonne impression de cette dernière année permet d'apprécier le talent d'une actrice qui fait face à l'endurance insolente de Stephen Gould. Monolithique sans toutefois peser sur les notes, cette montagne chantante trouve dans l'énergie incroyable de sa voix, une manière de fascination et de séduction, même dans les moments les plus exposés comme au dernier acte.

Le Roi Marke est confié à René Pape, contraint pour l'occasion à quelques allers-retours entre Bayreuth et Munich où il assure les dernières représentations de Parsifal dans le rôle de Gurnemanz. Plus prosaïque que Georg Zeppenfeld qui chantait le rôle la première année, et qui alterne avec René Pape cette année, il s'inscrit sans doute beaucoup mieux dans le profil du personnage que lui dessine Katharina Wagner. La puissance de l'émission se double d'une véracité dans le rendu des accents et du jeu. La Brangäne de Christa Mayer se situe au même niveau d'excellence, avec un timbre très large et sonore, tandis que le Kurwenal de Iain Paterson reste un peu court de souffle dans un rôle qui ne brille qu'à de brefs moments. Ni le Melot trop vibré de Raimund Nolte, ni surtout le pilote et Berger aléatoires de Tansel Akzeybek ne marqueront véritablement, tandis que les hauts décors dissimulent en partie la projection des beaux chœurs du Festival.
Impeccable d'impact et de finition, l'orchestre de Christian Thielemann trouve enfin dans ce Tristan une adéquation et une respiration qui manquait de toute évidence les années précédentes, faute de céder au désir envahissant du beau et du lissé. Le vaisseau glisse sur des eaux sombres, avec un drame qui guette à tous les instants et qui, pour une fois, nous touche.
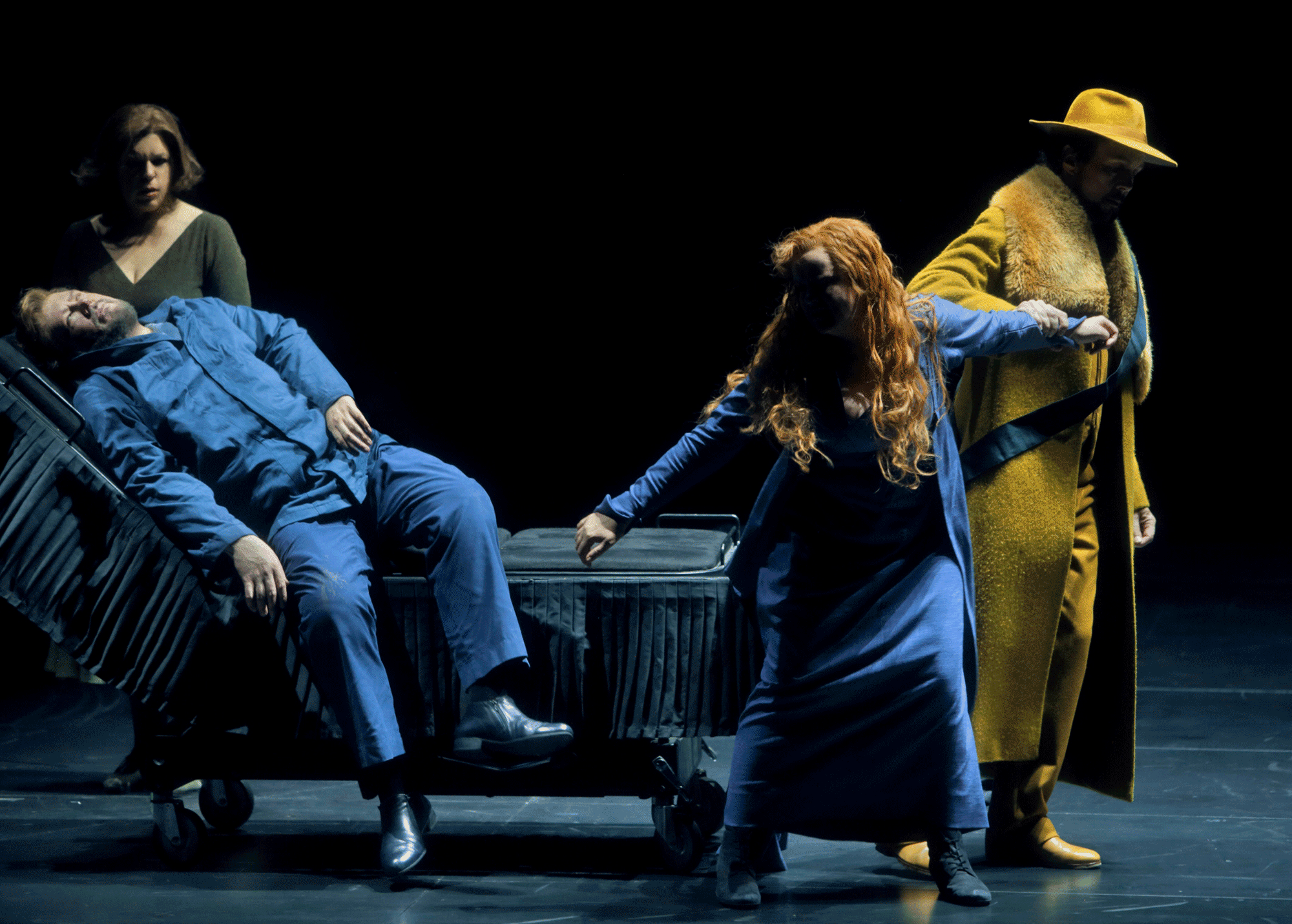

Cher Wanderer, chers Wanderern …. Qui est le Wanderer initial ? Guy Cherqui certainement. Ici David Verdier est-il le Wotan de Rheingold ou celui de Walküre : Mime se gratte la tête, il ne sait pas ! Mais au fond cela a‑t‑il de l’importance. Tristan ! Cette mise en scène je la connaissais par le DVD, mais cela a peu à voir avec la réalité de la représentation. Ici il s’agit de la dernière du 28 aout : Andreas Schager remplaçait Stephen Gould.
Disons-le tout net pour moi Tristan restera à jamais celui de Garnier le 25/02/1966 dans la mise en scène de Wieland Wagner (qui ce jour-là est venu saluer au rideau), Windgassen, Nilsson, Waechter, Hotter, Ludwig dirigés par G Sébastian. Quelle sublime vision du 1er acte, que l’on retrouve dans une magnifique photo couleur dans le livre de Haberfeld – Bauer sur Wieland Wagner paru récemment. Mais c’était surtout la mise en scène proprement dite, qui n’existe malheureusement que dans le souvenir, qui est importante (les excès de Claude Lust et la pédanterie d’Antoine Goléa n’en rendent pas compte, tout au moins en français). J’ai pleuré aussi lors de la série à Bastille en 2008, mise en scène de P Sellars / Bill Viola avec W Maier et Forbis (direction de S Bychkow, superbe), je passerais sur Garnier 1985, Lyon 2011 (Fura del Baus… mais Petrenko !) et curieusement sur Lyon 2017, malgré Heiner Müller (Je suis allé le voir deux fois car la première fois trop près et j’ai récidivé en me mettant dans l’axe au premier balcon : la magie ne passait pas !).
Revenons à Katarina W : disons que globalement je déteste mais je suis fasciné. Donc c’est une répulsion-amour ! Je me suis gardé de relire mes Wanderern (j’ai des incertitudes sur le pluriel) préférés et j’ai commenté le soir même : je vous retrouve sur certains points mais je suis arrivé à une conclusion personnelle différente. En fait je partage globalement l’avis d’une grande cohérence de la mise en scène.
Acte1 : bien sûr Tristan (T) et Isolde (I) s’aiment dès la première note ; il n’y avait peut-être que les spectateurs parisiens du XIXème siècle qui avaient la nécessité morale d’un philtre d’amour. Bon ; ici ils veulent s’embrasser, se toucher et Brangaene (B) et Kurwenal (K) essaient de les en empêcher…. d’où ce dispositif gigantesque, laid (c’est peut être sa seule qualité), bruyant, sinistre. Mais qui est le machiniste qui sécurise les passages ? Mark (M) sans doute ou un sbire… (mais il n’est pas en jaune serin) en tout cas il voit tout, même si on ne le voit pas distinctement. En tout cas, même si on ne le voit pas, M met à la fin de l’acte tout le monde au gnouf, ce qui est cohérent avec le début de l’acte 2. Mais qu’en est-il du philtre ? Alors là je dis, contre toute bienséance, que c’est ridicule ! En effet ce philtre ne peut être dans ce concept qu’un philtre de mort : T & I veulent se suicider. Et ils vont se livrer pendant cet extraordinaire moment de musique au jeu : « passe-moi le sel / passe-moi le poivre » ou « fais donc / je n’en ferais rien » : bref ils se repassent le flacon puis le vident par terre. Pourquoi ? Changement de programme ? Finalement pas la peine de se suicider ? Non, franchement ne préférez-vous pas le bon vieux concept Wielandien : ils veulent mourir, seule réalisation possible de leur amour, ils boivent un placebo, et s’attendant à mourir, ils font sauter les verrous des conventions… et vogue la galère ! Cela a une autre gueule !
Acte 2 – La petite troupe (T, I, B, K) est en prison, un vrai cul-de-basse fosse : c’est le fameux garage à vélos (pourquoi pas ?). Mais tout en haut M et ses sbires observent et surtout manient efficacement un projecteur pour que T & I soient toujours visibles. Je fais deux hypothèses :
1- c’est un couloir de la mort dans une prison de haute sécurité (à l’américaine). En faveur, le fait que T & I se construisent une « petite maison dans la prairie » pour pouvoir exprimer leur amour. Et aussi en faveur mon interprétation de la fin de l’acte. Mais on ne comprend pas le comportement de K qui fait les pieds au mur et convulse (vite, un antiépileptique !) et celui de B qui parait vouloir grimper aux murs (certes l'endroit n'est pas accueillant).
2- Il s’agit d’une salle d’expérimentation et de torture ou on se livre en quelque sorte à des expériences du type de celle de Milgram (soumission à l’autorité comme dans le film d’Henri Verneuil (i comme Icare). La torture c’est la lumière… Neunfels aurait pu prêter quelques rats de Lohengrin à Katarina. ! (nous convergeons). La torture conduit à la tentative de suicide, qui est immédiatement déjouée par M et ses sbires.
3- mais finalement je pense que les deux sont liés : c’est un couloir de la mort et un lieu de torture ; M n’est pas un caïd plus ou moins hésitant à faire exécuter T comme je l’avais d’abord pensé : c’est un despote qui veut tuer le rival et récupérer sa femme. Il hésite peut être à exécuter lui-même T, par une sorte de compassion ? je ne crois pas ; par calcul pour ne pas avoir du sang sur les mains lorsqu’il récupérera I ? peut-être ? En tout cas il fait exécuter T par Mélot, sciemment dans le cachot et Mélot TUE Tristan dès ce moment. Comment expliquer autrement qu’à l’acte 3 ils soient tous dans le même cachot ?
Acte 3. Je tente une explication différente qui me parait cohérente. Comment expliquer ce décor (au demeurant fort beau, cette lumière diaphane), enfin cette poésie, si T est blessé et finalement attend, délire, et appelle Isolde comme cela est sublimé dans une mise en scène comme celle de Wieland. D’autant que lorsqu’il meurt, le film de tulle, le halo poétique disparait pour faire apparaitre la réalité du cachot et la bande à M et les fidèles de T pour finalement voir l’arrivée d’I. Non, je crois que T est mort. Faisons appel à une autre vision, de type anthropologique : celle de l’animisme. T est mort mais la cérémonie funéraire n’a pas eu lieu. Donc son être spirituel n’a pu atteindre le lieu, ou l’état du repos : par exemple le statut d’ancêtre, ou même celui de guerrier au Walhalla… Toujours est-il que c’est ce T mort mais dans une situation intermédiaire qui appelle désespérément Isolde, c’est elle qui doit accomplir le rite funéraire et qui fait tout pour rejoindre T. Elle y arrive dans cette prison ou T a été exécuté car condamné à mort par M ; elle accomplit le rite funéraire sur le brancard en l’asseyant, en le faisant « revivre ». Finalement tous sont morts, Isolde a accompli le rite mortuaire, M, sorte de tyran sanguinaire, reprend son bien, sa femme… et la musique s’achève sublime dans la complétude de la mort de Tristan. L’ordre règne-t-il ? Pas sur puisque c’est un ordre de mort : la vie, « Tristan UND Isolde » n’existe plus sur terre. Peut-être dans les limbes ? Je ne crois pas…. c’est terminé.
Parlons des chanteurs (laissons de côté B, K et M qui sont magnifiques, surtout B, Mayer). Franchement Schager, quel braillard : tout en puissance. Au III c’est impressionnant : il se penche en arrière puis avec un balancement avant il projette les décibels ; aucun orchestre ne peut résister à cela. De plus il n’a aucune caractéristique vocale, un « fruité » qui le rende immédiatement reconnaissable. Quand à Petra Lang, de la puissance, des inexactitudes, pratiquement pas de poésie, de tendresse. Franchement Gould et Herlizius en 2015 (DVD) c’est autre chose. Nous avions ici les champions olympiques du lancer de décibels… L’orchestre : le prélude du I est curieux ; début diaphane, subtil mais finalement c’est un peu rustique, ensuite le crescendo magnifique de rigueur. Puis je dois dire que c’est le trou, un tunnel d’ennui dans ce premier acte, aucune émotion, surtout pas dans le moment crucial ou chez quelques metteurs en scène attardés T & I boivent le placebo, pas de tension, rien ; du prosaïque de chez prosaïque. Au II les chanteurs font oublier l’orchestre qui m’apparait bien classique. Le prélude du III est sublime, le cor anglais, les raclements de gorge… pardon, la poésie puis l’emportement pour lutter contre Schager et se faire entendre. L’orchestre, à partir du Liebestodt lied est magnifique.
Bon un Tristan que je n’aime pas…. mais je me suis inscrit l’année prochaine pour le revoir et le réentendre ! Répulsion / Amour. Quand tu nous tiens !