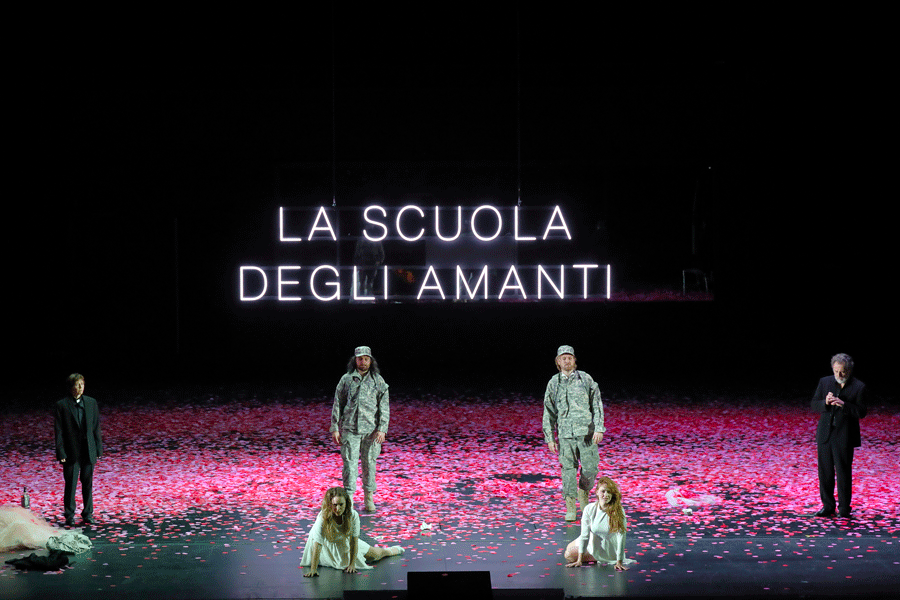
Évolution de la réception de l’œuvre
À l’instar de quelques autres œuvres théâtrales ou lyriques, Cosi fan tutte est un exemple typique d’évolution radicale de la lecture et de la réception d’une pièce, et ce en quelques décennies. Elle fait partie de ces comédies ressenties comme légères et sans grand intérêt et traitées comme telles pendant plus d’une siècle. Mais depuis une quarantaine d’années, l’œuvre apparaît comme une comédie amère voire un drame, une sorte de « comédie des erreurs » délétère.. Ce destin rappelle un peu celui du Misanthrope de Molière où le personnage principal, Alceste, passe de ridicule, de figure de farce moliéresque à celui de héros tragique et ombrageux.
Cosi fan tutte, c’est une autre folle journée, sortie cette fois toute fraiche de l’esprit de Lorenzo da Ponte, et non plus inspirée par d’autres œuvres (comme Nozze et Don Giovanni). Longtemps lue comme une pochade, au point d’être très rarement jouée tout au long du XIXe, avec ces deux héros qui partent à la guerre et reviennent aussitôt déguisés, et entreprennent de séduire l’amie de l’autre, sot us la direction d’un vieux libertin revenu de tout et d’une soubrette facétieuse. Ils y réussissent, facilement pour l’une, moins pour l’autre (mais le résultat est le même). Au final tout rentre dans l’ordre et l’on revient au statu quo ante. Dans le monde de la farce ou de la comédie légère, on peut à la limite accepter ce dénouement attendu par le genre, sans autre forme de procès. Mais si l’on s’interroge même superficiellement sur la situation réelle : peut-on envisager sérieusement que les couples se reforment « comme avant » alors qu’on vient de les voir exploser en vol, et sans trop d’hésitation sinon quelque scrupule de dernière minute.
Évidemment pas ! À tout le moins les jeunes gens auront appris à se méfier…
Ils auront appris. D’où le sous-titre La Scuola degli amanti, l’école des amants. Peut-être dans l’esprit de l’époque de la création s’agissait-il d’apprendre à se méfier des femmes et de leurs serments d’amour, c’est bien le sens de la discussion initiale d’Alfonso et des deux jeunes amoureux.
Aujourd’hui le regard social sur la situation a relativement changé, la question n’est pas celle des femmes et de leur légèreté, mais de la fragilité du couple et des sentiments, notamment à l’âge où l’on découvre le désir et du moins le croit-on, l’amour. Une thématique très actuelle, qui rend sans doute Così fan tutte, des trois opéras de Da Ponte, le plus à même de parler à un public d’aujourd’hui.
Mais le XVIIIe lui-même ne fut pas avare de textes sur la séduction, depuis Les égarements du cœur et de l’esprit (1736) de Crébillon fils aux Liaisons dangereuses de Laclos, autrement sulfureux (1782). Et au moment où est représenté Così fan tutte, Sade a déjà écrit Justine ou les infortunes de la vertu et Casanova entame la rédaction de ses mémoires.
Signe un peu particulier, alors que les deux autres livrets de Da Ponte donnent des hommes une image plutôt contrastée (Il Conte des Nozze di Figaro, et Don Giovanni), ce sont ici les femmes qui semblent être les infidèles, consommatrices d’hommes, comme le titre le suggère « Comme elles font toutes », toutes les mêmes, pourrait-on dire de manière moins littérale, mais tellement plus conforme au sens.
La réalité du livret même n’est pas si univoque. Les hommes se laissent séduire par ces femmes offertes, et ces amants fidèles ne s’arrêtent pas au moment où tout va basculer. Dans Così fan tutte, tout le monde va jusqu’au bout. À l’école des amants, c’est travaux pratiques à tous les étages.
La mise en scène de Hans Neuenfels à Salzbourg en 2000 était à ce titre très claire : les couples vus comme de gentils insectes anonymes (mêmes costumes blancs) se mélangeaient, et pas plus les hommes que les femmes n’échappaient au microscope de l’entomologiste Alfonso. Le titre serait plutôt Così fan tutti, avec un pluriel collectif au double genre (un tutti qui viserait elles et eux).
Et ce qui fait basculer tout le monde, ce n’est pas l’amour, mais essentiellement le désir. C’est là la thématique de la mise en scène de Bénédict Andrews, la loi du désir.
Les éléments de la mise en scène
Ce travail en effet tranche avec bien des lectures plus sombres qui ont essaimé ces dernières années et Benedict Andrews choisit de suivre scrupuleusement le livret, de se conformer aux lois de la comédie, si bien que le public répond par des rires fréquents, tout au long de la représentation.
Andrews choisit nettement de focaliser sur les personnages discrètement placés dans diverses situations, sans forcer sur certains aspects du livret (allusions à Messmer lors de la fausse guérison des amants par une Despina-médecin etc..), sans marquer l’espace non plus par des lieux bien définis, une vaste pièce, un garage, une sous-pente, et peu à peu les cloisons s’effacent pour un champ de fleurs, un château gonflable comme sorti d’un dessin animé de Walt Disney, ou la scène nue qui va recevoir une pluie de fleurs. On va d’un concret relatif à une abstraction volontaire, où les éléments symboliques prennent de plus en plus de place.
- D’abord cet affichage lumineux « La Scuola degli amanti » qui apparaît au début de l’œuvre et qui réapparaît dans les derniers moments pour disparaître à la conclusion. Il s’agit de montrer une didactique de la relation au désir, qui envahit tout, et qui conduit à constater que sexe et amour sont deux choses diverses, comme le dit Slavoj Žižek « L’amour est vécu comme un grand malheur, un parasite monstrueux, un état d’urgence permanent qui ruine tous les petits plaisirs ». Il s’agit donc ici de démonter tout ce qui pourrait référer à l’amour romantique, et exclusif ; L’école des amants, ou comment se débarrasser de l’amour. Quand tout le monde a compris la leçon, l’affichage lumineux disparaît…
- Deuxième objet symbolique, le matelas, un matelas tout simple qui ouvre l’œuvre et que Despina va brûler sous le regard résigné de tous lors de la scène finale.
Le matelas est le lieu de la joute amoureuse, et dans cette mise en scène, tous en usent, à commencer par Don Alfonso, dès le lever de rideau. Le matelas brûle à la fin, non pour affirmer qu’il ne faut pas désirer, ni pratiquer le sexe, mais pour montrer qu’on « efface le tableau » quand la démonstration est faite, une sorte de CQFD. Ce n’est pas une désillusion, c’est l’école du réel qui va s’ouvrir.
Ce matelas nous en dit plus sur la fonction du décor et des objets. Il ne s’agit pas de reproduire le réel, car le décor de Magda Willi est exclusivement fonctionnel et non illustratif, les espaces sont presque nus, ne comprenant que ce qui sert le propos. Ce sont des cadres, de boites qui changent selon les scènes, qui disparaissent aussi notamment à partir du deuxième acte. Rien dans ce décor n’est une « imitation » de la réalité, c’est un décor singulièrement brechtien. - Une exception, le garage, plus précis qui abrite une voiture qui est le centre d’une des scènes les plus drôles de la mise en scène et qui met la salle en joie, un SUV BMW (à Munich c’est bien le moins), qui est le lieu de tous les excès lacrimaux des deux jeunes filles. Pour montrer à la fois que cet amour démonstratif est caricatural, tout comme l’air smanie implacabili de Dorabella, Fiordiligi, toujours plus dramatique, prend un tuyau qu’elle met sur le pot d’échappement et s’enferme dans l’habitacle, tandis que Dorabella la rejoint en entrant par la fenêtre. Pur comique de gestes, dans des postures qui ravissent le public ; bien sûr, Benedict Andrews souligne le côté trop démonstratif du chagrin des deux jeunes femmes, mais si une seule seconde leur acte était pris au sérieux, on en reviendrait à la théorie de Žižek sur l’amour destructeur et monstrueux… Dans ce garage se retrouvent tous les symboles qui vont structurer la mise en scène si bien qu’on peut parler de moment scénique fondateur.

La scène désopilante de la voiture a néanmoins une fonction accessoire, elle illustre l’exagération (déjà notée par Alfonso) et sert à mettre le public en de bonnes dispositions, une sorte de captatio benevolentiae. Sans plus d’effet dramaturgique.
Plus intéressant pour la suite est le reste de la scène avec l’arrivée des deux « albanais » très aisément reconnaissables comme il se doit. Dans un coin on retrouve le matelas dont nous avons évoqué la fonction, et lorsque Ferrando entame Un’aura amorosa, il termine la construction d’un château fort aux dimensions d’un gros jouet en y posant la dernière tourelle à la forme phallique., tandis que quelques fleurs tombent comme dans les déclarations amoureuses des grands romantiques… et comme ce sera le cas au moment du « faux mariage » ; comme on le voit, toute la scène annonce en quelque sorte ce qui va suivre.
- Ce château, (de dimensions plus réduites et bien plus discrètement) était déjà présent dans la scène initiale, il réapparaît cette fois de manière plus démonstrative jusqu’à devenir plus tard totalement envahissant comme la montée des périls ou des désirs…Issu d’une imagerie enfantine, minuscule dans la première scène, le château-fort devient plus important dans le garage, là où les jeunes femmes comme on l’a vu veulent en finir avec la vie, mais là où apparaissent aussi les deux jeunes déguisés et où commence le jeu de la séduction : à quelques gestes ou quelques regards, Benedict Andrews montre qu’au-delà des mots et des déclarations grandiloquentes, quelque chose remue déjà dans les corps. Au deuxième acte, ce château devient énorme structure gonflable et les tourelles qui gonflent n’ont plus rien d’une allusion à la Disney, mais bien plutôt d’une vision paillarde et phallique, qui « débandent » en quelque sorte quand le château se dégonfle .
Cette symbolique d’abord enfantine, puis nettement sexuelle, montre l’évolution d’un jeu « innocent » vers quelque chose qui l’est bien moins, mais l’idée même de ce château, cette petite forteresse avec ses murs « imprenables » rappelle un peu le come scoglio de Fiordiligi, qui comme toutes les forteresses imprenables, finissent par céder sous les coups de boutoir des assaillants, comme il se doit dans la guerre amoureuse, si prisée par les Précieux au XVIIe..
La métaphore guerrière remplit la rhétorique amoureuse des âges baroques. Et l’idée même d’une forteresse qu’on ne prend pas au sérieux, dit en elle-même toute l’histoire et ce qu’il faut en penser.
Les décors deviennent alors essentiellement indicatifs d’un parcours non du Tendre, grande référence Précieuse des étapes du parcours amoureux, mais de celui du désir, en étapes de montées des sèves.
Jardin des délices : Avery Amereau (Dorabella, Konstantin Krimmel (Guglielmo) - Quelques scènes ironiques et faussement poétiques comme le jardin tapissé de fleurs, sorte de « jardin des délices » où les néo-couples se perdent comme dans les contes ou les récits d’amour, masquent bien autre chose. Tout cela montre que la mise en scène se veut non récit, mais raisonnement et démonstration, comme sortie du cerveau d’Alfonso, qui observe tout comme un voyeur.
Car l’originalité de ce travail ne réside pas forcément de la vision des deux couples, plutôt habituelle, même si les jeunes femmes sont habillées comme des jeunes filles à peine sorties de l’adolescence, un âge qui ne se définissait pas à l’époque de la création (on passait directement de l’enfance à l’âge adulte, aux alentours de 13/14 ans…).
La démonstration de Benedict Andrews s’inscrit dans le contemporain, mais un contemporain intemporel, comme l’est la question du désir et du sexe .

Sous cet angle, évidemment, l’histoire gagne en vérité humaine car elle se concentre sur les personnages, les caractères, les comportements, sans prendre de position morale, se limitant à une constatation assez distante et assez froide. Du théâtre didactique à la Brecht.
Benedict Andrews est bien plus intéressé par le couple Alfonso/Despina, qui fonctionne à merveille, avec une visible complicité, deux libertins qui veulent que les yeux soient dessillés.
Alfonso est traité de manière plus approfondie que dans la plupart des mises en scènes récentes.
La nouveauté, c’est l’enjeu personnel que semble mettre Alfonso dans la farce, sa manière d’être tout le temps présent en voyeur, ses énervements, son agressivité quelquefois. Andrews profite de l’intelligence et de la disponibilité de Gerhaher à jouer un autre Alfonso, plus incisif, moins rond, pour ce premier Alfonso de sa carrière.
Et tout est dit ou presque dès les premières images, qui montrent Alfonso et une soubrette sur le fameux matelas, lui muni d’un masque de cuir vaguement SM ou diabolique, avec un godemiché qui traîne et semble indiquer quelques difficultés érectiles. Alfonso aurait-il besoin pour s’exciter de se faire des scénarios ? Serait-il impuissant ? En tous cas, la rencontre érotique ne semble pas s’être déroulée de manière satisfaisante, ce qui semble motiver l’agressivité d’Alfonso se rhabillant quand les deux jeunes gens entre en vantant leurs belles.
Ainsi ce travail vécu comme une démonstration assez épuré est suffisamment habile pour que le public s’y retrouve, pour que la comédie retrouve ses droits, mais en orientant l’histoire vers des questions où l’amour a peu à voir, mais le jeu des désirs et des corps (Ferrando apparaît très déshabillé pour emporter la Fiordiligi convoitée : il faut employer les grands moyens pour prendre les forteresses imprenables…).
D’où cette image finale où tous contemplent le matelas brûler. La démonstration est faite que l’école des amants n’est pas l’école des « aimants ». Il reste à déterminer ce qui s’en suivra et la mise en scène laisse les choses en suspens, comme si le passage par cette école-là avait nourri les doutes et les incertitudes, sans rien créer que des fleurs qui gisent à terre après la fête.
La scène finale de Cosi fan tutte et l’ensemble où normalement se reconstituent les couples me rappelle à chaque fois une belle idée de Jean-Pierre Ponnelle dans sa mise en scène pourtant moins réussie que d’autres à Garnier en …1974. En se croisant pour aller rejoindre leurs « légitimes », Fiordiligi et Ferrando échangeaient un regard qui en disait long sur « la confusion des sentiments » et les ravages que cette histoire avait produits. En dix secondes, ce geste disait une des vérités de l’œuvre. Andrews nous laisse conclure… et c’est tout aussi bien, même si l’ensemble de ce travail très solide n’atteint pas le degré de conviction qui nous avait emportés dans L’Ange de Feu vu à la Komische Oper de Berlin et à Lyon.
Voix et fosse
La distribution dans son ensemble est particulièrement homogène. Non pas au sens où tous se vaudraient honorablement, sans plus. Mais au sens d’un véritable ensemble, dont les voix fusionnent parfaitement, se répondent toutes avec une parfaite musicalité, un sens des rythmes et de la respiration, et une certaine chaleur. Certes, dans l’ensemble de six chanteurs qui est celui de l’œuvre, il faut toujours compter 4+2, les deux couples et Don Alfonso/Despina, les montreurs de marionnettes, autre type de couple, non fusionnel mais complémentaire.

Ainsi notera-t-on d’abord l’extraordinaire conjugaison des deux voix féminines, Louise Alder en Fiordiligi et Avery Amereau en Dorabella qui nous gratifient de duos merveilleux, notamment pendant le premier acte et en particulier dans les premières scènes. Leurs timbres assez voisins facilitent cette impression.
Avery Amereau est une Dorabella très correcte sans être exceptionnelle, elle est très engagée dans le jeu, particulièrement naturelle. La voix est bien assise sans jamais aller au-delà d’une prestation très honorable. Son Smanie implacabili manque peut-être un peu de cette exagération caricaturale qui doit affleurer car l’air est un pastiche des opere serie de récente tradition et des grandes déclarations tragiques, mais la mise en scène qui fait grimper le personnage sur la voiture et lui fait faire quelques gestes grandiloquents supplée, sans que ce côté grandiloquent se retrouve toujours dans le chant. Elle est une bonne Dorabella, compte tenu aussi qu’il n’est pas si facile de trouver de très grandes Dorabella aujourd’hui. Le rôle n’est pas si facile à interpréter, qui doit tenir une ligne de contraste avec la « fidèle et sérieuse » Fiordiligi, sans être la tête un peu folle qu’on voit quelquefois. N’est pas Ann Murray qui veut, ni même Magdalena Kožená qui fut en son temps aussi une très notable Dorabella.
La Fiordiligi de Louise Alder est immédiatement plus séduisante, la voix est fraîche, avec une belle assise technique, une homogénéité sur tout le spectre, des aigus sûrs et larges même s’ils ne sont pas exceptionnels. Sa force, c’est de dessiner immédiatement un univers, un caractère, une poésie, d’avoir une vraie puissance évocatoire, mais le personnage peut-être nécessite encore de l’approfondissement notamment au deuxième acte. Certes, c’est une très jeune fille, mais sa prise de conscience de la fragilité des choses est déterminante et on doit sentir cette bascule au deuxième acte de la jeunesse à l’âge adulte dans le Per pietà. Une Bartoli savait le montrer de manière innée, ainsi qu’une Margaret Price, l’une des immenses Fiordiligi des cinquante dernières années ou même Julia Varady, l’une des grandes stars historiques de Munich. Même Elsa Dreisig avait su récemment à Salzbourg nous émouvoir avec son timbre particulier et la manière dont la couleur vocale évoluait d’un acte à l’autre. Louise Alder reste néanmoins sans doute la seule des quatre à faire ressentir un personnage qui prend une décision en toute connaissance de cause, à assumer son choix sans légèreté. Louise Alder est aujourd’hui sans doute l’une des voix les plus intéressantes pour Mozart, elle a « tout d’une grande » comme on dit.

Konstantin Krimmel est un très beau Guglielmo, le timbre est magnifique, chaleureux, et dégage une véritable épaisseur. La voix est sûre, bien posée, bien projetée. C’est une chance pour Munich de l’avoir en troupe parce qu’il est un chanteur autour duquel peut se construire une « équipe » un « ensemble » Mozart qui propulserait Munich aux avant-postes pour redevenir un des grands lieux pour faire renaître une vraie tradition mozartienne. Krimmel se révèle une des voix les plus intéressantes pour l’interprétation actuelle de Mozart.
Sebastian Kohlhepp, qui sort du Covid avait récupéré grande part de ses moyens, mais pas encore suffisamment pour convaincre totalement. C’est un Ferrando plus vivant que poétique. Il lui manque un peu cette couleur évocatoire qu’on aime chez certains ténors mozartiens. Il est très engagé, très présent, avec un chant sûr et une voix bien projetée, mais il manque un peu d‘âme, c’est notable dans le célèbre Un’aura amorosa très bien exécuté, mais sans trop de vibrations intérieures.
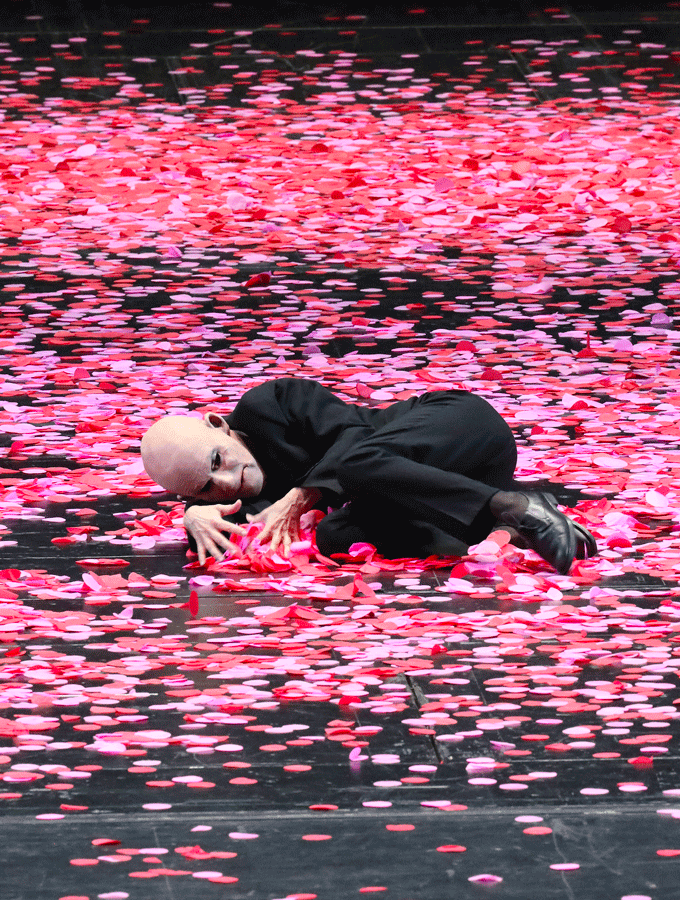
On ne sera pas étonné que Sandrine Piau soit une excellente Despina, elle qui est une mozartienne accomplie. Elle est complètement entrée dans ce personnage roué, qu’elle joue avec une distance très ironique qui se conjugue parfaitement avec le Don Alfonso un peu diabolique de Christian Gerhaher. Le chant est comme toujours précis, contrôlé, intelligent, coloré, même si la voix apparaît un peu petite dans le vaste vaisseau munichois, mais elle remporte un très gros succès mérité parce qu’on n’a pas vu depuis longtemps une Despina aussi juste scéniquement et aussi accomplie vocalement.

Don Alfonso est un rôle très particulier dans l’économie mozartienne, peu ou pas d’airs, mais une sorte de conversation, presque de Sprechgesang continu, qui exige une attention au mot de tous les instants. Gerhaher, pour qui c’était une prise de rôle, use de sa science de la parole, de son goût des textes, de son incroyable diction et de sa clarté légendaire pour faire évidemment merveille dans le rôle auquel il donne des intonations très variées, ironique évidemment souvent, mais quelquefois violent, plus violent qu’à l’accoutumée, en colère même lorsqu’il laisse entrevoir qu’il a perdu un peu de sa sûreté et qu’il ne sait pas si son stratagème réussira au final ou qu’il se retrouve face à ses propres problèmes. Toutes ces variations de couleur, d’une redoutable précision, sont évidemment exceptionnelles et font de cet Alfonso une caractérisation presque unique. On a rarement entendu Alfonso plus affuté, plus persifleur, plus dur aussi, presque cruel et assez dépourvu d’humanité, comme s’il réglait des comptes avec lui-même à travers les autres dans cette affaire. Il forme avec Sandrine Piau une paire qui fonctionne à merveille, avec la distance, la méchanceté effleurée, l’agressivité et l’absence d’empathie assumée. L’autre Alfonso du moment, Johannes Martin Kränzle, a des qualités voisines (diction, couleur, intelligence) mais il a toujours une certaine humanité que Gerhaher ici n’a pas. C’est une voix en quelque sorte glaciale que celle de cet Alfonso. Et c’est assez étonnant en même temps. Il faudrait voir une autre mise en scène pour comprendre comment Gerhaher construit et ressent Alfonso. Mais quel artiste !
En fosse, artisan et architecte de l’ensemble, Vladimir Jurowski propose une interprétation précise, quelquefois virevoltante, de l’ensemble de l’opéra pour une fois sans aucune coupure. Les chanteurs sont très bien soutenus, le rythme de la direction colle parfaitement à la mise en scène. Cela sonne quelquefois comme un Mozart très traditionnel des années d’avant les relectures des baroqueux, mais à d’autres moments avec des choix décisifs pour le son (utilisation de cors naturels) mais cela ne gêne aucunement tant le travail est ciselé et précis, avec une énergie inépuisable. Jurowski, avec des années passées à Glyndebourne n’est évidemment pas étranger à Mozart, bien au contraire, depuis Sawaliisch, il est dans cette maison le premier GMD à être un mozartien affirmé ce qui est de bon augure, mais son univers reste assez froid, assez distant. Il correspond sans doute en cela à une mise en scène qui laisse un peu de côté les mignardises amoureuses auxquelles elle préfère les montées de sève. Sa direction impose un Mozart aiguisé, affûté, manquant un peu d’humanité, manquant un peu de cette rondeur qu’on aime quelquefois entendre (mon premier Così, dirigé par Josef Krips, a laissé quelque traces, même cinquante ans après…) . Le travail de Jurowski est néanmoins remarquable, en cohérence avec le plateau, en cohérence avec ce que raconte la mise en scène, mais ce n’est pas une direction qui nous bouleverse. Il reste qu’elle contribue très largement à faire de ce Cosi fan tutte une production d’une telle solidité que l’on s’attend à la voir de alimenter pendant de nombreuses années le répertoire munichois.

