
La Dame de Pique, de Pouchkine à Tchaïkovski…et Neuenfels
La Dame de pique provient d’une nouvelle de Pouchkine que le frère de Tchaïkovski, Modest a adaptée pour la scène en transformant sensiblement l’ambiance. La nouvelle de Pouchkine est assez distanciée et décrit un cas clinique, celui d’Hermann obsédé par le jeu, avec une dose notable d’ironie : d’ailleurs, à part la Comtesse, aucun des héros n’y meurt : Lisabeta épouse un autre jeune homme bien sous tous rapports (financiers) et Hermann devient fou en répétant à l’envi les trois cartes fatales.
Il y a moins de fantastique dans la nouvelle que dans l’opéra : c’est Hermann par inattention qui lance l’as final, sans doute étourdi par ses deux précédents gains, et pris par l’hybris de la victoire. Une tranche de vie en quelque sorte.
L’opéra au contraire est un drame d’une rare noirceur où Hermann par démon du jeu laisse une Lisa héroïne tragique à son destin, et elle se jette dans la Neva, Hermann de son côté se suicide aussi, anéanti par son échec.
Neuenfels a concentré son travail autour de la relation de trois personnages, Lisa, Hermann la comtesse, tout le reste restant anecdotique, voire noyé dans les limbes du fantasme.
Dans ce monde-là, la société est distanciée, décrite et habillée (costumes de Reinhard von der Thannen) comme un monde lointain de fantômes : le chœur semble fait de personnages brechtiens, comme sortis de l’opéra de quat’ sous.
Il s’agit d’abord d’isoler Hermann, dans ce monde noir il est tout en rouge (rouge-passion évidemment), singularisé par le costume même, qu’il porte ouvert et débraillé, laissant apparaître son torse, élément perturbateur soulignant sa marginalité, mais aussi aux yeux de Lisa son pouvoir érotique. Il s’agit aussi d’isoler Lisa de sa propre société, elle qui est soumise à la comtesse, elle qui est issue de ce monde qui bride dès l’enfance et qui prépare les enfants à être soldats (le choeur d’enfants initial , calqué sur « la garde montante » de Carmen arrive dans des cages et à peine libéré, est tenu en laisse par les « nounous » aux seins débordants, presque animalisées),

d’où aussi tout le chœur en costume de bain début du siècle (le XXème) d’une société de plaisirs dont Hermann est exclu et dont Lisa s’exclut. Elle est courtisée par le Prince Yeletzki, richissime et noble, réellement épris, qui lui offre un avenir stable, mais pendant l’air de Yeletzki Я Вас люблю (Ia vas lioubliou, je vous aime), elle projette son avenir en imaginant la table familiale avec plusieurs enfants dont un bébé, et c’est justement ce qu’elle veut fuir : âme romantique éprise d’absolu et de liberté, étouffant dans son quotidien (et dans son habit de jeune fille sage), elle voit en Hermann un avenir de passion romanesque qui lui convient.
Un travail sur le couple et en particulier un regard approfondi sur Lisa
D’où un travail très précis de Neuenfels sur le couple, sur ses mouvements très chorégraphiés quand les deux héros sont ensemble, dans ce vaste espace sombre conçu par Christian Schmidt, où ils semblent perdus, âmes éprises d’ailleurs dans une société aristocratique qui n’offre rien que l’oisiveté et donc le vide. Dans ce couple, Hermann, exclu par ses pauvres moyens de cette société d’argent aspire à la liberté que donne la richesse, et Lisa qui a l’argent aspire à la liberté que donne la passion (elle est bien plus fade et conformiste dans la nouvelle de Pouchkine): ce sont des attentes tragiquement divergentes sur lesquelles s’attarde Neuenfels et qui vont conduire au drame.
La comtesse est aussi traitée comme un personnage à part, tranchant par le costume de tous les autres, chœur, princes, bourgeois. Un costume fantaisie, plein de couleurs, jeune, comme si elle était installée dans une sorte de jeunesse éternelle, avec une coupe de cheveux roux de type charleston. Les cheveux roux singularisent et représentent dans la tradition l’étrangeté, l’inquiétude, la violence et le crime.

Et le monde parisien qu’elle évoque (celui d’un XVIIIe mythique, sans doute de la Régence, particulièrement riche en folies de la noblesse) come celui du jour n’est qu’un monde de squelettes, de fantômes disparus en décomposition (magnifique apparition d’une Catherine II réduite à son squelette). La comtesse est la survivante de ce monde-là, qui dans son intimité, devient une malade du cancer (elle a perdu ses cheveux sous sa perruque rousse) dans une chambre clinique d’un blanc éclatant qui tranche sur le noir ambiant et sur les habitudes qu’on a de cette scène toujours dans une pénombre annonciatrice de drames.
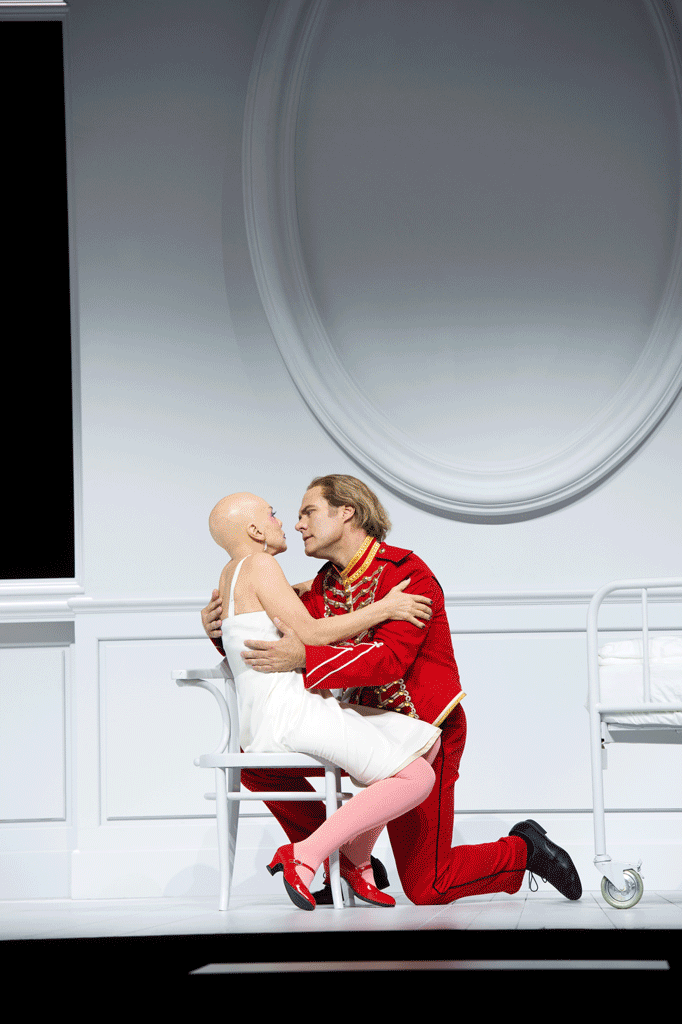
L’intrusion d’Hermann devient son dernier moment de séduction, et la scène est d’une rare tendresse, une des meilleures trouvailles de Neuenfels, qui tranche avec les vieilles dames fardées aux yeux révulsés qu’on rencontre la plupart du temps : Hanna Schwarz – une légende de 75 ans- joue parfaitement cette humanité/normalité de la comtesse, c’est justement la seule des « autres » qui ne soit pas un fantôme.
Jeu et tragédie
Autour d’eux gravitent tout un petit monde, les femmes inoffensives et anecdotiques, Polina, l’amie et confidente de Lisa, moins introvertie (Neuenfels la représente plutôt délurée y compris par le costume) la gouvernante, figure d’une règle étouffante et dépassée, et, plus inquiétants, les hommes, amis ou connaissances d’Hermann, soldats comme lui qui dans cette mise en scène sont plutôt des pousse-au-crime. Habillés de noir, avec de lourdes fourrures et de longs cheveux à la Raspoutine, ils semblent des figures d’une noblesse traditionnelle, riche et sans but sinon celui du divertissement au sens pascalien du terme. Tomsky lui-même est plus agressif que de coutume et laisse Hermann s’enferrer. C’est que pour eux, le jeu est une activité normale : l’argent n’est pas une affaire pour un aristocrate d’alors et dans la société de l’oisiveté et du divertissement, tout est léger, rien n’est tragique. Hermann au contraire est quant à lui hors-jeu au sens propre parce qu’il n’a pas l’argent pour jouer, mais il est aussi l’autre, l’étranger : il est allemand, ils sont russes et d’ailleurs son nom en russe est Герман « German », c’est à dire en jouant sur le mot « l’allemand » ((même si en russe, allemand se dit немецкий-nemetsktyi)), ce que Neuenfels souligne par les oppositions de costume, visibles qui singularisent le personnage dès son entrée en scène. En bref, tout oppose Hermann-le-tragique aux autres, des « amis » pas si amis qui raillent sa singularité : la fascination du jeu pour Hermann est d’abord d’origine sociale, par le jeu, il rentre dans le cercle, sans le jeu, il en est exclu. Neuenfels installe ainsi et l’opposition de classe, et un Hermann pour qui jouer a un enjeu suicidaire : il jouera une seule fois, à la vie et à la mort.
Tous ces rapports sont parfaitement inscrits dans la mise en scène, qui sans se livrer à une vision vraiment « fantastique », montre ce que les « amis » d’Hermann peuvent avoir de « diabolique » et de pervers pour l’âme agitée du héros.
D’un autre côté, Yeletzki est lui aussi hors-jeu, mais par choix : il se singularise par rapport aux autres et montre ainsi qu’il est d’une autre qualité, même s’il n’a à offrir à Lisa que cette « normalité » qu’elle déteste ; il ne jouera que contre Hermann, le rival qui lui a volé sa promise. Et il reste vivant à la fin, exclu du statut tragique.
La Dame de pique est un opéra qui peut être traité en opéra fantastique, mais il y a d’autres clefs possibles : Stefan Herheim à Amsterdam en a fait un rêve de Tchaïkovski, on peut aussi centrer le propos autour de Liza ou autour d’Hermann, de leur âme ou de leur amour, de leurs désirs ou de leurs fantasmes. La nouvelle fait clairement de Lisabeta une utilité, le moyen pour une fin : elle est la dame de compagnie de la comtesse et sert de marchepied pour arriver à la vieille. L’opéra est beaucoup plus ambigu et Neuenfels choisit de traiter de la rencontre et du couple, de la complexité des rapports amoureux et sociaux dans cette société d’ombres, bloquée dans ses fantômes/fantasmes.

Certains ont prononcé leurs oukases en considérant ce travail médiocre, ou faible ; ce ne sera sans doute pas le travail de Neuenfels le plus significatif, mais c’est une approche qui se défend, hésitant sans cesse entre le drame de l’opéra ou la nouvelle dont il est issu (un exemple en est le clin d’œil de la comtesse dont le visage se projette au moment où Hermann perd au jeu), qui est d’une certaine manière plus simple (une seule motivation, le jeu) mais aussi plus ambiguë, Pouchkine laissant traîner des indices de fantastique et de réalisme pour que le lecteur fasse son choix ou s’y perde. La mise en scène essaie de naviguer entre ces pôles.

C’est un travail moins linéaire qu’il n’y paraît, avec de l’ironie (l’intermède pastoral avec les trois moutons qui tricotent plus ou moins vite selon le « drame » qui se joue est assez drôle) avec de vraies finesses, notamment dans la manière de traiter les individus et notamment la psychè de Lisa, bien plus complexe dans cette mise en scène que dans d’autres, dans la manière de donner aux trois personnages une profondeur.
La comtesse elle-même est traitée de manière originale : son déshabillage par ses servantes laisse apparaître un personnage radicalement différent, malade, au bord de la mort, isolé lui-aussi dans sa vérité qu’elle masque socialement et Neuenfels conçoit l’intrusion d’Hermann comme une dernière rencontre, une rencontre amoureuse : il donne à la vieille comtesse une psychologie, là où dans d’autres mises en scènes elle n’est qu’une utilité, que le public attend pour l’ariette de Grétry : Neuenfels là-aussi donne du corps à ce qui n’en a pas si souvent. Ainsi au total retrouve-t-on le metteur en scène rigoureux et réfléchi, très analytique, qu’on connaît bien par ailleurs, même sans l’inventivité d’autres travaux – qu’on lui reprochait aussi… Et dans ce sens, le travail proposé sur le livret est profond et raffiné. Respect.
Les attentes salzbourgeoises
La distribution réunie ne comble peut-être pas les espérances : à Salzbourg le résultat déçoit quelquefois les attentes même si dans la plupart des cas le niveau reste très haut. Mais aujourd’hui, dans l’été festival bien des choses font événement avant, déception pendant et oubli le mois suivant. Il faut un Mortier pour aller humer l’air du temps, affronter le public, le heurter, en imposant des visions dérangeantes, la plupart du temps très bien ciblées et qui marquent la mémoire : mais même sous Mortier tout n’était pas que roses et fleurs (Mahagonny…).
Sous Karajan, c’était les épiphanies du Dieu vivant qu’on attendait, et rien d‘autre, puisque les dernières années il ne dirigeait l’opéra qu’à Salzbourg. Il lui suffisait d’apparaître sur le podium tel le Graal, et les chevaliers spectateurs s’en retournaient rassasiés.
Qu’en sera-t-il désormais avec Markus Hinterhäuser ? L’homme est intelligent, et sympathique, mais pour l’instant il essaie à la fois d’appeler les grands noms actuels de la mise en scène, qui font le tour des grands opéras européens, et il risque quelques nouveaux noms : c’était un vrai risque d’appeler Lydia Stayer pour Zauberflöte, un titre symbolique ici qui a connu des échecs retentissants au Festival (Strehler…) et que Mortier a essayer de proposer sur un autre terrain, dans un hall de la foire (Mise en scène Achim Frayer). En appelant Neuenfels et Castorf, il fait place aux grands de la génération précédente et c’est aussi stimulant, si face à eux il y a aussi les grands de demain. Il eût pu appeler Tobias Kratzer pour Zauberflöte par exemple qui en fit une à exceptionnelle à Heidelberg en 2009…
Tout cela pour laisser à la nouvelle direction le temps de trouver une voie qu’elle ne semble pas avoir trouvé encore, s’essayant au consensus par une offre diversifiée, mais on sait que le consensus pour un festival n’est pas forcément une solution d’avenir…
Pour cette Dame de Pique, il s’assure musicalement ce qu’il y a de meilleur : Mariss Jansons a‑t‑il dans ce répertoire des rivaux ? Et les Wiener Philharmoniker sont l’institution pérenne qui garantit au Festival un niveau d’excellence permanent et qui en fait son originalité.
De bonnes cartes dans la distribution
Il est difficile de distribuer Tchaïkovski, car il faut à la fois des voix puissantes, expressives, et suffisamment intelligentes pour sentir le texte de l’intérieur. Le marché russe est vaste et permet de faire son choix, mais même en Russie, on ne trouve pas forcément un Hermann ou une Lisa aussi facilement aujourd’hui. La solution Salzbourg a été de reproposer le duo gagnant du Chostakovitch 2017 qui s’en sont tout de même bien sortis dans l’ensemble, sans être les artistes définitifs dans ces rôles.

Brandon Jovanovich a un beau timbre chaleureux, des aigus puissants, mais une présence scénique discutable, il n’incarne pas le personnage, même s’il le chante globalement sans scorie avec tout de même quelques tensions à l’aigu, à la limite. Incarner, cela voudrait dire d’abord proposer un chant qui ait de la couleur, et cela reste tout de même singulièrement monochrome, sans authentiques accents : il n’est jamais déchirant, il n’émeut jamais parce qu’il reste un chanteur qui joue sans vraie intuition ni imagination : son Hermann est plus incarné que son Walther à Paris, mais ni plus ni moins que son Sergueï la saison dernière. On peut répéter mot pour mot ce qu’on en disait alors en remplaçant Sergueï par Hermann : « Le problème avec ce chanteur c’est plutôt le phrasé ou l’expressivité, qui n’a pas toujours la variété voulue, il entre peut-être dans le personnage mais pas forcément dans le texte et son Sergueï très respectable, dans l’ensemble réussi est plus joué qu’incarné ».
Evguenya Muraveva, c’est un peu le contraire, elle n’a pas tout à fait les moyens d’une Lisa (il faudrait une Kampe ?) mais elle a d’abord l’immédiat plain-pied avec la langue : il y a les accents, la variété des couleurs, le jeu vraiment incarné et l’émotion. Avec un peu plus de volume, elle serait idéale. Ici, elle chante certains moments sur ses réserves et on la sent souvent tendue et quelquefois couverte par l’orchestre. On a donc un couple juste en-dessous des moyens nécessaires (mais cela ne gêne pas trop) et un peu déséquilibré dans la manière de rendre les personnages. Lisa emporte la mise (dans un tel opéra, c’est l’expression juste : son dernier air (l’arioso) à l’acte trois « Ax, истомилась я горем » (Ah, le chagrin m’a épuisée) est vraiment brûlant et emporte les suffrages.

Igor Golovatenko est Yeletzki, c’est sans conteste le chant le plus dominé, avec des accents justes, avec une vraie douceur dans la voix et un contrôle total. Son air « Я Вас люблю»(Je vous aime) , avec la belle mise en scène qui va avec ici, où il chante à une Lisa qui refuse l’avenir sans relief et toute normalité/sécurité qui lui est proposé, est un moment de grâce et d’élégance qui correspond parfaitement au personnage, un anti-Hermann ; on entend derrière ce chant quel Onéguine il doit être (il était Onéguine dans l’Eugène Onéguine concertant d’Aix en Provence avec le Bolshoï dirigé par Tugan Sokhiev). De toute la distribution, il est celui dont retiendra la parfaite adéquation entre jeu et voix et chant et personnage.

La comtesse est Hanna Schwarz. Il est coutumier de confier ce rôle à de grandes chanteuses des générations passées quand elles peuvent encore l’assumer, et Hanna Schwarz, la Fricka de la production Chéreau-Boulez, est de celles-là.
J’avoue avoir une comtesse du cœur, vue à Paris au TCE en 1978, dans une Dame de pique concertante dont on fit un enregistrement avec Rostropovitch et Vichnevskaya : c’est Regina Resnik, assise, avec une étole d’hermine, ne bougeant pas, et murmurant l’ariette de Grétry dans un français impeccable. Ce fut un coup de tonnerre dans un ciel serein et la salle croula sous les bravos comme rarement. Mais Resnik avait en plus de la voix, un tel don des langues que chaque mot qu’elle prononçait, quel que soit l’idiome, était clair, compréhensible et les mots complètement évocatoires : la question du texte était d’ailleurs centrale dans ses Master Classes.
Hanna Schwarz ne peut satisfaire un auditeur français tant sa prononciation de la langue est problématique. Mais elle est un personnage éblouissant, avec une voix encore présente, au phrasé qui fait défaut, ainsi que la diction, ce qui pour un rôle tout en accents et en « mots », demeure problématique.
Il reste la composition, il reste cette sublime scène où elle s’enlace à Hermann et où ils se caressent tendrement. Il reste cette silhouette rousse qui tranche et qui à elle seule remplit la scène. Il reste cette silhouette chauve et pitoyable. Il reste donc l’image, qui frappera sans nul doute la mémoire et va s’inscrire dans le souvenir.

Le Tomski de Vladislav Sulimsky fait résolument partie, dans la mise en scène, du groupe d’amis « pousse au crime » dont il était question plus haut. Dans d’autres mises en scènes, il est plutôt un médiateur, essayant à accompagner Hermann. Ici, il n’est pas un « gentil », mais le représentant de cette société dont est exclu Hermann. Dans une mise en scène si attentive aux signes donnés par les costumes, il n’a pas les cheveux longs des autres mais il en a le manteau de fourrure, celui des nobles installés et oisifs.
Et l’interprétation dans ce cas n’est plus si maîtrisée : le chant n’a pas l’élégance de certains Tomski, mais se signale par une certaine brutalité qui confine à la vulgarité, avec quelques problèmes à l’aigu. Un peu décevant.
La Polina d’Oksana Volkova est assez séduisante ; son duo avec Lisa (« Уж вечер » c’est le soir) et sa romance « Подруги милые » (mes chères amies) sont exécutés avec élégance, le chant est bien contrôlé, bien projeté et le personnage est vif, dans un costume où elle apparaît sous son manteau dans un short très court, sorte d’excentricité qui doit trancher avec la tenue impeccablement coupée de jeune fille sage de Lisa. Joli succès au rideau final. Mais des deux mezzo, la voix de Margarita Nekrasova impressionne par la présence et le volume dans son arioso « Mesdemoiselles, что здесь у вас за шум ? » (Mesdemoiselles quel est ce bruit ?), et domine l’ensemble des participants à la scène.
Du côté des voix masculines, on signalera notamment le Tchekalinski d’Alexander Kravets, ténor de caractère à la voix perçante et à l’impeccable projection, qui s’impose dans toutes les scènes où ce « chœur des pousse-au-crime » intervient.
Ainsi la distribution compose un ensemble vocal de grande qualité, homogène sans être exceptionnel, mais on se souviendra du profil de Hanna Schwarz et du chant très incarné de Evguenya Muraveva.
Mariss Jansons, la carte maîtresse
Le chœur de l’opéra de Vienne « Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor », (c’est son nom quand il est engagé hors de l’Opéra de Vienne ) impressionne par son importance sur toute la largeur de la vaste scène du Grosses Festspielhaus, et par le volume déployé. L’intervention finale en sourdine à la mort d’Hermann reste particulièrement émouvante.
Mariss Jansons apparaît fatigué sur le podium, bien plus qu’avec le Concertgebouw à l’Opéra d’Amsterdam en 2016, mais sa lecture reste fascinante par la transparence et la fluidité des passages d’un style à l’autre (à ce titre le deuxième acte en pastiche de la musique du XVIIIe est vraiment très réussi) et la force des contrastes : une interprétation dramatique, avec des Wiener Philharmoniker aux cordes et bois de rêve (le hautbois !), mais avec des cuivres toujours un peu problématiques quelquefois. Si l’on se livre au jeu des comparaisons au sommet, sans doute le Concertgebouw était rentré de manière plus évidente dans cette musique en livrant une exécution éblouissante à tous niveaux.
Il reste que c’est quand même orchestre et chef ce soir qui enthousiasment le plus : il est évident que l’ancien assistant de Mravinski qu’est Mariss Jansons, formé à Saint Petersbourg, possède comme une seconde peau le style de cette musique, sans jamais la rendre tonitruante, sans jamais en exagérer les contrastes, en tempérant le tempo, jamais trop rapide, mais sans ralentissements excessifs et ni la manière un peu complaisante d’appuyer sur le pathos de certains moments très sentimentaux – ce qui est assez facile chez Tchaïkovski : il accompagne des voix qu’il sait plus lyriques que dramatiques et les laisse se déployer. Et il est évident qu’à la cinquième représentation, les choses sont au point, compte tenu du turn-over des musiciens en fosse, comme de tradition à Salzbourg. Telle qu’elle est, cette interprétation reste la référence aujourd’hui.


Vous avez eu de la chance.
A ma représentation Jansons était totalement épuisé et les wieners bien seuls.…… plusieurs fois pendant la représentation il ne dirigeait plus du tout .
Le défaut de prononciation de Schwarz ne m a gêné outre mesure, elle est sensée être une femme russe qui ne chante pas dans sa langue maternelle. Le chant est encore extraordinairement mélodieux et l interprète unique.
Pour vos commentaires sur le festival que je partage complètement j ajouterai que le staat oper de munich est bien supérieur à moitié prix et avec un public infiniment plus connaisseur…