
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=4O9SA-w2_IU
Étrangement, au lieu de disperser les actions et les lieux, tout est concentré autour de la villa du dictateur, entourée de murs de grilles, de chiens, et la scène est divisée entre deux plans superposés, le premier étage de la villa et le jardin, un étrange jardin cimetière où reposent toutes les victimes et les ennemis de Sylla, dont Caius Marius.
La villa est ultra moderne, avec une camera vidéo pour surveiller l’extérieur, et l’on verra bientôt au rez-de-chaussée les écrans multiples qui retransmettent les agissements de Giunia, retenue au sein de la villa à disposition du dictateur.
Un dictateur volontairement banalisé : Kratzer n’en fait pas un monstre, mais un homme très ordinaire. Le pouvoir agit sur les autres. Mais dans son privé, ce pouvoir est souvent décevant, voire banal.
Tobias Kratzer n’est absolument pas intéressé par l’histoire événementielle de Lucius Cornelius Sylla, le dictateur fauteur des premières guerres civiles du dernier siècle de la République Romaine, qui abandonna le pouvoir alors qu’il avait tout concentré entre ses mains, et qui mourut peu après. C’est pourtant cette histoire qui est l’arrière-plan du livret de Gamerra et Metastase, un livret qui pose une thématique aimée de Mozart, celle du souverain, de la clémence et de sa signification politique. Une question évidemment typique des Lumières, traitée chez tous les grands philosophes confrontés à la monarchie absolue, mais aussi au « despotisme éclairé ».
Tobias Kratzer tourne le dos à la question historique, pour s’intéresser plutôt à la mécanique de l’individu, et notamment de celui qui est dépositaire du dit pouvoir, entre ses peurs, ses exigences, ses insécurités, mais aussi la violence, sa seule réponse.
Tout commence par une vidéo qui montre les puissants dans leur privé, du moins dans leur privé style Paris Match, pour émerveiller la galerie, on y voit Poutine au petit déjeuner et la famille Kennedy sur un yacht ou dans l’eau, mais aussi d’autres images moins idylliques qui créent des motifs qu’on reverra dans l’opéra, couteau, sang, notamment dans le geste ou banal ou cruel d’ouvrir une huître, motif essentiel dans le processus de séduction de Lucio Silla envers Giunia ; ouvrir une huitre c’est aussi prendre le risque du sang de se blesser en faisant violence si l’huitre se refuse au couteau, et de temps à autre la vidéo est envahie de ce sang qui gicle.
Autre motif préparatoire, les poupées Barbie, ce qu’on découvrira être Giunia en jaune et Silla en Smoking, préfiguration du jeu de Celia. On prépare les poupées pour l’entrée en scène, et là aussi, le sang couvre l’écran, d’autant qu’entre temps on voit la fameuse scène de la douche de psychose.
Ainsi Kratzer, intelligemment comme toujours, prépare en cette ouverture musicale les thématiques scéniques qu’il entend développer : pouvoir, meurtre, sang. Rien que du sympa.
Et quand le rideau se lève, une grille fermée, un mur, un chien de garde qui passe et repasse…rien que du sympa là aussi. Et toute la première scène entre Cecilio et Cinna est un jeu de dedans-dehors, où Cinna entre en scène à quatre pattes, comme le chien de garde, de manière mimétique de tout ce qui pourrait venir de ce jardin. Il est en quelque sorte aussi un chien de garde…encore faudra-t-il découvrir de qui et de quoi.
Tout l’opéra se déroule donc dans une ambiance nocturne, et au fond, en un seul lieu, même s’il ce lieu est en soi multiple (chambre, salon, salle de surveillance, jardin, mur…) parce que le spectateur sans cesse embrasse par son regard l’ensemble d’un décor qui reste fixe, même avec la villa est installée sur une tournette. Une villa chic hyper protégée qui fait penser à ces quartiers reclus pour richissimes. Il reste que cet espace unique nocturne et clos ressemble par sa clôture à un espace tragique étouffant.
Nous sommes évidemment loin du drame très hiératique de Chéreau qui essayait de conjuguer les lois de l’opera-seria e celles de l’histoire politique racontée. Il en résultait un drame de haute tenue, voire un peu lointain quelquefois.
Avec Kratzer, nous entrons in medias res, dans un univers qui n’est pas sans rappeler les séries télévisées ou les thrillers, comme lui-même le souligne car son intention est d’entrer dans des mécaniques et des histoires d’individus et non pas de traiter l’ordre du monde. C’est ainsi qu’il présente Lucio Silla, d’une singulière banalité, « un homme comme les autres », dirait la presse people. On pense à la manière dont Tolstoï décrit Napoléon quand on s’approche de lui, sachant peu aller à cheval, avec ses mains potelées et nerveuses. Un Lucio Silla en son privé face à ses angoisses et ses incertitudes, qui regarde dans une caméra l’extérieur…on pense aussi à Hannah Arendt et à son concept de « banalité du mal » tant ce Lucio Silla est ordinaire, et l’interprète Jeremy Orenden à la voix relativement anonyme est tout à fait adapté à ce que veut faire de lui Tobias Kratzer.
Quel est cet univers :

D’abord un jardin, qui est non le jardin des délices, celui où les bosquets riants cachent des amours printanières, mais un jardin où circulent les chiens loups, difficilement pénétrable, un jardin-cimetière, où défilent les tombes des victimes du dictateur, des tombes déjà presque abandonnées et abîmées, que va parcourir Cecilio, cherchant toujours à venger la mémoire des siens, un jardin qui sera aussi la « prison » de Cecilio découvert par Sylla, une prison à ciel (bas et lourd) ouvert. Bref, tout sauf un jardin d’agrément.
La maison a l’aspect glacial d’une modernité forcée, des angles, des murs nus, des lits blancs, une candeur presque coupable, où tout est offert à la vue directe ou par écran interposé, grâce à des baies vitrées quelquefois obturées par des stores vénitiens, et offrant à la vue des scènes d’intérieur presque crispantes. Kratzer et son décorateur Rainer Sellmaier rendent-ils l’ambiance pesante d’un pouvoir dictatorial, comme un espace privé et coupé du monde.
Ainsi de Lucio Silla. Nous avons souligné sa banalité et son ordinaire. Nous le voyons entouré de sa sœur Celia, et de son âme damnée Aufidio. Celia en petite fille dissimulée sous la table avec ses poupées Barbie et sa maison de poupées, c’est à dire son théâtre privé qui reproduit par les poupées ce qui se joue entre Giunia-Barbie et Silla-Tom. Une mise en abyme qui est à la fois prémonition, mais aussi part des rêves de Silla ou des suggestions de Celia. De l’autre côté un Aufidio en costume XVIIIe et au maquillage de zombie. Quand les deux entourent Silla, c’est ‑excusez la trivialité de la comparaison- comme le capitaine Haddock pris entre son ange gardien et son diable. Silla pris entre ses penchants violents (Aufidio) et ses sentiments (Celia), un Aufidio zombie et fantômatique et une Celia petite fille perverse.
Cet Aufidio est un Esprit, le mauvais Esprit qui règne sur la maison et l’âme de Silla, et d’ailleurs dans la scène finale, les paroles de Silla l’interpellant sont changées : « Tu n’existes pas » lui lance-t-il.
Il n’existe pas, pas plus que ce peuple improbable dans ce décor de jardin privé qui arrive chanter la gloire de Silla, lui aussi maquillé en zombie…Vu que le jardin est aussi cimetière, c’est une sorte de Nuit des morts-vivants à laquelle on assiste et ce peuple qui hante le jardin n’est pas seulement réservé à Silla, mais aussi par exemple à Giunia,
De fait Kratzer agit sur le monde « reél » et celui « fantasmatique », fait des angoisses des vivants .
Car Silla est un violent : on comprend la présence des huitres dans le prologue cinématographié. Il reçoit Giunia en l’invitant à déguster des huitres avec lui (on croirait Tosca et Scarpia – il ne m’étonnerait pas que Tobias Kratzer n’ait pas pensé à ce jeu entre chat prédateur et souris victime), en lui offrant à déguster du vin, en ouvrant les huitres avec un joli couteau : il se blesse, et le sang coule. Nous avions déjà compris les allusions vaguement érotiques de l’ouverture des huitres dans le prologue à la vision de ce doigt caressant une huitre ouverte…Mais l’huitre ne se laisse pas facilement ouvrir (allusion claire au refus de Giunia), il faut forcer l’entrée et payer le prix du sang.

Et l’on verra par écran interposé que Silla viole Giunia, et que sa clémence est sans doute née de son remords : l’intervention finale de Celia auprès de lui ne vient que renforcer ce sentiment.
En face de ce personnage violent mais médiocre, les autres sont très nettement dessinés : Celia la petite sœur en petite fille s’amuse avec ses poupées et sa maison comme si elle créait-observait-prévenait-mimait-décrivait le drame entre Giunia, Silla et Cecilio. C’est une vision très pédagogique d’apprentissage de la vie et des réalités du sentiment. Jusqu’à ce que vers la fin dans le jardin tout se brise, poupées et maison de poupées mais où elle peut acquérir enfin son autonomie
Entre Giunia et Cecilio il y aussi quelque différence, Cecilio est une sorte d’étudiant attardé, lunettes, jeans, sac à dos, il ne semble pas faire partie de ce monde-là, comme élément extérieur, même à l’intérieur des murs. C’est l’exclu qui n’a pas le droit de pénétrer à l’intérieur de la villa, l’éternelle histoire de la princesse et du garçon pauvre. Tandis que Giunia est Barbie, blonde platinée, talons, robe élégante mais jaune, avec toute la symbolique négative du jaune. Une Barbie mal partie, une Barbie victime qui paie le prix fort pour son côté Barbie…
Nous avons vu en Aufidio la mauvais Esprit qui guide Silla, un fantôme, un zombie inexistant, mais présent sur tous les mauvais coups parce que n’est-ce pas, un zombie n’est pas un cœur tendre…
Reste Cinna.
Costume impeccable, la sobriété même, ami de Cecilio, ami de Celia et proche de Silla, il est au centre de tous les réseaux. C’est autour de lui que tourne l’histoire, et comme dans tous les bons thrillers, on le comprend à la fin.
En effet, Tobias Kratzer ne croit pas à la clémence « politique » de Silla, il croit à peine à ses remords. En revanche il croit aux manœuvres et ce qu’il nous raconte, c’est simplement l’histoire d’un coup d’Etat.
- Cinna personnage habillé de noir, strict, et observateur, agit d’abord sur Celia, celle qui aime son frère Silla et qui va essayer de le raisonner : Silla est haï de Rome et s’il ne revient pas sur cet amour insensé pour Giunia, il finira par être tué
- Celia intervient sur Silla, déjà en lui-même las d’être haï de tous et probablement déchiré du remords du viol commis.
- Silla unit Giunia et Cecilio et abandonne le pouvoir : il redevient un citoyen comme les autres…
- Et donc il devient proie facile pour Cinna qui le fait arrêter et probablement tuer vu qu’il passe devant les tombes de ses victimes : il sera la dernière. Cinna fait son 9 Thermidor…Et il devient à son tour le chef, et probablement dictateur…
Ainsi donc Kratzer fait de cette histoire celle d’un coup d’état, mort un dictateur, on en fait un autre ; la manière dont Cinna gère la Police pendant la scène finale en dit long sur ses réseaux et sa puissance. Et du coup, le chant de gloire à Silla sonne terrible, chanté par ce chœur de zombies. Et Cinna est plus réservé, plus distant plus glacé et en somme encore plus glacé que Silla. C’est toute la différence que La Bruyère construit entre Onuphre et Tartuffe, l’un est parfait, et l’autre avait ses failles.
Du même coup se dessine une théorie du pouvoir. Tel que se déroule la scène finale, il est difficile de croire au rétablissement de la démocratie ou de l’humanité. Et l’arrestation immédiate de Silla au moment où lui-même est sans défense est aussi un signe de cette violence. Du même coup, l’amour Cecilio-Giunia n’est plus au centre de cette histoire, mais celle d’un couple instrumentalisé au service d’un objectif caché.
Il ne fait pas bon manger des huîtres.
Musicalement, l’ensemble est très digne, dans la tradition d’une maison qui a toujours (au moins depuis Gérard Mortier) privilégié l’homogénéité sur les stars, et en grande cohérence avec la mise en scène par l’engagement de chaque participant.
L’Aufidio de Carlo Allemano a peut-être une voix un peu opaque ou fatiguée, mais qui convient bien à ce personnage fantôme, interprété avec relief. Allemano entre parfaitement dans ce personnage d’âme damnée ou de conscience mauvaise du dictateur. Son costume XVIIIe, le fait émerger du passé, – non du passé romain mais celui de la composition, faisant bien ressortir combien la problématique est typique de l’époque de la composition, mais ce costume et ce maquillage montrent aussi que le personnage n’est pas de même nature, tout comme le peuple. Et Tobias Kratzer joue ainsi sur la réalité et l’espace mental des personnages et de Silla en particulier.
La Celia très fraiche de Ilse Ferens ferait croire au contraire à un personnage direct, et lisible. Mais les petites filles de théâtre ne sont jamais si simples ni si lisibles. En tout cas le chant d’Ilse Ferens est à peu près sans défaut, offrant une belle variété de couleurs, de l’innocence à la maturité notamment à la fin où elle conquiert sa pleine autonomie, avec une voix bien posée, bien projetée, qui s’impose immédiatement.
Cecilio est Anna Bonitatibus, très engagée et parfaitement en phase avec la mise en scène, douée d’un beau phrasé, et surtout une très belle expressivité, donnant le texte avec une grande clarté et des couleurs exhalées par un timbre d’une belle qualité. Habituée du répertoire XVIIIe et rossinien, Anna Bonitatibus domine ici son sujet stylistiquement en donnant du personnage une allure à la fois juvénile, mais aussi ferme et décidée à aller jusqu’au bout.
Lenneke Ruiten est une Giunia très respectable, très en place, à la fois énergique et distante, mais aussi tendre, et fragile, elle réussit à donner ces deux facettes du personnage dans ce jeu très théâtral de l’apparence et de la réalité. Le rôle est redoutable et ce qu’en fait Kratzer en renforce la difficulté, elle est à la fois résolue et forte, mais étrangement solitaire dans cette maison glaciale. En plus, vêtue comme une Barbie, une sorte de femme-objet, elle a le physique du rôle et l’image de chair à prédateur. Avec des agilités impeccables, la voix reste assurée, et elle sait la mener pour construire le personnage à quelques excès (comme quelquefois le vibrato) qui enrichissent la caractérisation du personnage. Un travail d’une belle intelligence.
Simona Šaturová en Cinna est vraiment excellente, aussi bien par la diction, l’expression, le phrasé, les accents, mais aussi les agilités, sans aucune scorie, sans aucune difficulté, avec une grande fluidité, dominant son sujet, restant toujours avec ce zeste de distance et de froideur que la conclusion explique. Cinna est un calculateur qui construit son coup et ce chant dominé et quelquefois réservé ou en retrait contribue à dessiner son vrai profil.
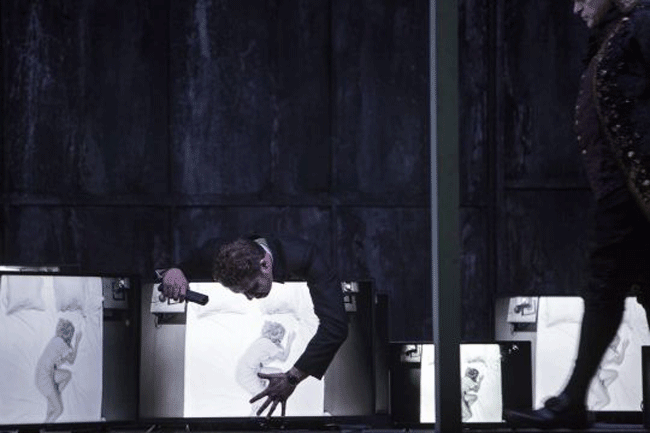
En Silla Jeremy Ovenden a pu sembler décevant, la voix n’a pas le brillant attendu d’un Silla triomphant sûr de lui et dominateur. Mais ce n’est pas le Silla voulu par Kratzer : Jeremy Ovenden incarne cette banalité grise, avec une voix certes bien posée, sans grands défauts mais sans qualités criantes, d’une platitude étudiée. À la limite quelquefois voulue de l’inexpression. Les gestes violents ou tendus (les huitres) masqués par un semblant d’effort de séduction, les regards hagards ou concupiscents, les attitudes de voyeur sont accompagnées d’un chant presque neutre quelquefois mais pas toujours qui renforce la violence de l’effet. En ce sens la composition est vraiment très réussie.
Antonello Manacorda a ici réussi à emporter l’orchestre symphonique de la Monnaie, et à imposer un style énergique, tranchant, fortement inspiré de la tradition baroque. Manacorda évite tout Mozart sucré et bonbonnière et effile les effets. Il y a du rythme, de la vivacité, et même quelque chose d’haletant qui tranche avec les habitudes qu’on croit avoir de l’opera seria. Ainsi, il épouse lui aussi dans le propos d’un spectacle sans concession et sans gracieusetés, où tout est tension et violence rentrée. D’ailleurs, la dernière image n’est-elle pas le chien de garde de la première scène ?
Une production qui revisite cet opéra assez peu donné au total et qui lui donne une vraie modernité, avec l'habituelle intelligence de Tobias Kratzer, mais aussi avec un engagement de tous . Une grande réussite.
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=4O9SA-w2_IU

