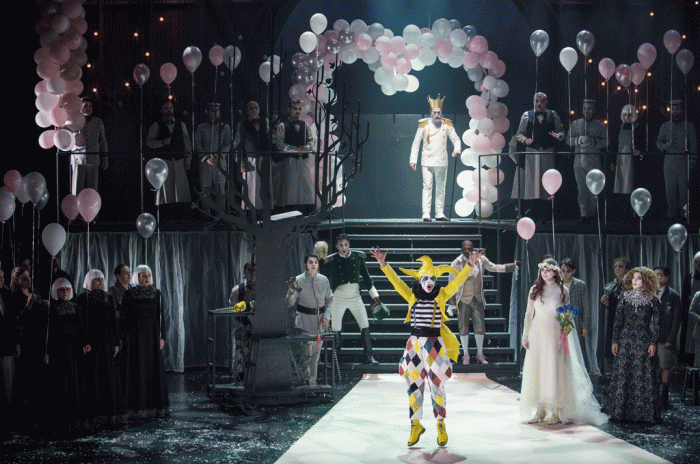 Fantasio est une œuvre postérieure à la guerre franco-prussienne de 1870 qui a marqué Offenbach, dont le regard sur le pouvoir est acéré (voir Le Roi Carotte, autre opéra créé la même année). La relation du pouvoir à la guerre se lit aussi dans le bien plus célèbre Grande Duchesse de Gerolstein, et également dans la Belle Hélène. Pour faire simple, Offenbach voit dans la guerre un divertissement du pouvoir sans aucun égard pour ceux qui la font. Offenbach, lui-même écartelé entre deux cultures en conflit, ne pouvait accepter une culture politique qui envoyait le bon peuple au charnier pour contenter les caprices des grands.
Fantasio est une œuvre postérieure à la guerre franco-prussienne de 1870 qui a marqué Offenbach, dont le regard sur le pouvoir est acéré (voir Le Roi Carotte, autre opéra créé la même année). La relation du pouvoir à la guerre se lit aussi dans le bien plus célèbre Grande Duchesse de Gerolstein, et également dans la Belle Hélène. Pour faire simple, Offenbach voit dans la guerre un divertissement du pouvoir sans aucun égard pour ceux qui la font. Offenbach, lui-même écartelé entre deux cultures en conflit, ne pouvait accepter une culture politique qui envoyait le bon peuple au charnier pour contenter les caprices des grands.
Fantasio est de cette veine. C’est un opéra-comique et non une opérette, un peu moins léger donc, et la musique (reconstituée en 2013 par Jean-Christophe Keck, le grand éditeur d’Offenbach aujourd’hui) surprend par son alternance bouffe et sérieuse, dès l’ouverture d’ailleurs. Son héros est inspiré du Fantasio d’Alfred de Musset publié en 1834 mais créé en 1966, à peine six avant l’œuvre d’Offenbach, dont le livret est écrit par Paul de Musset, le frère du poète.
Fantasio prend la place d’un bouffon mort à la veille du mariage forcé de la princesse Elsbeth, fille du duc de Munich avec le ridicule Prince de Mantoue, il réussira à la convaincre de choisir sa vie, empêchera la guerre entre les deux pays, et épousera la princesse…
 Thomas Jolly a su créer une atmosphère grâce au décor sombre de Thibaut Fack, fait de structures métalliques mobiles, de quelques objets et de l’image changeante du fond , au départ un château fort, présence imposante d’un symbole de pouvoir, en hauteur, alors que l’espace populaire est au sol, avec le peuple qui chante sa crainte de la guerre, grâce à des éclairages très précis de Antoine Travert et Philippe Berthomé, créateurs de formes et d’ambiances suggestives. Cette absence de couleur (elles apparaîtront dans la scène-fête finale) est un élément essentiel du travail proposé.
Thomas Jolly a su créer une atmosphère grâce au décor sombre de Thibaut Fack, fait de structures métalliques mobiles, de quelques objets et de l’image changeante du fond , au départ un château fort, présence imposante d’un symbole de pouvoir, en hauteur, alors que l’espace populaire est au sol, avec le peuple qui chante sa crainte de la guerre, grâce à des éclairages très précis de Antoine Travert et Philippe Berthomé, créateurs de formes et d’ambiances suggestives. Cette absence de couleur (elles apparaîtront dans la scène-fête finale) est un élément essentiel du travail proposé.
Thomas Jolly n’est pas un adepte du Regietheater. Interrogé dans le programme de salle, il déclare : « Je fais partie d’une famille de metteurs en scène qui prend la matière première des œuvres, texte et musique, comme base du travail scénique. Je n’essaie pas de tordre des éléments pour les faire correspondre à une idée ou une esthétique. L’œuvre m’impose certains éléments. »
Son travail s’inscrit donc dans une fidélité au livret, à la trame, sans regard distancié, avec des solutions « de théâtre » traditionnelles et toujours élégantes, la seule vraie tache de couleur étant le costume de bouffon, une tache jaune et lumineuse dans l’espace obscur, qui est évidemment une note signifiante dans la dramaturgie générale.
Un travail qui ne manque pas de poésie, sans la prétention insupportable d’Eliogabale, et qui accompagne l’œuvre avec efficacité grâce à un suivi précis des acteurs.
La distribution, sans être exceptionnelle, est d’un bon niveau, largement dominée par la Princesse Elsbeth de Melody Louledjian, membre de la troupe des jeunes solistes en résidence. La voix est bien posée et bien projetée, les aigus sûrs, la diction parfaite, et la présence scénique surprenante pour une chanteuse débutante. Elle obtient le plus grand triomphe de la soirée et c’est amplement mérité, c’est une vraie découverte.
 Si Katija Dragojevic est pleinement le personnage de Fantasio, très à l’aise en scène, svelte, mobile, à la belle présence, elle est moins convaincante vocalement, malgré un joli timbre sombre. La diction manque de précision et donc le ton et l’expressivité en pâtissent.
Si Katija Dragojevic est pleinement le personnage de Fantasio, très à l’aise en scène, svelte, mobile, à la belle présence, elle est moins convaincante vocalement, malgré un joli timbre sombre. La diction manque de précision et donc le ton et l’expressivité en pâtissent.
Pierre Doyen en duc de Mantoue est presque trop élégant et manque de ce ridicule qui vous tue un personnage, la voix porte bien, mais un peu serrée à l’aigu et engorgée, mais diction claire et joli timbre. Boris Grappe plutôt convaincant en roi de Bavière, un rôle relativement limité qu’il assume avec bonhommie. Spark (Philippe Estèphe et Marinoni (l’excellent Loïc Félix, déjà au Châtelet en 2017) ont une très belle présence et accompagnent les principaux rôles avec vigueur et une grande justesse. Héloïse Mas en Flamel est aussi douée de présence présence et d’une jolie voix de mezzo. qui s'impose à chaque apparition Dans ce type d’œuvre, il est important qu’il n’y ait pas de faiblesse au niveau des rôles de complément, l’homogénéité restant la qualité essentielle pour la couleur d ‘ensemble.
Le chœur dirigé par Alan Woodbridge est particulièrement présent, dans une œuvre où il est sollicité et l’orchestre dirigé par Gergely Madaras (remarqué dans Die Zauberflöte en 2015, montre une belle précision d’ensemble, faisant ressortir les raffinements de l’orchestration, les moments plus lyriques, mais aussi les moments de fantaisie avec une jolie énergie. L’œuvre, on l’a vue, est contrastée, tantôt vive tantôt plus retenue, avec une couleur quelquefois plutôt grise. Madaras sait jouer sur ces contrastes et propose une jolie interprétation : cela confirme l’impression très positive de la prestation de ce chef, directeur actuel de l’Orchestre de Dijon Bourgogne.
Au total une soirée agréable, qui fait redécouvrir une œuvre inconnue et qui montre qu’Offenbach n’est jamais aussi simple qu’il y paraît.

