On annonçait, voire décrivait après les générale et première de cette nouvelle production de Pelléas une version chambriste et aérée dans le son, délicate et retenue dans le spectacle. Le spectacle d’ensemble a bien des mérites, mais à mon sens, ceux-ci sont assez différents. Un aspect essentiel de ce Pelléas est effectivement son accent orchestral, d’un grand intérêt quoi que sa réalisation ne soit pas exempte de scories (mais on s’était préparé à pire). Mais c’est que, concerné comme ici ou touriste comme souvent ces dernières années, l’ONF a un son debussyste bien à lui, qui ne correspond pas vraiment au cliché de l’orchestre français forcément aéré, boisé, fin, et tant qu’on y est, arachnéen et diaphane. Pour autant, son identité dans son répertoire n’est pas sans attache ni tradition, et n’a rien d’hors-sol. Il y a toujours eu – sans exclusive –, de la Société des Conservatoires à l’OP en passant par les diverses formations de l’ORTF, une façon (plus qu’un son) de chez nous caractérisée par un trait plus franc, direct et acéré qu’ailleurs. Ainsi en va-t-il d’une relation nationale au répertoire cultivant une même singularité vis-à-vis de l’international que les Italiens avec Verdi ou les Russes avec Tchaikovsky : quelque chose d’originel et d’enraciné, économe d’interrogations physiques et métaphysiques sur la bonne façon de sonner, faisant place à l’expression nue, au phrasé simple, ne gommant rien des aspérités rythmiques ou de conflits de texture. S’ajoute dans le cas du National (plus que du Philhar ou de l’OP) un penchant supplémentaire pour le rauque, le sombre, la coloration à partir des pupitres forts que sont chez eux les altos et les violoncelles. Loin d’un scintillement pointilliste à l’équilibre haut, la tessiture souvent médiane de l’orchestration debussyste est valorisée d’un bout à l’autre : on pourrait dire que ce Pelléas jaillit tout entier de la sonorité de ses premières mesures, idéales, surtout montant de cette fosse dans cette salle qui lui va si bien. C’est aussi un Debussy wagnérien, comme l’étaient ceux de Daniele Gatti ; chambriste, mais sans rien réduire de l'espace dynamique ; débarrassé de legato karajanien, mais capiteux et souvent viril de timbres. Un léger dégraissage par rapport à la manière de l'ancien directeur est bien perceptible, mais l'identité de l'orchestre demeure, et ne correspond pas à une image d'Epinal du son debussyste de souche, bien plus à chercher quelque part entre l'OPRF et l'orchestre de l'Opéra.
Il n’y aucune d’opposition entre le wagnerisme omniprésent de Pelléas, avec ses préparations d’accords de Tristan et ses motifs structuraux dérivés des profils motiviques de Parsifal, qui ne se cachent que par inachèvement, et la recherche d'une finesse, d'une qualité d'écoute interne faisant justice à la parcimonie d'orchestration. Louis Langrée n’est certes pas le wagnérien passionné et brillant qu’est Gatti (qui a culminé en fosse dans son Tristan l'an passé), mais ne cherche pas à transformer l’inclination spontanée de l’orchestre vers l’ombre et la densité. Lui qui avait récemment officié avec l’Orchestre des Champs-Elysées à l’Opéra Comique trouve à pétrir une pâte sans doute plus goûteuse, et il s’en accommode sans difficulté en veillant d’abord à la clarté des articulations, des liaisons et des déliaisons, et leur cohérence. Les silences ont une qualité forçant l’écoute. C’est d’une intelligence de chaque instant, non seulement dans la maîtrise des équilibres, mais du flux et du reflux de tension théâtrale. Voilà une direction qui n’a pas le caractère indifférent de ce que proposait Philippe Jordan avec les forces plus raffinées de l’Opéra de Paris : une frise délicate et glacée. Il ne s’agit pas de mettre dans cette partition, dont la décantation garde toujours une part de mystère, une dramaturgie grossière, mais de ménager un espace sonore en mouvement, au sein duquel les lignes vocales si elliptique, indécises, peuvent être portées, soutenues, comme le danseur sur sa corde est assuré qu'elle est bien ferme.
 A ce jeu, les cordes du National se montrent à leur avantage du prélude jusqu’aux transitions les plus dramatiques des III et IV. L’extraordinaire quatrième interlude (qui suis « Si j’étais Dieu, j’aurais pitié du cœur des hommes ») convainc autant par la franchise de son mouvement que par la tenue de son jeu de flux et de reflux de textures : alors que sont fidèlement servis la lettre et l’esprit debussystes, la marche en expansion de la Verwandlungmusik de Parsifal (que Gatti et l’ONF exécutaient superbement dans cette même salle il y a six ans) n’est pas loin. Ici, même les violons de l’ONF, qu’on s’était habitué à entendre jouer chacun pour soi et avec des niveaux d’implications aléatoirement répartis, montrent ici comme presque partout une cohésion profitable. Seul reproche, la petite harmonie est timide par moments, le hautbois de Cismondi subtil et joueur, mais un peu seul, et comme souvent, les cors tendent à jouer trop fort, mais par endroits seulement. La direction privilégie des tempos médians, sages, au risque de l’indifférenciation ou d’une légère raideur peut-être – le mini-interlude de l’acte III et le début de la scène 3 (« Ah ! je respire enfin ») manquent de vie intérieure, de féérie. Et l'ultime imploration de Golaud dans le V manque un peu d'impact orchestral, de dynamiques aux cuivres, de déchirement, pour être soutenue.Mais ces passages sont d’espèces, et rares, dans Pelléas et les réserves qu’ils suscitent tout autant. Le déroulé musical de l'acte V est superbe, n'outrepasse ni ne surjoue son trait de rituel, ni mort d'héroïne, ni déploraison statique : comme le disait Boucourechliev, du théâtre antique, avec sa pulsation intérieure, son inexorable, sa majesté discrète.
A ce jeu, les cordes du National se montrent à leur avantage du prélude jusqu’aux transitions les plus dramatiques des III et IV. L’extraordinaire quatrième interlude (qui suis « Si j’étais Dieu, j’aurais pitié du cœur des hommes ») convainc autant par la franchise de son mouvement que par la tenue de son jeu de flux et de reflux de textures : alors que sont fidèlement servis la lettre et l’esprit debussystes, la marche en expansion de la Verwandlungmusik de Parsifal (que Gatti et l’ONF exécutaient superbement dans cette même salle il y a six ans) n’est pas loin. Ici, même les violons de l’ONF, qu’on s’était habitué à entendre jouer chacun pour soi et avec des niveaux d’implications aléatoirement répartis, montrent ici comme presque partout une cohésion profitable. Seul reproche, la petite harmonie est timide par moments, le hautbois de Cismondi subtil et joueur, mais un peu seul, et comme souvent, les cors tendent à jouer trop fort, mais par endroits seulement. La direction privilégie des tempos médians, sages, au risque de l’indifférenciation ou d’une légère raideur peut-être – le mini-interlude de l’acte III et le début de la scène 3 (« Ah ! je respire enfin ») manquent de vie intérieure, de féérie. Et l'ultime imploration de Golaud dans le V manque un peu d'impact orchestral, de dynamiques aux cuivres, de déchirement, pour être soutenue.Mais ces passages sont d’espèces, et rares, dans Pelléas et les réserves qu’ils suscitent tout autant. Le déroulé musical de l'acte V est superbe, n'outrepasse ni ne surjoue son trait de rituel, ni mort d'héroïne, ni déploraison statique : comme le disait Boucourechliev, du théâtre antique, avec sa pulsation intérieure, son inexorable, sa majesté discrète.
 Tous ces chanteurs, s’ils n’ont pas (exception faite de la Geneviève incontournable, à juste titre, de Sylvie Brunet-Grupposo) été abonnés aux productions les plus fastueuses de l’œuvre en ce début de siècle, montrent une maîtrise et un vécus solides de leurs rôles, offrant un plateau tout à fait homogène. Par son rude hiératisme tout antique, sa présence physique athlétique et imposante, et sa stabilité rarement prise en défaut, Kyle Ketelsen impressionne en son Golaud, qui peut se concevoir comme le rôle plus exigeant et complexe, d'autant qu'il est celui qui a peut-être été le plus approprié par son titulaire phare des dernières années – Naouri. Ketelsen n'a sans doute pas (encore) la densité vocale de celui-ci, mais il a la puissance, l'intonation et le sens dramatique. Et, cela va sans dire, un français à la hauteur. Son « Absalon ! Absalon ! » est aussi animal que dominé techniquement. Avec Yniold, on lui sent une marge de lâcher-prise et d'appropriation, et son « Il faut dire la vérité à quelqu'un qui va mourir » est légèrement forcé (du moins si on le préfère plus froid et sévère). Mais pour un bayton dont la prise de rôle a moins d'un an (à Zurich), ce sont plus que des promesses, une garantie d'un Golaud solide pour l'avenir. Le reste du plateau, en étant moins marquant, ne dépare pas, même si le dernier soir de Jean-Sébastien Bon est plus beau que poignant (sa scène à la chevelure est en revanche très habitée et accomplie. Teitgen est un Arkel bon, plein sans la royauté de luxe d'un Selig, et cela va bien, dans la mesure où il ne s'effondre nullement devant la responsabilité de conclure. Je suis favorable aux Yniold enfants, et à défaut (c'est hétérodoxe, il est vrai), à une soprano déguisant le timbre pour s'infanter, ce que Jennifer Courier fait avec mesure. Enfin, Brunet-Grupposo délivre son miracle épistolaire coutumier. La seule façon dont elle colore le ré-fa-mi au contact des basses sur « …bien que nous ne soyons pas nés du même père » est un miracle justifiant seul le déplacement à la dernière représentation. Parfaitement.
Tous ces chanteurs, s’ils n’ont pas (exception faite de la Geneviève incontournable, à juste titre, de Sylvie Brunet-Grupposo) été abonnés aux productions les plus fastueuses de l’œuvre en ce début de siècle, montrent une maîtrise et un vécus solides de leurs rôles, offrant un plateau tout à fait homogène. Par son rude hiératisme tout antique, sa présence physique athlétique et imposante, et sa stabilité rarement prise en défaut, Kyle Ketelsen impressionne en son Golaud, qui peut se concevoir comme le rôle plus exigeant et complexe, d'autant qu'il est celui qui a peut-être été le plus approprié par son titulaire phare des dernières années – Naouri. Ketelsen n'a sans doute pas (encore) la densité vocale de celui-ci, mais il a la puissance, l'intonation et le sens dramatique. Et, cela va sans dire, un français à la hauteur. Son « Absalon ! Absalon ! » est aussi animal que dominé techniquement. Avec Yniold, on lui sent une marge de lâcher-prise et d'appropriation, et son « Il faut dire la vérité à quelqu'un qui va mourir » est légèrement forcé (du moins si on le préfère plus froid et sévère). Mais pour un bayton dont la prise de rôle a moins d'un an (à Zurich), ce sont plus que des promesses, une garantie d'un Golaud solide pour l'avenir. Le reste du plateau, en étant moins marquant, ne dépare pas, même si le dernier soir de Jean-Sébastien Bon est plus beau que poignant (sa scène à la chevelure est en revanche très habitée et accomplie. Teitgen est un Arkel bon, plein sans la royauté de luxe d'un Selig, et cela va bien, dans la mesure où il ne s'effondre nullement devant la responsabilité de conclure. Je suis favorable aux Yniold enfants, et à défaut (c'est hétérodoxe, il est vrai), à une soprano déguisant le timbre pour s'infanter, ce que Jennifer Courier fait avec mesure. Enfin, Brunet-Grupposo délivre son miracle épistolaire coutumier. La seule façon dont elle colore le ré-fa-mi au contact des basses sur « …bien que nous ne soyons pas nés du même père » est un miracle justifiant seul le déplacement à la dernière représentation. Parfaitement.
 Le cas dePatricia Petibon peut s’appréhender de diverse manières. Un atout non négligeable est sa projection toujours bien supérieure à la moyenne, qui lui assure une marge de manœuvre confortable puisqu’elle ne semble jamais devoir forcer ses moyens pour se faire entendre. Sa diction est sans reproche sérieux, sa présence scénique limitée, mais à l’image d’un plateau statique, à dessein apparemment. Ce qui est plus déroutant est sa versatilité de timbre, qui selon les passages et les registres oscille entre la blancheur et une coloration extrême, curieusement là où le vibrato semble se limiter – typiquement, dans l’a capella (Saint Daniel et Saint Michel), qui donne la sensation étrange, compte tenu de l’aisance dynamique, d’une voix amplifiée. Son entame paraît surjouée mais prend cependant un sens possible à la lumière de la réserve dramatique qu’elle adopte au fur et à mesure que sa Mélisande se fait impavide, femme déjà revenue de tout après qu’on l’avait trouvée petit animal sauvage. Quand une Dessay présentait une princesse de conte trop parfait emportée dans le cauchemar d’Allemonde, et qu’Hannigan campait une héroïne se consumant sensuellement en défiant destin qu’elle connaîtrait par avance, Petibon présente l'intérêt de se placer dans une ambiguïté vocale et théâtrale frappante, quoi que rarement émouvante : peut-être parce que la mise en scène très terre à terre, ou plutôt pieds dans l’eau, n’y aide pas. Cependant, cette Mélisande aussi peu naïve que refusant l'incandescence trouve une forme d'équilibre dans son finale, où la sobriété maîtrisée de son phrasé parvient à donner corps à son pardon ambivalent ; au moment du jugement, elle est par-delà innocence et culpabilité, et son expression parvient à l'accent d'une compréhension supérieure des choses. Son chant n'est pas réfugié dans l'onirisme ou le délire pre-mortem : il est résolu, en contrepoint de Golaud, à mourir sans savoir.
Le cas dePatricia Petibon peut s’appréhender de diverse manières. Un atout non négligeable est sa projection toujours bien supérieure à la moyenne, qui lui assure une marge de manœuvre confortable puisqu’elle ne semble jamais devoir forcer ses moyens pour se faire entendre. Sa diction est sans reproche sérieux, sa présence scénique limitée, mais à l’image d’un plateau statique, à dessein apparemment. Ce qui est plus déroutant est sa versatilité de timbre, qui selon les passages et les registres oscille entre la blancheur et une coloration extrême, curieusement là où le vibrato semble se limiter – typiquement, dans l’a capella (Saint Daniel et Saint Michel), qui donne la sensation étrange, compte tenu de l’aisance dynamique, d’une voix amplifiée. Son entame paraît surjouée mais prend cependant un sens possible à la lumière de la réserve dramatique qu’elle adopte au fur et à mesure que sa Mélisande se fait impavide, femme déjà revenue de tout après qu’on l’avait trouvée petit animal sauvage. Quand une Dessay présentait une princesse de conte trop parfait emportée dans le cauchemar d’Allemonde, et qu’Hannigan campait une héroïne se consumant sensuellement en défiant destin qu’elle connaîtrait par avance, Petibon présente l'intérêt de se placer dans une ambiguïté vocale et théâtrale frappante, quoi que rarement émouvante : peut-être parce que la mise en scène très terre à terre, ou plutôt pieds dans l’eau, n’y aide pas. Cependant, cette Mélisande aussi peu naïve que refusant l'incandescence trouve une forme d'équilibre dans son finale, où la sobriété maîtrisée de son phrasé parvient à donner corps à son pardon ambivalent ; au moment du jugement, elle est par-delà innocence et culpabilité, et son expression parvient à l'accent d'une compréhension supérieure des choses. Son chant n'est pas réfugié dans l'onirisme ou le délire pre-mortem : il est résolu, en contrepoint de Golaud, à mourir sans savoir.
 Sur le plan scénique donc, la proposition d’Eric Ruf ramène à une approche assez littérale de l’œuvre, au moins en termes de climat, et d’attention aux enjeux les plus matériels de la pièce. Elle tranche, parmi les productions des dernières années, avec les personnalisations appuyées (et sans doute réussies parce qu’appuyées) de l’esthétisme chevaleresque zen de Robert Wilson à Paris et du théâtre sophistiqué, érotisé et cinématisé de Katie Mitchell à Aix. Et se rapproche en un sens de la recherche de Stéphane Braunschweig à l’Opéra Comique, au plus près des vibrations du monde aqueux, au cœur des ténèbres même en plein jour. Ruf s’est semble-t-il inspiré d’une base sous-marine pour installer aussi bien le château que la grotte et la fontaine dans une sorte de puit La scénographie repose largement sur des micro-variations d’ordonnancement du plateau et de l’éclairage, dont la subtilité accrédite le sentiment d’avoir affaire, sans que ce ne soit nécessairement un reproche, à un travail d’ambiance davantage que de direction théâtrale, ce qui surprend quelque peu de la part de Ruf. Le caractère statique de cette approche pose quelques problèmes dans les trois premiers actes, dont le découpage n’est guère marqué visuellement. Le jeu d’acteurs classique et réservé ne permet pas d’habiter cette claustrophobie figée de tension intérieure, et de pulsion de fuite. Seule la musique, au fond, parvient à camper un contrechamp Un vrai raté est à déplorer, dans un registre burlesque : la chevelure de Mélisande, puisque tout est littéral dans cette mise en scène, tombent bien de sa fenêtre, qui est perchée aussi haut que possible, cinq ou six mètres peut-être. La prothèse capillaire se déroulant de la nuque de Petibon, dans un louable souci de présenter une couleur crédible et un volume flatteur, ressemble à une improbable queue de rongeur géant des alpages, ce qui ne manque pas de déclencher l’hilarité des spectateurs les moins (ou les plus) avertis, dans un contexte quelque peu embarrassant. Il y a aussi des réussites, en dépit ou par la grâce du côté sage et appliqué : les montées et descente de l'inquiétant filet de pêche ; les passages des servantes anticipant leur venue fatale. Mais on ne sent pas de direction d'acteur qui, sans avoir à être spectaculaire, dénoterait une vision de l'oeuvre. Au contraire de la direction musicale et de sa réponse instrumentale, qui restera la bonne surprise de cette production. Après les promesses des débuts, le mandat de Gatti a laissé le National quasi exsangue en niveau moyen de prestation symphonique, et comme perdu au milieu de la sécheresse analytique du nouvel auditorium de Radio-France, bien plus adaptée (si on la supporte) à son rival philharmonique. Mais il faut admettre qu'à chaque fois qu'il retrouve l'avenue Montaigne, sur scène ou en fosse, l'orchestre montre qu'il vaut beaucoup mieux que ça. De là à se dire que ces musiciens n'ont plus envie que d'opéra…
Sur le plan scénique donc, la proposition d’Eric Ruf ramène à une approche assez littérale de l’œuvre, au moins en termes de climat, et d’attention aux enjeux les plus matériels de la pièce. Elle tranche, parmi les productions des dernières années, avec les personnalisations appuyées (et sans doute réussies parce qu’appuyées) de l’esthétisme chevaleresque zen de Robert Wilson à Paris et du théâtre sophistiqué, érotisé et cinématisé de Katie Mitchell à Aix. Et se rapproche en un sens de la recherche de Stéphane Braunschweig à l’Opéra Comique, au plus près des vibrations du monde aqueux, au cœur des ténèbres même en plein jour. Ruf s’est semble-t-il inspiré d’une base sous-marine pour installer aussi bien le château que la grotte et la fontaine dans une sorte de puit La scénographie repose largement sur des micro-variations d’ordonnancement du plateau et de l’éclairage, dont la subtilité accrédite le sentiment d’avoir affaire, sans que ce ne soit nécessairement un reproche, à un travail d’ambiance davantage que de direction théâtrale, ce qui surprend quelque peu de la part de Ruf. Le caractère statique de cette approche pose quelques problèmes dans les trois premiers actes, dont le découpage n’est guère marqué visuellement. Le jeu d’acteurs classique et réservé ne permet pas d’habiter cette claustrophobie figée de tension intérieure, et de pulsion de fuite. Seule la musique, au fond, parvient à camper un contrechamp Un vrai raté est à déplorer, dans un registre burlesque : la chevelure de Mélisande, puisque tout est littéral dans cette mise en scène, tombent bien de sa fenêtre, qui est perchée aussi haut que possible, cinq ou six mètres peut-être. La prothèse capillaire se déroulant de la nuque de Petibon, dans un louable souci de présenter une couleur crédible et un volume flatteur, ressemble à une improbable queue de rongeur géant des alpages, ce qui ne manque pas de déclencher l’hilarité des spectateurs les moins (ou les plus) avertis, dans un contexte quelque peu embarrassant. Il y a aussi des réussites, en dépit ou par la grâce du côté sage et appliqué : les montées et descente de l'inquiétant filet de pêche ; les passages des servantes anticipant leur venue fatale. Mais on ne sent pas de direction d'acteur qui, sans avoir à être spectaculaire, dénoterait une vision de l'oeuvre. Au contraire de la direction musicale et de sa réponse instrumentale, qui restera la bonne surprise de cette production. Après les promesses des débuts, le mandat de Gatti a laissé le National quasi exsangue en niveau moyen de prestation symphonique, et comme perdu au milieu de la sécheresse analytique du nouvel auditorium de Radio-France, bien plus adaptée (si on la supporte) à son rival philharmonique. Mais il faut admettre qu'à chaque fois qu'il retrouve l'avenue Montaigne, sur scène ou en fosse, l'orchestre montre qu'il vaut beaucoup mieux que ça. De là à se dire que ces musiciens n'ont plus envie que d'opéra…

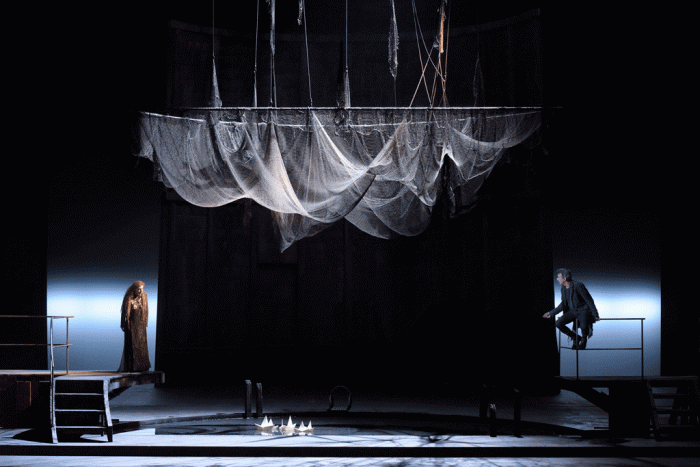
En tant que wagnérien, j'ai entendu "plus de Wagner" que d'habitude, ce qui m'a satisfait, même si ce n'est pas ce que je rechercherai lors des prochaines productions. Je n'ai jamais enten du une "lettre" ausi bien chantée (mais doit-elle l'être, je ne sais plus). Selon moi, Patricia Petitbon a également manqué son "Je t'aime aussi" qui ne venait ni du bout du monde, ni n'était passé sur la mer au printemps. Sauf omission de ma part, je n'ai pas lu de commentaire concernant Jean Teitgen dont les qualités vocales en font un grand Arkel. Je suis en plein accord avec vous pour le reste, bien qu'ayant autant apprécié Eric Ruf que Stéphane Braunschweig. Robert Wilson ne m'a pas apporté une vision enrichissante de l'oeuvre. En revanche, la production d'Aix demeurera gravée en moi en tant qu'une des merveilles auxquelles j'ai pu assister.
Merci de votre lecture. J'ai été succinct sur Teitgen mais je suis d'accord avec vous.
Le "Je t'aime aussi" est assez inchantable à mon sens, très rarement réussi, et je pense que sa réussite dépend autant du chant que de la mes., et qu'il y a un caractère trop aléatoire à sa cette combinaison.