Alain Perroux est directeur de l'Opéra National du Rhin depuis 2019, une fonction qui vient couronner une carrière débutée sur les rives du lac Léman comme critique musical au Journal de Genève avant de rejoindre Le Temps. Diplômé en littérature allemande et musicologie, sa passion dévorante pour l'art lyrique l'a conduit à explorer le monde de l'opéra sous tous les angles : chant et direction de chœur, mise en scène, dramaturgie, conférences et présentations, responsable de distributions et de productions, dramaturge au Grand Théâtre de Genève, conseiller artistique au Festival international d'Aix-en-Provence… Au mitan d'une saison 22-23 marquée par les turbulences de l'après Covid et les arbitrages budgétaires, nous avons choisi de dresser le portrait de cet amoureux fervent du lyrique et faire avec lui un premier point sur un début de mandat très prometteur pour l'institution alsacienne.
Vous êtes né en Suisse où vous avez suivi des études de musicologie et de littérature allemande. La musique était pour vous un choix personnel, une volonté parentale ?
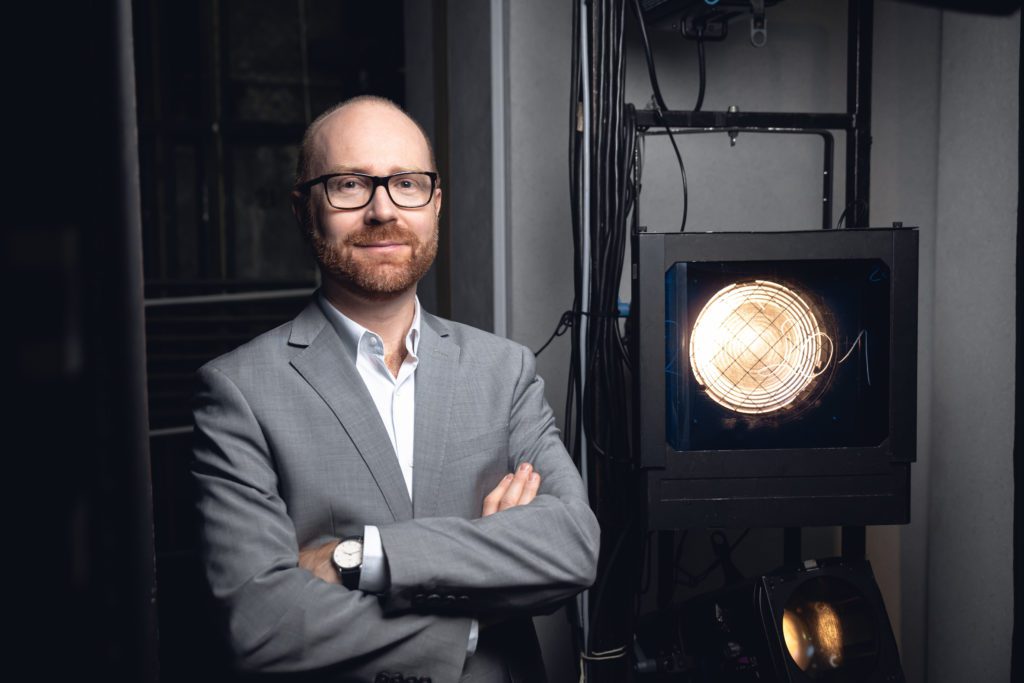
C'est une histoire un peu étonnante. Mes parents n'avaient presque pas de pratiques culturelles. Ils allaient peu au théâtre, jamais à l'opéra et ne lisaient pas particulièrement d'ouvrages littéraires. J'ai découvert la musique aux alentours de dix ans, de manière fortuite, au hasard d’émissions télé et aussi parce qu'en classe, nous avions un instituteur qui nous faisait écouter une fois par semaine un morceau de musique classique. Je me suis aperçu que j'aimais ça, sans trop savoir d'où me venait ce goût. Par ailleurs, j'ai toujours été fasciné par le théâtre et le jeu d'acteur. J'étais un enfant assez timide, mais j'ai le souvenir qu'une fois sur scène (notamment dans le cadre d’un atelier-théâtre au lycée), j'étais totalement désinhibé parce qu'il était clair dans mon esprit que le plateau avait pour propriété de nous affranchir de la réalité. Au croisement entre ces deux penchants, je devais fatalement me passionner pour l’opéra… J'ai commencé par écouter des tubes comme les Quatre Saisons ou la 40e de Mozart, et puis surtout des disques de la collection Le Petit Ménestrel avec les grands compositeurs racontés aux enfants. Je me souviens aussi d'une Flûte enchantée racontée par Claude Rich qu'on m'avait offert à Noël : mon premier opéra ! D'une manière générale, c'est l'écoute des disques qui a été fondamentale dans la construction de ma connaissance de l'Histoire de la musique et de l'opéra. J'habitais à la campagne, dans les environs de Genève, et mes parents n'avaient pas les codes pour fréquenter les lieux de culture. C'était l'époque où Hugues Gall dirigeait le Grand théâtre de Genève. Plus de 80% des places étaient occupées par des abonnés, si bien que l’institution paraissait une forteresse inaccessible pour des gens comme mes parents. Il n'y avait que très peu d’abonnements en vente chaque saison – les gens qui voulaient s'abonner payaient des étudiants pour faire la queue à leur place devant la porte du Grand Théâtre ! J'ai commencé à y aller grâce à des places réservées aux jeunes spectateurs, notamment pour les générales, ou parfois grâce à des amis de mes parents qui m'emmenaient avec eux.
Quel parcours de formation avez-vous suivi ?
J'ai suivi des cours de musicologie et de littérature allemande à la faculté des lettres à l’Université de Genève. En parallèle, je suivais aussi des cours théoriques au Conservatoire supérieur de Genève. J'arrivais à combiner la musique et la littérature allemande à l'université. Déjà au lycée, je me souviens de quelques travaux de recherche que j'essayais de relier à ma passion, comme par exemple une étude sur Tristan et Isolde. À l'université, j'ai fait de la linguistique – sujet difficilement compatible avec l'opéra, encore que je me souvienne d'avoir travaillé sur le statut linguistique des indications dans les partitions… En littérature allemande, je n'ai pas fait de thèse mais me suis contenté d'un petit mémoire sur le livret de la Femme sans Ombre d'Hugo von Hofmannsthal. En musicologie, j'ai consacré mon mémoire de master à Franz Schreker et à l'idée de la spatialisation du son à travers l'utilisation qu'il fait des orchestres de coulisses dans Der ferne Klang ou d’une spatialisation fictive avec son travail sur le timbre, comme l'indique le titre de cet opéra (le Son lointain).
Quelle a été pour vous la porte d'entrée dans le monde de l'opéra ?
J'ai pratiqué le chant, notamment au sein de l'Ensemble Vocal de Lausanne de Michel Corboz. Ce dernier a été très important dans mon parcours : il m’a fait toucher du doigt ce qu’est l’émotion musicale. Sans aller jusqu'à prétendre que je pourrais donner des cours de chant, je pense que ma pratique chorale m'a donné une connaissance intime de ce qu'est la voix, en particulier dans un ensemble. Pour le chant soliste, mon oreille et mon écoute se sont surtout formées grâce au disque et à la pratique de la critique musicale. J'ai eu un poste de pigiste puis de salarié au Journal de Genève, auguste quotidien fondé en 1826 qui est devenu Le Temps en 1998. Cette activité m'a permis de développer des compétences dont je ne savais pas qu'elles me seraient utiles pendant toute ma vie. Il m'a fallu apprendre à écrire vite, et écrire bien si possible. Je rédigeais ce qu'on appelait les "flashes minuit", c'est-à-dire qu'après un concert de l'Orchestre Suisse Romande au Victoria Hall, sur le coup des 22h30, je me précipitais à la rédaction (qui se trouvait juste en face, c’était pratique !) et avant minuit je devais rendre mon article de 2000 signes pour parution le lendemain. Cela m'a appris l'écoute critique, à laisser s’exprimer les émotions tout en les analysant pendant le concert, afin de pouvoir rédiger rapidement ensuite. Cette pratique a été pour moi une vraie discipline, qui continue de m'être utile dans le dialogue que je peux entretenir avec des artistes ou des chefs d'orchestre, pour pouvoir échanger librement et avec précision sur tel ou tel aspect de l'interprétation, ou donner des arguments articulés après une audition.

Quel regard portez-vous justement sur ce métier de critique ?
Il est toujours aussi fondamental qu'il y ait des personnes qui écrivent et discourent sur les objets artistiques. D’abord parce que tout objet artistique est adressé à un public et donc à autant de subjectivités différentes qui produisent du débat, du dialogue, du discours et parfois des désaccords. Il est fondamental, presque philosophique dans une démocratie, de solliciter l'expression des artistes, mais aussi les expressions du public. Pour moi, le critique musical est une sorte de «super-spectateur», quelqu'un qui a vu plus de choses que la moyenne des gens qui sont dans la salle et donc qui a un regard un peu plus informé pour pouvoir développer un discours et une pensée. Évidemment, la critique a toujours soulevé des aigreurs et des disputes, c'est humain. À titre personnel, je préfère toujours qu'on me dise franchement les choses, même si elles ne sont pas agréables à entendre. Concernant la professionnalisation de la critique musicale, les choses ont beaucoup évolué. Il y a 30 ans, c'était un métier pratiqué par un petit groupe de personnes qui avaient un parcours personnel et une certaine maturité. Aujourd'hui, tout le monde peut s’essayer à la critique, dans des fils de commentaires sur les réseaux sociaux ou en créant un blog. Nous sommes dans une jungle d'avis, d'opinions et dans une société du commentaire beaucoup plus tentaculaire aujourd'hui qu'aux débuts de la postmodernité. Cette explosion d'avis, il est très difficile de la réguler. Il faut donc en tirer parti : l’important, c’est que l’on parle d’opéra, si possible beaucoup, et qu’il continue de déchaîner les passions. Puis c'est aux lecteurs de trouver ce qui leur semble plus sérieux, plus informé et peut-être plus intéressant.

En tant que directeur, comment prenez-vous en compte la réception d'une œuvre au moment de construire une programmation ?
C'est une question à laquelle je réfléchis constamment. En tant que directeur, mon rôle n’est pas de programmer des spectacles juste pour faire plaisir aux critiques qui ont vu 40 productions différentes de La Flûte enchantée et qui ont besoin d’être surpris pour se sentir stimulés. Ce qui plaît à ces spectateur-là n'est pas forcément ce qui plaît au spectateur lambda qui voit La Flûte enchantée pour la première fois. Mais mon rôle n'est pas non plus de contenter tout le monde. D'abord c'est impossible. Et puis si l'on veut remplir une salle sans se fatiguer, il suffit de ne programmer que des tubes dans des mises en scène illustratives qui ne dérangent personne. Cela n’a aucun intérêt et, à terme, tuera le genre. En réalité, je crois fondamentalement qu’un spectacle réussi doit pouvoir parler au néophyte tout en renouvelant le regard des mélomanes qui voient beaucoup de spectacles. Il s'agit de trouver un équilibre, une «troisième voie» qui nous permette d’échapper à la dichotomie bien trop simpliste opposant les productions conceptuelles souvent clivantes aux spectacles conventionnels dénués d’imagination. Je suis convaincu qu'un spectacle inventif, puissant et cohérent est stimulant à la fois pour le grand public mais aussi pour les aficionados. Il est stimulant parce qu’il travaille sur des liens concrets entre un «texte» (livret, partition) et un spectateur d’aujourd’hui, qu’il sait susciter à la fois l'émotion et la réflexion chez ce spectateur. La Flûte enchantée de Simon McBurney ou Le Songe d'une Nuit d'été par Robert Carsen sont pour moi deux exemples de spectacles qui ont marqué l’histoire car ils s'adressent à tout le monde, le mélomane chevronné comme le néophyte. J'essaie, avec les moyens qui sont les nôtres à l’Opéra du Rhin, de viser à produire de tels spectacle. Il y a toujours des prises de risques, donc parfois des paris perdus. Et la dimension plurielle du public lui-même, qui rassemble des sensibilités multiples, est la raison pour laquelle je tiens à déployer une grande diversité des approches dans une même saison, sans enfermer la maison dans une esthétique. On ne dirige pas un opéra de région qui a un monopole sur les 150 kilomètres à la ronde comme une maison parisienne qui cohabite avec d’autres opéras sur le même territoire, à l’instar de ce qui se passe à Berlin ou à Londres. En Alsace, j'ai le devoir de montrer au public local la riche pluralité de la scène internationale, avec des approches esthétiques très diverses. Voilà pourquoi nous réunissons dans une même saison des gens confirmés comme Katie Mitchell ou Christophe Loy mais aussi des émergents comme Johanny Bert ou Evgeny Titov.
Est-ce que vous pensez qu'il existe à Strasbourg une spécificité, une marge de manœuvre qui n'existe pas ailleurs ?
C'est possible. En tout cas je constate que l’on peut programmer des raretés comme Stiffelio, le Chercheur de trésors ou les Oiseaux et obtenir près de 80% de remplissage en période de post-COVID – ce qui est remarquable – ou remplir à 96% la création française de la Reine des neiges d’Abrahamsen ! La proximité de l'Allemagne joue peut-être un rôle, mais il y a aussi à l'Opéra du Rhin une part d'héritage qui s'est transmise de génération en génération depuis le XVIIIe siècle et pendant la période allemande. C'est une ville universitaire avec un public cultivé, d'un niveau socioculturel assez élevé. On recueille également les fruits de l’important travail de médiation qui a été fait depuis plus de vingt ans. Et l’on peut désormais s’aventurer un peu plus souvent qu’ailleurs hors des sentiers battus.
L'Opéra du Rhin fête ses 50 ans cette année. Pouvez-vous rappeler l'originalité de cette structure commune qui regroupe Strasbourg, Colmar et Mulhouse ?
C'est une expérience pionnière que l'on doit à André Malraux et à son directeur de la musique, Marcel Landowski, lequel avait pris son bâton de pèlerin pour aller dans les régions de France afin de redynamiser l'opéra en région, notamment en proposant à des municipalités de mutualiser leurs moyens. Il est allé dans le Sud de la France, dans le Sud-ouest et en Alsace. Finalement, il n'y a que les Alsaciens qui ont réussi à s'entendre ! Il fallait quand même avoir des politiciens assez volontaristes et courageux pour accepter de discuter et de réfléchir ensemble à cette question. Ces trois villes sont de tailles différentes, avec des populations sociologiquement différentes, mais l'activité lyrique était à l'arrêt dans deux d’entre elles. L'idée était de les réunir au sein d'une structure unique et que l'État subventionne en proportion des besoins. En 1972 est donc né l'Opéra National du Rhin avec des équipes réparties dans les trois villes et un pôle principal situé à l'Opéra de Strasbourg qui réunit administration, chœur, ateliers décors-costumes et services techniques. À Mulhouse, nous avons le ballet, avec ses studios de répétition pour les 32 danseurs et les bureaux de l'administration. À la Manufacture de Colmar, il y a l'Opéra Studio (qui s'appelait à l'époque Atelier lyrique du Rhin) avec ses 8 jeunes chanteurs en insertion professionnelle, deux pianistes et, depuis la saison dernière, un ou une jeune chef(fe) d'orchestre. Nous travaillons avec l'Orchestre philharmonique de Strasbourg et l'Orchestre symphonique de Mulhouse qui se partagent la saison. Nos représentations s'inscrivent dans les plannings des salles qui nous offrent un certain nombre de services, à savoir : le Théâtre de la Filature ou le Théâtre de la Sinne à Mulhouse ; et la Comédie ou le Théâtre municipal à Colmar. À Strasbourg, il arrive exceptionnellement qu'on donne des formes réduites au Conservatoire ou dans d'autres lieux, cela nous oblige à être constamment en dialogue avec beaucoup d'interlocuteurs. L’OnR étant un syndicat intercommunal, j'ai parmi mes interlocuteurs des élus et des fonctionnaires des trois villes, avec une présidence tournante assurée pendant deux ans par l'adjoint à la culture de chacune des trois municipalités. Il s’agit vraiment de mutualisation intelligente et qui fonctionne plutôt bien, malgré les grandes contraintes de planning. Nous avons 248 agents permanents, avec des règlements différents pour le chœur, la technique… Heureusement, j'ai un bras droit formidable pour organiser tout cela en la personne de Claude Cortese, qui a travaillé à Angers Nantes Opéra (autre syndicat intercommunal construit sur le modèle de l'Opéra du Rhin).

Dans quelles circonstances êtes-vous arrivé à Strasbourg ?
Eva Kleinitz, l'ancienne directrice, est décédée fin mai 2019 et j'ai été nommé en décembre de la même année. J'ai pris mes fonctions deux semaines après, ce qui est totalement inhabituel dans le monde de l’opéra, où les transitions se font normalement en deux ans pour pouvoir préparer sa première saison. Je m'étais entendu avec Pierre Audi, directeur du Festival d'Aix-en-Provence, pour une période de transition où je restais à 50% à Aix-en-Provence jusqu'à l'été 2020 et à 50% à l'Opéra National du Rhin. La maison était très déstabilisée par le décès d'Eva – une personne attachante et charismatique, adorée par les équipes et qui a apporté beaucoup de choses nouvelles. J'ai admiré la résilience des collaborateurs, grâce à laquelle l’institution a fonctionné durant l'intérim assuré par Bertrand Rossi juste avant qu’il soit nommé à la tête de l'Opéra de Nice, en novembre 2019. Quand je suis arrivé en janvier 2020, on sentait les équipes encore très affectées par la disparition d’Eva. Deux mois plus tard, le COVID est arrivé. Nous avons basculé dans une nouvelle crise. Après le premier confinement, nous nous sommes remis au travail le plus vite possible. On a donné des spectacles avec beaucoup de contraintes, des salles avec des jauges limités, le port du masque, des orchestrations réduites, nous avons diffusé des spectacles en streaming pendant le deuxième confinement… Les équipes de l'Opéra National du Rhin sont très attachées à cette institution, elles produisent un travail rigoureux, quitte à travailler d'arrache-pied quand il y a des demandes particulières des metteurs en scène ou des chefs d'orchestre. Les agents s'identifient aussi beaucoup à la maison, c'est quelque chose d’inestimable et en tant que directeur, je veille à entretenir cet esprit.
Vous avez intitulé l'édito de la saison 22-23 par un titre emprunté et détourné d'Olivier Py : L’art qui panse. Comment envisager aujourd'hui de défendre une utopie lyrique et des contes de fées ?
J'y crois absolument. Et je peux citer à ce propos une autre phrase d'Olivier Py quand il dit que les œuvres d'art nous donnent «une vie en plus». Écouter du Bach, assister à un drame wagnérien ou à une création réussie, se replonger dans les grandes partitions, cela donne de la valeur et du sens à nos vies. Cela justifie que l'on dépense autant d'efforts et d'énergie pour la culture. L'art nous permet de nous abstraire du quotidien. Le théâtre lui-même est un lieu idéal pour éprouver des émotions et se divertir. Je n’ai aucune difficulté à employer ce mot par lequel Brecht ouvre son Petit organon : «le théâtre est d’abord et avant tout une source de divertissement. […] C’est un lieu de divertissement pour la communauté et à propos de la communauté.» Se divertir, c’est étymologiquement se «détourner». Se détourner de notre quotidien anecdotique, non pas pour s’évader dans des «paradis artificiels» anesthésiants, mais pour prendre du recul et mieux observer le monde, mieux comprendre notre humaine condition. Une représentation réussie nous procure des émotions et en même temps nous met en état de penser. Cela contredit 2000 ans de culture judéo-chrétienne et de conception platonicienne qui voudraient nous faire croire que le corps et l'esprit sont ennemis. En fait, ils vont de concert et Olivier Py a absolument raison quand il dit : «le théâtre, c’est de la matière qui pense». Le théâtre musical est une matière en lien avec des émotion épidermiques, or il permet d’atteindre à quelque chose d'ineffable et d'inanalysable qui n’endort pas la pensée mais la stimule. Quand j'assiste à une représentation, je peux avoir des émotions fortes, parfois contradictoires, rire ou pleurer, mais aussi penser à beaucoup de choses qui me renvoient à mon vécu. L'opéra est un lieu privilégié pour ressentir des émotions et réfléchir le monde. Pour avoir personnellement vécu cette expérience, je crois fondamentalement que l'opéra nous transforme. C’est pourquoi je dis aux gens : «venez dans nos salles, et vous ressortirez un peu différent de celle ou celui que vous étiez quand vous êtes entrés».

Comment se présente les prochaines années pour l'Opéra National du Rhin ?
Dans un horizon de quelques années, la perspective de devoir faire de gros travaux dans le théâtre strasbourgeois nous obligera à passer sans doute plusieurs années dans un autre lieu, qui sera certainement un théâtre provisoire puisqu'il n'y a pas de salle disponible dans la ville. On s’inspirera de ce qui s'est fait à Genève ou à la Monnaie de Bruxelles. Il faut faire de nécessité vertu. Cette salle provisoire ne sera peut-être pas au centre de Strasbourg, mais ce sera l'occasion de travailler sur un environnement et un public un peu différents. À terme, il y a la perspective de bénéficier d'un équipement modernisé et mis aux normes, avec de meilleures conditions de travail, d'accueil et de sécurité. L'idée, c'est d'avoir moins de contraintes techniques pour les spectacles. Le cadre de scène à Strasbourg est moins large que celui de la filature de Mulhouse et l’on a assez peu de dégagement. La fosse d’orchestre est étroite et peut contenir 70 musiciens au maximum. Sans parler des problèmes de sécurité qui nous ont contraints à créer des sorties de secours supplémentaires, ajouter du personnel et des pompiers pour pouvoir ouvrir quand même. Le conseil municipal a lancé une mission d'information et d'évaluation composée d'élus de tous bords qui ont travaillé sur différentes hypothèses : mise aux normes et réfection simple, mise aux normes et réfection-agrandissement ou nouvelle construction. Ma préférence va clairement aux deux dernières hypothèses. Mais le choix n'est pas encore tranché, la décision de la maire doit intervenir dans le courant de l'année 2023. Soit on effectue une réfection et un agrandissement sur site, soit on opte pour un nouveau bâtiment. Tout dépendra des arbitrages politiques, en lien évidemment avec les coûts mais aussi les partenaires que la ville de Strasbourg arrivera à réunir autour du projet, en plus de l'État et la région Grand-Est. Il y a également la question de l'accessibilité à prendre en compte. Actuellement, nous sommes idéalement situés au centre-ville de Strasbourg, à dix minutes de la gare et dans une salle à l'italienne à laquelle les gens sont très attachés. La façade étant classée, on pourra difficilement la modifier. En revanche, la disposition à l'italienne peut être interrogée. Elle pose de nombreux problèmes en termes de places aveugles et de jauge.
À court terme, quelles sont les difficultés et les solutions que vous envisagez pour y faire face ?
On sait aujourd’hui que les villes de Strasbourg et Mulhouse vont baisser leurs subventions. Les subventions des autres partenaires sont maintenues, mais il faut savoir qu'elles stagnent depuis une quinzaine d'années, ce qui est déjà un vrai problème… Les temps sont donc difficiles. Nous entretenons un dialogue constructif avec les tutelles pour qu'elles comprennent les problématiques qui sont les nôtres, quitte à ce qu'on réfléchisse à une part plus importante pour le mécénat. Il nous faut, en tous les cas, revoir ensemble le modèle économique. Rien n'est facile en période de crise financière et de forte inflation, avec des hausses des charges très lourdes auxquelles nous faisons face depuis l'an dernier. Dans le même temps, nos recettes de billetterie sont très bonnes sur l'exercice 2022 et nous avons augmenté le nombre d’abonnés : nous en avons davantage en 2022-23 qu’en 2019-20 (avant la crise COVID). Et par ailleurs, nous sommes en train de développer avec succès un principe de tournées dans les territoires. J'avais défendu ce projet quand j'ai été nommé à l'Opéra du Rhin et j'ai tenu parole dès ma première saison avec le dispositif "Opéra volant". L'idée consiste à donner des opéras de chambre portés par l'Opéra Studio dans les trois villes de notre syndicat intercommunal (Strasbourg, Mulhouse, Colmar), mais aussi dans d'autres villes, moyennes ou petites, d'Alsace et du Grand Est. C'est une chose que l'on fait de manière très volontariste et c'est un vrai bonheur de dialoguer avec des enfants et des familles qui viennent découvrir l’opéra dans des lieux comme le beau théâtre municipal de Sainte-Marie-aux-Mines. Nous avons commencé avec L'Enfant et les sortilèges la saison dernière, et cette année c’est au tour de la Petite ballade aux enfers de Valérie Lesort et Marine Thoreau La Salle – un spectacle lyrique avec marionnettes, d’après Orphée et Eurydice de Gluck. On se rend sur place à l'avance avec les jeunes chanteurs du Studio pour préparer le public en organisant des présentations et des rencontres. Il y a une vraie demande de médiation auprès d'un public le plus diversifié possible et je crois que cela donne du sens à notre démarche de pouvoir proposer des productions d'un format plus souple. Nous explorons aussi toutes sortes de formes et de dimensionnements, comme avec le spectacle Histoire(s) d’opéras en septembre. L'idée était de faire déambuler des petits groupes de spectateurs d'une forme à l'autre dans des scènes ou cantates qui s’apparentent à des «opéras miniatures», avec une mise en scène minimaliste, des costumes et quelques accessoires puisés dans nos stocks.
Quels sont les spectacles marquants de cette fin de saison ?
Parmi les titres dont j'attends beaucoup, il y a la Voix humaine de Poulenc dans une nouvelle production de Katie Mitchell avec Patricia Petibon dans le rôle principal. J'ai noué une relation étroite avec Katie depuis mes années au Festival d'Aix, c'est une des premières personnes que j'ai appelées quand j'ai été nommé. Je citerai aussi le Couronnement de Poppée mis en scène par Evgueny Titov et dirigé par Raphäel Pichon. Je suis heureux de présenter pour la première fois en France le travail d’Evgueny, metteur en scène russe formé en Allemagne et résolument opposé à la politique de Poutine. Je me réjouis également de faire venir Raphaël Pichon pour la première fois en Alsace afin de diriger ce chef d'œuvre absolu. Et puis il y a bien sûr le Conte du Tsar Saltane de Rimski Korsakov, dans la fabuleuse production de Dmitri Tcherniakov. Je suis très heureux que nous puissions reprendre ce spectacle de La Monnaie malgré les difficultés inhérentes aux coûts. C'est un spectacle parmi les plus marquants que j'aie vus depuis dix ans et parmi tous ceux qu'a réalisés ce metteur en scène. Sa proposition très forte, qui parle à tous les publics, est parfaitement en phase avec la thématique de notre saison : cette mise en scène est construite autour de la fonction thérapeutique du récit ; on y voit une femme qui élève seule son enfant autiste, et son unique moyen de communiquer avec lui, c'est de lui raconter des contes de fées. Tcherniakov peut ainsi faire passer toute la fantaisie débridée du conte de Pouchkine au premier degré, avec des images d'animations. Pour terminer, il y aura la Turandot mise en scène par Emmanuelle Bastet avec la formidable Elisabeth Teige qui vient de triompher à Bayreuth dans le rôle de Senta. Le spectacle sera proposé avec comme particularité le premier finale d'Alfano. Peu de gens le savent, mais ce qu'on entend d’habitude est une version amendée et raccourcie sous la contrainte de Toscanini pour la création. Dans sa version originale, le finale est plus long de dix minutes ; on est dans quelque chose de luxuriant, encore plus «fin de siècle» que ne pouvait l'être le reste de la partition composée par Puccini. Sans oublier le suspens dramaturgique, puisque Calaf révèle son nom avant que le jour se lève, ce qui laisse à Turandot la possibilité de le mettre à mort…
Reverra-t-on du Schreker prochainement ?
Nous venons de donner avec grand succès la création française de son Chercheur de trésors (Der Schatzgräber), qui a suscité beaucoup d’intérêt pour ce compositeur. J'aimerais bien présenter les Stigmatisés (Die Gezeichneten) et, s’il n'avait pas été monté à Strasbourg il y a dix ans, j’aurais programmé le Son lointain (Der ferne Klang). À mon sens, ses inventions les plus fortes et les plus belles sont dans ces trois œuvres-là. Sinon je m'intéresse à d'autres partitions de la même période comme celles de Zemlinsky ou Korngold. Il y a dans notre maison une tradition des premières françaises d’œuvres devenues par la suite des titres importants du répertoire : Wozzeck, l'Amour des trois Oranges, la Femme sans ombre, Jenůfa, la Ville morte, etc. Il m’importe d’être fidèle à cette tradition – par respect de l’identité de la maison comme par goût personnel. La saison prochaine, nous donnerons donc un opéra baroque en première française, ainsi qu’une absolue rareté du répertoire français. Et deux créations mondiales.
Conservez-vous le festival Arsmondo ?
Oui, simplement nous avons un peu développé le concept. Je garde l'idée d'un festival interdisciplinaire qui nous permet de travailler avec les autres institutions culturelles de la ville. Le festival tel qu'il avait été créé par Eva Kleinitz mettait en avant des cultures du monde, si possible de pays lointains comme l'Inde, le Japon ou l'Argentine. J'élargis un peu ce concept en nous ouvrant sur des cultures transnationales. L'année dernière, c'était la culture tsigane, qui nous a permis de parler de l'Europe mais aussi de la réalité sociale de l'Alsace puisque la communauté Rom est fortement représentée ici. Cette année, ce sera la culture slave – thème choisi avant que le conflit en Ukraine n'éclate. On travaille sur la programmation avec un dramaturge invité ; ce sera passionnant, même s'il faut aborder le sujet avec délicatesse.
L'Opéra National du Rhin, c'est aussi un ballet…
Oui, notre ballet est un Centre Chorégraphique National intégré dans l'Opéra national du Rhin. Son directeur, Bruno Bouché, est quelqu'un qui aime collaborer au-delà de son monde chorégraphique. Sous son impulsion, nous suscitons des rencontres avec des artistes d'autres disciplines. C'est lui qui m'a poussé à faire appel au ballet de l'Opéra national du Rhin pour notre West Side Story ou bien la création d’Until the Lions de Thierry Pécou. Il y a un projet qui verra le jour à l'été 2023 et que nous présenterons en Alsace lors de la prochaine saison de l'Opéra national du Rhin : c'est une forme qui réunit danse et théâtre autour du roman On achève bien les chevaux d'Horace McCoy, très connus à travers le film que Sidney Pollack en a tiré. Bruno a développé ce projet avec Clément Hervieu-Léger, metteur en scène talentueux et sociétaire de la Comédie Française. Ils se connaissent depuis longtemps et Clément a sa propre troupe, la Compagnie des petits champs. Ils ont imaginé ensemble un projet dans lequel la troupe de ballet de l'Opéra du Rhin et la compagnie de Clément ne forment sur scène qu'une seule et même entité pour raconter cette histoire de jeunes gens qui participaient, durant la grande crise américaine, à des concours de danse où il fallait danser presque jusqu'à la mort. Le ballet fait partie intégrante de l'Opéra national du Rhin, y compris pour les actions de médiation puisqu'il est en résidence dans la région et participe aux actions culturelles sur les territoires au même titre que les autres forces vives de la maison.
Des projets, des rêves ?...
Plein de rêves, mais je dois aussi travailler avec une réalité budgétaire… Dans la diversité dont je parlais, il y a d'autres œuvres du répertoire frappées par le IIIe Reich de la mention Entartete Musik (Musique dégénérée). J'aimerais également aller regarder du côté de l'Italie à la même époque, avec des compositeurs comme Riccardo Zandonai. Par ailleurs, la création d’aujourd’hui occupe une place de choix dans la programmation de l’Opéra national du Rhin, et nous allons continuer – avec notamment deux créations mondiales en 2023-24. Et en parallèle, il y a le monde de la comédie musicale… Je trouve dans ce genre une créativité foisonnante, chez des compositeurs comme Stephen Sondheim par exemple. On y dénombre des chefs-d’œuvre dont les dramaturgies sont souvent plus inventives que dans beaucoup d’opéras contemporains. L'an dernier, nous avons donné West Side Story avec un succès fantastique et cette saison, c’est au tour de Candide de Bernstein en version de concert. Il y aura la saison prochaine une comédie musicale de chambre, peu connue en France mais très populaire en Amérique… Je voudrais aussi produire Follies de Sondheim. C'est un rêve absolu, mais vu ses coûts importants, je ne sais pas si nous pourrons le monter dans les saisons à venir. Diriger un opéra, c’est pouvoir réaliser un certain nombre de rêves… sans jamais perdre de vue les contraintes du réel.

