
En une journée, nous avons eu le privilège d’entendre la première et la dernière œuvre de Rossini, ou presque dans la mesure où La Cambiale de Matrimonio est la première œuvre qui vit la scène mais pas la première composition (c’est Demetrio e Polibio en 1806), et la Petite Messe Solennelle eut une seconde version pour orchestre en 1867 alors que la version originale remonte à 1863.
On peut se demander si le titre presque oxymorique n’a pas nui au destin de cette œuvre. Petite Messe, ça n’a pas l’air très sérieux, ça fait exercice de style. Petit en Français, ça fait gentil, presque enfantin. Solennelle par ailleurs appartient à un chant sémantique inverse qui renvoie à la cérémonie, à l’hommage. Dans ce cas « qu’on ne me parle de rien qui soit petit ». Il est clair que Rossini avant habilement travaillé son titre pour donner un peu de mystère à son œuvre, créée comme un travail privé pour un privé.
Et pourtant, l’œuvre n’a rien d’une plaisanterie ni d’un "péché" de vieillesse. C’est plutôt une trouvaille géniale de la vieillesse, un peu à la Falstaff, toutes proportions gardées. Rossini n’a plus rien à perdre, lui à qui la vie a tout donné et qui vit de ses rentes depuis plus de trois décennies. Il reste à l’époque LA référence musicale, imité par les grandes gloires de la musique qui lui ont succédé, Auber, Meyerbeer, le Belcanto, et évidemment Offenbach dont les opérettes (opéras bouffe) à succès doivent beaucoup au maître de Pesaro.
Et s'il n’est pas imité, il est respecté (Wagner). En 1863, la grande époque du Romantisme est passée, Wagner a définitivement assis son système théorique et peaufine son Tristan, il est en train de composer Meistersinger von Nürnberg où il revient à la comédie trente ans après Das Liebesverbot. On est en train de passer à autre chose.
Rossini quant à lui reste un observateur de la musique de son temps, et il est clair qu’il ne va pas écrire une musique qui sentirait son âge et serait passée de mode. En revenant à la composition, et par une œuvre sacrée, il va affirmer en même temps cette liberté que lui donnent la gloire et la considération. Il est clair que ce retour de Rossini, vieille gloire déjà embaumée par certains, sur la scène musicale va provoquer des jugements contradictoires, entre ceux qui considéreront ce retour inutile et stérile (Verdi) et ceux qui admireront par principe parce que Rossini ne saurait être mis en cause. Au fond, peu de gens mettront la Petite Messe Solennelle au rang des chefs d’œuvre ni même des œuvres dignes d’intérêt .
Et pourtant il faut peu de temps d’écoute pour se laisser surprendre par la modernité assez étonnante des mélodies au piano, qui semblent presque sorties d’un recueil du XXe siècle. En fait, la présence du piano à la place de l’orchestre auquel ces formes nous ont habitués donne une étrange impression : comme si on assistait à la générale-piano d’une œuvre encore en devenir, et en même temps tellement accomplie qu‘on peut se passer de l’orchestre. Et ce sentiment est aussi marqué par le travail musical des airs des solistes, particulièrement soigné notamment les voix féminines.
Rossini semble répondre à une sorte de défi personnel : écrire une « grande » messe pour un salon, réduire les forces au strict nécessaire et suffisant pour asseoir l’œuvre et lui donner sa grandeur. Une petite messe par les forces en présence et grande par la musique.
De fait il s’agit d’une « vraie » messe à la durée canonique, qui est exercice de style, et sorte de pari à la fois amusé (il faut lire les textes de Rossini sur cette œuvre qui devrait lui ouvrir les portes du paradis) et très sérieux (il y a des moments surprenants de modernité, mais aussi des moments qui spirituellement sont d’une élévation sublime). On a dit que c’était une œuvre « théâtrale », un peu une sorte de Requiem de Verdi du pauvre, et je n’arrive pas à confirmer cette impression. Les parties vocales tant des solistes que du chœur (que Rossini voulait voir chanter ensemble) sont pour moi particulièrement marquées spirituellement, et les parties solistes du ou des pianos (le piano en double donne évidemment plus de force) sont celles où Rossini semble non faire du théâtre mais aller plus avant dans la recherche rythmique, mélodique et tonale également (c’est frappant durant l’offertoire). Rien de spectaculaire, ni de théâtral, mais la volonté d’aller au-delà de l’attendu avec une extrême liberté. Comme nous l’avons écrit, Rossini n’a plus rien à attendre du jugement des hommes (critiques ou musiciens), il est pleinement libre de vagabonder dans les possibles, et il réussit à nous étonner.
Il est donc pleinement légitime que dans sa ville natale, l’hommage aux soignants et à la mémoire des victimes soit marqué par l’œuvre qui pouvait le mieux correspondre à une manifestation publique qui constituait l’ouverture officieuse du Festival.

En effet, l’exécution musicale a été précédée de quatre interventions. Celle du Président du Festival Daniele Vimini, qui est aussi Maire-adjoint à la Culture de Pesaro, du Président de la Région des Marches Luca Ceriscioli, ancien Maire de Pesaro. On sait quelle part les régions ont prise en Italie pour que reprennent les spectacles. Le Maire actuel Matteo Ricci qui a insisté sur l’importance que « l’après » recommence par la culture et enfin, Ernesto Palacio, sovrintendente du festival, a conclu ces interventions liminaires, importantes. Le concert a d’ailleurs commencé par une minute de silence.

Enfin, dans l’assistance, la sénatrice Liliana Segre, une des figures essentielles de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme en Italie, particulièrement respectée en ces temps où l’extrême-droite rode et applaudie de manière vibrante par le public présent.
Pour ce concert offert par la Ville de Pesaro il était essentiel que soient célébrées la mémoire des victimes, l’engagement des personnels au service de la population qui ont tant donné durant le confinement, et des valeurs que tous devraient partager.
La petite Messe n’en était que plus solennelle encore et la musique de Rossini avait pour l’occasion une vraie grandeur.

Elle a d’ailleurs été superbement servie par les artistes qui étaient réunis. Bien sûr l’espace très ouvert exigeait la sonorisation et de grands écrans vidéo latéraux laissaient voir de plus près les exécutants.
Bien sûr, on peut musicalement émettre des doutes sur la pertinence d’un lieu aussi ouvert et aussi vaste pour une œuvre conçue pour une exécution dans un salon privé. On perd évidemment tout ce que l’œuvre peut avoir d’intime, voire de recueillie, et la sonorisation ne sert pas forcément la vérité musicale : il y avait par des déséquilibres entre les trois instruments solistes, notamment l’Harmonium (Luca Scandali) et le deuxième piano (Ludovico Bramanti) perdaient beaucoup, par rapport au premier piano (Giulio Zappa) qu’on on a pu en revanche vraiment apprécier pour la fluidité, l’élan, les nuances.
Belle prestation du Chœur du Teatro della Fortuna de Fano, dirigé par Mirca Rosciani. On avait déjà noté sa qualité lors d’éditions précédentes, et il a confirmé l’impression positive, par une présence affirmée, un son compact mais réussissant aussi à exprimer des nuances assez délicates.
Les solistes réunis dont l’importance est notable dans l’œuvre évidemment, allaient du jeune ténor débutant dans la carrière (Manuel Amati) au soprano déjà bien affirmé sur les scènes européennes Mariangela Sicilia. Dans les solistes, les voix féminines se taillent la part essentielle d’ailleurs.
Manuel Amati, au très joli timbre, a encore besoin de s’affirmer. Il était un peu hésitant (il était sans doute ému de la circonstance). Il n’a pas réussi à donner les couleurs voulues à ses interventions, restées en retrait surtout au début, où il intervient à découvert.
La basse Mirco Palazzi s’en est sortie avec les honneurs, voix assurée qui sait s’imposer, mais ce sont les deux voix féminines qui ont retenu l’attention (mieux servies aussi par la partition). Cecilia Molinari acquiert toujours plus d’assurance, la voix sombre se tressait admirablement à celle plus lumineuse du soprano par des interventions marquées, où elle savait varier la couleur et montrer un chant intelligent.
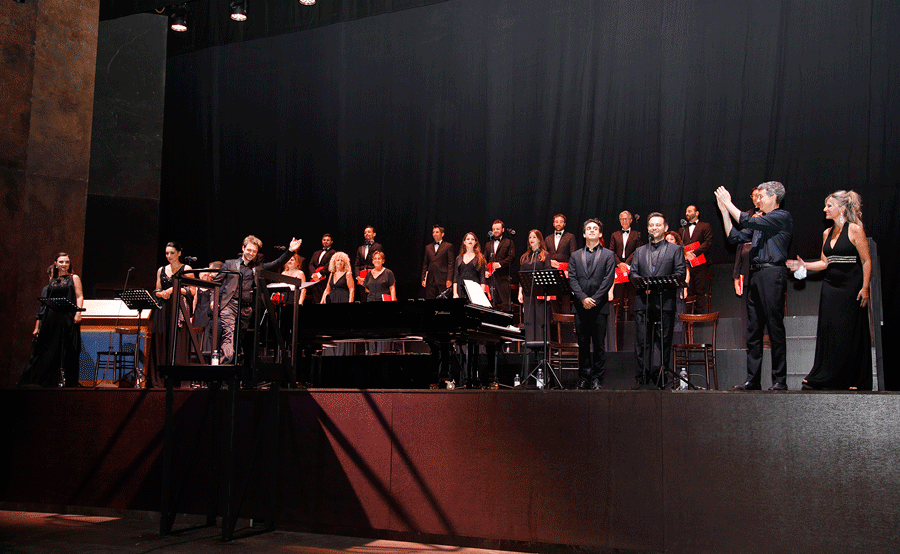
Mariangela Sicilia, qui a les interventions peut-être les plus « spectaculaires », si l’on peut user de ce terme en la circonstance, a montré sa maîtrise technique, le contrôle vocal de tous les instants sur tout le registre, un chant particulièrement attentif aux nuances, avec de beaux pianissimi, mais des aigus toujours lumineux et clairs, et surtout elle a su faire ressentir une émotion souvent vibrante. Une magnifique prestation.
Le tout était dirigé avec une grande précision par le jeune Alessandro Bonato, qui a su parfaitement, à ce qu’on pouvait en juger par la sonorisation, veiller aux équilibres et donner cohérence à l’ensemble. À suivre.
Au total un moment important, à la fois symboliquement et artistiquement : il a permis à la fois d’ouvrir officiellement un Festival qui a pu proposer une programmation redessinée mais de grande qualité comme toujours, dans le souvenir des temps difficiles que le monde a passés au printemps, et de rendre aussi hommage à une œuvre qui mériterait d’être plus souvent exécutée. En ce temps où il faut redimensionner les propositions, c’est une œuvre parfaitement adaptée aux temps qui nous attendent.

