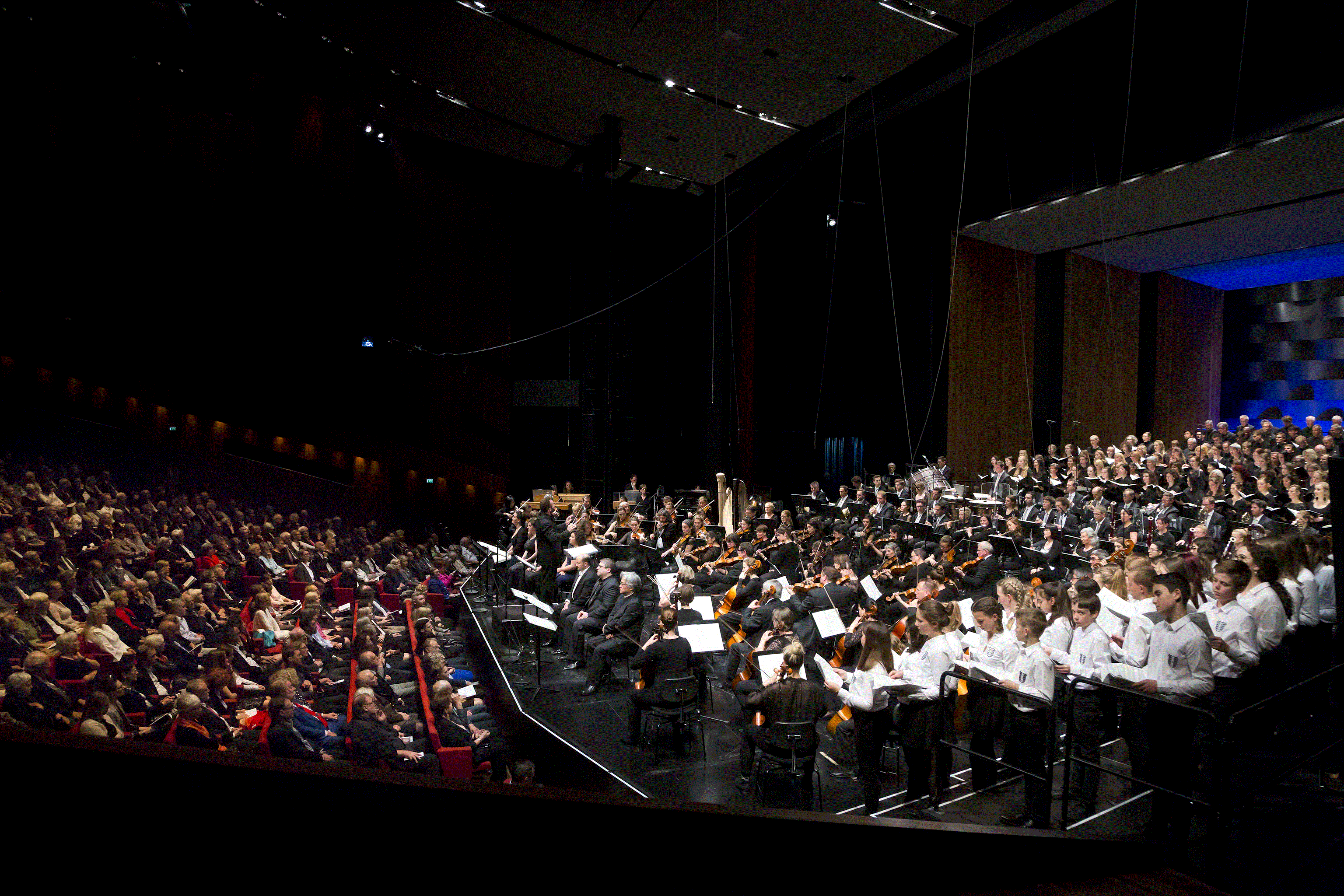En temps ordinaire, les concerts du Symphonieorchester Vorarlberg (dont le nouveau directeur musical vient d’être nommé, le britannique Leo Mc Fall) se passent alternativement à Bregenz et à Feldkirch, l’autre cité importante du Vorarlberg, distante de 35 km, mais pas ce concert parce que la salle de Feldkirch ne contiendrait pas l’énorme dispositif requis. Le programme exceptionnel, et la réputation désormais établie du chef, fait que les deux concerts ont affiché complet, sans compter la répétition générale publique, ici toujours ouverte aux jeunes et aux écoles.
La Symphonie n°8 de Mahler, on le sait n’est pas toujours une pièce favorite des salles de concert, à cause de la complexité de la mise en place, mais aussi du caractère même de cette musique, un peu pompeuse, un peu excessive, un peu superficielle même qui tranche avec les autres symphonies de Mahler et notamment la 7ème et la 9ème, qui l’entourent. On se souvient que Claudio Abbado, grand mahlérien devant l’éternel, a renoncé à la diriger à Lucerne en 2012, parce qu’avait-il dit « il n’y arrivait pas » et que « depuis la dernière exécution (1995), il ne trouvait pas de motifs nouveaux à la diriger ». D’où l’intérêt d’un concert qui a programmé une œuvre qu’un chef n’aborde pas forcément avant la pleine maturité. Mais, lancé avec le Symphonieorchester Vorarlberg dans une intégrale Mahler, inévitablement le passage par la Symphonie des Mille s’imposait.
Comme c’est désormais une habitude, Kirill Petrenko « rode » ses programmes avant de les présenter dans des saisons plus prestigieuses (aux Akademiekonzerte de Munich et bientôt avec le Philharmonique de Berlin), de fait, il dirigera la Symphonie des Mille en juin 2020 à Munich.
La mise en place de cette symphonie exige une logistique importante, l’effectif ( à la création 171 instruments, 8 solistes, 3 chœurs dont un chœur d’enfants) impose une préparation particulière, d’autant que l’œuvre est montée assez rarement du fait des forces à rassembler. On doit donc déjà saluer l’effort important consenti par le Symphonieorchester Vorarlberg, un orchestre d’une région grande comme un gros département français, un petit bout d’Autriche coincé entre Suisse et Allemagne.
La symphonie est presque exclusivement vocale (à l’exception de l’adagio du début de la deuxième partie), avec une première partie constituée par le Veni Creator Spiritus, hymne grégorien du IXe siècle composé par Raban Maur, archevêque de Mayence, particulièrement intense vocalement, alternant de manière très serrée partie chorales et de solistes, dans une vision éperdue de la Pentecôte, la descente de l’Esprit qui va visiter les cœurs. Cette impression débordante et irrésistible marque la volonté presque utopique de Mahler de traduire une totalité spirituelle qui aille sans cesse au-delà du terrestre pour atteindre et le spirituel et le Divin. Si la première partie est la descente de l’Esprit sur les êtres, la seconde est une aspiration vers le céleste dans une apothéose qui s’appuie non plus sur un texte religieux, mais sur un texte bien terrestre et particulièrement problématique qui est le final du Second Faust de Goethe, que Mahler adorait, d’une structure musicale complètement différente, qui s’assimile presque à la cantate, voire au final d’opéra, où les voix solistes ont comme des rôles « Doctor Marianus » « Maria Aegyptiaca » etc..
L’écriture vocale est redoutable pour les solistes, et notamment pour le ténor et les voix féminines, très tendues, très sollicitées à l’aigu et devant évidemment s’imposer face aux masses musicales qui risqueraient de couvrir. Pas question ici de mettre les solistes entre le chœur et l’orchestre comme Kirill Petrenko l’a fait pour la Missa Solemnis ou la IXe de Beethoven : ils sont tous au premier plan parce qu’ils sont protagonistes.

En salle (balcon latéral) comme prévu par la partition, un ensemble de cuivres (trompettes et trombones) et au centre du balcon l’intervention finale de « Mater Gloriosa » (Letizia Scherrer).
On reproche souvent à cette symphonie de trancher trop avec la 7 et la 9, plus tendues. Mahler ici explose les traditions de la symphonie parce qu’il veut que sa musique embrasse une totalité instrumentale et vocale, comme si c’était une représentation du monde dans son ensemble qui était impliqué, enfants, femmes hommes, avec tous les instruments et tous les types vocaux. Il y a dans cette volonté d’embrasser une totalité sans aucun doute une utopie, et la musique par son optimisme affiché semble presque sonner comme une musique de contes de fées, une musique d’une naïveté presque enfantine. On théorise un Mahler souffrant, et on se trouve devant ce « monstre » d’optimisme.

C’est bien justement ce qui marque dans l’interprétation que Kirill Petrenko vient de nous livrer, qui pourrait nous mettre sur la voie d’un regard sur son travail qui en ferait un chef de la joie. Cette approche qui épouse l’optimisme de l’œuvre ne s’affiche en rien comme intellectuelle ou distanciée, elle est donnée, telle quelle avec un travail musical de détail qui caractérise toujours Petrenko, qu’on lit désormais partout, sur la clarté du rendu, la limpidité du son, la précision avec laquelle chaque pupitre est isolé et mis en valeur. De fait, de l’orchestre on entend le moindre son, toujours très contrôlé par le chef qui ici retient d’abord le volume. Dans une œuvre aussi débordante que la Huitième, la question du volume est centrale, évidemment, et Petrenko veille à le contenir juste au-dessous du niveau où l’on passerait dans le domaine du « trop ». Ce qui surprend (et dès l’attaque initiale avec orgue et harmonium) c’est que le son est à la fois clair et dominé, mais qu’il surprend par sa relative réserve : on connaît l’approche de Petrenko privilégiant la dynamique au volume, on l’a sans cesse vérifiée dans son Ring quelquefois, y compris dans ce site, qualifié de « chambriste ».
Si la joie est affichée, le rendu de l’œuvre fait émerger aussi un sentiment que l’on n’attendait pas forcément qui est la tendresse, particulièrement claire dans le début de la deuxième partie, cet adagio dont Abbado faisait presque un lamento avec Berlin au disque en 1994.
Ici Petrenko donne à ce début l’aspect d’un mystère, assez tendu, où les bois lancent des traits acérés, presque sarcastiques (comme souvent chez Mahler), avec une pointe d’inquiétude. Ce début mystérieux est comme l’intrusion dans une symphonie où la rencontre entre l’humain et le Divin est centrale, de quelque chose d’une nature encore indomptée et mystérieuse sinon très vaguement menaçante, que l’intervention humaine va rassurer.
Ce qui marque aussi le travail de Petrenko c’est aussi une énergie communicative et presque juvénile, presque adolescente d’une sève qui monte de manière inextinguible et qui laisse l’auditeur quelque fois sonné : c’est là l’impression qui prévaut tout au long de la symphonie mais évidemment dans la première partie, le Veni Creator Spiritus d’où émerge une énergie tous azimuts, débridée, où les voix chorales et les voix solistes se laissent la main tour à tour, et où l’orchestre intervient plus en soutien et en accompagnement qu’en protagoniste (on l’entend plus dans la seconde partie). Cette impression de dérèglement comme si la descente de l’Esprit sur les hommes provoquait cette joie d’apocalypse joyeuse qu’on lirait dans un plafond de Tiepolo, aux couleurs claires, aux mille nuances, mais en même temps avec des visages un peu déformés qui nous éloignent d’une reproduction réaliste.
Il y a dans cette partie une impression à la fois souriante et agressive qui envahit l’univers pour l’inonder et l’emporter.
Évidemment, la seconde partie est à la fois plus maîtrisée et plus ordonnée, et le début fait naturellement contraste. Mais la présence des voix solistes impose aussi un traitement de l’orchestre plus voisin de l’opéra, avec un soutien plus manifeste, d’autant que les parties solistes sont pour la plupart tendues et difficiles.
La question du Faust de Goethe est évidemment centrale dans l’histoire de la culture aux XIXe et XXe siècles, si importante d’ailleurs que le système scolaire français l’ignore largement puis que seuls Berlioz, Schumann, Liszt, Wagner, Gounod, Stravinski, Busoni chez les musiciens, mais aussi Lessing, Lenau, Heine, Boulgakov, Valéry, Thomas Mann, Tourgueniev, Jarry, Ghelderode, Pagnol, McOrlan, Giono, Pessoa, Butor et bien d’autres ont abordé ou adapté le mythe.
Mahler l’aborde d’une manière particulière : après avoir en première partie étourdi le monde par la descente parmi les hommes de l’Esprit, il pose la question de la faiblesse humaine et de la force de l’amour qui va élever jusqu’à Dieu. L’amour englobe tout ce qui fait humanité et la conclusion de Faust est cette fin de parabole que Goethe citait dans sa fameuse expression « tout ce qui est transitoire n’est que parabole ».
Il y a donc un double mouvement descendant et ascendant qui crée la dynamique de la symphonie, où l’humain est au centre, à la fois écrasé et aspiré par le son, où la musique crée la dynamique de l’amour et en devient en quelque sorte l’outil.
La question de l’amour est donc étroitement associée à celle de la joie et sa respiration est le moteur d’une symphonie qui essaie d’en traduire la totalité. L’amour qui est aussi source d’angoisse, qui est aussi le moteur des tragédies, est ici vécu comme irriguant la totalité de l’être, bousculé d’abord, qui ensuite entame son ascension vers une rédemption par l’amour toute wagnérienne.
Alors Petrenko travaille comme à son habitude en faisant de l’orchestre un accompagnateur attentif de la parole, ne lui donnant jamais la prééminence si un texte est en face, ce qui donne toujours l’impression d’un travail de musique de chambre, où tous doivent s’écouter. Des chefs comme Abbado faisaient souvent signe aux musiciens de s’écouter. Pas Petrenko qui dirige en s’attachant presque à chaque individu dans une communication étonnante qui fait de chaque musicien de l’orchestre une sorte d’interlocuteur singulier du chef : et l’attention est redoublée dans le cas d’un orchestre moins rodé comme l’est le Symphonieorchester Vorarlberg. Mais si l’on attend évidemment le Bayerisches Staatsorchester la saison prochaine, force est de saluer le travail important conduit par l’orchestre, et l’absence totale de bavures ou de scories, ainsi qu’une belle capacité à moduler (très beaux pianissimi). Certes, le son global de cette phalange n’a peut-être ni la pâte ni la chair d’autres orchestres plus fameux, mais la prestation est très honorable, avec un premier violon solo excellent (Hans-Peter Hoffmann) et évidemment transcendée par le chef, dont l’approche assez retenue et comme on a dit « chambriste » (un choix de Petrenko qu’on retrouve dans sa vision de bien d’autres compositeurs) convient peut-être mieux aux musiciens qu’il dirige ici.

Comme on l’a dit plus haut, la présence des voix solistes impose aussi un traitement de l’orchestre plus voisin de l’opéra, qui puisse accompagner les voix qui sinon risqueraient d’être noyées dans la masse. Ce soutien est particulièrement évident dans le cas de la voix de ténor de Norbert Ernst. Le chanteur (qui fut un Loge apprécié dans le Ring de Frank Castorf) a un format vocal qui ne correspond pas tout à fait aux exigences de la partie de Doctor Marianus, très tendue. Malgré tout, Norbert Ernst, grâce à une diction exemplaire, grâce à un phrasé impeccable et une projection bien dominée, réussit à imposer le rôle avec sa voix au volume plutôt limité, et il faut saluer la performance.

Boaz Daniel est un des barytons assez demandés par le marché lyrique, il chante notamment beaucoup à Vienne, mais n’est pas l’un des plus expressifs et des plus marquants : pourtant
timbre clair et belle diction marquent une présence plus affirmée que sur scène et au total assez engagée dans Pater Ecstaticus. Seuls les suraigus sont un peu serrés, mais c’est un détail. Plus fameux Kwangchul Youn, la basse qui essaime sur les scènes wagnériennes et qui dans cette symphonie a la partie la plus longue, le monologue de Pater profundus. On y retrouve ses qualités habituelles de phrasé et de diction, avec une projection notable. Peut-être un peu moins engagé dans l’expression, il reste que son intervention énergique montre l’étendue d’une voix qui reste l’une des plus importantes dans le répertoire germanique.
Du côté des voix féminines, il faut saluer d’abord la prestation du soprano sud-africain Elza von den Heever (Una poenitentium c’est à dire Gretchen / Marguerite), habituée des rôles belcantistes, ce qui s’entend par les qualités de contrôle d’une voix très homogène dans tous les registres, avec une ligne impeccable du grave à l’aigu et au suraigu. Une prestation vraiment exceptionnelle.
Sarah Wegener (Magna Peccatrix) remplaçait Sara Jakubiak souffrante et a offert elle aussi une remarquable prestation ; l’aigu est stupéfiant, large, tenu, clair et puissant. La voix manque un tantinet d’homogénéité (au centre du registre essentiellement) et la ligne n’est pas aussi contrôlée que chez sa collègue, mais elle fait tout de même très grande impression.
Claudia Mahnke (Mulier samaritana) a un timbre de mezzosoprano clair qui était tellement séduisant et émouvant dans Selika de l’Africaine à Francfort et qui séduit ici également. On reconnaît là aussi une belle science du phrasé et une projection très contrôlée avec une particulière intensité, et une ligne de chant bien soutenue par le souffle.
Moins en relief l’autre mezzo, Diana Haller, qui remplaçait Daniela Sindram souffrante également ; la voix est un peu plus terne, même si elle assure la partie de Maria Aegyptiaca dignement mais sans véritable éclat.
Enfin Letizia Scherrer était Mater Gloriosa, au centre du balcon, pour une intervention très brève à la fin de l’œuvre, mais exigeante (Komm ! Hebe dich zu höhern Sphären) qui exige une solide tenue de notes aiguës. La voix n’est pas vraiment stable, sans l’appui nécessaire, et c’est dommage.
En tous cas une distribution de solistes dans l’ensemble vraiment de très grand niveau, qui rend cette soirée exceptionnelle : en effet, une fois de plus comme souvent chez Petrenko, l’écart entre l’attendu et l’effectif est énorme, tant la surprise et l’émotion qui parcouraient le public étaient grandes. Ce court silence qui sépara la dernière mesure des premiers applaudissements était comme un silence interdit, suspendu, qui précéda une immédiate standing ovation devant un concert qui a fait de cette œuvre souvent écrasante et au total un peu superficielle un moment à la fois poétique et profond. Petrenko a réussi à faire dire à cette symphonie bien plus qu’on ne lui prête habituellement, et rendre certains moments authentiquement extatiques en leur conférant une dimension inattendus. Une pierre blanche dans un parcours Mahlérien.
Voir Blog du Wanderer : Symphonie des Mille, Lucerne 2016 et ci-dessous, la Symphonie des Mille par Eliahu Inbal à Hambourg